Représentations

Portraits






Le 5 janvier, l’Unaf, représentée par Isabelle Saunier, présidente du département parentalité/enfance à l’Unaf, a été réélue au Conseil d’administration du nouveau GIP France Enfance protégée pour représenter les familles et défendre les besoins des enfants. Florence Dabin a quant à elle été réélue à sa présidence.
Le 10 mars, le Sénat a adopté à l’unanimité l’amendement de René-Paul Savary et Elisabeth Doineau, demandé par l’Unaf, pour compenser les carrières hachées dues à la maternité et à l’éducation. La réforme des retraites prévoit ainsi qu’afin que les mères et pères de familles conservent une part des avantages liés à la majoration de la durée d’assurance (MDA), il sera accordé une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire de cotisation dans la limite de 5 %, à celles et ceux qui dépasseront les 43 annuités (172 trimestres) un an avant l’âge légal de départ (63 ans), dès lors qu'ils ont au moins un trimestre de MDA pour la maternité ou l’éducation des enfants.
Le 10 février, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, portée par la députée Isabelle Santiago, a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. C’était l’une des 50 propositions de l’Unaf pour donner confiance aux familles, pour la mandature 2022-2027.


Suspendre temporairement l’autorité parentale d’un parent auteur de violences à l’égard de l’autre parent

Le 10 mai, Marie-Andrée Blanc, Présidente et Guillemette Leneveu, directrice générale de l’Unaf, ont été reçues par Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées pour échanger sur les mesures attendues sur l’accueil de la petite enfance, et notamment le service public de la petite enfance dont l’Unaf est partie prenante. La politique de la branche Famille pour les 5 années et l’accès aux prestations familiales ont également été discutés lors de cette rencontre. Une Conférence des familles, réunissant les acteurs de la politique familiale, doit se tenir en fin d’année « pour faire le point et tracer des perspectives pour l’avenir », a par ailleurs annoncé le ministre.


L’Unaf a publié, au mois de mars, le 20e numéro de sa revue scientifique « Recherches familiales ». L’occasion de valoriser son rôle dans l’animation et la diffusion des travaux de recherche scientifique pluridisciplinaire sur la famille. Pour Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Unaf, « il est essentiel que la recherche sur les familles soit vivante et que ses résultats puissent être diffusés et discutés. Je suis donc à la fois fière et heureuse de remercier tous ceux qui continuent de faire vivre cette revue et de souhaiter à Recherches familiales un joyeux anniversaire. »
de l’Unaf
L’actualité de l’Unaf a été marquée par de nombreux sujets qui reflètent les préoccupations des familles. Face à l’augmentation des prix qui entame le budget des familles dans tous les domaines et en particulier l’alimentation, nous sommes plus que jamais engagés pour défendre leur pouvoir d’achat.
Dans le cadre de la réforme des retraites, qui a généré tant inquiétudes, nous avons bataillé pour que les mères de famille ne soient pas pénalisées et avons obtenu des améliorations du texte initial, grâce à un travail pointilleux auprès des parlementaires.
En matière de défense des intérêts des familles, il faut se réjouir que l’accueil de la petite enfance intègre le projet de loi « plein emploi » : cette inscription dans la loi marque l’intégration de la conciliation entre vie familiale et professionnelle comme un enjeu et un levier à part entière des questions liées au travail et à l’accès à l’emploi. La Première ministre a d’ailleurs donné plus de détails, le 1er juin dernier, à propos des moyens et de la mise en œuvre du futur service public de la petite enfance, un projet dont l’Unaf est bien sûr partie prenante. Nos propositions et positions sont à retrouver dans le dossier central de ce numéro. Vous retrouverez également dans votre magazine les autres propositions que nous défendons avec énergie dans le cadre de la négociation de la future Convention d’objectifs et de gestion (COG) État/Cnaf. Nous sommes pleinement mobilisés pour qu’elle soit synonyme d’avancées concrètes pour les familles.
Bonne lecture !
Pour la plupart des parents, accueillir un enfant représente une grande joie, mais aussi beaucoup d'incertitudes et de bricolage dans la recherche de solutions de conciliation avec leur emploi. Ils peuvent être confrontés à des risques professionnels, donc financiers, et ils font face parfois à des dépenses considérables.

Depuis 10 ans la situation s’est dégradée : l’accueil devient plus cher sans qu’il soit pour autant plus disponible ou de meilleure qualité, et le congé parental s’est effondré. La politique de la petite enfance connait une situation de blocage : les objectifs de création de place de la Convention d'objectifs et de gestion (COG) sont loin d’être atteints malgré des financements conséquents disponibles. La concurrence entre modes d’accueil et la difficulté d’investissement des collectivités locales obligent à réfléchir à une évolution d’envergure des dispositifs et de la gouvernance.
L’engagement du Président de la République de mettre en place un service public de la petite enfance, représente une opportunité très forte de revoir en profondeur l’offre globale d’accueil, de s’adapter aux besoins des parents, mais aussi des enfants.
L’ensemble des rapports récents - rapport Cyrulnik sur les 1 000 premiers jours, avis du CESE, rapport Heydeman Damon sur la conciliation, conférence des familles, enquêtes de l’Unaf sur les attentes des familles - font tous consensus : on doit garantir à tous les parents un parcours serein et fluide de la naissance à la maternelle.
Concrètement pour l’Unaf, le SPPE doit se traduire par un parcours d’accueil serein et fluide pour tout enfant qui naît, jusqu’à son entrée en maternelle ouvrant une possibilité aux parents de ralentir ou suspendre leurs activités professionnelles dans de bonnes conditions et garantissant une solution d’accueil de qualité et accessible financièrement.
Pour concrétiser ce parcours, l’Unaf a élaboré des propositions concrètes. Voici les trois propositions phares, indispensables selon l’Unaf.
Créer un congé parental accessible à tous, mieux indemnisé (75 % du revenu professionnel) jusqu’au 1 an de l’enfant, pour concentrer l’accueil non familial de la petite enfance sur les enfants de 2-3 ans.
En trois ans, pas moins de 6 rapports officiels et une directive européenne plaident pour une meilleure indemnisation des congés parentaux, lors de la première année de l’enfant. Instaurer un congé court mieux indemnisé, apporterait une réponse correspondant aux besoins des parents et des jeunes enfants et permettrait aux deux parents, quelles que soient leurs différences de revenus, d’y avoir recours. La France se mettrait ainsi en conformité avec l’exigence européenne d’un congé parental indemnisé à un montant permettant son recours par les deux parents. Il permettrait également de concentrer les investissements pour la petite enfance sur les âges les plus avancés, moins exigeants en termes de taux d’encadrement.
Il faudrait toutefois, parallèlement, permettre un congé parental indemnisé jusqu’aux 3 ans de l’enfant, à temps partiel ou complet, notamment pour les parents dont les enfants requièrent une présence parentale renforcée (prématurité, naissances multiples, pathologies, handicap, adoption, famille nombreuse…) ou en cas de pénurie de modes de garde adaptés à la situation professionnelle des parents ou simplement pour permettre à un des parents de se consacrer à l’éducation de leur(s) enfant(s).
Instaurer une compétence obligatoire des communes/intercommunalités et confier aux Caisses des allocations familiales (Caf) un rôle de garant de l’équité territoriale via un pilotage départemental et un renforcement des outils de financement et de péréquation.
Le volontarisme et les incitations ne suffisent plus. Seule l’instauration d’une compétence obligatoire des communes/intercommunalités en la matière est à même de débloquer la création de modes d’accueil. C’est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La Cnaf et les Caf doivent également avoir un rôle renforcé pour concrétiser un véritable service public de la petite enfance. La compétence obligatoire des communes pourrait se traduire par :
• Une obligation d’accompagnement des assistants maternels et de recensement de l’offre d’accueil ;
• La responsabilité de l’organisation et de la création des places en crèches sur leurs territoires ;
• L’instauration d’un guichet unique d’information et d’orientation des parents afin de comptabiliser les demandes et de s’assurer de la mise en place d’une solution adaptée aux besoins des parents avec l’appui de monenfant.fr ;
• Un engagement à réduire la proportion de familles sans solution d’accueil.
Entre 2007 et 2016
Renforcer la responsabilité et le pilotage aux niveaux communal et départemental
2e
L'Unaf plaide pour un reste à charge de maximum
Les Caf joueraient un rôle essentiel de pilotage départemental, d’incitation, et de garant de l’équité territoriale en lien avec le schéma départemental des services aux familles. Les Caf pourraient mettre en place dans le cadre des Conventions territoriales globale (CTG) des objectifs à atteindre en matière de réduction de la proportion de familles sans solution d’accueil. Pour ce faire, les Caf devraient avoir la possibilité de renforcer les financements et d’utiliser davantage d’outils de péréquation.
À plus long terme, le service public de la petite enfance pourrait se traduire par l’instauration d’un “droit opposable” sous forme d’indemnisation, en cas de non-disponibilité de places. Cette indemnité serait financée par les collectivités territoriales, afin de les inciter à investir massivement dans la petite enfance. Il faudrait faire en sorte que, quel que soit le mode d’accueil, la collectivité ait à investir financièrement un montant quasi équivalent ; en d’autres termes que les familles aient recours à un assistant maternel, une crèche, une micro-crèche, une Maison d'assistant(e)s maternel(le)s (MAM), ou qu’elles n’aient pas eu de places disponibles, le reste à charge pour la collectivité resterait le même.
Instaurer un plafond de 500 euros de reste à charge maximum pour un temps plein d’accueil et réintégrer le crédit d’impôt pour frais de garde dans la Prestation de service unique (PSU) et le Complément mode de garde (CMG)
Pour les parents de jeunes enfants en emploi, le coût de l’accueil du jeune enfant joue comme un impôt sur les revenus professionnels. Si ce coût est trop lourd, il incite les parents à réduire leur activité professionnelle et souvent ce sont les mères qui supportent ces arbitrages.
La France doit, sur ce point, suivre l’exemple de la Suède et considérer comme repoussoir le modèle britannique où les restes à charge des familles dépassent coutumièrement les 1000 € mensuels. Il faut éviter un système à deux vitesses qui n’aiderait massivement pas l’accueil des enfants de niveau de vie modeste ou moyen, tout en amputant 15 ou 25 % des revenus des autres familles.
Plus généralement, les restes à charge de l’accueil du jeune enfant ne sont pas de bons véhicules de redistribution verticale. C’est en grande partie le fait que les parents soient ou non en emploi à temps plein (donc grands consommateurs d’accueil) – qui détermine leur niveau de vie. Une tarification trop progressive risque d’aboutir à un système paradoxal, où plus les parents utilisent d’heures, plus leur coût horaire d’accueil serait élevé.
Des taux d’effort excessifs
• Un accueil coûteux
• En Suède, le taux d’effort ne peut dépasser 3 %, plafonné à 150 €
• En France, une assistante maternelle absorbe 12 % des ressources d’un couple dont chaque membre touche un SMIC
• Le coût de la garde représente le principal « coût du travail » des parents de jeunes enfants.

Actuellement, les taux d’effort appliqués en France, si on les rapporte aux salaires médians, tant des mères que des pères, sont encore très élevés. Le rapport de l’OCDE note que la France est proche de la moyenne européenne, tout en indiquant qu’un grand nombre de pays, dont l’Allemagne et la Suède, ont fait des choix de reste à charge faible pour les familles. À noter également qu’au-delà du taux d’effort, des pays tels que la Suède ont fait le choix de plafonner à 150 euros maximum les restes à charge des parents.*
Nous plaidons pour l’instauration d’un reste à charge maximum de 500 euros pour un temps plein, quel que soit le mode d’accueil. De même, les crédits d’impôt pour frais de garde pourraient être réintégrés à la PSU et au CMG afin de diminuer les avances de trésorerie.
Congé parental, compétence obligatoire englobant accueil collectif et individuel, reste à charge plafonné, voilà, selon l’Unaf, les conditions de la réussite de ce futur ser-
vice public de la petite enfance. Parce que cela prendra du temps, il faut donner une perspective, avec des traductions concrètes chaque année, et un engagement à garantir les moyens de la branche famille.
Le 1er juin, la Première ministre Elisabeth Borne a donné des précisions sur l’ambition du SPPE :
• 100 000 places d’accueil sur la durée de la COG
• 5,5 milliards sur 5 ans pour le développement des crèches
• + de contrôle qualité sur les établissements
• Renforcement des formations au niveau régional
L’adoption d’une stratégie nationale pour la petite enfance figure par ailleurs à l’article 10 du projet de loi « plein emploi », qui confie au bloc communal le rôle d’autorité organisatrice. Pour l’Unaf, si ces annonces, qui posent les premières pierres du SPPE, vont dans le bon sens, aucune mention d’un congé parental mieux indemnisé n’a été faite. Le PLFSS 2024 sera un nouveau rendez-vous de mobilisation sur ce sujet.
À terme : SPPE = un parcours d'accueil serein et fluide pour tout enfant qui naît, jusqu'à son entrée en maternelle.
Une possibilité de congé parental accessible pour les deux parents, mieux indemnisés (75% du salaire) jusqu'au 1 an de l'enfant avec une option plus longue à temps partiel
Une place d'accueil de qualité garantie par la commune et accessible financièrement : taux horaire identique quel que soit le mode d'accueil, reste à charge connu à l'avance et sans avance de trésorerie, plafond garanti de reste à charge (500€/mois pour un temps plein)
Un guichet unique d'orientation pour les parents assuré par les communes/intercommunes avec l'appui du site monenfant.fr
Instaurer une compétence « petite enfance » obligatoire des communes/ intercommunalités = un engagement à réduire le nombre de familles sans solutions d'accueil
ASSISTANTS MATERNELS
Obligation d'accompagnement
Confier aux Caf le rôle de garant da l'équité territoriale via un pilotage départemental et un renforcement des outils de financement et de péréquation.
ACCUEIL COLLECTIF
Responsabilité de l'organisation et de la création des places en crèches sur leur territoire
La branche famille doit renégocier une nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) avec l’État pour la période 2023-2027, ainsi que les modalités d’utilisation du Fonds national d’action sociale (Fnas) et du Fonds national de gestion administrative (Fnga). L’Unaf a élaboré des propositions pour que les 5 années à venir soient synonymes d’améliorations significatives pour les familles.
Afin de tenir compte des grandes variations actuelles des prix et des salaires, le Fnas devrait être revalorisé de façon dynamique sur les cinq prochaines années. Les ambitions du Gouvernement en matière de service public de la petite enfance et les enjeux de cohésion sociale nécessitent de tels investissements. Nous proposons d’investir dans la politique familiale en garantissant une augmentation annuelle du Fnas équivalente à un indice mixte 20 % prix/ 80 % salaire, afin de solvabiliser les services aux familles, majoré de 1 %, pour répondre aux enjeux en matière de conciliation, de soutien à la parentalité et de qualité de service aux allocataires.
Pour l’Unaf, ce Fnas doit également garantir un maintien en euros constants des fonds locaux d’action sociale, pour soutenir les capacités d’innovation et d’adaptation aux spécificités territoriales des caisses locales d’allocations familiales.
Les fonds locaux ont une importance capitale dans l’histoire de l’action sociale de la branche famille. Ils ont notamment permis de préfigurer au niveau local, des prestations qui ont ensuite été étendues à l’ensemble des familles. C’est le cas récemment encore de l’allocation pour décès d’enfant qui a été expérimentée dans certaines Caf avant d’être généralisée. On peut égale-
ment citer les aides à l’investissement pour les ALSH (Accueil de loisir sans hébergement), qui ont d’abord été supportées par les fonds locaux, avant d’être étendues au niveau national.
Investir davantage dans le périscolaire et l’extrascolaire Au-delà de la petite enfance, le développement de solutions d’accueil périscolaire et extrascolaire doit être une priorité de la prochaine COG État/Cnaf.
Selon le baromètre de la Cnaf des temps et activités péri et extrascolaire de 2021, 22 % des familles justifient la non-inscription de leur enfant dans un centre de loisirs du fait du coût trop élevé et 51 % des familles considèrent qu’elles paient trop cher.
L’Unaf propose que soit expérimentée une PSU (Prestation de Service Unique)
« ALSH » imposant un barème des participations familiales sur 13 départements. Dans l’attente d’une généralisation de ce dispositif, l’Unaf préconise de simplifier, en instaurant une prestation socle de 1 € par heure, auquel on associerait trois bonus :
• un bonus territoire qui permette de mieux aider les communes en difficulté,
• un bonus handicap pour continuer à encourager l’accueil des enfants en situation de handicap,
• un bonus extrascolaire pour tenir compte du surcoût pour ce type d’accueil.
Les dispositifs de soutien à la parentalité, gratuits pour la plupart, ne touchent que 10 à 15 % des familles. Pour les parents d'enfants âgés de 0 à 6 ans, ces financements sont estimés à 100 millions d'euros, soit 0,5 % du budget consacré aux crèches, assistants maternels et écoles maternelles. Pour donner de l’ampleur à cette politique, la Cnaf doit sécuriser financièrement les porteurs de projets, mieux structurer l’offre et apporter de la visibilité aux actions. Plusieurs propositions autour du fonds national parentalité, de l’animation territoriale, des LAEP, des TISF, sont présentés plus en détail dans le document global*.

Les politiques publiques ont considérablement renforcé, ces dernières années, les moyens dévolus aux politiques de soutien des parents séparés, notamment via une action proactive contre les impayés de pensions alimentaires, et en majorant les prestations légales pour les parents en situation de monoparentalité, via l'allocation de soutien familial.
Or, si l'action des Pouvoirs publics a été déterminée ces dernières années sur le volet du soutien financier apporté aux foyers monoparentaux, elle est restée encore trop peu engagée :
• sur la prévention des ruptures familiales (sujet mis en avant lors de la Conférence des familles de 2021) ;
• sur la préservation des liens post-séparation entre parents (et grands-parents) et enfants. Les services dont c’est la vocation (médiation familiale, espaces de rencontre…) rencontrent de grandes difficultés d’ordre financier.
Pour l’Unaf, cela doit passer par un investissement dans l’apaisement des conflits familiaux, en créant une prestation de service pour le conseil conjugal et familial afin de le rendre accessible financièrement à toutes les familles et en créant les conditions d’un meilleur déploiement des dispositifs de médiation familiale et d’espaces de rencontre, en offrant une prestation de service délivrée par les Caf à 100 % et en facilitant la création d’ETP au sein des services conventionnés.
La délivrance des prestations pose des enjeux multiples. Le projet phare annoncé pour la future COG est celui de la solidarité à la source. L’Unaf est particulièrement en alerte sur les impacts de cette réforme sur les allocataires. Ce projet doit être mis en œuvre uniquement si des garanties en matière d’accompagnement sont prévues en cas d’erreur : circuit de modification des données à la charge des Caf et non de l’allocataire et possibilité de versement en attente de rectification.
Au-delà de ce projet, d’autres sujets semblent importants à prendre en compte dans la future COG :
• Le tournant numérique et ses impacts Pour l’Unaf, les Caf devraient mieux repé-
Seuls 10 à 15%
des parents sont touchés par les dispositifs de soutien à la parentalité
rer et orienter les publics en difficulté rencontrés par les professionnels Caf vers des lieux d’inclusion numérique. Les Caf pourraient également conventionner avec les partenaires locaux pour mener des actions d’inclusion numérique pour l’utilisation du compte caf.fr et le recours à ces droits auprès des publics en difficulté.
• L’accompagnement des difficultés budgétaires
Pour améliorer cet accompagnement, l’Unaf suggère de renforcer les liens entre les Caf et les Points conseil budget afin de favoriser le repérage et le traitement des situations budgétaires fragiles.
Suite à la signature de la COG entre la Cnaf et l’État, les Caf élaboreront leur Contrat pluriannuel d’objectif et de gestion (CPOG). Ces contrats constituent la feuille de route stratégique et opérationnelle des Caisses jusqu’en 2027, en déclinant localement les grandes orientations de la nouvelle COG. Y seront présentées les caractéristiques spécifiques du territoire en matière d’action sociale et de relation de services aux usagers. C’est également dans ce document que sont précisés les indicateurs de suivi de la qualité de service et de la performance de gestion.
Cette CPOG devra recevoir un avis favorable du conseil d’administration de la Caf pour être validée. C’est pourquoi, nous conseillons vivement aux représentants familiaux de demander qu’un travail de concertation ait lieu via un temps de bilan du CPOG précédent et un temps d’élaboration du nouveau contrat. Cela peut donner lieu à des séminaires spécifiques. C’est dans l’intérêt du directeur et du président de la Caf d’associer l’ensemble des membres du CA à l’élaboration de ce document stratégique. Pour respecter le calendrier, et si la COG est signée comme précédemment en juillet, le bilan devrait être fait durant le 1er semestre et la phase d’élaboration en début de 2e semestre.
Afin d’avoir une bonne connaissance des spécificités de votre territoire, vous pouvez vous appuyer sur le schéma départemental des services aux familles et sur les bilans des CTG fait par votre Caf.
• Les spécificités induites par les mesures de protection juridique et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)
L’effectivité des droits des personnes bénéficiant d’une mesure reste encore aujourd’hui limitée. Elles rencontrent encore aujourd’hui de trop nombreuses difficultés pour être considérées comme des citoyens à part entière. Il est donc essentiel que la prochaine COG prévoie une meilleure prise en compte des spécificités induites par les mesures de protection juridique et les MJAGBF afin que, comme tout citoyen, les personnes en bénéficiant soient toujours en mesure d’exercer leurs droits.
Action sociale - Fnas
(Fonds national d'action sociale)
• La petite enfance* : la PSU, les bonus territoires, mixité, handicap, la PS Relais Petite Enfance, plan d'investissement crèches
• Périscolaire : PSO
• Jeunesse : PAEJ, PS Jeunes, aides BAFA...
• Parentalité : LAEP, PS Médiation familiale, PS Espace de rencontre, Fonds National Parentalité (REAAP...)
• Animation sociale : Centre sociaux, EVS
• Fonds publics et territoire, les CTG
• Fonds locaux d'action sociale
Gestion administrative - Fnga (Fonds national de gestion administrative)
• Délivrance des prestations, accès aux droits
• Système informatique
• Dépenses de personnels et de fonctionnement pour assurer la mission de gestion des prestations
• Dépenses de personnels des CAF en charge de l'action sociale (travailleurs sociaux, conseillers techniques)
En savoir + Retrouvez l’ensemble des propositions de l’Unaf sur le service public de la petite enfance et la future COG Etat/Cnaf sur :
L’Unaf a réalisé une enquête auprès des familles, à la demande de trois inspections qui souhaitaient connaître l’opinion des parents sur la médecine scolaire.
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), et l’Inspection générale de l’administration (IGA) rédigent en effet un rapport sur ce sujet, qui sera ensuite envoyé aux parlementaires. Malgré une période d’enquête peu propice à la mobilisation des parents (vacances de Noël), plus de 450 parents y ont répondu. Ce nombre traduit l’intérêt que portent les parents à la médecine scolaire. Ces résultats ont été présentés aux inspections lors d’une audition, le 4 janvier 2023, qui a permis de rappeler les positions de l’Unaf.
En synthèse, il ressort de cette enquête que les parents sont massivement favorables à la présence de professionnels de santé au sein des établissements scolaires (93 %), même si certains déclarent mal connaitre les missions des différents professionnels.
Cette présence leur semble néanmoins indispensable pour :
• Participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins et à la prévention : Les actions de dépistage, de prévention, de repérage, d’éducation à la santé peuvent toucher tous les enfants d’une même génération. La médecine scolaire agit ici comme un « filet de sécurité » permettant de récupérer des enfants invisibles des parcours de santé habituels et rétablir ainsi une sorte « d’égalité des chances », d’autant plus que la prise en charge de la santé de l’enfant est indispensable pour une bonne scolarité.
• Être un relais entre les parents et l’établissement, notamment pour les enfants ayant des besoins particuliers. Certains parents sont confrontés à des lourdeurs administratives ou à des organisations conduisant à des pertes de chance pour leurs enfants. Les professionnels de la médecine scolaire peuvent être des « faci-
litateurs » et faire œuvre de pédagogie auprès des équipes éducatives pour expliquer certaines situations.
• Accompagner les parents et les orienter dans le dédale du système de santé.
• Permettre aux enfants d’avoir un contact avec des adultes avec qui ils sont en proximité et en confiance, pouvoir poser des questions sans risque de jugement.
• Agir vite dans le cas d’un accident ou de petits maux au sein de l’établissement.
Les thématiques de la prévention du harcèlement (sexuel, scolaire, cyberharcèlement…) et des violences intra familiales ont pris de l’ampleur ces dernières années et ceci se traduit par de nombreux témoignages sur la nécessité de renforcer l’action et la formation de ces professionnels sur ces sujets.
Enfin, le développement d’actions de prévention et de promotion de la santé par les pairs doit aussi, de l’avis des parents, être encouragé.
En savoir + Tous les résultats complets
1médecin/ 12 572 élèves 1 512 élèves assistant social / infirmier/ 1 300 élèves
Il s’agit d’une complémentaire santé destinée aux personnes en situation de précarité. Elle regroupe l’ancienne CMU-C et l’ancienne ACS. Elle est gratuite pour les personnes ayant des ressources inférieures à 798 € par mois et payante, avec une cotisation qui augmente en fonction de l’âge, pour les personnes ayant des ressources mensuelles comprises entre 798 € et 1077 €.
En savoir + Emission Consomag en partenariat avec l’Unaf « La complémentaire santé solidaire »
1. Attribution automatique de la C2S pour les personnes percevant le RSA (revenu de solidarité active) et transmission par l’assurance maladie d’une demande de C2S simplifiée pour les personnes percevant l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)
2. Pour les bénéficiaires de la C2S avec contribution financière, dispense d’envoi du bulletin d’adhésion lors du renouvellement si sa situation financière n’a pas changé.
3. Utilisation du dispositif de ressources mensuelles (DRM) qui transmet aux organismes de sécurité sociale, dont les CPAM, les informations sur les revenus d’activité salariée et les prestations sociales versées.
4. Intégration d’un enfant majeur de moins de 25 ans possible au cours de l’année où est ouvert le droit pour une famille.
5. Ouverture de droit à la C2S uniquement pour certains membres du foyer (et pas l’ensemble), par exemple uniquement pour les enfants mineurs et non pour les parents.
• Pas d’avance de frais chez les professionnels de santé (PS)
• Les PS ne peuvent pas pratiquer de dépassement d’honoraire
• Bénéficie du 100 % santé
• Pas de participation forfaitaire de 1 € lors d’une consultation chez un PS
• Pas de franchise médicale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires
• Prise en charge intégrale de certains matériels et équipements médicaux (pansements, cannes, déambulateurs, produits pour diabétiques…)
• Prise en charge du forfait journalier hospitalier en cas d’hospitalisation de plus de 24h
5,73millions C2S gratuite
7,19 millions de bénéficiaires à fin mai 2022
1,46millions C2S contributive
L’assurance maladie met en place plusieurs actions afin de favoriser le recours et faciliter l’accès à la C2S.
1. L’utilisation des missions accompagnement santé (MAS) de la CPAM, avec notamment des démarches d’aller-vers, qui réalisent un bilan des droits auxquels peuvent prétendre les familles et les accompagnent dans leurs démarches si besoin.
2. La mobilisation de partenaires, notamment la signature d’une convention de partenariat entre nos réseaux (Assurance maladie et Unaf-Udaf). Cette convention nationale CNAM – Unaf signée en novembre 2021 et déclinable entre les CPAM et les Udaf vise notamment à accompagner les publics cibles (familles monoparentales, Protection juridique des majeurs et aidants familiaux) dans leurs recours aux droits et aux soins.
3. La consommation des aides financières des services de l’action sanitaire et sociale (ASS) des CPAM. Pour 2021 par exemple c’est :
• 61 970 aides versées pour compenser l’effet de seuil induit par les plafonds de ressources de la C2S avec et sans participation (a concerné 93 % des CPAM)
• 7 168 aides à la prise en charge partielle ou totale de la C2S avec participation financière (a concerné 68 % des CPAM)
• 2 528 aides à la prise en charge du ticket modérateur sur la période rétroactive entre la demande de C2S avec participation et l’ouverture des droits (66 % des CPAM)
60% 34,4%
des bénéficiaires de la C2S sans participation sont des familles de 3 personnes et plus des bénéficiaires de la C2S avec participation sont des personnes de 60 ans ou plus
• Que la cotisation à la C2S soit fonction des ressources du foyer et non de l’âge.
• Qu’une cotisation familiale soit mise en place, et non comme c’est le cas aujourd’hui une cotisation par personne au sein du foyer.
• Vérifier / proposer que la C2S soit inscrite dans l'action sociale de votre caisse.
• Encourager la mise en place d’une convention entre l’Udaf et votre caisse pour faciliter l’ouverture de droit à la C2S des publics accueillis par l’Udaf.
• Dans le cas où les bénéficiaires de la C2S ont choisi la CPAM, interroger sur ce que propose votre caisse en tant que gestionnaire, ainsi que sur le taux de recours, les délais de traitement des dossiers, la communication/ information qui est faite sur le dispositif…
Depuis 2014, on constate une augmentation du nombre d’arrêt de travail et donc des indemnités journalières (IJ), et ce même en ne prenant pas en compte les arrêts liés au Covid. Par ailleurs, depuis 2020, les arrêts supérieurs à 1 mois sont de plus en plus récurrents.
Objectif de délai de paiement : 7 jours
Socle : 35 jours
Délai moyen de paiement : 33,45 jours
Les bénéficiaires de la C2S contributive demandent de plus en plus une gestion par la CPAM plutôt que par un organisme complémentaire.
Pourcentage de bénéficiaires de la C2S contributive gérés par la CPAM : 38%
La loi Elan du 25 novembre 2018 a introduit une réforme de la gouvernance des organismes d’HLM.
Grâce à l’intervention de l’Unaf, la place des Udaf a pu être conservée au sein des CA des Offices publics de l’habitat (OPH), mais des nouveautés mobilisent de nouveau notre vigilance.
En effet, l’entrée au Conseil d’administration (CA) des OPH de représentants du personnel, prévue par la loi, est désormais possible, depuis la publication du décret d’application de cette disposition en avril 2022. Dès les prochains renouvellements de CA, cette nouveauté va modifier leur composition. Si les Udaf ont toujours la possibilité de siéger au CA, au titre des Institutions socioprofessionnelles (Udaf, Caf, Action Logement et les organisations syndicales les plus représentatives dans le département), leur désignation n’est plus automatique. Le collège socio-professionnel des CA d’OPH dans lequel siège l’Udaf pourrait ne plus compter de représentant de l’Udaf.
Pour permettre d’intégrer les nouveaux membres, des précisions ont du être apportées. Désormais, l’Office n’est pas tenu de désigner un représentant de chacune des 4 Institutions, mais d’en choisir au minimum 2 parmi les 4.
Ces nouvelles règles s’appliqueront lors des renouvellements de CA dans les offices qui peuvent intervenir :
• En cas de fusion avec un autre OPH ou d’un changement de rattachement.
• A l’issue des élections municipales (2026) ou départementales (2028), selon la collectivité de rattachement de l’Office concerné.
Contact : Marilia Mendes, coordonnatrice du pôle Habitat-cadre de vie mmendes@unaf.fr
Il nous faut donc dès maintenant être attentifs à ces évolutions pour ne pas manquer l’occasion de faire valoir auprès de l’Office notre souhait de continuer à y siéger. Il s’agit de défendre une représentation importante pour les familles, encore plus en temps de crises.
C’est l’occasion de rappeler la plus-value apportée par le représentant de l’Udaf :
• Une expertise des attentes et besoins des familles en matière de logement, à chaque étape de la vie, avec une vision d’ensemble qui va au-delà de la seule problématique logement, une vision en termes d’habitat (services, écoles, transports...).
• La connaissance des familles en difficulté à travers leurs représentations (Ccapex, Commission DALO, Commission de surendettement, CCAS …) et l’accompagnement de ces familles à travers leurs services (d’Accompagnement social lié au logement, d’Accompagnement budgétaire, MJAGBF, Logements accompagnés et inclusifs…),
• La défense de l’intérêt de l’ensemble des familles : celles qui sont logées dans le parc HLM mais aussi celles qui sont en attente d’un logement.
En savoir + La fédération des OPH propose une cartographie des OPH et des regroupements par région :
La loi Kasbarian dite « anti-squat », présentée comme une loi visant à durcir les pénalités à l’encontre des squatteurs, contient un deuxième volet qui vise à accélérer les procédures d’expulsion des locataires en impayés de loyer.
Lors de son audition au Sénat, l’Unaf a exprimé ses vives inquiétudes quant aux mesures de ce chapitre 2, qui risquent d’augmenter de façon considérable le nombre d’expulsions fermes, sans solution de relogement pour les ménages concernés. Elle a fait des propositions d’amendements à ce texte. Les Udaf et les représentants familiaux ont également été nombreux à les porter dans leurs territoires auprès de leurs parlementaires.

L’Unaf a ainsi alerté sur les conséquences dramatiques de ce texte pour les familles de bonne foi, rencontrant des difficultés financières surtout dans un contexte de forte crise de l’inflation, de fragilisation de nombreux ménages et de tension sur le secteur locatif. Elle a déploré la réduction des délais dans la procédure contentieuse qui complexifie le travail de prévention et de résorption des dettes des locataires de bonne foi. Elle a enfin dénoncé l’assimilation des locataires de bonne foi, n’ayant pu trouver de solution alternative de relogement, à des squatteurs ; ainsi que les peines encourues.
Pour l’Unaf, il s’agit de mieux prévenir les impayés et les expulsions locatives en agissant le plus en amont possible afin d’éviter les expulsions et trouver des solutions.
Voté en première lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2022, ce texte a été adopté au Sénat le 2 février puis par l’Assemblée nationale le 4 avril avant d'être définitivement adopté par le Sénat le 14 juin 2023. Les sénateurs ont largement amendé ce texte, répondant en partie aux préoccupations de l’Unaf : l’obligation d’informer le locataire de son droit de demander des délais de paiement ; le rétablissement de la possibilité du juge d’accorder d'office un délai de paiement au locataire de bonne foi ; l’introduction d’un nouveau chapitre visant à améliorer l’accompagnement social des locataires en difficulté et à donner aux CCAPEX les moyens d’agir. Concernant la pénalisation du locataire qui se maintiendrait dans les lieux à la suite d'un jugement définitif d'expulsion, le Sénat a supprimé la peine de six mois d’emprisonnement encourue en maintenant toutefois la peine d’amende.
La fin de la trêve hivernale est effective depuis le 31 mars 2023, ouvrant la reprise des expulsions locatives pour les ménages en situation d’impayés. Une instruction adressée aux préfets de régions et de départements précise qu’aucune mise à la rue de ménages vulnérables ne devra être réalisée cette année et cible en priorités les familles avec enfants mineurs et en bas âge, les personnes âgées de plus de 65 ans, ou encore les personnes souffrant de maladies chroniques.
La circulaire incite par ailleurs les préfets à renforcer la prévention des expulsions en utilisant les outils mis en place dans le cadre du 3ème plan interministériel de prévention des expulsions locatives : éviter toute expulsion sèche « dans la mesure du possible », mobiliser le fonds d’indemnisation des bailleurs en cas de refus de la force publique, travailler en lien avec les CCAPEX et les équipes mobiles de prévention des expulsions.
Toutefois, l’année 2023 est annoncée comme une année de transition pour sortir des dispositifs mis en place pendant la crise sanitaire pour « revenir à une situation normale d’octroi du concours de la force publique » à partir de 2024.
Cette annonce inquiète l’Unaf, alors que les impayés de loyers augmentent, que de nombreuses expulsions ont été reportées du fait des mesures exceptionnelles mises en place pendant la crise sanitaire, et que le parc social n’a pas la capacité d’absorber l’ensemble des besoins.
Dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, l’Unaf appelle les pouvoirs publics à agir face au risque d’expulsion de familles en difficultés, en particulier en amont, via des actions de prévention et d’accompagnement social et budgétaire.
2,4millions
de ménages sont en attente d’un logement social
Faute d’information ou en difficulté face aux complexités des démarches administratives, de nombreuses personnes renoncent à certains droits et prestations. Ce phénomène, appelé non-recours aux droits, est massif avec des conséquences sociales importantes.
34% des personnes qui ont droit au RSA ne le demandent pas
Pour lutter contre ce phénomène, « l’une des priorités des prochaines années en matière de politique de solidarités », un appel à projets a été lancé fin mars par le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe. Dix territoires pilotes rejoindront l’expérimentation « Territoires zéro non-recours » qui vise à repérer, informer et accompagner les personnes qui ont des droits, mais ne les demandent pas, vers une sortie concrète de la pauvreté. Les territoires sélectionnés lanceront des initiatives de lutte contre le nonrecours aux droits sociaux et mobiliseront différents acteurs : collectivités, associations, caisses de sécurité sociale, bailleurs sociaux, etc. L’objectif de l’ensemble des projets sera de développer des démarches ciblées pour
QUESTION : Selon vous à quel public l’action sociale doit-elle s’adresser en priorité, en premier, en second ?
informer et accompagner les personnes sur leurs droits : accès aux RSA, prime d’activité, mais aussi chèque énergie, APL, ainsi que l’accès aux services publics.
L’expérimentation durera 3 ans, sera dotée d’un budget de 2 millions d’euros par an et sera suivie par le Comité de coordination pour l’accès aux droits et par un comité scientifique, animé par Nicolas Duvoux, président du comité scientifique du Conseil national de la lutte contre l’exclusion (CNLE). Selon le cahier des charges de l’expérimentation, les expérimentations démarreront en juillet.
Selon Jean-Christophe Combe, ces actions de proximité sont un complément indispensable à un autre grand chantier, la solidarité à la source : « La lutte contre le non-recours ne peut se faire sans accompagnement humain. Les algorithmes les plus performants pour repérer les non recourants potentiels, ne nous dispenseront pas par la suite de devoir contacter ces personnes ni de les accompagner dans le processus d’accès à leurs droits. »
Ces initiatives doivent permettre d’agir pour un meilleur accès aux droits sans attendre la mise en œuvre de la solidarité à la source, qui doit s’étaler sur plusieurs années. Une première étape, programmée au second semestre 2024, consistera à simplifier massivement les démarches pour accéder au RSA et à la prime d’activité par un système de préremplissage à valider par les bénéficiaires — sur le modèle de la déclaration d’impôt sur le revenu.
Dans les Conseils de famille des pupilles de l’État, Isabelle Saunier et Marie-Anne Casagrande sont chargées de participer à la construction du projet de vie des enfants pupille. Un rôle passionnant dont elles ont bien voulu témoigner.
siège au Conseil de famille du Tarn depuis 9 ans
Au Conseil de famille, notre rôle n’est pas seulement de confier les enfants à l’adoption : presque 70 % des décisions du conseil concernent la mise en œuvre du suivi des pupilles jusqu’à leurs 18 ans. Les trajectoires des enfants sont très diverses : certains peuvent devenir pupille à 2 mois, à la suite d’une naissance sous le secret, d’autres plus tard. Nous nous mobilisons autour du projet de vie de chaque enfant. Leur profil étant différent, nous faisons appel, pour chacun, à des compétences différentes (psychologiques, juridiques, humaines…) pour les suivre et les orienter au mieux, comme le feraient des parents. Notre première boussole, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins. Par exemple, quand il s'agit d'un bébé né sous le secret, nous essayons d’avoir un maximum d’information sur son histoire, celle de sa mère, dans la limite de ce que nous offre la loi. Il s’agit vraiment de trouver la meilleure famille pour cet enfant-là, et non l’inverse.
Entre les membres du Conseil, il faut établir de la confiance. Bien se connaître permet de travailler en transparence, d’exprimer en toute liberté ce qui nous semble le meilleur pour l’enfant. En général, les décisions sont très collégiales. Mais parfois elles ne le sont pas et il faut savoir accepter la décision du Conseil de famille. Globalement, nous avons une vision commune de ce qu’est l’intérêt d’un enfant. Certains membres apportent une compétence juridique ou médicale… En tant que représentante familiale, j’ai un regard plus global, plus généraliste sur la famille. Cette représentation est vraiment « à part » : construire un projet d’avenir pour un enfant , exercer à son égard les responsabilités liées à l’autorité parentale tout en appréhendant son vécu et ses souhaits sont des missions importantes . Il y a un mois, j’ai annoncé à un enfant qu’il allait être adopté par l’assistant familial chez qui il vit depuis sa naissance. C’était très émouvant, c’était un grand moment.
Au conseil, nous « portons » les enfants que nous suivons. Le travail sur leurs dossiers, en amont des réunions, est conséquent. Il faut vraiment entrer dans l’histoire particulière de chaque enfant : impossible de les prendre à la légère, d’autant plus qu’il s’agit d’enfants au vécu difficile, qui n’ont plus de parent. On les porte aussi après, on rentre chez soi avec leur histoire.
Les échanges au sein du Conseil sont riches et passionnants, car venant d’horizons divers, nous apportons tous quelque chose de différent : moi, en tant que représentante des familles, la représentante des associations d’adoption, les psychologues... Rester humble nous permet de dépasser nos points de vue personnels. Il y a une confiance mutuelle pour déterminer ensemble ce qui est le mieux pour l’avenir des enfants.
(1) Isabelle Saunier est aussi Présidente du département Parentalité-Enfance à l’Unaf et Présidente de l’Udaf du Tarn


En tant que mère de 6 enfants, j’apporte un certain recul. Mes enfants sont grands, j’ai pu consolider ma vision de l’éducation. Ayant eu 5 filles, je suis particulièrement sensible aux étapes vécues par des filles, à la vie affective et sexuelle. Je porte aussi attention aux variations de notes, aux détails qui peuvent alerter. Durant 2 ans, j’ai accueilli un petit garçon autiste avec sa sœur. Cette responsabilité m’a permis de mesurer la charge du handicap pour les familles. Je suis donc très attentive à cet aspect quand il s’agit de choisir une famille pour un enfant porteur de handicap.
Cette représentation m’apporte beaucoup. Nous sommes au service de la construction d’un enfant, d’un avenir. C’est grand, un enfant ! La qualité du travail autour des pupilles me réjouit énormément. C’est beau, c’est une fierté.
Sécurité routière
Le 13 avril 2023, Marie-Andrée Blanc, présidente de l'Unaf, et Florence Guillaume, Déléguée interministérielle à la Sécurité routière (DISR), ont signé pour la période 2023-2025, la convention-cadre entre l’Unaf et La DISR, afin de promouvoir la sécurité routière auprès des familles. La signature de cette nouvelle convention marque la poursuite des engagements conclus auparavant et la mise en place de nouveaux, de part et d’autre, pour une période de 3 ans. Ces engagements prennent en compte les attentes des référents Transports/Sécurité routière des Udaf, Uraf et Mouvements familiaux. Pour les Udaf, Uraf et Mouvements familiaux impliqués en matière de sécurité routière, les principes et engagements se déclinent autour de différents axes :
• sensibiliser les familles, les enfants, et les jeunes ;

• favoriser l'éducation routière ;
• développer des supports d'information en lien avec la sécurité routière ;
• promouvoir l'usage des mobilités alternatives ;
• encourager le travail partenarial avec les acteurs locaux. De son côté, la DISR s’engage notamment à associer les Udaf et Uraf aux différentes concertations locales, ainsi qu’au travers de la formation, et à intervenir lors des journées nationales Udaf et Uraf pour présenter la politique de sécurité routière
S’agissant des actions inscrites aux Plans départementaux de sécurité routière (PDASR) issus des politiques locales, les unions sont invitées à se référer aux sites des préfectures invitant à répondre aux appels à projets, ou à se mettre en contact avec les coordinateurs locaux : le directeur de cabinet du préfet qui anime et coordonne la politique de sécurité routière et/ou le coordinateur Sécurité routière lui étant rattaché.
Contact :
Hélène Marchal, chargée de mission
Transports – Sécurité routière hmarchal@unaf.fr
La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption modifie les règles relatives à l’adoption.
Deux décrets d’application sont particulièrement attendus. Le premier concerne le fonctionnement des conseils de famille des pupilles de l’État. Il devrait être publié au moment où vous lirez ces lignes. Le second porte sur les commissions d’agrément et n’est pas attendu avant la fin de l’été. Afin d’accompagner les représentants familiaux dans leur mission, l’Unaf organisera, après la publication des décrets précités, des visioconférences sur le fonctionnement de ces instances, en partenariat avec EFA, et en collaboration avec la FNADEPAPE.
La DGCS nous présentera à cette occasion les apports de la loi et pourra répondre à vos questions. Nous vous informons en outre de la création d’un espace dédié à cette mission sur le site internet pour les représentants familiaux « défendre les familles », où figurent les informations indispensables, ainsi que la création d’un groupe de travail sur l’espace REZO au sein duquel seront invités les représentants siégeant dans les CFPE qui souhaiteraient être conviés à des temps d’échanges, ou poser des questions à leurs homologues (dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel).
Contact : David Pioli, coordonnateur du pôle Droit de la famille, enfance, parentalité à l’Unaf dpioli@unaf.fr
Le compte rendu de mandat présente une synthèse annuelle de votre engagement pour les familles. Découvrez « Contributions », votre nouvel outil numérique de gestion et de valorisation de votre action au sein du réseau Unaf,Udaf, Uraf !
En utilisant « Contributions », vous valorisez votre engagement pour les familles et l’impact de votre action avec :
• facilité : en quelques minutes,
• sécurité : l’ensemble de vos déclarations sont accessibles et conservées au même endroit,
En qualité de représentant familial, vous devez également adresser une fois par an un compte rendu de mandat à l’Union qui vous mandate. Cette synthèse annuelle présente notamment les principaux sujets sur lesquels vous êtes intervenu/avez participé au cours de ces représentations pour la défense des familles.
• liberté et autonomie : c’est vous qui choisissez votre rythme : 1 fois par mois, 1 fois par trimestre, 1 fois par semestre ou 1 fois par an !
L’outil est accessible uniquement via votre compte Rézo (la base de connaissances), à l’aide de votre e-mail et mot de passe personnel. Vous devriez recevoir vos identifiants par mail prochainement. Si ce n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre Udaf !
Rézo Contributions Rézo
Votre espace est créé et personnalisé en fonction de votre représentation par le référent de votre Union !
« Contributions », c’est votre nouvel outil numérique de gestion et de valorisation de votre action au sein du réseau Unaf,Udaf,Uraf : que vous soyez bénévole au sein d’instance(s) interne(s) et/ou représentant familial.
Vous y retrouvez :
• vos comptes rendus de mandats numériques : une liste de(s) (l)’instance(s) de représentations dans lesquelles vous siégez pour l’Union,
• vos contacts utiles : un interlocuteur à votre disposition si besoin,
• votre module de rappel : un mail automatique envoyé directement par mail pour ne pas oublier (un rappel mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel),
• votre historique : une synthèse des résultats précédents des campagnes de votre Union, ainsi que vos précédentes contributions !
« Notes de frais », accessible uniquement via « Contributions », facilite la saisie et le traitement des notes de frais prises en charge par votre Union.
Pour aller plus loin :
Depuis le 1er janvier 2020, la valorisation du temps bénévole est devenue obligatoire. Cette valorisation contribue à donner une meilleure visibilité des ressources que nous mobilisons, à confirmer le dynamisme, l’activité et le volume d’heures bénévoles consacrées à la défense des familles.
Réalités Familiales n°140/141 : Naître
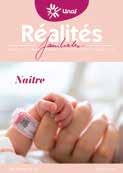
Entre choix intime, bouleversement existentiel, et responsabilité collective, le nouveau numéro de Réalités familiales, intitulé « Naître », s’intéresse au moment unique de l’arrivée à la vie. Préfacée par Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, la revue plaide, à travers les éclairages de contributeurs de tous horizons, pour un meilleur accompagnement des bébés et de leur famille.
Commandes auprès du service communication de l’Unaf : realitesfamiliales@unaf.fr ou en ligne sur : www.unaf.fr/boutique
Observatoire des familles
« Comment les familles réussissentelles à concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle ?
Besoins et aspirations »
L’Unaf a publié, dans le cadre de son Observatoire des familles, une enquête thématique inédite réalisée auprès de 2500 parents sur l’ensemble du territoire métropolitain à l’automne 2022 sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle. Réalisée par l’institut Opinion Way, elle a été complétée par des échantillons de parents dans 39 départements et 9 régions afin de dégager les spécificités ou les ressemblances entre territoires.
Conseils de famille des pupilles de l’État : nouvelles ressources en ligne

• Un espace collaboratif en ligne sur REZO (la base de connaissance de l’Unaf) : les inscrits seront conviés à des temps d’échanges, et pourront poser des questions à leurs homologues (dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel auxquels les membres des CFPE sont tenus).
• Une nouvelle rubrique dédiée à la mission est désormais disponible sur le site www.défendre les familles.fr, sur lequel figurent des informations indispensables.
Le catalogue de formations de l’Unafor propose de nombreuses formation dédiées aux représentants familiaux :
• La fonction de représentation
• Administrateurs CCAS ou CIAS : premiers pas/approfondissement
• Connaître son territoire pour mieux représenter les familles dans une CAF
• Prendre la parole ou participer aux réunion
• Animer et réussir une réunion
• Savoir argumenter
• Pratiquer l’écoute active, etc.
En tant que représentant familial, votre expertise, votre expérience, vos réussites mais aussi vos difficultés peuvent aider les autres représentants. Si vous souhaitez la partager, être interviewé, n’hésitez pas à nous écrire pour partager votre expérience avec les autres lecteurs.
N°5 - Juin 2023
Magazine édité par L’Union nationale des associations familiales 28, place Saint-Georges - 75009 PARIS
www.unaf.fr - Contact : defendrelesfamilles@unaf.fr
Direction de la publication : Marie-Andrée Blanc
Directrice générale : Guillemette Leneveu
Besoin d’information sur un point particulier, remarque, suggestion ? Ce magazine est le vôtre : participez à l’améliorer en nous écrivant.
Contact : defendrelesfamilles@unaf.fr
Dépôt légal : Juin 2023 / N°ISSN : 2781-9248
Périodicité : Semestriel - n° 5 - Juin 2023
Responsable de la communication : Laure Mondet Rédaction en chef : Jean-Philippe Vallat Coordination éditoriale : Élise Séaume Chefs de rubrique : Servane Martin (CAF), Élise Séaume (CCAS-CIAS), Céline Bouillot (Assurance maladie), Nicolas Brun (Santé), Marilia Mendes (Habitat), Lucie Fillon (Vos droits) Diffusion et abonnement : Cécile Chappe Crédits photos : X, Shutterstock
Création et Impression : Agence Hawaii Communication 78310 Coignières - Tél. : 01 30 05 31 51
Diffusion et abonnements : Abonnement annuel (2 numéros) 10 € / an
Respectueux de l’environnement, ce document est imprimé sur du papier utilisant la certification forestière PEFC (Programme européen de certification forestière). La certification PEFC donne l’assurance que le papier que nous utilisons est issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement.
Reproduction interdite sauf autorisation de l’Unaf