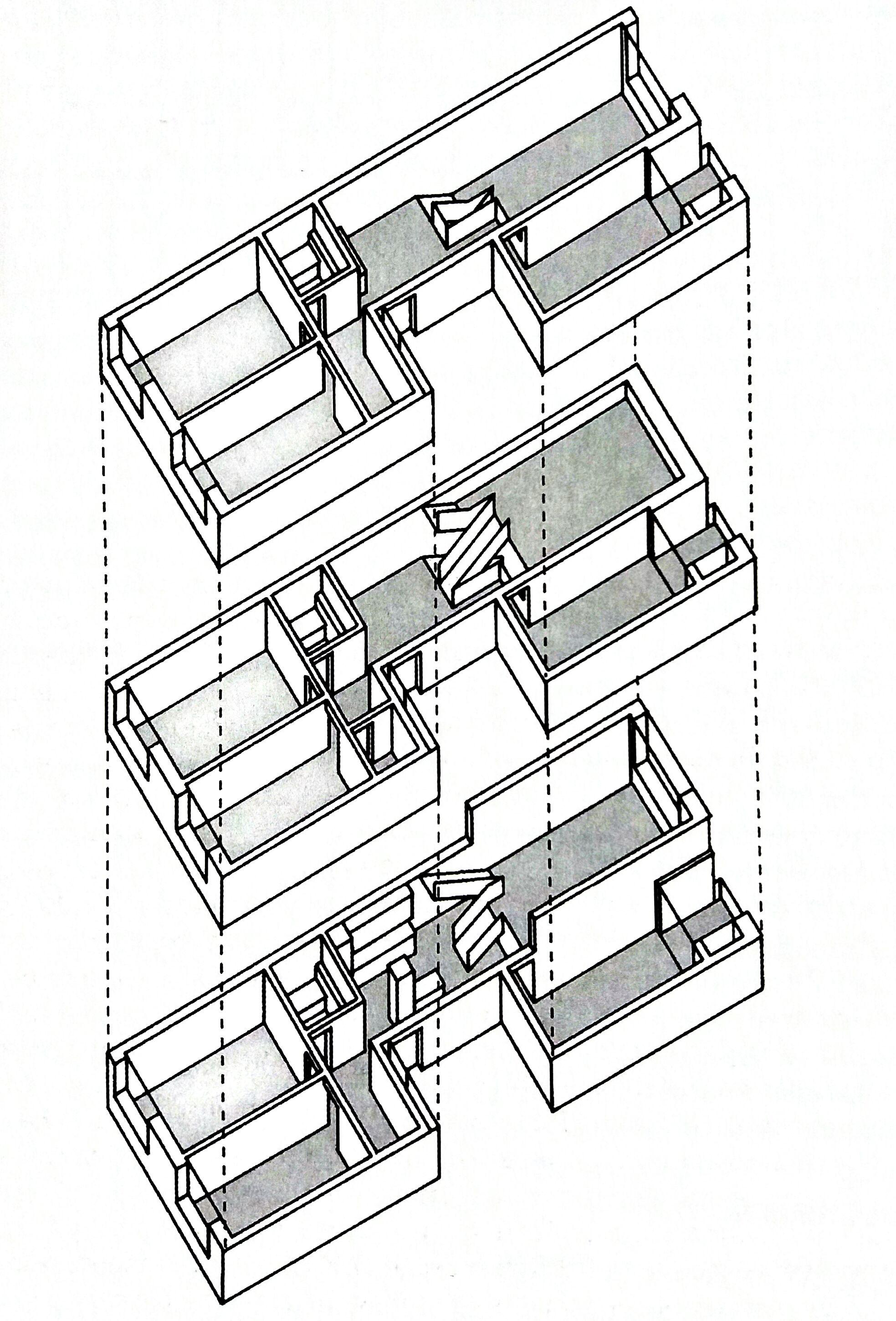6 minute read
1. Un savoir citoyen
1
Un savoir citoyen
Advertisement
L’habitat participatif est une expression d’ « expertise citoyenne » 10 . Il existe trois catégories de savoirs citoyens; la raison ordinaire (savoir d’usage) ; l’expertise citoyenne (savoirs professionnels) et le savoir politique (savoirs militants). Ils sont en interactions avec les savoirs institutionnels (élus, politiques). Les projets participatifs sont le résultat d’interactions entre ces différents savoirs. Ils fonctionnent grâce à la connaissance et au vécu des usagers. En effet, le savoir d’usage se traduit par une pratique du territoire. Il est donc intéressant de comprendre les pratiques de vie du citoyen afin de comprendre son approche du territoire.
John Dewey 11 affirme que les utilisateurs connaissent mieux que quiconque leurs intérêts. Cette idéologie est de plus en plus mise en pratique dans les politiques locales.
La Suisse, État fédéral, est une démocratie dite « semi-directe
» 12 . La confédération 13 est le niveau politique le plus élevé en Suisse, elle est composée de 26 cantons; celui de Zurich est le plus peuplé. Chaque canton 14 a sa propre constitution, gouvernement, parlement, tribunaux et police. Elle dispose d'une liberté de décision importante et d'une certaine autonomie. Les instruments de la démocratie directe existent à tous les niveaux : cantonal, fédéral et communal. Le citoyen a une parole plus importante et il peut agir de manière plus rapide, notamment avec l’initiative populaire 15 . La Suisse fonctionne sur un système très
10 DEBOULET Agnès et NEZ Héloïse, Savoirs citoyens et démocratie urbaine,Presses universitaires de Rennes, 2013. 11 DEWEY JOHN, The Public and Its Problem, Swallow Press/Ohio University Press Books, Athens, 1954 (1927). 12 La démocratie semi-directe est une combinaison des institutions représentatives et des institutions de la démocratie directe d'après ce que son nom indique. La démocratie semi-directe laisse donc une possibilité au peuple d'exercer directement les compétences attachées à sa souveraineté sur quelques points, c'est-à-dire lors d'un référendum, élément de démocratie par excellence, que la doctrine de la souveraineté populaire préconise d’ailleurs. <http://www.doc-du-juriste.com> 13 Confédération : Association durable d'États qui, pour mieux défendre des intérêts communs, se mettent sous la dépendance d'un organisme central commun sans renoncer à leur autonomie dans d'autres domaines. <http://www.cnrtl.fr/> 14 Les électeurs peuvent voter des projets et des lois et choisir les membres du Conseil municipal, le Gemeinderat, et du Conseil exécutif, le Stadtrat. Le Gemeinderat comprend 125 membres et le Stadtrat 9. Les deux conseils sont élus tous les quatre ans élus par le peuple. <https://www.zuerich.com/fr/visite/informations-sur-zurich/le-systeme-politique> 15 L’initiative populaire permet à un groupe de citoyens, à un parti politique ou à une association de récolter un nombre défini de signatures en faveur d’une proposition et d’obliger les autorités à organiser un référendum sur la question. L’initiative populaire peut être constitutionnelle, c’est-à-dire qu’elle vise à modifier la constitution, ou législatives, c’est-à-dire qu’elle vise à modifier une loi. Elle doit de plus respecter l’unité de matière. Le nombre de signatures nécessaire est de 100 000 en 18 mois au niveau fédéral et varie en fonction des cantons ou des communes pour les autres niveaux. Au niveau fédéral, seule l’initiative constitutionnelle est possible. <http://elections-en-europe.net/institutions/democratie-directe-en-suisse/>
différent du système français, État unitaire 16 . Le citoyen a un rôle central dans la gouvernance du canton. C’est sûrement la raison pour laquelle l’habitat participatif s’est développé beaucoup plus facilement.
En France, la politique de la ville tente d’aider les quartiers défavorisés, économiquement et socialement. Elle souhaite ramener le droit commun (accès aux mêmes services que le reste du territoire), favoriser l’émancipation des habitants et réduire l’endettement. Pour cela, plus de moyens vont être mis en place; une police sera présente au quotidien, des structures contre le décrochage scolaire et une éducation à la citoyenneté vont être adoptés. Le gouvernement prône le réinvestissement dans l’économie des quartiers avec le financement d’une politique sociale par les entreprises 17 . Cela, dans le but de réduire une pauvreté et une exclusion sociale toujours présente.
Il me semble que ces projets économiques ainsi que les moyens mis en place ne changeront pas le modèle statutaire dans lequel nous sommes actuellement. La politique de la ville ne propose pas de nouveaux modèles en réelle faveur de la mixité sociale. La mise en place de pratiques spécifiques pour ces quartiers crée une forme de ségrégation. De plus, le développement, principalement économique, de ces quartiers peut promouvoir le phénomène de gentrification 18 . Seuls des projets mettant en oeuvre une réelle mixité permettront de répondre aux problèmes actuels. La loi ELAN 19 promeut un dialogue de proximité entre tous les acteurs.
On remet souvent en question le savoir citoyen qui est sous-estimé et méprisé. Les collectifs citoyens se développent de plus en plus afin de porter leurs idées vers le haut (bottom-up). Zurich et la France sont deux États démocratiques. Toutefois, les savoirs citoyens en France sont encore peu exploités, à travers le pouvoir décisionnel; même s’il est légitime de convoquer le référent de la citoyenneté pour justifier une construction au nom du bien commun.
16
LOUIS FAVOREU, PATRICK GAÏA, RICHARD GHEVONTIAN, OTTO PFERSMANN, ANDRÉ ROUX, GUY SCOFFONI, JEAN- LOUIS MESTRE,Droit constitutionnel, 20e éd., 2018, Dalloz (Paris), p. 514 et s. 17 Politique de la ville, conférence de presse du Président Emmanuelle Macron, 14 novembre 2017 à Tourcoing, France. <https://www.youtube.com/watch?v=xu3nLRZKCPY> 18 Gentrification : le terme vient de l'anglais gentry, bourgeoisie. Il désigne un processus de renouvellement de la composition sociale et démographique d'un quartier au profit de ménages plus aisés. C'est un phénomène qui touche principalement les centres et les péricentres des métropoles. Les programmes de rénovation et de réhabilitation de certains quartiers ou îlots des centres-villes, dont le bâti se trouve ainsi requalifié, provoquent souvent une hausse des prix du foncier, des loyers et favorisent ainsi la concentration de populations des catégories supérieures aux activités fortement liées aux spécialités des métropoles. Ce processus de reconquête résidentielle s'inscrit à l'encontre du délaissement des centres-villes par les populations attirées par les périphéries urbaines. Mais il concerne plutôt les jeunes actifs sans enfants ou les populations plus âgées dont les enfants sont émancipés. Les politiques de rénovation urbaine sont parfois précédées par l'installation, dans des quartiers populaires centraux, de populations aisées pionnières (artistes, dinkies, etc) dont le pouvoir d'achat participe à la hausse des prix. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ gentrification>, octobre 2016. 19 Loi portant sur l’évolution du logement et l’aménagement numérique.
Un système politique avec un pouvoir décisionnel « plus local » permettrait de développer des projets plus proches du citoyen dans le but qu’il s’investisse d’avantage; dans une société où il incarne un rôle majeur.
Nous pouvons nous demander si la politique de la ville est adaptée aux enjeux 20 actuels. Un rapport de la Cour des comptes, publié en 2012, souligne que la plupart des objectifs de la politique de la ville n’ont pas été atteints 21 . Il signale un enchevêtrement des zonages et une organisation éclatée. Faut-il modifier la politique de la ville ou la supprimer ? Elle tente d’aider les quartiers défavorisés mais le fait de les classer et d’en faire un cas particuliers ne contribuerait-il pas à son isolement ? À travers le modèle de l’habitat participatif, nous traiterons la question de la mixité sociale à travers la pratique du territoire.
20 Politique de la ville : La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'Etat et la région. Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques. <http://www.legifrance> 21 La Cour des comptes publie en 2012, un rapport intitulé « La politique de la ville : une décennie de réformes" <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-de-la-ville-une-decennie-de-reformes> .