Terre-net.fr - Web-agri.fr - Terre-net-occasions.fr


Terre-net.fr - Web-agri.fr - Terre-net-occasions.fr

DÉCRYPTAGE
Planter les pommes de terre

ENGRAIS Décarboner la production

BIOCONTRÔLE
Quelle efficacité ?





Revue éditée par : MEDIA DATA SERVICES
Avenue des Censives - TILLE BP 50333 60026 BEAUVAIS Cedex - Tél. : 03 44 06 84 84 www.terre-net.fr et www.web-agri.fr www.facebook.com/terrenet
Twitter : @TerrenetFR
Linkedin : Terre-net Média ÉDITEUR DÉLÉGUÉ
CIP Médias - 7, rue Touzet-Gaillard CS 30009 93486 Saint-Ouen Cedex
Media Data Services et CIP Médias sont des filiales du groupe NGPA, dirigé par Hervé NOIRET RÉDACTION
redaction@terre-net.fr
Éditeur du pôle Agriculture : Jonathan HAVART
Rédacteur en chef adjoint Terre-net Le Magazine : Sébastien DUQUEF
Rédacteur en chef terre-net.fr : Arnaud CARPON
Rédactrice en chef web-agri.fr : Delphine SCOHY
Secrétaire de rédaction : Adélaïde BEAUDOING-NEGRO
Journalistes : Amélie BACHELET (rédactrice en chef adjointe Terre-net.fr), Céline CLÉMENT (installation-transmission), Sophie GUYOMARD (cultures), Julien HEYLIGEN (machinisme), Delphine JEANNE (économie et politique), Laure SAUVAGE (marchés)
Ont participé à ce numéro : Agence PAP, Nathalie TIERS INFOGRAPHIE, FABRICATION
Conception graphique et maquettiste principale : Nathalie JACQUEMIN-MURTIN
Responsable fabrication : Vincent TROPAMER assisté de Florian SANDOZ PUBLICITÉ
Votre contact : publicite@ngpa.fr
Directeur commerce et développement : Jérôme BUFFARD
Directeur commercial adjoint : Christophe CASANOVA
Back-office : Solène DELATTRE BASES DE DONNÉES & MARKETING DIRECT infohyltel@hyltel.fr
Directrice des offres de services : Delphine DUCLOS
Directeur du marketing des offres : Mikaël MENAGER
Responsable des offres : Christophe SEMONT ANNONCES OCCASIONS contact@terre-net-occasions.fr
Directeur commercial régie locale : Laurent GARREZ
Responsable back-office commercial : Isabelle THURET Mise en place et montage : Élodie MERAT ABONNEMENT
contact-abos@terre-net-media.fr
Directeur gestion des abonnés : Jean-Marie LAVIGNE
Chef de produit digital : Maéva PELOSO
Responsable de la relation clients et ventes directes : Pamela GAVILA
Chargée des abonnements : Cécile BEAUVAIS
SERVICES GÉNÉRAUX, JURIDIQUE & FINANCIER
Responsable du contrôle de gestion : Céline CASSAGNE
Administration/comptabilité : Valérie MARTIN
Comptable général : Maxime LAPERCHE Tél. : 03 44 06 68 66
MEDIA DATA SERVICES
SAS au capital de 1 500 000 € 829 606 599 RCS BEAUVAIS
Pour Groupe ISA, Gérard JULIEN, directeur de la publication, Hervé NOIRET, directeur général NGPA
Imprimé par : ROTO FRANCE IMPRESSION 25, rue de la Maison-Rouge – 77185 LOGNES N° 114 – Février-mars 2025
Dépôt légal : à parution - Diffusion : 50 000 exemplaires
Crédits photos de la couverture : Luc Tiffay/Adobe Stock/ Amazone/Hardi
Soucieux de la préservation de l’environnement, Terre-net Média sélectionne des fournisseurs engagés dans une démarche environnementale. Ce magazine est imprimé sur du papier 100 % certifié PEFC issu de forêts gérées durablement. Les encres utilisées sont végétales. Tous les produits qui ont servi à la réalisation de ce magazine ont été recyclés ou retraités conformément à la certification IMPRIM’VERT. Origine du papier : Suisse - Taux de fibres recyclées : 52 %
Certification : 2015-PEFC-SXM-117
« Eutrophisation » : Ptot 0,006 kg/t

Le début d’année ne serait pas complet sans les traditionnels vœux – que je vous adresse bien sûr à tous –, mais c’est aussi le moment de dévoiler un classement très attendu : celui des marques ayant immatriculé le plus de tracteurs en France. Un palmarès presque devenu un concours, scruté avec avidité par toute la filière. Depuis des années, Terre-net.fr achète les données du SIV (Système d’immatriculation des véhicules), le fichier officiel du ministère de l’Intérieur. Ces données, véritable thermomètre du marché, suscitent débats et… polémiques.
Certains tractoristes n’hésitent pas à remettre en question la légitimité de ces chiffres, voire à pointer Terre-net du doigt, à l’accuser de biaiser les résultats et de manquer de transparence. Pourquoi ces données, issues de la même source que celles d’Axema, génèrent-elles autant de méfiance ? La réponse tient peut-être dans l’interprétation. Là où certains voient une manipulation, nous revendiquons une analyse enrichie pour éclairer les tendances. De quoi froisser ceux qui préfèrent des chiffres bruts qu’on ne questionne pas – quitte à fermer les yeux sur leur propre stratégie.
Cette controverse révèle un malaise plus profond. Dans un secteur en mutation, entre pressions économiques et transition écologique, les chiffres ne sont plus des statistiques anodines. Ils cristallisent des tensions, influencent des décisions et opposent parfois des visions de l’avenir agricole. Avant de publier, les journalistes invitent chaque marque à commenter les estimations. Certaines préfèrent ne pas répondre, arguant qu’elles attendent les « données officielles ». Une posture qui peut sonner comme un refus d’assumer la réalité.
Car soyons honnêtes : il y a une carte bien connue que certains jouent sans complexe, celle des sur-immatriculations. En décembre, certains constructeurs immatriculent massivement pour gonfler artificiellement leur part de marché et noyer la concurrence. Et cette fois, ils avaient une excuse en or : l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2025, de l’obligation d’un double circuit de freinage. Résultat : pour certains, les immatriculations de décembre ont explosé, multipliées par deux ou trois. Mais soyons clairs, un tracteur immatriculé n’est pas forcément un tracteur vendu…
Bonne lecture !
Sébastien Duquef

N° 114
Février-mars 2025
REPÈRES
6 Bon à savoir
7 Agenda
10 Décryptage : planter les pommes de terre en bonnes conditions
TENEZ-VOUS PRÊT
12 TEMPS FORT
Prolonger la décarbonation des usines d’engrais dans les champs
20 Quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs en France en 2024 ?
DOSSIER
22 Financement du tracteur : ouvrir la porte aux bonnes options
34 TEMPS FORT
Cultiver autrement sans recourir à la chimie
42 Cultiver du tournesol dans les Hautsde-France, c’est possible ?
BRÈVES DES CHAMPS
44 En photos : polyvalence, quand les marques ont un langage universel
46 Seriez-vous prêt à manifester à nouveau ?
47 Les premiers enseignements de la plateforme Zéro fuite (Marne)
49 AgriSima : une édition 2026 plus conviviale ?
ANNONCES D’OCCASION
50 Sélections de matériels de seconde main
Sont joints à ce numéro, sur une partie de la diffusion, un encart Amazone, un encart TSE et un encart Huttepain.



















































XARVIO FIELD MANAGER

Avec le module PreciseN, Xarvio Field Manager propose une solution pour déplafonner la dose d’azote en fonction de l’évaluation de la biomasse (colza) ou des rendements estimés en saison (céréales). « On peut avoir tendance à sur-fertiliser le colza, ce qui augmente le risque de verse et peut affecter sa teneur en huile. En utilisant la carte de modulation intra-parcellaire PreciseN, l’agriculteur sera plus précis et économisera facilement quelques dizaines d’unités d’azote par hectare », détaille Thomas Lomberty, responsable terrain chez Xarvio. BASF Digital Farming précise que « le conseil apporté par PreciseN est conforme à la réglementation en vigueur au niveau national et respecte les paramètres de calcul de
dose de la Réglette azote colza de Terres Inovia ». Leurs experts contrôlent et valident également chaque année la qualité des estimations de biomasse colza réalisées par Precifield, partenaire du projet. Concernant les céréales, « les cartes d’estimation de rendement sont livrées à partir du 15 mars en orge et du 1er avril pour le blé. Elles sont actualisées tous les quinze jours, indique Alexandre Weil, fondateur de Precifield. Comme en colza, ces règles de calcul ont été présentées au Comifer. Le déplafonnement de la dose peut donc se faire en toute sérénité, si l’outil le préconise. » « La stratégie adoptée par défaut est le renforcement, ajoute Thomas Lomberty. PreciseN propose à l’agriculteur de mettre plus d’azote là où les rendements estimés sont les plus forts. Ce sera déterminant pour 2025, car les mauvaises récoltes de 2024 vont faire baisser les moyennes olympiques et les doses X, risquant de limiter les rendements. Mais les utilisateurs sont également en mesure de modifier la répartition de la dose. Dans ce cas précis, nous recalculons la dose moyenne et affichons un avertissement clair si cette modification provoque un dépassement. L’agriculteur reste maître de ses décisions. » Sarah Chenevier, responsable des partenariats chez Xarvio, explique que « la majorité des données parcellaires peuvent être récupérées depuis Smag, Wiuz, Scopix ou Géofolia. Reste à compléter quelques données dans l’outil Xarvio, telle que la dose totale de son PPF* en céréales En saison, les conseils arrivent par e-mail et via des notifications sur le mobile. Toutes les consoles peuvent lire les cartes et ainsi moduler ».
*PPF : plan prévisionnel de fumure.
LA CITATION
Si vous n’avez pas de grande gueule, vous vous faites bouffer. Il faut parler cash ! Ceux qui sont aux manettes depuis soixantedix-huit ans [la FNSEA a été fondée en 1946, NDLR] ont réduit le nombre de fermes d’année en année.
ALAIN QUEYRAL, figure historique de la Coordination rurale en Dordogne

SPOTIFARM
« Grâce à un algorithme innovant et à l’intelligence artificielle, Spotifarm peut désormais offrir aux agriculteurs des images satellites de leurs parcelles, tous les dix jours, quel que soit le temps », indique le spécialiste de l’imagerie satellite agricole dans son communiqué de presse. Malgré la présence de nuages ou en situation météorologiques défavorables, l’application se montre dorénavant capable de « nettoyer » les images pour les rendre exploitables. Elles sont ensuite automatiquement intégrées dans les outils Spotifarm, sans que l’utilisateur n’ait à paramétrer quoi que ce soit. L’évolution devrait permettre au producteur de doubler le nombre d’images exploitables en vue de suivre ses cultures et ainsi mieux les gérer.
Le 6 janvier, le Groupe Isagri a annoncé avoir acquis Sencrop. L’opération marque l’union de deux leaders européens en matière d’agrométéo et de gestion parcellaire. Avec ce rachat, Isagri entend fournir aux agriculteurs des données toujours plus précises. Selon Pascal Chevalier, directeur général : « Intégrer Sencrop renforce la volonté de fournir l’excellence technologique, la qualité et la pertinence des services apportés. » À date, le réseau Météus d’Isagri compte environ

5 000 stations météorologiques sur le terrain, Sencrop 35 000. « Avec plus de 40 000 stations actives, une communauté de 30 000 agriculteurs et 600 groupements d’utilisateurs dans 35 pays, Sencrop devient le numéro un en matière de données et de risques agrométéorologiques en Europe grâce au parc Météus », se félicite Pascal Chevalier. Les équipes des deux marques vont plancher sur deux chantiers d’importance : la construction d’une plateforme agro-météo et l’élaboration d’une nouvelle station physique de dernière génération. Le nouveau leader de l’agro-météo, qui réalise un quart de son activité hors de France, compte aussi se développer à l’international, en renforçant notamment sa présence dans les pays d’Europe de l’Est, au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu’en investissant les pays d’Europe du Sud.
22 février au 2 mars
Le SIA à Paris Expo Porte de Versailles (75) www.salon-agriculture.com
23 au 25 février
Le SIA’Pro au parc des expositions Paris Le Bourget (93) visiteurspro.salonagriculture.com
4 et 5 juin
Innov-agri Nord à Essigny-le-Grand (02) www.innovagri.com
10 et 11 septembre
Les Méca-Culturales à Saint-Agnet (40) www.lesculturales.com
24 et 25 septembre
Tech&Bio à Valence (26) www.tech-n-bio.com
9 au 15 novembre Agritechnica à Hanovre (Allemagne) www.agritechnica.com/en
Depuis l’annonce de la fermeture de la féculerie d’Haussimont (Marne), Tereos cherchait un repreneur. C’est chose faite avec GR Agri, producteur, conditionneur et négociant de pommes de terre fraîches implanté à Fère-Champenoise, à une quinzaine de kilomètres du site. « C’est un emplacement stratégique en termes de transport – nous sommes connectés aux principaux axes routiers – et qui présente l’avantage de disposer d’un espace suffisant pour nous permettre de développer pleinement notre projet. C’est surtout un site qui était déjà dédié à la pomme de terre. Une partie des activités est commune, ce qui nous permet de récupérer des bâtiments et équipements de l’usine. Grâce à Tereos, nous avons en quelque sorte trouvé le site idéal », explique Romain Gandon, gérant de GR Agri. Tereos cédera à GR Agri les 25 ha du site ainsi que le bâtiment de conditionnement équipé de quais de

chargement, celui de stockage de matériel, le centre de réception, les locaux administratifs et les ponts-bascules. GR Agri prévoit de son côté de construire un autre bâtiment de
conditionnement et un de stockage. Le projet représente un investissement de 10 millions d’euros. Le centre devrait entrer en activité fin 2025 et accueillera 15 salariés.

C’est la première fois que les réponses au sondage « Pour vous, l’année agricole écoulée était plutôt… », effectué régulièrement sur Terre-net.fr, sont aussi négatives. Pour 33 % des 2 405 votants, 2024 s’est révélée « une année catastrophique », pour 35 %, « une mauvaise année », pour 22 %, « une année moyenne », et pour 7 % seulement, « une bonne année ». Seuls 2 % des répondants estiment qu’il s’agissait « d’un grand cru ». Ces dernières années, il n’y a qu’en 2020 que plus de la moitié des agriculteurs avaient considéré l’année
comme mauvaise ou catastrophique. Ils n’étaient plus que 20 % de cet avis en 2021, année de reprise post-Covid 19. En 2022, la hausse des prix avait permis à 41 % des agriculteurs de juger l’année bonne, voire excellente. L’année dernière, les avis étaient plutôt mitigés, mais 41 % des répondants avaient estimé que 2023 était dans la moyenne.
[NB : Ce sondage a été réalisé en ligne sur Terre-net.fr entre le 17 et le 24 décembre 2024. Les résultats sont indicatifs, l’échantillon n’a pas été redressé.]
8,6 M€
Face au contexte inflationniste et à la dégradation du contexte économique, qui a entravé sa dynamique, le groupe coopératif Cérèsia annonce un plan de transformation visant à économiser en moyenne 8,6 millions d’euros (M€) par an d’ici fin 2027. Celui-ci se traduira par une simplification de son maillage territorial et de son organisation. 33 des 141 sites de collecte vont fermer, le nombre de régions commerciales passera de cinq à trois, l’effectif des administrateurs et des salariés sera réduit.
PIÈCES DÉTACHÉES
Le projet de loi d’orientation agricole (LOA), qui a pris du retard après la dissolution de l’Assemblée nationale, a été examiné au Sénat à partir du 4 février. Le calendrier prévoit un vote du texte le 18 février, avant le Salon de l’agriculture, prévu du 22 février au 2 mars. Ce projet de loi avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 28 mai 2024, juste avant la dissolution. S’il est amendé par les sénateurs, il pourrait être renvoyé à l’Assemblée nationale, où une commission mixte paritaire pourrait être chargée de trouver un compromis. Élaborée pour répondre à la grogne du secteur, la LOA place l’agriculture au rang d’intérêt général majeur, met en place un guichet unique pour l’installation de nouveaux agriculteurs et facilite la construction de bâtiments d’élevage ou de réserves d’eau, entre autres mesures. Avant de s’occuper de cette loi, le Sénat s’est penché sur le projet de budget 2025 à partir du 15 janvier, ainsi que sur un autre texte visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », proposé par la majorité sénatoriale.


Le groupe Agco réorganise totalement sa logistique de pièces détachées. L’Américain voit les choses en grand : 84 000 m² de bâtiments sur un terrain de 200 000 m² pour un investissement total de 87 millions d’euros. La future plateforme logistique sera implantée aux Portes de l’Orne, à Amnéville, en Moselle, à seulement 12 km du centre historique d’Ennery, ouvert il y a trente ans, dont l’activité et les équipes (440 employés) seront transférées. Les installations d’Ennery, éclatées sur plusieurs sites, seront ainsi réunies sous un même toit.
L’ouverture est prévue fin 2026. Ce centre, construit sur l’ancienne friche sidérurgique de Rombas-Gandrange – dont la fermeture avait fait l’actualité en 2009 –, desservira principalement l’Europe et le MoyenOrient. Il servira également de base pour l’approvisionnement de l’Asie et de l’Amérique du Nord et du Sud. La plateforme logistique sera capable de traiter plus de 5 millions de commandes par an. Grâce à cette concentration, l’entreprise devrait mieux répondre aux urgences et réduire les délais pour les clients.











































d’information des deux marques référentes de la FILIÈRE ÉLEVAGE !

















































Tous les contenus de L’éleveur laitier et de Web-agri en illimité : actualités, articles et dossiers techniques



Tous les outils professionnels (météo, cotations...) Les newsletters d’actualité L’éleveur laitier en version numérique

Toute la formule 100% WEB + NOUVEAU | Agriflix : la plateforme audio et vidéo 100% agricole +


NOUVEAU | Agriflix : la plateforme audio et vidéo 100% agricole



Les 11 numéros de L’éleveur laitier chez vous, chaque mois





Oui, je m’abonne et je choisis ma formule :






Nom :
Prénom :










Société :
Adresse :


CP :
Portable :
Localité :

Merci de joindre à ce bulletin d’abonnement, votre chèque à l’ordre de Groupe France Agricole - L’éleveur laitier Web-agri. Conformément à la loi informatique et Libertés du 6/01/1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer, en nous contactant par mail : serviceclients@ngpa.fr. Notre politique de confidentialité des données est accessible sur notre site www.ngpa-abonnements.com. O re réservée à la France métropolitaine et aux personnes non abonnées, valable jusqu’au 30/06/2025. Groupe France Agricole - 7 rue
Avant de planter, le sol doit avoir été émietté, ameubli et débarrassé de ses cailloux, pour assurer le bon développement des tubercules.


L’itinéraire cultural de la pomme de terre ne doit pas négliger l’implantation. Celle-ci influence principalement le comportement des plantes en végétation, mais aussi les conditions de récolte de la parcelle.
1Émietter et ameublir le sol
La pomme de terre est une culture exigeante en termes de préparation de sol. Celui-ci doit avoir été émietté, ameubli et débarrassé de ses cailloux pour assurer le bon développement des tubercules. Le labour reste la solution majoritairement choisie pour ameublir la terre en profondeur, et donc faciliter le travail des outils de reprise. Selon une enquête menée par Arvalis, 97 % des producteurs du nord de la France cultiveraient
la pomme de terre en système labouré. Or, des expérimentations ont démontré que recourir à des outils de préparation de sol performants (type herses rotatives ou fraises) permettait d’obtenir en sans-labour des reprises tout aussi profondes et affinées. Seul impératif : que l’ameublissement en profondeur ait été effectué pendant l’interculture (décompaction). La productivité et la qualité de la culture se montrent alors équivalentes à celles obtenues en labourant.
2
Enfouir les résidus pailleux
Des précautions doivent cependant être prises en termes de gestion des résidus et de conduite de la fertilisation azotée. Les résidus pailleux non décomposés, en système non labouré, accroissent les risques de contamination en rhizoctone des tubercules. En outre, leur présence attire les limaces, et ce d’autant plus si une culture intermédiaire a précédé la pomme de terre. Les spécialistes
recommandent de les broyer et de bien les incorporer. La dynamique des éléments minéraux est différente selon que le système est ou non labouré. Recourir à la méthode Comifer et à des diagnostics de nutrition azotée (Jubil, Hydro N-Tester) est conseillé pour ne pas sous-estimer les besoins.
La technique d’épierrageandainage et tamisage permet d’éliminer du lit de plantation tous les cailloux ou mottes susceptibles de nuire au bon développement des tubercules. Elle comporte deux étapes : le billonnage puis le tamisage, et peut être suivie d’une plantation en buttes ou en billons. Après récolte, procéder à un ré-étalement des andains de pierres grâce à deux passages croisés avec un outil à dents est nécessaire. Ceci afin de préserver la structure du sol et assurer la régularité de croissance des cultures suivantes.
Cultiver en billons permet d’obtenir des tubercules de petits à moyens calibres, dans le cadre d’une culture de grenaille ou de variétés à chair ferme. La technique consiste à installer généralement trois rangs dans une butte plus large et de forme aplanie (billon ou planche). Par rapport à la technique en buttes classiques, ce type d’implantation permet, a densité de plantation identique, d’améliorer l’occupation du sol par les plantes. Ce qui limite la compétition entre elles et favorise la hausse du rendement, avec des tubercules de formes et de calibres homogènes. La planche limite en outre le dessèchement du sol, en début et en fin de végétation. La culture en billons s’accompagne par contre d’un risque de battance accru, elle implique de planter plus superficiellement et sans possibilité de rebuttage, et le volume de terre à éliminer au moment d’arracher est plus important, ce qui peut s’avérer préjudiciable en conditions humides. Il est conseillé d’utiliser cette technique en cas de récoltes précoces.

Solène Garson, ingénieure filière pommes de terre Arvalis région Nord
« Planter en priorité les parcelles ressuyées et réchauffées »
« Avant de démarrer la campagne, en hiver, identifiez les parcelles afin d’anticiper les programmes de désherbage. À noter que 2025 est la dernière année pour utiliser les herbicides à base de métribuzine et de flufénacet. Ne pas oublier les reliquats azotés : il faut épandre la juste dose pour garantir la qualité de production. La pomme de terre ayant un faible enracinement, le prélèvement fin février-début mars peut s’opérer sur les deux premiers horizons ou sur l’horizon 45 cm. À la ferme, quand le plant certifié arrive, pensez à garder les étiquettes Soc, puis vérifiez les qualités et l’état germinatif des lots. Pour cela, il faut ouvrir les big-bags ! Les plants doivent en être sortis afin d’éviter la condensation et la germination. Le stockage sur une dalle ou en palox retarde cette dernière. Si les plants sont mis en frigo, pensez à les sortir quelques jours avant de planter pour favoriser leur réveil. Manipuler le plant limite sa germination, car le géotropisme du lot se retrouve bouleversé. Si, malgré ces précautions, maîtriser la germination s’avère difficile, un égermage peut être effectué (germes de 5 cm). Dans ce cas, respectez une phase de cicatrisation de trois à cinq jours avant de planter. Observer la qualité du plant est primordial pour réaliser le traitement seulement si nécessaire. Attention : couper le plant peut s’effectuer si le calibre est trop important, mais pour l’heure, seules quelques variétés sont coupables. En outre, si la coupe est mal réalisée, des pertes considérables à la levée peuvent être observées. Et un plant coupé n’est plus certifié ! Dernier conseil : avant la campagne, réalisez la prophylaxie pour limiter le risque mildiou. Bâchez les tas de déchets pour éviter que la maladie ne démarre trop tôt. Pour anticiper le retrait de certaines molécules et limiter la perte d’efficacité, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. Pour planter, privilégiez les parcelles ressuyées et réchauffées (T °C >8 °C), quitte à modifier l’ordre prévu. Observez le ressuyage du sol à l’aide d’une bêche. Lors de la préparation du terrain, ouvrez la terre au vibroculteur avant de passer avec les outils animés (herse rotative ou fraise). Ils permettent de bien affiner ; la fraise le fera de façon plus importante, mais en cas de ressuyage insuffisant, elle risque de lisser le fond de la butte. Pour rappel : le tubercule doit être planté à 15-18 cm du sommet de butte, et déposé sur de la terre veule sur au moins 3 cm d’épaisseur. Il faut donc affiner le sol sur au moins 15 cm de profondeur. N’oubliez pas d’ajuster la densité en fonction du calibre, le nombre de tiges par hectare en dépend, et c’est la base du rendement. »
5Espacer selon l’utilisation
Pour une plantation en buttes, l’espacement s’échelonne généralement de 75 à 90 cm. À 75 cm, à densité de plantation équivalente, la compétition sur le rang entre les plantes est moindre. L’écartement favorise la tubérisation, et donc un calibrage plus homogène des tubercules à la récolte. Préférer entre 75 et 80 cm d’écartement si les débouchés recherchent des pommes de terre de calibre moyen. Pour le gros à très gros calibre, mieux vaut partir sur 90 cm. Cette valeur est compatible avec la voie du tracteur et du pulvérisateur, le plus
souvent de 1,80 m de large, ainsi qu’avec la betterave, semée à 45 cm d’inter-rangs. Cela permet une hausse de 30 % du volume de butte et réduit le risque de verdissement des variétés longues, et de mildiou. Sans oublier la baisse du temps d’intervention, inférieur d’environ 15 % pour la plantation, le buttage et l’arrachage. En planche de 1,2 m de large, il faut prévoir 1,5 m à la base et 1,8 m pour la voie du tracteur. Ceci permet de planter trois rangs écartés de 45 cm, distance idéale pour obtenir le meilleur (en petits et moyens calibres). Planter quatre rangs à 30 cm est possible, mais pour du très petit calibre. ■

Les industriels du secteur des engrais modernisent leurs outils et optimisent leurs procédés, parfois au prix de lourds investissements, dans le but de réduire leur impact carbone. Toutefois, ils ne portent pas seuls la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre générées par les engrais. Une large part revient aux pratiques de fertilisation qui doivent elles aussi faire leur révolution.


Un tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur des engrais est issu de la fabrication des produits, tandis que les deux autres tiers proviennent de l’utilisation au champ.
Les gaz à effet de serre émis lors de la production et l’usage des engrais (minéraux et organiques) représentent 2,6 milliards de tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone), soit 5 % des émissions annuelles mondiales. Ce bilan a été établi par une étude de l’université de Cambridge publiée en février 2023 par la revue scientifique Nature Food Il indique que les deux tiers de ces émissions proviennent de l’épandage dans les champs (protoxyde d’azote issu de la dénitrification ou de la volatilisation), tandis que le tiers restant est émis au cours de la fabrication (CO2 lié à la consommation énergétique des usines notamment). Avec 30 % des émissions nationales de l’agriculture, le protoxyde d’azote (N2O) est le deuxième gaz à effet de serre du secteur après le méthane (CH4, 56 % des émissions agricoles) et devant le CO2 (14 %). L’agriculture est responsable de 87 % des émissions françaises de N2O, dont le pouvoir de réchauffement est très supérieur à ceux du CO2 et du CH4 D’après cette étude, améliorer l’efficacité de l’épandage des fertilisants et la gestion des effluents d’élevage se révèle donc prioritaire, afin de limiter les pertes et de réduire la consommation d’engrais. C’est là un chantier titanesque de sensibilisation, formation et équipement des agriculteurs pour faire évoluer les pratiques aux champs. En parallèle, il est indispensable que l’industrie des engrais innove dans des produits plus efficients et/ou à empreinte carbone réduite, et qu’elle décarbone ses méthodes de fabrication, très énergivores.

Le protoxyde d’azote (N2O)est un gaz à effet de serre qui réchauffe plus que le CO2 ou le CH4. 87 % des émissions françaises sont dues à l’agriculture.
En France, l’Union des industries de la fertilisation (Unifa) regroupe 35 adhérents représentant 74 sites de fabrication et de stockage d’engrais dans l’Hexagone. Plusieurs ont déjà engagé la transformation de leurs usines et procédés dans l’objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Certains annoncent même la neutralité carbone de leur production d’engrais d’ici 2035 à 2050. D’après l’Unifa, les sites de production d’ammonitrate en France et en Europe utilisent déjà une nouvelle méthode de catalyse réduisant de plus de 90 % les émissions de N2O. L’empreinte carbone globale des engrais azotés produits en Europe aurait ainsi diminué de 50 % depuis le début des années 2000.
Hydrogène et ammoniac « verts » Numéro un mondial des engrais minéraux azotés, détenant trois sites industriels en France, la société Yara vise la neutralité

L’empreinte carbone globale des engrais azotés produits en Europe aurait déjà diminué
en 2050. Dans l’usine d’Ambès, près de Bordeaux (Gironde), elle a mis en service en 2024 un nouveau réacteur pour la production d’acide nitrique permettant d’atteindre 99 % d’abattement des rejets de N2O ; une opération en partie financée par l’Ademe. Cet investissement, ajouté à ceux des années précédentes, aboutit à un site émettant aujourd’hui 10 000 t équivalent CO2 par an, contre 800 000 t dans les années 1990, soit une réduction de près de 99 %.
Les industriels ont recours à l’hydrogène « vert », obtenu en électrolysant de l’eau, dans le but de fabriquer de l’ammoniac et de produire des engrais azotés bas-carbone.
L’usine Yara d’Ambès (Gironde) émet aujourd’hui 10 000 t éq. CO2 par an, contre 800 000 t dans les années 1990, soit une réduction de près de 99 %.


Le fabricant norvégien a également inauguré en 2024, dans son pays d’origine, une usine d’hydrogène renouvelable. L’hydrogène (H2) est produit par électrolyse de l’eau (H2O) à partir d’énergies renouvelables, ce qui permet de remplacer le gaz naturel et de réduire les émissions du site de 40 000 t de CO2 par an. Cet hydrogène est utilisé pour produire de l’ammoniac, employé à son tour dans la fabrication d’engrais. Il peut également servir de carburant pour le transport maritime. Ainsi, les premières tonnes d’engrais bas-carbone ont été produites à partir de cet ammoniac renouvelable (dit « vert »), issu d’hydrogène et d’énergies renouvelables. La source d’énergie utilisée en Norvège est l’hydroélectricité, mais Yara a également des projets en cours à base d’énergie éolienne aux Pays-Bas et d’énergie photovoltaïque en Australie. La commercialisation d’engrais bas-carbone aurait également démarré depuis 2022 chez Fertiberia et représenterait 10 % de la production de l’usine de Puertollano, en Espagne. Celle-ci utilise de l’ammoniac « vert » produit à partir d’hydrogène issu d’électricité solaire. L’entreprise
prévoit la conversion de toutes ses usines à l’ammoniac vert d’ici 2035.
En France, le fournisseur d’engrais LAT Nitrogen mène lui aussi un projet de ce type sur son site d’Ottmarsheim, en Alsace. Avec Hynamics, une filiale d’EDF spécialisée dans l’hydrogène bas-carbone, il développe une unité de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau dans le but de fabriquer de l’ammoniac et de produire des engrais azotés décarbonés à l’horizon 2025-2026. L’objectif est de mettre fin à la dépendance du site au gaz naturel fossile en remplaçant ce dernier par « le mix électrique bascarbone français » (constitué en majorité d’électricité nucléaire), afin d’éviter l’émission de 48 000 t de CO2 par an.
Stockage à 2 600 m sous la mer
LAT Nitrogen est par ailleurs engagé, aux côtés de Yara entre autres, dans le consortium ECO2-Normandy qui mise sur un autre procédé : la production d’hydrogène et d’ammoniac dits « bleus ». Il s’agit là de décarboner la production en capturant
de 50 % depuis le début des années 2000 à
En 2025, 800 000 t de CO2 devraient être captées, compressées et liquéfiées pour être transportées puis stockées à 2 600 m sous la mer, dans des infrastructures en cours d’installation en Norvège.

L’AVIS DE L’EXPERT

Éric Giovale, PDG d’OvinAlp, président de la section Fertilisants organo-minéraux et organiques de l’Unifa
« Améliorer l’efficience de la production agricole par l’apport d’engrais organiques »
« Nous produisons 55 000 t d’engrais organiques et organominéraux par an à partir de fumier de mouton collecté localement dans la zone de production de l’agneau IGP de Sisteron. Pour réduire leur empreinte carbone, nous produisons 60 % de notre électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Nous avons en outre développé l’approvisionnement local de nos ressources végétales : il s’agit de marcs humides issus du pressage des olives et des raisins que nous associons à nos composts de fumier pour fabriquer des fertilisants en bouchons. Cela contribue aussi à la réduction de l’impact carbone. Nous avons également modifié la formulation de notre gamme de biostimulants : autrefois vendus sous forme liquide en bidons plastique, ils sont maintenant sous forme de poudre hydrosoluble et conditionnés en sacs papier. Leur empreinte carbone est donc plus favorable. Enfin, sur notre flotte de trente camions, nous en comptons six roulant au biodiesel à ce jour. Au-delà des aspects de fabrication, conditionnement et transport, nous pensons que l’apport de fertilisants organiques est crucial pour des sols en bonne santé, fonctionnant bien et permettant de stocker davantage de carbone. On ne peut pas remplacer tous les engrais minéraux par des engrais organiques, mais en améliorant les fonctions du sol par des apports organiques, on obtient une meilleure efficience de la production agricole, ce qui permet d’être moins interventionniste, d’utiliser moins de produits de synthèse et ainsi de réduire l’impact carbone global de la production agricole. »



* étude réalisée en ligne par l’institut d’études indépendant Statista entre le 22 avril et le 7 juin 2024.














Votre confiance, notre engagement.
Continuer à avancer à vos côtés, avec la même passion.
Production grandes



et en stockant le CO2 issu de l’activité industrielle. Les partenaires projettent le développement d’une infrastructure de captage et de transport de CO2 depuis le bassin industriel normand en vue de le stocker en mer du Nord (jusqu’à trois millions de tonnes par an). Yara a d’autres projets de ce type, dont celui concernant son usine de production d’ammoniac de Sluiskil, aux Pays-Bas : 800 000 t de CO2 devraient être captées, compressées et liquéfiées en 2025, pour être transportées puis stockées à 2 600 m sous la mer dans des infrastructures en cours d’installation en Norvège. Mais avant de se lancer dans de tels investissements, à la fois innovants et coûteux, la plupart des fabricants travaillent déjà sur l’efficacité énergétique de leurs outils. C’est ce que met en avant notamment l’entreprise K+S. Pour ses sites en Allemagne
Les premières tonnes d’engrais bas-carbone ont été produites à partir d’ammoniac
renouvelable, dit « vert », issu d’hydrogène et d’énergies renouvelables

Pour améliorer leur bilan carbone, certains acteurs du marché des biostimulants ont supprimé les bidons en plastique grâce à leur formulation en poudre hydrosoluble, conditionnée en emballage papier.

Pierre-Yves Tourlière, responsable développement productions végétales, Timac Agro « Il est possible de réduire les émissions en équivalent CO2 de 8 à 16 % »
« La décarbonation du secteur des engrais va au-delà du processus de fabrication en usine, sachant que les émissions de gaz à effet de serre au champ représentent jusqu’à 70 % des émissions totales dans le cas de la fertilisation azotée. C’est pourquoi notre stratégie se focalise sur l’amélioration de la nutrition des plantes : l’objectif est que la plante absorbe et transforme au maximum l’azote apporté. Car un gain de rendement sans intrant supplémentaire n’est pas l’ennemi des émissions de gaz à effet de serre, au contraire ! Nous travaillons sur trois axes d’efficience : le développement de la rhizosphère, qui constitue “la bouche” de la plante et permet le stockage de carbone dans les sols, la disponibilité en phosphore, et l’apport en soufre et magnésie en complément de l’azote pour optimiser la production de chlorophylle et la photosynthèse. Nous avons développé plusieurs produits en ce sens : Top-Phos, solution de stimulation de la croissance racinaire avec un phosphore 100 % biodisponible, Apex N-Process, association d’un engrais et d’un biostimulant optimisant l’absorption et la transformation de l’azote en réduisant les pertes, et la solution biostimulante Genaktis pour optimiser la photosynthèse. Nous travaillons également sur le levier du pH du sol en proposant l’amendement Calcimer à base de carbonate de calcium marin. Si tous les sols acides passaient au-delà d’un pH de 6,8, on réduirait de 10 % les émissions de N2O par la transformation de ce gaz en diazote inoffensif grâce aux bactéries du sol. En fonction de l’usage de l’un ou l’autre de ces produits, nous estimons qu’il est possible de réduire les émissions en équivalent CO2 de 8 à 16 %. »
et dans le reste du monde, elle s’appuie sur la démarche ISO 50001 afin d’optimiser sa performance énergétique, et elle a recours par exemple à des technologies de production combinée d’électricité et de chaleur. Dans ses trois usines de la Werra, en Allemagne, K+S cherche à sécuriser l’extraction de potasse et de magnésie à l’aide de procédés de séparation dits « secs » (électrostatiques). En plus de consommer moins d’énergie et de rejeter moins de CO2 (-50 %), ils utilisent aussi moins d’eau (-50 %).
Certifiée ISO 50001 pour ses huit sites industriels et son siège à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la société française Timac Agro œuvre elle aussi depuis des années à l’optimisation énergétique de ses usines : moteurs à haut rendement, chaudières vapeur performantes, etc. Elle a investi dès 2005 dans une première chaudière à biomasse, et vient d’inaugurer en décembre 2024 le troisième équipement de ce genre (en partie subventionné par l’Ademe) pour couvrir 80 % des besoins thermiques du site de Saint-Malo en remplacement du gaz. L’approvisionnement en biomasse est assuré dans un rayon de 150 km et permet de réduire les émissions de 2 000 t de CO2 par an. « Nous ne






Timac Agro a mis en service en décembre 2024 sa troisième chaudière biomasse afin de couvrir 80 % des besoins thermiques de son site de Saint-Malo.

sommes pas producteurs d’ammoniac, nous sommes assembleurs de matières, précise Pierre-Yves Tourlière, responsable développement productions végétales chez Timac Agro. Pour nos fabrications, nous achetons du sulfate d’ammoniac, qui est un coproduit de la filière nylon, ainsi que de l’urée. Côté énergies, nous avons à la fois besoin de chaleur et d’électricité. Pour la chaleur, nous misons sur la biomasse : actuellement 50 % de l’énergie thermique consommée par nos sites industriels provient de la biomasse, permettant une réduction de plus de 60 % des émissions de CO2 par rapport aux chaudières gaz. Pour l’électricité, nous atteindrons 15 % de production photovoltaïque en 2030. » Timac Agro s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions globales de 30 % d’ici à 2040.
Si l’étude de l’université de Cambridge évoquée en introduction établit une lourde contribution pour l’industrie des engrais dans les émissions de gaz à effet de serre, elle évoque aussi la possibilité de réduire ceux-ci de 80 % d’ici à 2050. La première piste, selon les auteurs, est d’augmenter l’efficacité des épandages, aussi bien organiques que minéraux, car « nous mettons beaucoup plus d’engrais dans les terres cultivées que la quantité vraiment nécessaire aux plantes pour se développer », expliquent-ils. La seconde piste est d’éviter, lors de l’épandage, la dégradation des engrais en N2O par les bactéries du sol, via l’usage d’inhibiteurs de nitrification ; et d’éviter aussi, via l’enfouissement rapide, la volatilisation de l’ammoniac, synonyme de pertes d’éléments fertilisants. Enfin, l’industrie doit poursuivre la modernisation de ses équipements, déjà largement engagée, comme nous l’avons vu ici.
Par ailleurs, dans leur synthèse collective réalisée en 2024, The Shift Project, l’Ademe et l’association négaWatt évoquent plusieurs scénarios d’avenir : tous anticipent une augmentation de la part d’azote d’origine organique, issu de la fixation symbiotique par des plantes légumineuses ou du recyclage des nutriments (compostage, digestats de méthanisation). La baisse de la consommation d’azote de synthèse s’échelonne de 10 %, pour le scénario où l’agriculture conventionnelle domine, à 85 %, pour le scénario le plus ambitieux, conjuguant pratiques agroécologiques et recyclage de l’azote.
Fertilisation associée, de quoi s’agit-il ?
La fertilisation associée représente une piste sérieuse pour les productions agricoles et la préservation de la santé des sols. Elle repose sur un principe simple : combiner différentes matières et technologies fertilisantes – qu’elles soient minérales, organiques ou biostimulantes – dans le but de créer des synergies et d’améliorer ainsi leur performance agronomique. Mais la démarche ne s’arrête pas là. Les membres de l’Unifa intègrent la fertilisation associée dans une vision plus large, répondant à différents grands enjeux. La mise en commun des savoir-faire des producteurs de matières fertilisantes sur laquelle elle repose doit permettre de développer des solutions adaptées aux défis environnementaux (changement climatique), sociétaux et économiques. L’ambition de l’Unifa est de proposer une expertise pointue sur la fertilisation associée, qu’elle considère comme un levier stratégique pour construire une souveraineté alimentaire française décarbonée, tout en garantissant la santé des sols.

La baisse de la consommation d’azote de synthèse s’échelonne de 10 %, pour le scénario où l’agriculture conventionnelle
domine,
à 85 %, pour le scénario le plus ambitieux, conjuguant pratiques agroécologiques et recyclage de l’azote
Les industriels de la fertilisation déploient de multiples initiatives pour jouer un rôle clef dans la transition écologique. Ils agissent tant sur la réduction de leur propre empreinte environnementale que sur l’élaboration de solutions de fertilisation innovantes. Ces actions contribuent directement à diminuer l’impact carbone de l’agriculture et, par conséquent, de notre alimentation. Par ailleurs, l’implantation stratégique de leurs sites de production et de stockage d’engrais sur le territoire français, à proximité des besoins agricoles, permet de réduire l’empreinte


carbone des productions nationales par rapport à celles d’autres régions du globe.
Les engrais bas-carbone, une réalité en marche
La majorité des sites de production en France et en Europe affiche déjà une empreinte carbone réduite. Cette performance repose sur des procédés peu énergivores et faiblement émetteurs de CO2, notamment pour les amendements minéraux basiques « crus », qui représentent 80 % de la production nationale. Les industriels multiplient les innovations. Par exemple, les chaudières utilisées pour sécher les matières premières adoptent de plus en plus des énergies renouvelables ou bascarbone comme la biomasse. Des avancées significatives sont aussi réalisées dans la production d’ammonitrates grâce à l’intégration de technologies catalytiques. Celles-ci permettent de réduire les émissions de N2O de plus de 99 %. Ce type de procédé représente actuellement la « meilleure technique disponible » à l’échelle européenne.
Autre exemple prometteur : un projet pilote dans les Hauts-deFrance, où un site de production de chaux vive expérimente la captation et la liquéfaction du CO2 émis. Ce système ambitionne de capter 600 000 t de CO2 par an d’ici 2030, offrant ainsi une perspective concrète de plus pour réduire l’impact environnemental des fertilisants. ■







Les estimations de Terre-net, issues du Système d’immatriculation des véhicules (SIV) du ministère de l’Intérieur, après enquête auprès des principaux constructeurs, confirment la baisse du marché pressentie par les constructeurs eux-mêmes au fil des derniers mois. Une baisse de 10,4 % du marché global (standards et spécialisés).
Pour les tractoristes, 2024 restera parmi les années compliquées… et 2025 s’annonce déjà incertaine. Tous semblent être dans le même bateau. Le total des immatriculations de tracteurs standards et spécialisés de plus de 50 ch, pris en compte dans nos estimations, dévisse de 10,4 %. La prise de commandes est en berne, elle ne présage pas de retour à la croissance avant, au mieux, le second semestre 2025. C’est ce qu’ont montré les dernières enquêtes et analyses diffusées par Axema et le Sedima. L’année a aussi été marquée par de la sur-immatriculation en décembre, une tradition pour certains constructeurs, renforcée cette fois-ci par l’arrêt du freinage simple ligne au 31 du mois. L’objectif était donc d’immatriculer le maximum de tracteurs en stock avant la date limite, pour éviter qu’ils se retrouvent invendables sur le marché français.
L’infographie ci-contre reprend, selon nos estimations, le classement des marques de tracteurs sur le podium des parts de marché 2024. Pour gagner en lisibilité, seules les marques dont le score est égal ou supérieur à 1 % ont été conservées. ■
Les données présentées ici sont issues des immatriculations brutes officielles du Système d’immatriculation des véhicules (SIV) fournies par le ministère de l’Intérieur. Elles sont filtrées pour ne conserver que les tracteurs agricoles neufs standards et spécialisés de plus de 50 ch de puissance. Chenillards, quads, modèles espaces verts et télescopiques sont exclus des résultats de manière à obtenir l’estimation la plus fine possible du marché du tracteur agricole. Ces chiffres sont ensuite affinés après enquête auprès de tous les constructeurs cités.


« Ce résultat reflète notre stratégie : bonne gestion post-pandémie grâce à notre outil industriel, anticipation des normes de freinage pour limiter les stocks, et qualité de notre réseau. La légère baisse s’explique par un marché tendu et des retards limités. »


« Nous sommes fiers de cette 2e place ! Malgré un marché complexe, nos volumes et parts de marché ont progressé, grâce à la performance du réseau. Retards résolus, lancement réussi du 600 Vario, image solide et stock écoulé sans avoir à baisser les prix. »

« La sur-immatriculation liée à l’arrêt du freinage simple ligne impacte les parts de marché et la valeur des tracteurs concernés est moindre. Nous progressons grâce au Claas Arion 660, notre 200-ch, désormais devant l’Arion 450. Les modèles les plus puissants, comme les 430 et 450, dominent aussi la série 400. » Massey Ferguson n’a pas souhaité commenter les chiffres publiés par Terre-net. La marque a préféré attendre la publication d’Axema.

« Une légère baisse dans un marché agricole tendu. Le T7 reste leader. Pour 2025, nous visons des équipements et financements adaptés. Après le succès de la CR11, notre plan de lancement est prêt pour renouveler les gammes de tracteurs. »

La rédaction a contacté la marque, mais n’a pas obtenu de commentaire avant la publication initiale de cet article.
L’année 2024 a été marquée par de la sur-immatriculation en décembre, une tradition renforcée par l’arrêt du freinage simple ligne au 31 du mois

« Pas de sur-immatriculation, avec moins de 50 tracteurs concernés par l’arrêt du freinage simple ligne. Malgré le début d’année calme et la perte d’un concessionnaire en Bretagne (600 tracteurs), les séries N et T dominent. La série Q monte en puissance et la S démarre fort. »

« Malgré un marché agricole difficile, nous avons résisté sans recourir à la sur-immatriculation liée à l’arrêt du freinage simple ligne. En anticipant la nouvelle norme, ni nous ni nos concessionnaires n’avons subi de pression sur les stocks. »

La rédaction a contacté la marque, mais n’a pas obtenu de commentaire avant la publication de cet article.

« Année difficile sur le plan concurrentiel, économique, et au niveau des besoins du marché, avec des tensions tant chez les concessionnaires et que chez les clients. Pour 2025, l’objectif est de stabiliser, voire augmenter, notre part de marché, si celui-ci repart. »

Voir le commentaire pour Deutz-Fahr, appartenant au même groupe. Same a suivi une stratégie identique.


La location avec option d’achat (LOA) permet d’accéder à un tracteur moderne en préservant sa trésorerie, avec des mensualités adaptées. Toutefois, son coût total dépasse souvent celui d’un achat direct, ce qui reste avantageux pour une utilisation durable et personnalisée. LOA, LDD, achat à crédit… chaque option exige une analyse minutieuse des besoins.

Par SÉBASTIEN DUQUEF sduquef@terre-net-media.fr
Acquérir un tracteur représente le plus souvent un investissement majeur pour une exploitation agricole. D’autant plus à l’heure actuelle, période économique difficile durant laquelle bien gérer sa trésorerie et optimiser les coûts semble une priorité absolue pour survivre. C’est sans doute la raison pour laquelle de plus en plus d’exploitants se tournent vers des solutions alternatives à l’achat direct, telles que la location avec option d’achat (LOA). La formule permet de bénéficier d’un matériel de qualité tout en préservant ses finances. Toutefois, certains aspects nécessitent d’être bien compris avant de s’engager dans cette voie. La LOA, ou le crédit-bail ou leasing, est un contrat de location à long terme – généralement compris entre trois et sept ans – qui permet à l’agriculteur de louer son tracteur en payant des loyers. À la fin du contrat, il a la possibilité de lever l’option d’achat pour acquérir la machine pour un montant résiduel (souvent appelé « valeur résiduelle »), ou

En pleine période économique difficile, acquérir un tracteur représente un investissement majeur auquel il convient de réfléchir attentivement pour optimiser les coûts.
de la rendre à la société de location. La formule est donc particulièrement adaptée pour ceux qui souhaitent bénéficier de matériel performant sans en supporter immédiatement le coût total d’achat. Sans oublier ceux qui renouvellent régulièrement leur matériel.
La location avec option d’achat (LOA) permet de louer un tracteur sans débourser une somme faramineuse en une seule fois
Parmi les avantages qu’il est possible de lister, celui de préserver la trésorerie constitue sans doute le principal. En effet, la LOA permet de louer un tracteur sans débourser une somme faramineuse en une seule fois. Les finances des exploitants étant suffisamment sollicitées par ailleurs, entre les autres investissements et les dépenses liées au fonctionnement de la ferme. Le paiement de la machine se fait en versant des loyers dont le montant est connu à l’avance. Et surtout, celui-ci est adapté à la capacité de financement de l’agriculteur. En outre, les loyers peuvent être ajustés en fonction de la durée du contrat, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des finances. Notons également que la LOA rend les tracteurs neufs et de dernière génération accessibles au plus grand nombre. Des engins équipés des technologies les plus récentes dont le rôle est d’améliorer l’efficacité et la productivité de la ferme. Des engins qui riment aussi avec meilleures performances énergétiques et environnementales.
Dans de nombreux contrats LOA, les coûts de maintenance et d’entretien du tracteur sont inclus

dans le loyer. Un gain de temps et d’argent pour l’agriculteur, qui n’a pas à se soucier des réparations imprévues ou des coûts liés à l’entretien régulier. En fin de contrat, s’il choisit de ne pas acheter la machine, il peut en choisir une nouvelle en gardant le système de contrat de LOA. Cela lui permet de renouveler régulièrement son matériel et ainsi de rester à la pointe de la technologie sans avoir à débourser de grosses sommes.
Des inconvénients à ne plus être propriétaire
Difficile de trouver des chiffres précis, mais les tendances récentes indiquent une adoption croissante du leasing dans le secteur agricole. En 2024, le Crédit Mutuel a observé qu’il représentait 20 % des financements de matériels, une proportion ayant doublé en un an. En 2020, le crédit-bail concernait au moins 17 % des acquisitions. Selon les évaluations, le marché mondial du financement des équipements agricoles est en croissance : 228,27 milliards de dollars américains (Md$ US) en 2023, 240,17 attendus en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,23 % jusqu’en 2029.
Ne plus acheter son tracteur permet une gymnastique plus facile avec sa trésorerie mais au final, bien que les loyers soient plus faibles que le remboursement d’un crédit classique, le coût total de la LOA (y compris les loyers et la valeur résiduelle en fin de contrat) peut s’avérer supérieur à celui de l’acquisition directe. Surtout si on choisit de lever l’option d’achat. Le paysan se retrouve en outre face à un engagement contractuel de plusieurs années. Un inconvénient potentiel pour ceux qui envisagent de renouveler rapidement leur matériel ou dont les besoins peuvent évoluer à court terme. à



Autre difficulté : le contrat prévoit un nombre d’heures d’utilisation. Une certaine restriction est donc de mise pour ne pas dépasser la limite contractuelle. Faute de quoi, des frais supplémentaires s’ajoutent à la facture. Cela peut constituer un problème dès lors que les pics d’activité saisonniers ou les besoins d’utilisation intensifs s’avèrent difficiles voire impossibles à prévoir. De plus, même si l’entretien est souvent inclus, le tracteur peut devoir être entretenu et employé dans des conditions spécifiques aux termes du contrat.



En cas de non-respect, là aussi, des pénalités ou des frais s’appliquent, qui constituent un risque supplémentaire pour l’exploitant. Tant que l’option d’achat n’est pas levée, le tracteur ne vous appartient pas, ce qui peut représenter un blocage psychologique, tant le consommateur français à la culture de la carte grise ! N’étant pas propriétaire, impossible de personnaliser son équipement et surtout, oubliée, la revente du matériel en fin de vie. Si, à la fin du contrat, l’agriculteur décide de ne pas acheter, il n’aura pas d’actif à revendre. Il aura payé tous les loyers sans en récupérer une quelconque valeur résiduelle ; une perte potentielle par rapport à un achat direct.
Le crédit classique pour une accessibilité immédiate
La LOA incarne certes une solution financière pouvant se montrer avantageuse, mais mieux vaut bien analyser ses besoins, sa capacité à utiliser le tracteur de manière optimale et les conditions du contrat avant de se lancer. Autre possibilité : le crédit classique, qui reste une solution parmi les plus répandues. Il permet d’acquérir rapidement le tracteur, sans attendre de disposer des fonds nécessaires. Cette accessibilité est essentielle pour maintenir ou améliorer la productivité, surtout si le modèle actuel est obsolète ou hors d’usage. Posséder un matériel performant aide à réduire les coûts de production et optimiser les rendements. Ce mode de financement offre la possibilité de répartir le coût de l’investissement sur plusieurs années. Les mensualités, souvent fixées en fonction des capacités financières de l’agriculteur, permettent de limiter l’impact sur la trésorerie de l’entreprise. La flexibilité financière est utile dans un secteur où les revenus sont irréguliers et soumis aux aléas climatiques ou aux fluctuations des

Thibault Vandenberghe, responsable marketing et développement chez John Deere Financial
« Le crédit-bail et la location financière sont en hausse »
« Bien que la majorité des agriculteurs finance toujours l’achat de son matériel grâce au crédit classique, les solutions de crédit-bail et de location financière sont en expansion depuis plusieurs années. Ces deux produits permettent de bénéficier d’engins neufs et équipés des dernières technologies que John Deere propose, le tout avec un coût horaire, ou à l’hectare, le plus faible possible. Le crédit-bail est également une solution pour optimiser sa fiscalité si besoin, grâce au système de loyer majoré et à la flexibilité des paiements. La location financière offre quant à elle davantage de liberté aux exploitants coutumiers du renouvellement régulier de leurs matériels. Sans oublier qu’avec cette option, l’extension de garantie et la maintenance connectée peuvent être ajoutées, sans franchise, avec une expertise annuelle pour une plus grande sérénité. C’est ce que propose l’offre John Deere Protect. Enfin, les clients peuvent opter pour le parcours entièrement digitalisé, avec une décision en ligne instantanée, la signature électronique des contrats et l’espace client regroupant tous les documents contractuels. »
Acheter ou louer ? Chaque solution peut être intéressante, selon le besoin et la situation financière de l’exploitation.

marchés. En optant pour le crédit, acheter le tracteur devient envisageable tout en visant un modèle récent, bien équipé ou plus puissant. Et un engin moderne, adapté aux besoins spécifiques de l’exploitation, représente non seulement une source d’économie en matière de carburant, mais aussi une diminution de l’impact environnemental puisque le matériel émet moins de CO2 Dans certains cas, les intérêts du crédit sont déductibles fiscalement. Cela peut représenter une opportunité intéressante pour réduire la base imposable, même si ce levier dépend des régimes fiscaux appliqués à chaque exploitation. Soulignons également que le recours au crédit classique contribue à nouer une relation solide avec sa banque… à condition de gérer rigoureusement les remboursements ! C’est ce qui améliorera votre dossier bancaire et permettra d’obtenir plus facilement d’autres financements.
Bien connaître le coût de l’opération
Côté inconvénients, le principal réside dans le coût global de l’opération. Les intérêts ainsi que les éventuels frais annexes (frais de dossier, assurances) augmentent le prix final du tracteur. Selon les taux pratiqués, ce surcoût peut représenter une part importante de l’investissement initial. Vous connaissez tous le message contenu dans
à






HORSCH Finer SL : un travail du sol précis et e cace. Configuration libre jusque dans les moindres détails. HORSCH.COM
Nombreuses possibilités de configuration parfaitement adaptées à vos besoins
Adaptation précise au sol pour un travail très superficiel sur toute la surface
Conception compacte du châssis
Semis de couverts végétaux avec le HORSCH MiniDrill
Kit dents semeuses pour semer en conditions très humides


POUR


la publicité « Un crédit vous engage et doit être remboursé ». Le fermier qui contracte un crédit s’engage sur plusieurs années, souvent entre cinq et sept. Durant cette période, il doit s’assurer de disposer des revenus nécessaires pour honorer ses mensualités. En cas de mauvaise récolte ou de baisse des prix agricoles, l’engagement peut vite devenir un poids difficile à porter. Contrairement aux solutions comme le crédit-bail ou la LOA, le crédit classique impose généralement des échéances fixes, non ajustables en cas de difficultés. Bien calibrer l’emprunt, ou le combiner à d’autres dettes existantes, demeure primordial. Sous peine d’exposer son exploitation au surendettement. Un risque particulièrement élevé pour ceux dont les charges sont déjà importantes ou, a contrario, dont les marges sont faibles. Par ailleurs, en cas de revente du tracteur avant la fin du crédit, il faut veiller à ce que le prix de revente couvre le capital restant dû à la banque, afin d’éviter de se retrouver avec une dette résiduelle à rembourser même si le matériel n’est plus dans le parc.
En fin de contrat de location, si l’agriculteur opte pour le non-rachat de sa machine, il en choisit une nouvelle et garde son contrat de LOA.
Les tracteurs représentant des investissements majeurs, leur mode d’acquisition, à savoir l’achat ou la location, ne doit pas être pris à la légère
Les agriculteurs perçoivent le recours fréquent au crédit comme une dépendance accrue envers les banques, ce qui limite évidemment leur marge de manœuvre financière au long terme. Quoi qu’il en soit, avant de signer tout contrat, étudier différentes propositions bancaires s’avère crucial. Au niveau du taux, notamment, même si l’écart peut paraître minime, sur la durée du prêt, l’économie peut se montrer importante. Les capacités de remboursement doivent être évaluées. Calculer les mensualités en fonction des revenus moyens de l’exploitation, en tenant compte des éventuelles périodes creuses, est essentiel.
Certains organismes acceptent de réduire les frais de dossier ou de moduler les échéances. L’assurance emprunteur protège contre les imprévus, cependant, son coût doit être évalué attentivement. Avant de se décider, examiner d’autres options, comme le crédit-bail, qui donne parfois davantage de flexibilité, peut être utile. En résumé, l’analyse minutieuse de vos besoins, de vos capacités de remboursement et des conditions du crédit est incontournable !
Les matériels et équipements représentant des investissements majeurs, leur mode d’acquisition, à savoir l’achat ou la location, ne doit pas être pris à la légère. Acheter peut devenir avantageux dès lors que la réflexion est menée jusqu’au bout. Cela permet non seulement de devenir propriétaire,
à

Les adventices représentent une menace pour les grandes cultures, avec environ 1200 espèces en


Ce guide propose une méthode simple et pratique pour les identifier rapidement dès leur stade plantule, grâce à plus de 600 photos et dessins techniques.











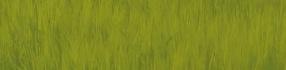






Il couvre une centaine d’espèces courantes, avec des informations sur leur biologie, leur nuisance et les méthodes de gestion adaptées, qu’elles soient mécaniques, chimiques ou culturales, afin de maîtriser efficacement ces plantes nuisibles.





Groupe France Agricole 60643 Chantilly Cedex 01 40 22 79 85 (lundi au vendredi : 9h à 17h)
(paiement 100% sécurisé)
Je vous règle un montant total de € TTC par : Chèque à l’ordre des éditions France Agricole
et couleurs non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Les renseignements demandés ici sont nécessaires au traitement de votre commande, et réservés aux services concernés du Groupe France Agricole. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer, en nous contactant par mail : abos@gfa.fr Notre politique de confidentialité des données est accessible sur notre site. Pour toute question concernant votre commande, nos conseillères sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 17h au 01 40 22 79 85. Les délais de livraison sont compris entre 3 à 7 jours ouvrés à compter de la date d’enregistrement de la commande, sous réserve de disponibilité des produits. En cas de rupture de stock, nous pourrons être amenés à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde, dès disponibilité du reste de la commande. Avec votre commande, vous recevrez une facture acquittée. Les
et commandez
mais en plus de choisir un modèle parfaitement adapté à ses besoins et à sa capacité financière, en termes de puissance, de fonctionnalités et de technologies. Contrairement à la location, où l’offre est souvent restreinte à des modèles standardisés. Acheter permet de garder toute liberté quant au choix du modèle, voire de le personnaliser si nécessaire. En outre, un tracteur acheté reste dans l’exploitation pour une durée illimitée, sans risquer de perdre l’accès au matériel en fin de contrat. Il s’agit d’un investissement au long terme. Certes, la somme à débourser est parfois colossale, mais l’amortissement se fait sur plusieurs années. Une fois le financement soldé, l’équipement n’entraîne plus de coûts significatifs, hormis ceux liés à son entretien. Et un tracteur bien entretenu conserve une valeur résiduelle certaine qui, en cas de revente, constitue un apport pour financer son remplaçant. Autre aspect non négligeable : le tracteur en propriété permet à l’agriculteur de jouir librement de son utilisation, sans contrainte de calendrier. Dans le cadre d’un contrat de LOA, les restrictions sur l’utilisation ou les pénalités liées à une usure excessive pouvant s’appliquer limitent une flexibilité de plus en plus indispensable. Si la location peut sembler avantageuse à court terme, il ne faut pas négliger les coûts récurrents qui s’accumulent rapidement. Certains trouvent que les mensualités d’un achat financé à crédit
L’analyse minutieuse de vos besoins, de vos capacités de remboursement et des conditions du crédit est incontournable !
Acquérir son tracteur permet non seulement d’être propriétaire, mais aussi de choisir un modèle adapté à ses besoins et à sa capacité financière, en termes de puissance, de fonctionnalités et de technologies.
sont comparables à celles d’un contrat de leasing Sauf qu’au terme du remboursement, le tracteur devient un actif durable de la société. En France, de nombreuses aides sont disponibles pour les exploitants qui souhaitent investir dans du matériel agricole – neuf ou d’occasion –, comme les subventions Pac ou les aides régionales. De quoi rendre l’achat plus accessible et plus intéressant du point de vue économique. Autre avantage : posséder son tracteur rime avec fin de la gestion administrative liée à la LOA. Pas de renouvellement de contrat à prévoir, ni de formalités en cas de fin de bail. Ce qui simplifie énormément le quotidien des agriculteurs, dont les charges administratives sont suffisamment importantes. Le tracteur acheté donne de la valeur à la ferme et à son patrimoine. En cas de transmission ou de revente de l’exploitation, les matériels en propriété constituent des actifs qui augmentent la valeur globale.
Avant d’acheter, cependant, prendre quelques précautions reste important, car le risque zéro


Lionel Gelay-Turtaut, directeur commercial chez Agco Finance
« Plus de 60 % des clients optent pour le crédit-bail »
« Partenaire financier du groupe Agco, la filiale Agco Finance offre aux agriculteurs clients des marques Fendt, Massey Ferguson et Valtra des solutions personnalisées pour acheter leur matériel. Agco Finance est un acteur majeur du financement, notamment en crédit-bail, plus de 60 % des clients optent pour cette formule. En effet, elle apporte une grande flexibilité sur le contrat, que ce soit en termes d’apport initial, de plan de remboursement, du nombre d’heures d’utilisation, de durée mais aussi question valeur résiduelle en fin de contrat (option d’achat). En agissant sur tous ces critères, le crédit-bail s’adapte au cycle de l’exploitation et à la capacité de remboursement des clients. Même une fois le contrat signé, via la formule Agriceo, nous offrons la possibilité de moduler les loyers en fonction des flux de trésorerie. Le créditbail est d’ailleurs un bon outil de capitalisation puisqu’il est possible d’acquérir le matériel en réglant l’option d’achat. En cas de transmission de l’exploitation, le contrat est transférable facilement. »
n’existe pas ! Le paysan doit bien analyser ses besoins pour éviter d’acquérir un appareil suréquipé ou sous-dimensionné. Un entretien préventif de la machine est conseillé pour lisser les besoins de trésorerie. Prévoir un budget et un planning d’entretien permettra en outre de préserver sa durée de vie. Le volet économique ne doit surtout pas être négligé pour s’assurer que l’achat n’entraînera pas de surcharge financière. Faire des simulations s’avère donc utile, cela permet parfois de demander une aide pour acheter son engin. Une des clefs : prendre son temps pour évaluer ses besoins et bien préparer son projet. Attention de ne pas tomber dans le « piège » du commercial qui risque de vous pousser pour que vous vous engagiez le plus vite possible, en prétextant par exemple une fin d’opération ou le faible nombre de machines concernées.
Pour déjouer les techniques commerciales, mieux vaut être vigilant et préparé. Voici donc quelques conseils pratiques. Premièrement, se renseigner en amont. Analyser ses besoins réels avant d’entamer toute discussion commerciale permettra d’éviter de se laisser séduire par des fonctionnalités inutiles. Il ne faut pas hésiter à consulter les avis à


RÉPONDANTS
















Bonnes pratiques RH, QVT, idées reçues : retrouvez des conseils précieux pour vous di érencier !

FLASHEZ-MOI pour télécharger GRATUITEMENT le Livre blanc
Sponsorisé par


d’autres agriculteurs, à comparer les marques et les modèles. Éviter aussi les décisions précipitées. Il ne faut jamais céder à l’urgence créée artificiellement par le commercial (par exemple, une promotion limitée dans le temps), et prendre toujours le temps de réfléchir et de consulter d’autres options. Étudier plusieurs offres, demander des devis à différents fournisseurs, est important. Les prix, certes, doivent être comparés, mais pas seulement.
Le crédit classique permet d’acquérir rapidement son tracteur, sans attendre de disposer des fonds nécessaires.
Le montant de l’apport personnel peut faire varier celui des remboursements échelonnés.

➜ Avant d’acheter son tracteur, il faut connaître le budget global. En incluant le prix d’achat, les frais annexes et les éventuelles options, vous connaîtrez le coût global de l’opération. Reste à calculer le revenu disponible pour financer l’achat afin de vérifier s’il est réalisable ou non.
➜ La durée du remboursement s’adapte à la durée de vie du tracteur.
Il faut adapter la durée du remboursement pour rester cohérent avec la durée de vie du matériel acheté.
Les conditions de garantie, de maintenance et du financement doivent aussi attirer l’attention du futur acheteur. Et méfiance avec les discours trop optimistes : les commerciaux peuvent exagérer les économies ou les performances du produit. À vous de demander des données chiffrées, vérifiables, et des retours d’expérience.
Les contrats sont bien sûr à lire attentivement. Leurs clauses doivent être analysées en détail, surtout en matière de location ou de leasing. Gare aux pénalités cachées et aux frais supplémentaires. Mieux vaut se fixer un budget strict, définir sa capacité financière maximale, l’objectif étant de refuser toutes les offres allant au-delà, même si elles paraissent alléchantes. Pendant la négociation, garder par moments le silence constitue une technique comme une autre. Le silence peut mettre mal à l’aise le vendeur, qui pourrait alors proposer de meilleures conditions ou réductions. Les questions posées doivent quant à elles être précises, l’idée étant d’obtenir des explications claires sur les frais, les garanties et les engagements à long terme.
Enfin, ne pas oublier de vérifier les aides disponibles, de s’informer sur les subventions ou programmes de soutien financier applicables afin
En général, il s’agit de dix à quinze ans pour un usage modéré. N’hésitez pas à utiliser les guides techniques proposés par les constructeurs.
➜ Acheter un tracteur d’occasion coûte moins cher. Le choix entre un tracteur neuf et un d’occasion dépend de nombreux facteurs, comme le budget, les besoins spécifiques de l’exploitation et la stratégie à long terme. Chaque situation est unique, le neuf convient à ceux ayant besoin d’un engin fiable et moderne sur le long terme. L’occasion est parfaite pour les fermes aux besoins plus limités ou avec
un budget ne permettant pas d’investir dans le neuf.
➜ Je peux acheter mon tracteur en leasing les yeux fermés. Ce n’est pas conseillé. Bien que le leasing présente de nombreux avantages, il implique des engagements financiers spécifiques et peut ne pas convenir à toutes les situations. Ce mode de financement peut constituer une excellente solution à condition de bien évaluer votre besoin (à court et long terme), votre capacité financière et les détails du contrat. Demandez conseil à votre comptable ou votre banquier.

d’éviter de payer plus que nécessaire. Ainsi que de faire jouer la concurrence. Mentionner de meilleures offres reçues peut inciter le vendeur à s’aligner, voire à proposer mieux.
Les achats aux enchères en hausse
La vente aux enchères de machines agricoles connaît une croissance significative, principalement en raison de la hausse des prix du neuf, qui incite les exploitants à se tourner vers le marché de l’occasion pour réaliser de bonnes affaires. Des entreprises spécialisées, telles que Ritchie Bros, jouent un rôle clef dans ce secteur en organisant régulièrement des ventes proposant une large gamme d’engins.
Les ventes aux enchères peuvent être l’opportunité d’acquérir du matériel performant à des prix souvent inférieurs à ceux du marché traditionnel. Leur popularité croissante est aussi attribuée
Les enchères donnent accès à des fiches techniques détaillées et à la possibilité d’examiner les machines au préalable
à la diversité des machines qui y sont proposées, allant des tracteurs aux moissonneuses-batteuses, en passant par divers outils. Par ailleurs, depuis la crise de Covid-19, tout le monde peut participer en ligne, ce qui a élargi l’accès pour de nombreux agriculteurs, leur permettant de comparer et d’acquérir sans contraintes géographiques. Combiné à la transparence du processus et à la variété des équipements disponibles, cela n’a fait que contribuer à l’essor de la méthode de vente.
Les enchères donnent accès à des fiches techniques détaillées et à la possibilité d’examiner les machines au préalable. Autre avantage : leur rapidité. Une fois l’achat conclu, l’acquéreur peut récupérer son tracteur sans attendre les délais parfois longs liés aux commandes de matériel neuf. Par ailleurs, les tracteurs aux enchères proviennent souvent de professionnels qui ont assuré leur bon entretien, ce qui limite les mauvaises surprises. Car il n’y a aucune garantie. Même si les prix sont souvent plus faibles que ceux du reste du marché de l’occasion, la prudence est de mise, et il faut également garder en tête que des frais de vente seront à ajouter. Là encore, se fixer un budget à l’avance est important pour ne pas dépasser ses moyens et pouvoir ainsi conjuguer économies, rapidité, diversité et efficacité. ■

La stratégie nationale de déploiement des produits de biocontrôle vient de fêter ses 10 ans. Fin 2024, 765 étaient officiellement recensés dans cette catégorie, mais seule une trentaine est autorisée en grandes cultures. Retours d’expériences…


Les produits de biocontrôle doivent être au moins au niveau de la protection chimique pour espérer se développer davantage même s’ils ne coûtent pas moins cher. HARDI
Plutôt que de viser l’éradication des agresseurs des cultures, le biocontrôle regroupe un ensemble de techniques de protection des végétaux fondées sur la régulation naturelle des équilibres de ces populations. Il s’appuie sur des agents vivants ou issus du vivant dont le profil toxicologique et écotoxicologique est plus favorable, et donc plus à même de maintenir la biodiversité. Des produits tels que le soufre sont utilisés depuis bien des décennies, alors que le terme de biocontrôle n’existait pas. Le premier emploi de macro-organismes en Europe remonte aux années 1970, et la diffusion de phéromones dans les vergers comme technique de confusion sexuelle n’a commencé à être employée qu’au début de ce siècle. Dans la mouvance de la loi de 2014, qui a introduit la mise en place d’une réglementation nationale
spécifique pour l’utilisation des produits de biocontrôle, leurs processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché se sont accélérés, contribuant à leur diffusion. La gamme s’est particulièrement développée dans la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage et l’entretien des espaces verts, mais des solutions s’offrent aussi aux grandes cultures. À l’image de Didier, Alexandre, Vincent, Éric et Jérémy, certains céréaliers se sont lancés dans l’aventure. Avec ou sans succès, ils ont expérimenté et partagent leurs expériences.
Cuivre et manganèse
En 2024, au Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire), Jérémy Tourneux a réussi sa première campagne d’orge d’hiver sans fongicide ni régulateur. « J’ai sorti 66 q/ha avec 64 de PS, indiquet-il. Sur notre secteur, c’était plutôt entre 50 et 60 de PS, et en dessous de 60 q pour la moyenne. Je n’avais que 4 ha, mais pour l’année, on ne va pas se plaindre. Elle n’était pas belle au démarrage et j’ai réussi à la ramener avec ma conduite. C’est sûr, ça fait un peu plus de passages. Je mets un peu de biostimulant au début, puis je travaille beaucoup sur la nutrition de la plante avec un passage d’oligo-éléments (1 L de cuivre et 2 L de manganèse à l’hectare) après chaque apport d’engrais. Ça fait trois passages. Après, je travaille aussi avec des EM [effective microorganisms ou micro-organismes efficaces, NDLR]. Un mélange de bactéries, champignons et levures qu’on multiplie avec de la mélasse, du sel et de l’eau non chlorée. On chauffe ça à 32 °C pendant cinq à sept jours pour descendre à un pH assez bas. Ça peut ensuite être pulvérisé. 30 L d’EM (à environ 15 centimes du litre) jusqu’à quinze jours après chaque épandage d’engrais. Je mets aussi des acides humiques et fulviques pour le désherbage afin de limiter au maximum l’oxydation sur les plantes. »
115 € par hectare
« Avec tout ce que j’ai apporté, poursuit Jérémy Tourneux, je suis à 115 €/ha. En traitement, on serait à 119 €, hors désherbage. Ça ne coûte pas moins cher, ça c’est sûr, mais le résultat est là. La paille, je la donne à mes vaches. Au moins, je suis sûr qu’il n’y a pas d’hormone ou de résidu de pesticide. » Installé depuis 2014, il exploite 130 ha en polyculture-élevage (50 de blé, orge, colza ; 30 de maïs et 50 en herbe pour 750 000 L de lait).
L’agriculteur reprend : « On fait entre 60 et 65 q par hectare, et 70 les bonnes années. On n’est pas sur des gros potentiels de rendement. On a toujours été économes sur les phyto pour limiter les frais. Depuis deux trois ans, je cherche des alternatives aux fongicides et aux régulateurs. Je n’utilise plus du tout de régulateur depuis trois ans. Je force en potasse pour le durcissement des parois internes. J’ai aussi fait des essais sur le blé. C’est plutôt concluant, avec les mêmes résultats pour des prix équivalents. Je vais en refaire quand même cette année. » Il a ainsi testé des biostimulants, des produits à base de soufre, du Vacciplant (à la laminarine), le Silzan (à base de silice), des acides aminés… « Ça dépend de ce qu’on me propose, je ne suis pas arrêté sur certains produits », ajoute-t-il.
Globalement, Jérémy Tourneux se dit très agréablement surpris par les résultats, mais précise qu’il choisit aussi des variétés adaptées. « Je ne suis pas là pour chercher à produire du à
blé à 100 q/ha. C’est surtout la résistance aux maladies qui m’intéresse », insiste-t-il.
Les trichogrammes en pionniers
Installé au début des années 1990 en grandes cultures (blé, colza, tournesol, lentilles, orge, maïs semence et maïs grain) à Saint-Rémy-de-Chargnat (Puy-de-Dôme), Didier Manlhiot exploite 110 ha et n’a pas tardé à s’intéresser aux solutions de biocontrôle. D’emblée, il évoque les trichogrammes qu’il utilise depuis une vingtaine d’années en remplacement d’un insecticide. « C’est le premier produit de biocontrôle qu’on a utilisé dans les fermes », remarque-t-il. Ces microguêpes parasitoïdes mesurant souvent moins d’un millimètre de long luttent contre la pyrale du maïs. En déposant leurs œufs dans ceux de la ravageuse, elles entravent notamment le développement de ses chenilles. Les auxiliaires sont lâchés dans les cultures pour contrôler les bioagresseurs. « La quantité de trichogrammes est calculée en fonction des sommes de températures, ce n’est pas nous qui décidons. On nous dit : dans votre secteur, il faudra les poser entre telle et telle date. Mais une fois dans la culture, il y a plusieurs générations d’œufs dans les paquets, les insectes sont libérés au fur et à mesure. On dépose une fois les paquets, ils couvrent tout le cycle de la culture. Les trichogrammes, c’est ce qui se rapproche le plus, en termes d’efficacité, des produits chimiques. J’en suis satisfait, mais l’efficacité dépend toutefois de l’année et de la parcelle », nuance-t-il en soulignant la moindre efficacité en cas de grosse pression de pyrales, par fortes chaleurs ou s’il y a beaucoup de maïs autour.

« Ça ne coûte pas moins cher, ça c’est sûr, mais le résultat est là »
JÉRÉMY TOURNEUX, polyculteur-éleveur dans le Maine-et-Loire

En laboratoire, cette technicienne arrose les plants pour les aider à se développer et tester l’efficacité des produits.

Dans ces flacons, diverses solutions sont en attende d’être homologuées, condition indispensable pour pouvoir être utilisées comme produits de biocontrôle.
Depuis six-sept ans, Didier Manlhiot a vu l’offre de produits de biocontrôle s’étoffer considérablement. Sur son colza, il a ainsi essayé le Contans WG, un fongicide biologique contenant un champignon mycoparasite des sclérotes. « Ça marche bien, c’est du préventif, mais je ne l’utilise plus parce que je n’en ai presque plus besoin. Il y a toujours du sclérotinia, mais moins que par le passé. De toute façon, sur le colza, on fait quand même toujours un traitement fongicide », explique-t-il. Il utilise aussi des stimulateurs de défenses naturelles, pour que les plantes soient un peu plus résistantes aux maladies. « Il y a des produits à base de silice dont le but est de durcir les tissus, mais si la pression est forte en maladies cryptogamiques (rouille, fusariose, septoriose…) sur les céréales, ce n’est pas suffisant. Les années à maladies, comme en 2024, les produits de biocontrôle ne suffisent pas, où alors il ne faudrait faire que ça d’appliquer, en passant chaque semaine. »
Didier Manlhiot dit recourir aux produits de biocontrôle par conviction, pour limiter les interventions chimiques et les effets néfastes de la chimie sur le sol. « Les premières choses qu’on a faites, détaille-t-il, c’est de réduire les doses de produits chimiques et de mieux appliquer. Le biocontrôle, ça s’utilise en mode préventif, car l’efficacité n’est pas la même. Et ça coûte plus cher en général. Les trichogrammes coûtent 40 €/ha, là où une couverture insecticide revient à 10 ou 15 €. Mais il faut compter deux passages ! Ce ne sont pas des produits miracles. Tout est histoire de compromis, et ça dépend de plein de choses. C’est comme un médicament, si on le prend mal ou à mauvais escient, c’est plus néfaste que bénéfique. »
Conquis par les macérations


Comme son nom l’indique, ce mémento d’agriculture est un aide-mémoire dans lequel figure l’essentiel des notions développées dans la quatrième édition du Petit précis d’agriculture (du même auteur, Éditions France Agricole). Pour avoir des explications plus détaillées et un approfondissement des notions évoquées dans cet ouvrage, vous devez donc vous référer à ce même Petit précis d’agriculture.









à
Cette année, à Audes (Allier), Alexandre Poucet entame sa quatrième campagne sous protection biocontrôle. Pas question de renoncer à ses macérations de purin d’ortie et de consoude qu’il utilise désormais sur toutes ses cultures, excepté le colza. Il s’en sert pour éviter les maladies. « On complémente avec des oligo-éléments. On a étendu ça à toutes les céréales avec










Cet ouvrage comprend 38 fiches synthétiques qui se répartissent en 5 grandes parties : • Les politiques agricoles et l’environnement juridique et institutionnel de l’exploitation. • L’environnement physique des productions végétales. • Les principales espèces cultivées en France. • Les productions animales. • Les différentes formes d’agriculture.


Chaque fiche s’achève par deux rubriques : • Deux questions («Pour aller plus loin») dont le degré de difficulté est évalué par « * » (le plus accessible) à « ** » (le plus complexe). La réponse à ces questions ne se trouve pas forcément dans la fiche mais vous trouverez l’information dans le corrigé présenté de façon rédigée à la fin de chacune des 5 parties. • Un « Le saviez-vous ? » qui propose une anecdote/une curiosité autour du thème de la fiche.
Ce livre s’adresse : Aux étudiants et élèves pour les aider à structurer leurs connaissances et à améliorer l’efficacité de leurs révisions. Aux professionnels des structures agricoles ou para-agricoles qui souhaitent un aide-mémoire très synthétique.
2024 - 232 pages - 16,5 x 23 cm
29 € - Réf. : 926801
01 40 22 79
NOM et Prénom :
GAEC / Société :
Adresse :
CP : Localité :
Tél. portable :
Je vous règle un montant total de € TTC par : Chèque à l’ordre des Éditions

succès, ce qui ne dispense pas de surveiller de près. Une fois que la maladie est présente, c’est trop tard, alors on passe aux fongicides. C’est bien dans un système préventif type T0, T1, T2, T3 (fongicide à épis 1 cm, un à deux nœuds, dernières feuilles et éventuellement à floraison) avec des petites doses », annonce l’agriculteur, qui estime le coût de trois passages à 30 €/ha, à raison de

Alexandre Poucet, exploitant à Audes (Allier)
« Toujours partant pour des essais »
« J’ai testé le purin ail/fougère contre le méligèthe du colza, mais sans succès. Je pense qu’il y avait déjà trop de méligèthes dans la parcelle pour avoir une efficacité équivalente à celle d’un insecticide. Je suis convaincu que ça peut marcher dans les colzas, mais avec beaucoup plus d’anticipation. Il faudrait faire le traitement aux premières annonces de vol de méligèthes, même s’il n’y en a pas encore dans la parcelle. J’ai également essayé les thés de compost, mais avec du lombricompost industriel, sur lequel je suis tenté d’émettre quelques réserves… On a essayé d’autres choses moins concluantes, mais on n’a pas encore le recul nécessaire pour en parler, dire que ça marche ou pas. C’est un peu plus laborieux, je préfère me cantonner aux macérations de plantes, aux extraits fermentés, aux choses que l’on maîtrise avant de donner des leçons et tirer des conclusions. »
La nutrition des plantes requiert d’ajouter des oligo-éléments (cuivre, manganèse, calcium, bore, soufre…) après chaque apport d’engrais.

des macérations de purin d’ortie et de consoude sur toutes ses cultures, excepté le colza.
10 L par application. « L’entrée est économique et agronomique, complète-t-il. Il ne faut pas dissocier les deux ! Quand on engage plus de 50 €/ha dans un programme fongicide, ça commence à coûter cher ; à moins de 35 €/ha, on a une efficacité moyenne. Sans oublier qu’on apporte quand même de la chimie : on manipule les produits, ce qui nous expose à d’éventuels problèmes de santé. Si l’on arrive à faire mieux à moindre coût avec une évolution visible sur l’équilibre des sols, la santé des plantes et la dégradation des résidus de pailles dans les parcelles, on voit le bénéfice. De surcroît, ça permet de répondre aux attentes sociétales en matière de respect de l’environnement. »
Couverture/résistance en prime
« Ce qu’on visait sur l’exploitation, déclare Alexandre Poucet, c’était de réduire la quantité de fongicide, mais en même temps, on a un effet couverture/résistance vis-à-vis des insectes. Le but, c’est de conserver les plantes en bonne santé, tout en délaissant les produits de synthèse. Ce qui ne nous classe pas en agriculture biologique pour autant, donc on conserve la possibilité de recourir à la chimie. » En comparaison avec le voisinage, le fermier constate que les maladies arrivent plutôt en fin de cycle dans ses parcelles, suffisamment tard pour que le blé ait atteint sa maturité sans difficulté, ni fongicide. « On peut avoir quelques petits ronds de rouille, comme l’an dernier, sur les périodes très humides, mais qui arrivent tellement tard et avec une si faible pression qu’il n’y a pas d’incidence sur le rendement », précise-t-il.
« On essaie de démarrer à la mi-mars, décrit l’agriculteur bourbonnais, dès que les températures sont plus clémentes et que l’on peut passer dans les champs. Après, on va essayer de passer toutes les trois semaines environ. Au premier passage, on fait seulement de

la nutrition. Si on a plus de 12 °C, on ajoute directement le premier purin. L’an dernier, à certains endroits, avec un temps vraiment très humide, on a quand même réussi à faire du zéro fongicide – hormis sur l’orge d’hiver – en faisant deux passages de macération et un à deux passages de nutrition avec des oligo-éléments. Les années précédentes, on faisait trois passages au printemps. Idéalement, il faudrait en faire quatre : un à l’automne et trois au printemps. Mais on fait selon la météo ! L’application à l’automne conditionne le sol et la plante, celles du printemps viseraient plutôt à protéger la plante, même si je suis certain qu’il y a aussi un effet sur le sol. Chez certains agriculteurs, il y a eu des effets visibles sur la structure du sol. Le purin ortie/consoude, c’est ce qu’il y a de plus polyvalent. Ça fonctionne bien, quelle que soit la culture. Nous, on n’a pas vraiment de problème d’insectes sur les céréales. À partir du moment où la plante est saine, il n’y a pas de raison. Sur l’orge, c’est un peu plus délicat. L’an dernier, la pression maladie a été précoce, on a dû intervenir avec du fongicide et ensuite repasser avec des purins. Il faudrait arriver à attaquer tôt avec un T0. Le problème, c’est qu’il faut une température minimale et que dans l’Allier, il fait relativement froid à la reprise de végétation. On ne peut pas tout de suite intervenir avec ce type de produits. Donc, on essaie de nourrir les plantes pour éviter un traitement fongicide au stade épi 1 cm, mais parfois, quand on arrive au stade 1-2 nœuds, la maladie est déjà présente. » Alexandre Poucet travaille avec son père sur une surface totale de 400 ha (une base de colza, blé, orge et un complément en lin, avoine, tournesol, triticale, maïs, féveroles, sarrasin et millet). Leurs macérations, ils les conservent à l’abri du soleil. « On les achète en cubi de 1 000 L. C’est assez chronophage à faire, je n’ai ni le temps ni la maîtrise pour les produire et les stocker sur le long terme », justifie-t-il. En termes de mise en œuvre, le paysan

Vincent Loisel, exploitant à Bonvillers (Oise)
« Le fruit d’une réflexion globale »
« Il y a dix ans, j’étais arrivé à mi-carrière et j’ai pris un virage par rapport à ma façon de cultiver. C’était un nouveau challenge et cela a mis un vrai coup de boost à ma passion de notre métier. Quand je l’ai fait, c’était pour les problèmes de résistances aux herbicides et je savais que les produits allaient être restreints et que j’allais avoir des contraintes nitrates. Je l’ai fait de façon volontaire. J’insiste : pour aller dans le biocontrôle et les autres sujets, il faut être bien encadré, formé, entouré, et il faut une réflexion à 360°. Il faut regarder tout ce qui se passe autour. C’est une approche vraiment globale qui va sur la technique, l’agronomique, l’économique et aussi sur la charge de travail, qui n’est plus tout à fait la même. Le biocontrôle, c’est un des paramètres, un des leviers qu’on utilise dans la philosophie globale. Le virage se fait aussi par étapes, on y va crescendo. Il faut avoir conscience qu’on peut avoir des échecs, qu’on s’expose aux risques. Avec un collectif, c’est mieux parce qu’on a le retour d’expérience de chacun. »
souligne l’importance de bien nettoyer son pulvérisateur, ainsi que les filtres après utilisation, et d’adapter ses réglages. Il insiste aussi sur la nécessité de se former correctement sur ces techniques avant de se lancer tête baissée. Il a ainsi suivi des formations dispensées par la chambre d’agriculture de l’Allier et un organisme privé. Dans le cadre du dispositif Dephy et Ferme 3000, il a également travaillé sur ces sujets.
Anticiper les contraintes de demain
« Avant de parler de biocontrôle, il faut savoir pourquoi on en arrive là. Tout est lié à la stratégie et à l’état d’esprit de l’exploitant. Ça s’inscrit dans une réflexion globale », remarque Vincent Loisel, agriculteur à Bonvillers (Oise). Il cultive 215 ha implantés avec des céréales, des oléoprotéagineux, du lin textile et des betteraves sucrières. « Tout est parti, témoigne-t-il, d’un GIEE H3 eau+ dans lequel on a voulu anticiper les contraintes de demain et les problématiques du territoire par rapport à un bassin d’alimentation de captage Grenelle où certains produits phyto et des nitrates avaient été détectés. L’idée première, c’était de trouver des solutions en restant maîtres du jeu et indépendants. On a créé ce groupe en 2016. Une année marquée par un problème de maladie de fin de cycle sur les céréales, ayant fait chuter les rendements de 40 %. On pensait que personne ne viendrait, au contraire, ça a bien pris. Aujourd’hui, nous sommes huit, tous en grandes cultures, sur une dizaine de communes. Au début, on était le double, les agriculteurs sont conscients de la problématique, mais il faut être prêt dans sa tête avant de franchir le pas. » « Dans un monde idéal, si la plante est en bon état, il n’y a pas besoin de la pulvériser avec des phyto. Nous avons commencé par les couverts en interculture longue, le mélange de couverts. Ensuite, on a parlé de la santé de la plante au travers d’analyses pour en venir
Côté pulvérisation, il est primordial de contrôler l’état des filtres après utilisation et d’adapter ses réglages.

aux oligo-éléments (bore, cuivre, manganèse, molybdène, zinc…). Puis, aux macérations d’ortie, de consoude, de bardane et de luzerne – on s’auto-suffit et c’est ce qui est intéressant dans la démarche –, et enfin aux produits dits de biocontrôle, vendus par des fournisseurs. Ceux-ci arrivent en bidon de 20 à 25 L. Depuis cette année, on utilise aussi des extraits fermentés, appelés EM, qu’on injecte dans le sol pour favoriser la vie microbienne. On les prépare également nousmême, à partir de produits de base achetés. On les trouve tout prêt dans le commerce, mais ils coûtent beaucoup plus cher », constate Vincent Loisel, qui reconnaît faire plus de tours de plaine qu’auparavant et passer davantage de temps à se former.
Face aux interdictions
« Pour la betterave, ajoute l’exploitant, depuis 2018-2019, les rendements sont plutôt en déclin, notamment en 2020 suite à l’arrêt des néonicotinoïdes. Aujourd’hui, c’est la cercosporiose qui explose. Le cuivre fait l’unanimité, mais nous essayons également d’autres modalités. » Avec l’Institut technique de la betterave (ITB), Vincent Loisel s’est engagé dans un programme national de recherche et d’innovation (PNRI) dont le but est de tester, en conditions réelles, différentes combinaisons de solutions contre la jaunisse. Sur sa ferme, l’agriculteur a semé des plantes compagnes et des bandes mellifères pour gérer les problèmes de pucerons… Il utilise des produits de biocontrôle contre les problèmes de gel ou de stress hydrique, d’autres qui renforcent la plante après un passage de phyto ou encore des répulsifs à base d’ail… « On a commencé en 2018 et plus ça va, plus ça prend de l’importance, reconnaît-il. On s’aperçoit d’une certaine efficacité. » En fonction des stades végétatifs, il réalise jusqu’à trois applications par culture. L’an dernier, sur son secteur, 90 % des pois protéagineux ont été retournés. Lui a réussi à sauver sa récolte, même si son rendement a été impacté. Parfois, c’est au prix d’une combinaison avec des produits chimiques : « J’utilise le biocontrôle parce que, pour moi, c’est une solution d’avenir potentielle, mais je ne m’interdis rien. Quand le contexte pédoclimatique est négatif, ce n’est pas toujours la bonne
solution, le chimique demeure une valeur plus sûre. Pas facile de prédire ce qui fonctionnera le mieux ! En définitive, c’est la rentabilité de l’exploitation agricole et la santé du dirigeant au sens large qu’il faut viser. Au niveau économique, il faut garder en tête que ça ne paie pas immédiatement, cela doit se faire progressivement. L’objectif est a minima de faire au moins aussi bien qu’en conventionnel. » Cerise sur le gâteau : le producteur constate que, grâce à cette approche globale, son exploitation évolue vers des pratiques qui lui donnent droit à des financements. En outre, il a reçu les certifications HVE3 et Bas-carbone sans trop de contraintes. « Les
L’AVIS DE L’AGRICULTEUR

Éric Bonnefoy, exploitant à Cottier (Doubs)
« Neutre sur l’IFT avec HVE en perspective »
« Les produits de biocontrôle n’ont pas d’incidence sur l’indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT). Sans molécule de synthèse, on est neutre. C’est comme si on n’avait rien appliqué. Ces méthodes peuvent donc être complétées avec d’autres produits plus adaptés à la pression maladie, sans trop d’incidence. C’est comme pour nous, on peut utiliser de l’homéopathie, mais parfois, il faut passer aux antibiotiques. L’usage du biocontrôle casse le cycle des maladies en limitant les résistances et les accoutumances à d’autres produits au même titre que certaines pratiques. J’ai une rotation assez longue des cultures. Je reviens sur un cycle de blé tous les quatre ans. C’est mon habitude de travail d’avoir un assolement assez long avec plusieurs cultures. C’est un état d’esprit de travailler avec le biocontrôle. Je suis en attente de certification HVE, et je pense qu’il n’y aura pas trop de problèmes. »

obstacles réglementaires sont plus facilement franchis », se félicite-t-il.
Incité par l’agroalimentaire
Travailler avec Lulu l’Ourson, c’est du sérieux. C’est d’ailleurs ce qui a motivé Éric Bonnefoy à prendre le train du biocontrôle. Tout en jouant la carte de la proximité, la charte Harmony du biscuitier LU donne des directions visant à cultiver le blé de manière plus respectueuse de l’environnement. « L’industriel nous incite à travailler avec des produits de biocontrôle », précise Éric Bonnefoy, qui produit des céréales (blé, orge, maïs) et des graines oléagineuses (colza et soja) sur 150 ha à Cottier, dans le Doubs. En 2023, il a franchi le pas en testant le Pygmalion, un fongicide de biocontrôle contre la septoriose du blé. L’année 2024 a fini de le convaincre. « Ce fut une année avec beaucoup de pluie et de pression maladie, rappelle-t-il, et, en utilisant le biocontrôle, je n’ai pas eu plus de maladie que les années précédentes. Après, je suis dans une région de polyculture où on a beaucoup de diversification. Pour la charte, j’ai choisi l’option biodiversité. Je sème des plantes mellifères. J’ai un partenariat avec un apiculteur qui met ses ruches à proximité de mes champs. Notre particularité, c’est qu’on cultive le

La charte Harmony du biscuitier LU donne des directions visant à inciter à cultiver son blé en respectant davantage l’environnement.
blé et qu’on le stocke sur la ferme où l’on a tout ce qu’il faut pour conserver les céréales sans insecticide, comme l’exige la charte. Ensuite, mon blé part à la meunerie à 30 km de la ferme. Après transformation en farine, il va directement à la biscuiterie à Besançon. Ça fait dix-huit ans que je travaille comme ça. » Il précise toutefois que le biocontrôle ne vient pas de débarquer sur sa ferme. « Depuis plus de trente ans, j’utilise des trichogrammes contre la pyrale du maïs », remarquet-il en évoquant l’époque révolue qui nécessitait trois lâchers : « Aujourd’hui, on a des plaquettes avec différents stades. Il n’y a plus qu’un passage. Ça s’est bien démocratisé. Le biocontrôle pour les fongicides, c’est un peu moins développé, mais ça fonctionne. Il faut l’appliquer correctement avec un appareil de traitement bien réglé et bien contrôlé pour mettre la bonne dose au bon moment. Au niveau du coût, il n’y a pas grand écart, c’est sensiblement pareil. » Pour l’assolement 2024-2025, en partenariat avec Arvalis, Éric Bonnefoy accueille des essais de produits de biocontrôle. Certains pourraient durablement s’installer dans ses cultures. ■














En matière d’exploitation agricole, trouver un remplaçant pour l’agriculteur qui part en retraite est une chose et la transmission de l’outil professionnel à l’heureux élu en est une autre. Plusieurs termes peuvent définir une transmission : cession, vente, reprise, installation, succession… Dans cet ouvrage, la transmission s’entend comme la passation d’une entreprise agricole, par un cédant, un donateur ou un décédé à un repreneur. Il s’agit ainsi d’une ou plusieurs installations pour un départ, contrairement aux démantèlements d’exploitation qui ne permettent qu’un agrandissement des exploitations existantes. La transmission peut s’effectuer en une seule fois ou en plusieurs étapes ; elle peut également avoir fait l’objet d’une intégration progressive du successeur au sein de l’exploitation, par exemple comme associé ou aide familial. Mais ce n’est pas toujours aisé de réaliser et réussir une transmission. Les difficultés rencontrées (1ère partie) risquent de se faire jour. Elles sont souvent dues à une réglementation tatillonne, à la complexité du monde agricole ainsi qu’au patrimoine composant une exploitation.
NOM et Prénom :
GAEC / Société :
Adresse : CP : Localité :
Tél. portable :
E-mail :
Je vous règle un montant total de € TTC par : Chèque à l’ordre des Éditions France Agricole
Il y a deux ans, Bertrand Coustenoble, céréalier bio dans le Nord, a sorti 35 q de tournesol. En 2024, l’humidité a ruiné son implantation.


Des céréaliers des Hautsde-France se mettent à produire du tournesol, depuis quelques années, pour des raisons d’assolement ou de valorisation de terres à faible potentiel. Mais le climat reste peu adapté, les semis doivent se faire sur sols bien ressuyés, suffisamment tôt pour pouvoir récolter avant le retour de l’humidité.
Est-ce grâce au microclimat qu’il réussit ses cultures de tournesol ? Michel Delille en produit depuis trois ans à Brunémont (Nord), entre Douai et Cambrai. Ici, il fait un petit peu plus chaud que dans les cantons alentour, la moisson commence toujours une semaine avant. Sur ses 80 ha de cultures, le céréalier bio de 36 ans implante 5 ha de tournesol, et cela marche. Les semis demandent cependant de la vigilance : ils doivent être réalisés le plus tôt possible, donc attention aux gelées ! « Chez moi, indique le cultivateur, c’est fin avril/ début mai au plus tard, car si j’attends trop, la récolte risque de ne pas être à maturité ou trop humide. » Il choisit la variété la plus précoce possible et sème à 75 000 pieds/ha maximum. « Cela ne sert à rien de semer plus dense, on perd du rendement », commente-t-il. Gare également aux corbeaux et pigeons, la graine de tournesol s’avérant particulièrement
appétente. Si les chasseurs se chargent de les effaroucher, la culture peut lever facilement. « Elle couvre le sol très rapidement, avec des interrangs de 45 cm », observe Michel Delille.
À 50 km au nord-ouest, à Marquillies, Bertrand Coustenoble, un autre céréalier bio qui produit de la bière et des pâtes, n’était pas peu satisfait de sa culture de tournesol il y a deux ans. « J’ai fait 33 q/ha, c’était super ! » se souvient-il. Pour l’implantation, il a attendu que les conditions météorologiques soient réunies, il fallait non seulement que le champ soit bien ressuyé, mais aussi que la terre soit suffisamment réchauffée pour que les plantes lèvent avant les adventices. Alors il a semé au 1er juin. Évidemment, il a choisi une variété ultra-précoce. Et comme l’arrière-saison fut belle, il a pu récolter au 8 octobre. En 2024, il a voulu semer un peu plus tôt, le 10 mai. Mais les conditions n’avaient rien à voir, le sol était humide.
« Quand on a vu les graines germer, on s’est rendu compte qu’elles étaient attaquées par les limaces. On a mis du phosphate ferrique, mais rien n’y a fait », déplore-t-il Tout fut à recommencer. Bertrand Coustenoble a ressorti le semoir début juin… pour des résultats identiques. À cela sont venues s’ajouter les attaques de pigeons. « Il n’y avait pas assez de population de tournesols pour que la culture se montre rentable, donc on a implanté un maïs à la place », conclut l’agriculteur.
Pas d’intrants
Une fois levée, la culture n’est pas compliquée : deux passages de bineuse-étrille et c’est propre, pas besoin d’intrants. « C’est une culture assez simple à mener, il faut juste bien vérifier le taux de matière organique, parce qu’elle aime bien les sols riches », recommande Michel Delille. À la récolte, il « roule tranquillement avec la batteuse, et laisse juste les releveurs un peu écartés, sans forcément beaucoup de perte, 3 à 4 % c’est bien le max ». Encore faut-il savoir déterminer le meilleur moment pour sortir la batteuse. « Il ne faut pas chercher à avoir l’humidité la plus basse, sinon il peut se mettre à pleuvoir et les têtes peuvent se charger en eau. Dès que l’on voit que c’est mûr, il faut y aller, avant que les oiseaux commencent à attaquer », met en garde le céréalier de Brunémont. Il y a deux ans, la météo s’est montrée si clémente à l’automne que Bertrand Coustenoble n’a pas eu besoin de sécher ses tournesols. En 2024, il a récolté à 20 %
La maturation de la culture peut être retardées par les conditions météorologiques ainsi que des implantations tardives.
« Dans le Nord, c’est humide, alors mieux vaut prévoir de sécher »
BERTRAND COUSTENOBLE, céréalier bio dans le Nord
d’humidité. Dans le Nord, l’humidité reste fréquente, mieux vaut donc prévoir une étape de séchage, qui peut se faire de façon artisanale ou sous forme de prestation, mais il faut l’anticiper. Attention à la température, « si cela sèche trop fort, cela peut cramer », avertit Hélène Plumart, conseillère grandes culture chez Bio en Hauts-de-France.
Pourquoi cultiver du tournesol Michel Delille cultive du tournesol pour valoriser ses terres à faible potentiel, là où produire des légumes s’avère risqué. « Je le vends 600 €/t avec 3 t/ha de rendement environ. Je marge mieux qu’avec du maïs, mais si je n’avais pas de terres argilo-calcaires, je n’aurais pas d’intérêt à en faire », précise-t-il. Quand le prix retombe à 440 €/t comme en 2023, ce n’est plus rentable, surtout si les rendements se montrent inférieurs à 20 q/ha. Si des céréaliers se mettent à cultiver du tournesol dans les Hauts-de-France depuis cinq ou six ans, c’est pour des raisons agronomiques. « Jusque-là, quand ils voulaient intégrer une culture sarclée dans

leur rotation, ils semaient du maïs, explique Hélène Plumart. Désormais, le tournesol le remplace, car il nécessite moins d’intrants. » Les coopératives de Saint-Hilaire-lezCambrai, Oriacoop ou Biocer s’y intéressent, mais la filière reste à construire. « Il faudrait qu’il y ait plusieurs opérateurs à collecter, et capables de sécher dans les quarante-huit heures, propose Bertrand Coustenoble. Si 200 ha sont mis d’un coup en culture, cela fait du volume à sécher et à écouler, cela nécessite une infrastructure et des débouchés. » Et puis la récolte, actuellement, se fait généralement avec des becs à maïs. « Il faudrait du matériel de récolte spécifique au tournesol pour réduire les pertes », abonde Hélène Plumart.
Une culture avec du potentiel
Les conditions météorologiques de l’année qui vient de s’achever ont donné du fil à retordre aux producteurs de tournesol. Du début à la fin, tout aura été difficile. Des implantations souvent tardives, suivies de précipitations abondantes et de températures fraîches en fin d’été et à l’automne… des circonstances idéales pour retarder la maturation des grains et rendre les récoltes complexes. Celles-ci se sont étalées sur plus de trois mois ! Le résultat n’a pas été celui escompté, le rendement moyen national est estimé à 20 q/ha, soit une performance en deçà de la moyenne quinquennale, qui est de 23,1 q/ha. En dépit de ces difficultés, la production nationale 2024 se situe autour de 1,4 million de tonnes, soit une quantité comparable à celle des années 2015 à 2020. Ce qui souligne que la culture en a sous le pied en matière de potentiel.
Le tournesol est resté rentable grâce à la hausse des prix de fin de campagne. La marge brute est estimée à 1 000 €/ha pour ceux ayant semé en avril. Les récoltes tardives ont toutefois engendré des frais de séchage élevés, liés au taux d’humidité important. La culture se distingue grâce à sa robustesse, démontrée dans les essais conduits par Terres Inovia et Arvalis, et par ses faibles besoins en engrais azoté. Ce qui en fait une option économique et adaptée aux contraintes climatiques. Les agriculteurs sont invités à la considérer davantage dans leur rotation afin de diversifier leurs assolements et de bénéficier de ses atouts agronomiques. ■
Einböck : une lame de rasoir pour trancher le sol
Le Razor de l’Allemand Einböck se destine à détruire les couverts végétaux ou à déchaumer, en mode scalpage utra-plat jusqu’à 12 cm.



Koncéo : l’appli qui met fin aux post-it Pour en finir avec les pannes coûteuses et évitables, l’application Koncéo modernise le suivi des entretiens matériels sur une exploitation, en Cuma ou en ETA…
Quelle que soit la marque, la couleur ou l’utilisation de l’outil, les constructeurs misent sur sa polyvalence tant les conditions d’emploi, les habitudes et les techniques de culture diffèrent.

Kubota : 10 ans de made in France
Fabriquée à Bierne, dans le Nord, la dernière version du tracteur phare du Japonais Kubota, le M7, marque une progression nette de la gamme en matière de technologies et d’automatisations.
John Deere : une benne plus généreuse pour le Gator
+ 13 % de capacité par rapport au modèle précédent pour le Gator XUV 875M de John Deere, qui devrait être disponible en concession dès le printemps 2025.


Présentée à l’Eima, la charrue allemande
Lemken Diamant 18 garde sa maniabilité grâce au positionnement de la roue porteuse derrière le châssis principal.
Kuhn : l’Espro affine sa polyvalence
Plus légers et maniables, les quatre modèles de la gamme Kuhn Espro 1002 s’adressent aux pratiques culturales simplifiées.



le monde
La GX 520 AgriLiner de Krone est une semi-remorque de 52 m3 qui s’attelle à un tracteur routier, pour être à l’aise tant dans les parcelles que sur la route.
Manitou augmente ses standards de qualité sur ses télescopiques agricoles, rayon dans lequel la marque française a vendu 20 000 machines l’an passé.
Alex :
« C’est perdu d’avance ! J’estime que les syndicats agricoles ont déjà tout arrangé avec les dirigeants politiques. Aucun intérêt à se déplacer à nouveau, tant que c’est sous une bannière syndicale. »
Maxens :
« [...] Certes, depuis les manifestations d’agriculteurs en janvier 2024, il y a eu la météo pourrie, les mauvaises récoltes, les crises sanitaires FCO et MHE… Mais de toute façon, le gouvernement ne lâchera que des mesurettes comme l’allègement d’impôts, la défiscalisation du GNR. Des aides à court terme qu’il faudra ensuite rembourser, sans aucune garantie de prix, de rendement ou de baisses des charges. »
Maxens :
« L’Europe distribuera aussi des clopinettes, pour faire accepter l’accord de libre-échange avec le Mercosur, des clopinettes qui se noieront dans des primes et disparaîtront au gré des contraintes budgétaires. Rappelons que le monde agricole a déjà été échaudé. Ce qu’il manque dans les exploitations, c’est du cash, pas des promesses […] à part vider les cours de ferme, ces manifestations ne serviront pas à grand-chose. »

Plusieurs syndicats, la FNSEA et les JA notamment, ont appelé mi-novembre les agriculteurs à se (re)mobiliser pour obtenir enfin des réponses de l’État face à la crise agricole. Laquelle s’est accentuée en raison de la moisson catastrophique et des épizooties de FCO et MHE.
Sans compter les pluies abondantes à répétition, qui ont compromis les semis. Les lecteurs de Terre-net avaient réagi.
DaSa :
« Que de la figuration ! Moi, j’en aurais marre de manifester pour ne rien avoir en retour. De la perte de temps et d’argent !! De beaux engagements au niveau local, réduits en fumée à l’échelon national. Quelle réelle force de conviction et pouvoir de négociation ont ces syndicats ? Peut-être est-ce voulu ? »
« Ce qu’il manque dans les exploitations, c’est du cash, pas des promesses »
MAXENS
Bapt :
« […] Des actions fortes… pour des mesurettes ! Nous réclamons des marges rémunératrices et une baisse des coûts de production […] Il faut manifester devant les entreprises de l’amont et l’aval de la filière ! »
Jérôme :
« Depuis la colère agricole de début 2024, rien de neuf, si ce n’est l’ampleur des dégâts dans les campagnes ! […] Il n’y a plus de pilote dans l’avion depuis longtemps !! Au soutien financier de
l’État, je préférerais que celui-ci n’enfonce pas les agriculteurs avec des choix discutables. »
Pioupiou :
« Astiquez vos beaux tracteurs pour les montrer sur les ronds-points ou ailleurs, et rentrez chez vous avec des promesses qui ne seront pas tenues. »
Steph72 :
« Pourquoi attendre ? »
Nn :
« C’est-à-dire attendre que l’accord Mercosur soit signé ?? […] Ils ne veulent pas sortir trop tôt. Il faut être à la une pour la fin d’année, à l’approche des élections chambres. »
Gibero :
« Il fallait faire la grève des semis […] »
Maxens :
« Ou bloquer Rungis le 15 décembre ! Sans quoi les agris n’obtiendront que quelques peccadilles dont ils ne verront pas la couleur, le Mercosur sera signé et les exploitants continueront à faire faillite. »
Marus :
« Je crains qu’il y ait de la casse et cela ne ferait qu’entretenir l’agribashing […] » ■
La chambre d’agriculture de la Marne a présenté les résultats de sa plateforme expérimentale Zéro fuite lors du colloque Syppre Champagne, en octobre dernier.


Depuis 2019, la chambre d’agriculture de la Marne conduit, en lien avec le lycée agricole de Somme-Vesle, un essai système « zéro fuite » en terre de craies, en vue d’améliorer la qualité de l’eau. Si « les objectifs exigeants fixés ne sont, pour le moment, pas tous atteints », plusieurs enseignements sont déjà à tirer de cette expérimentation.
Sur la plateforme expérimentale
Zéro fuite, située en zone vulnérable dans un bassin d’alimentation de captage, la chambre d’agriculture de la Marne et le lycée agricole de Somme-Vesle entendent « produire de l’eau propre», ne contenant pas de résidus phytosanitaires et dont la teneur maximale en nitrates ne dépasse pas 25 mg/L. Pour cela, les deux partenaires ont choisi de ne pas recourir aux produits phytosanitaires sur les 30 ha de la zone, composée de huit parcelles. Ils ont également opté pour une couverture du sol maximisée et une fertilisation azotée réduite (- 30 u/ha). «Ontesteengrandeur naturedespratiquesutiliséesenagriculturebiologique,maisons’autorisel’apport
d’engraisdesynthèsepourmaintenirun objectifdeproductivité», explique Sylvain Duthoit, conseiller à la chambre d’agriculture de la Marne.
« Lacombinaisondecouvertsdétruitstardivementetd’unefertilisationplusfaible permet de limiter le lessivage de l’azote. Ons’estapprochédel’objectifdequalité del’eautroisannéessurcinq,entre2019 et2023. Les résultats sont très dépendants de la climatologie: si la couverture du sol n’est pas performante, c’est forcément plus compliqué. Et le seuil de 25mg/Lpourlaconcentrationennitrates sous racinaire reste un objectif très
ambitieux», fait remarquer le conseiller. Des cultures bas-intrants ont aussi été intégrées pour diversifier la rotation, comme la luzerne et le chanvre, il y a respectivement trois ans et un an. Ces dernières sont mises en avant pour réduire la pression adventices, et notamment le développement des chardons. L’implantation de la luzerne s’étant révélée difficile, une implantation directement dans les pois a été testée en 2024. « Du miscanthusetdelasilphieontégalementété implantés,maislesrésultatsnetiennent pas compte de leurs performances, car ces cultures pérennes ne font pas partie de la rotation suivie. Ils représentent pourtant une brique intéressante pour atteindrel’objectifdéfini», ajoute Sylvain
Duthoit. Outre l’allongement de la rotation, les équipes ont recours au désherbage mécanique : bineuse pour les blés et le colza, herse-étrille sur les orges de printemps, et robot FarmDroid pour le semis guidé au GPS et le binage des betteraves.
«Lebinagedubléestunepratiqueplutôt robuste, indique le conseiller, le contrôle du salissement se montre en revanche pluscomplexesurpoisetbetteraves.» Parmi les autres leviers mobilisés, on peut citer le choix variétal pour la gestion du risque maladies. « Cela fonctionne en céréales à paille, c’est plus compliqué dans le cas des betteraves sucrières, visà-visdelacercosporiose, précise Sylvain Duthoit. Le mélange variétal est utilisé pour la plupart des cultures, sauf en orge brassicole, car ce n’est pas accepté parlafilière.»
Face aux insectes ravageurs, les équipes misent sur la technique dite de pushand pull, en se servant des intercultures ou des jachères fleuries pour les attirer en dehors des parcelles de cultures. Leur gestion reste toutefois encore aléatoire.

Un manque à gagner de l’ordre
Les performances économiques de l’essai système ont été évaluées pour déterminer une possible compensation à l’hectare. Sur blé, orge de printemps et colza, les pratiques mises en œuvre engendrent une baisse de productivité de l’ordre de 20 %. Elle atteint 50 % en betteraves, car « les levierspréventifsetalternatifsnesontpas assezrobustespourlemoment, détaille le
conseiller. Entre2019 et2021,lemanque à gagner est ainsi estimé à 400€/ha, et il a atteint 740€ en 2023 du fait du prix de vente élevé des betteraves. » Sylvain Duthoit souligne aussi une augmentation du temps de travail de 30 %.
Afin d’éprouver encore les leviers, l’essai Zéro fuite est reconduit pour la récolte 2025 et prévu également en 2026, l’Agence de l’eau Seine-Normandie ayant validé son soutien au moins jusqu’à cette date. ■
par la revue experte de la filière pomme de terre !
























ABONNEZ-VOUS MAINTENANT
pour :




● Doubler votre productivité grâce à nos enquêtes spéciales sur des sujets majeurs.



Je souhaite recevoir une facture Je joins mon règlement par chèque






● Recevoir un magazine livré chez vous tous les 2 mois avec un contenu inédit.












● Prendre une longueur d’avance en découvrant tous les grands changements de votre filière.



Prénom :



















Le Sima se réinvente et revient aux fondamentaux.
Dans les grandes lignes, le salon du machinisme annonce plus de contenu, plus de convivialité et moins de dépenses pour les constructeurs.
Lecheminn’apasétéfacile.L’édition2022nefutpasàlahauteur denosespérances,carpasassez devisiteurs.Laresponsabilitéen revient à l’organisateur. Et nous n’avons passuréussirnotreEverest,organiserle Sima2024», reconnaît Damien Dubrulle, le président d’Axema. Le syndicat des constructeurs a présenté en décembre dernier la nouvelle mouture du salon, désormais baptisé « AgriSima ». La grandmesse française du machinisme agricole se tiendra en 2026, du 22 au 25 février, au parc des expositions de Villepinte (SeineSaint-Denis). Elle aura lieu, tous les deux ans, en même temps que le Salon international de l’agriculture, pour profiter d’une exposition médiatique maximale. La voilure a été réduite : elle s’étalera sur 150 000 m² et son coût global sera raboté de 30 %. Ses organisateurs recentrent également ses cibles : les grandes cultures et la polyculture-élevage. Ils visent 200 000 visiteurs et 1 200 exposants. L’objectif est de repartir sur des bases saines, en attirant de nouveau les visiteurs et les exposants. Les inscriptions n’ont pas encore été lancées, mais aucun grand nom du machinisme – y compris parmi ceux ayant tourné le dos à l’édition 2024 –, n’a dit « non » lors des premières consultations. « On leur faisait payer le chauffage! 8 € le mètre carré… Je n’avais jamais vu ça. Ça, c’est fini», s’étrangle Gaëtan Ménard, spécialiste des salons, cofondateur d’EspritMeuble, aux manettes de l’AgriSima avec Frédéric Bondoux, qui a notamment lancé le Salon des ETA. Le prix de la location sera réduit

de 20 % le mètre carré pour les exposants (avec par exemple une ristourne de 50 % sur la moquette). « Quand on met sur piedunsalon,onestquandmêmepayé parlesmarques,ilnefautjamaisl’oublier. Lacommunicationlesmettraégalement en valeur », souligne Gaëtan Ménard. « Nous avons besoin d’eux. 60% des visiteurs viennent pour les nouveautés », abonde Frédéric Bondoux.
Un salon sans grandes exclusivités
Conscients du rang de l’AgriSima dans la hiérarchie actuelle des salons dédiés au machinisme, les organisateurs ne s’attendent pas à bénéficier des dernières exclusivités. Ils comptent mettre en avant les machines dévoilées trois mois plus tôt lors de l’Agritechnica, à Hanovre (Allemagne). « C’est ce que l’on fait au Salon des ETA et cela fonctionne très bien», précise Frédéric Bondoux. « Ilfaut éviterdesemettreenfrontalavecd’autres évènements,c’estpérilleux.Legrosmarchéindustriel,c’estl’Allemagneetl’Agritechnica.EtlescomposantssontenItalie, avec l’Eima », ajoute Gaëtan Ménard.
Si les constructeurs jouent le jeu, reste ensuite à attirer les visiteurs, échaudés par une édition 2022 où s’acheter un sandwich virait vite à la foire d’empoigne. Un accueil spécifique sera déployé à la gare RER de Roissy-Charles-deGaulle, un café sera servi entre 7 et 9 heures, des animations et moments de détente auront lieu chaque soir entre 18 et 20 heures… « C’est aussi dans ces moments-là que l’on crée des relations et qu’on fait du business», assure Gaëtan Ménard. Côté restauration, une offre variée et importante sera mise en place, mettant en valeur les terroirs, avec pour modèle culinaire ultime le Sommet de l’élevage, où l’on peut s’offrir une truffade ou un aligot entre deux tractoristes.
Sans renier son ambition, le Sima renaît avec plus de pragmatisme et de proximité avec le terrain et ceux qui le font vivre. « Si on ne peut pas réaliser un salon d’envergure dans le secteur du machinisme en France, qui reste le premier pays agricole d’Europe, je ne vois pas où on peut le faire! » conclut Gaëtan Ménard. ■











































Périphériques de suivi des pesées et logiciels de gestion adaptés Ponts bascule de grande largeur de 3 à 3.5m spécial milieu agricole



































Avec Revystar® XL à base de Revysol® construisez un itinéraire agroécologique blé avec moins de traitements*, et avec des rendements optimisés :
Une HAUTE protection contre le complexe septoriose-rouilles en T2,
Une GRANDE adaptation de la dose à votre situation,
Une LARGE souplesse d’utilisation,
Une FORTE gestion des résistances et des modes d’action.


Et pour une protection sur mesure : l’OAD xarvio® FIELD MANAGER.





* selon les conditions de l’année, économie du T1 septoriose ou introduction de biocontrôle.
Ensemble vers l’agroécologie.
BASF France SAS - Division Agro – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex. Agrément n° IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. REVYSTAR® XL : AMM n° 2190686. Composition : 100 g/L méfentri uconazole (nom d’usage : Revysol®) + 50 g/L uxapyroxad (nom d’usage Xemium®). Détenteur d’homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Usages, doses conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou uww.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Crédits photos : Shutterstock. Septembre 2024.
REVYSTAR® XL : SGH07, SGH09 - ATTENTION - H302 : Nocif en cas d’ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.