
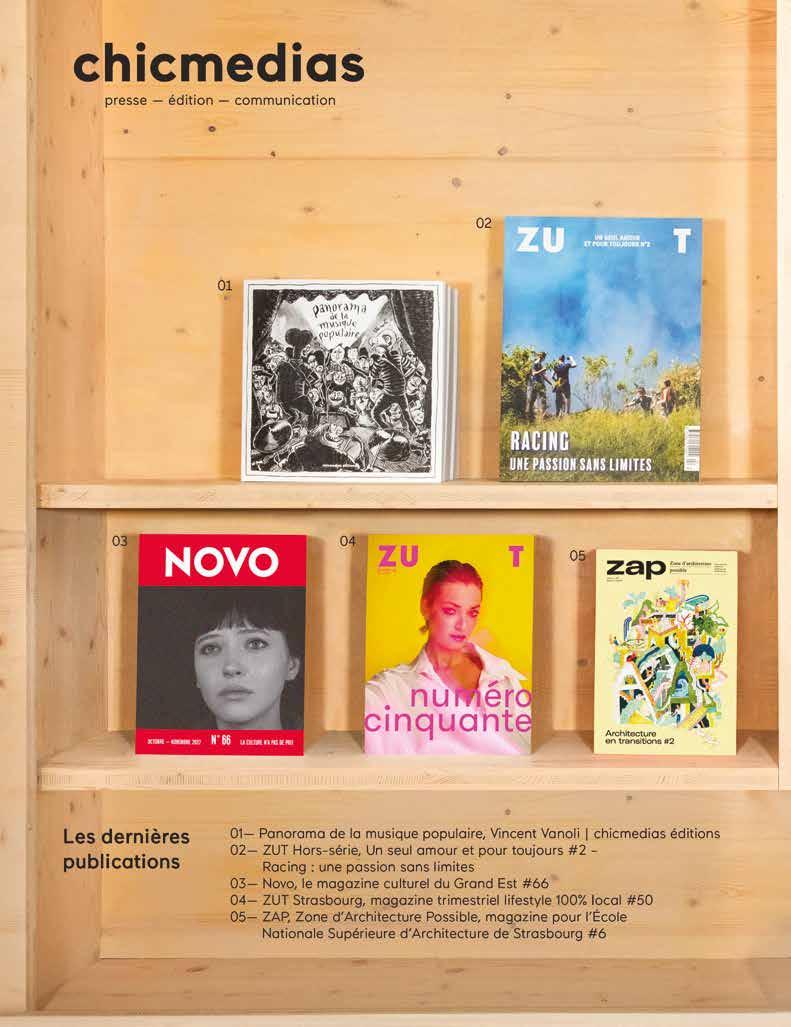


Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Martial Ratel, Mylène Mistre Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Aude Ziegelmeyer.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
Anna Karina dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard (1962)
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : octobre 2022
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2022
Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg
Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse
Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 € Hors France : 5 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
ÉDITO 7
JEAN-LUC GODARD ET ANDRÉ S. LABARTHE 8-11
FOCUS 13-40
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
ÉCRITURES 41-60
Les éditions Corti 42-49, Jean-Michel Maulpoix 50-51 , Michel Butel 52-53, Mark Z. Danielewski 54-55 , Brigitte Giraud 56-60
SCÈNES 61-74
Antoine Defoort et Sofia Teillet 62-65, Anne Théron 66-68 , L’Opéra-Théâtre de Metz 69-71, Élise Vigier 73-74
SONS 75-88
Le Noumatrouff 76-78, Renaud Sachet 79-81 , October Tone 82-83, Météo 84-85, Stéphane Grégoire 86-88
ÉCRANS 89-102
Le Festival du film italien de Villerupt 90-91 , Sarah Leonor 92-94, Entrevues 95-102
ARTS 103-110
La LAW 104-105, Tschabalala Self 106-107 , Charlemagne Palestine 108-110
IN SITU 111-124
Les expositions de l’automne
CHRONIQUES 126-138
Nicolas Comment 126-133, Stéphanie-Lucie Mathern 134-135 , JC Polien 136, Nathalie Bach 138
SELECTA
Livres 140 Disques 142
ÉPILOGUE 144
SOMMAIREOURS
WWW.NOVOMAG.FR 5

LE PLUS BEAU GÉNÉRIQUE DU MONDE
Par Philippe Schweyer
Je suis en train de me brosser les dents quand j’entends des coups contre ma porte. Ce doit être un imprimeur à cran qui vient me casser les rotules pour m’apprendre à honorer mes dettes. J’entrouvre malgré tout prudemment la porte. C’est le voisin du dessous qui a encore un problème existentiel :
— J’étais installé devant la télé en attendant Godard quand je me suis mis à pleurer. Je peux le regarder avec toi ?
— J’allais me coucher.
— Déjà ?
— Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.
— Les gens qui pensent que le monde leur appartient me font de la peine.
— Demain, je me lève de bonne heure…
— Au moins ta vie a un sens. Tu as de la chance.
— Ma ligne de chance. Ma ligne de chance. Dis-moi chéri ce que t’en penses ?
— C’est pas possible de chanter aussi mal ! Il te reste de la bière ?
— Tu devrais te calmer sur la bière. C’est quoi ton Godard ?
— Le Mépris
— Et ma bière, tu l’aimes ma bière ?
— Avec Godard, c’est toute une époque qui fiche le camp.
— À chaque fois, tu me dis ça…
— Plus rien ne sera comme avant.
— Il faut que tout change pour que rien ne change bla-bla-bla. Le Mépris, il faut le voir au ciné, pas à la télé. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse.
— La télé, c’est quand même mieux qu’un smartphone.
— Tu devrais te trouver un boulot au lieu de cogiter dans ton coin. Qu’est-ce que tu aimerais faire ?
— Je sais pas quoi faire… Qu’est-ce que je peux faire…
— Tu pourrais être livreur pour faire de l’exercice.
— J’aime pas l’idée de transpirer pour de l’argent.
— Alors serveur pour voir du monde.
— Je préfère servir à rien.
— Ou chauffeur routier ? Ça te ferait du bien de voir du pays.
— Le paysage m’ennuie.
— Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… Allez vous faire foutre ! Tu ne peux pas passer ta vie dans ton canapé.
— Je préfère ça que de me faire exploiter.
— Tu devrais penser à ta retraite. Ça te plaît d’être un vieux marginal ?
— La marge, c’est ce qui fait tenir les pages ensemble.
— Pas moyen de parler sérieusement.
— Les gens sérieux m’ennuient.
— L’ennui est contre-révolutionnaire. Tu devrais avoir un projet de vie. Te sentir utile, ça te ferait du bien.
— Pauvre type.
— Pauvre type toi-même !
— Alors ce Godard, on le regarde ? On va finir par rater le générique.
— Le plus beau générique du monde.
— Qu’est-ce que tu en sais ?
— Je le sais. Maintenant, tais-toi.
7

LE CINÉMA POUR PENSER L’IMPENSABLE Propos de Jean-Luc Godard et André S. Labarthe recueillis et mis en forme par Aurélien Bory et Yvan Schreck ~ Photo : Benoît Linder L’homme au cigare rencontre l’homme (au chapeau et) à la Gitane maïs. C’était à Strasbourg, un soir de décembre 94. Godard venait d’y montrer Allemagne année 90 neuf zéro, JLG/JLG, autoportrait de décembre, Histoire(s) du cinéma 3A, d’autres encore dont Lothringen! des Straub. Labarthe renvoyait la balle du fond du court. J.-L. G. dit : « Il faut parler. » Il faut, oui. 8
Mercredi 15 décembre 1994. Jean-Luc Godard et son ingénieur du son passent trois heures au cinéma L’Odyssée à Strasbourg, pour régler le son de la projection du soir. Films choisis et installés par ses soins. On ne pouvait mieux les voir, mieux les entendre. Jeudi 16 au soir, il se fait projectionniste de ses propres vidéos. Deux jours, six films inédits : Allemagne année 90 neuf zéro, Lothringen!, un film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, JLG/JLG, autoportrait de décembre, puis Histoire(s) du cinéma 3A, Deux fois cinquante ans de cinéma français, et Les enfants jouent à la Russie. Deux jours, deux débats et doubles parenthèses. Parenthèse de l’Allemagne, ou la place échouée de l’Allemagne en Europe. Parenthèse du cinéma, telle que l’explique André S. Labarthe dans Le Monde du 15 décembre, A.S.L. une fois encore à Strasbourg, répondant à l’invitation de son complice. Nous vous proposons ici quelques extraits de la rencontre publique, organisée à l’issue de la séance du mercredi 15.
Jean-Luc Godard : Allemagne 9-0 s’est fait parce qu’une dame voulait produire des films sur la notion de solitude… Et puis moi, je ne veux pas… Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de faire la solitude d’un individu, mais c’est de faire la solitude d’une nation, ou quelque chose qui s’est cru être une nation. J’ai proposé de faire la solitude d’une partie de l’est de l’Allemagne, pour ne pas dire l’Allemagne de l’Est. Après ce film, je propose une autre étude sur l’Allemagne, de nos amis, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Lothringen!. C’est un film difficile mais intéressant car si vous arrivez, au deuxième ou troisième plan, à passer le guet de la carte de géographie, vous vous dites : voilà un film où l’image ne sert qu’à recueillir un son d’autrefois, un son où la Lorraine était allemande et un son où une voix française dit qu’elle ne veut pas être allemande, c’est un film qui s’impose ce soir à Strasbourg. Vient ensuite un film qui s’appelle simplement Autoportrait de décembre, commandé par Gaumont, qui n’est pas une biographie. JLG/JLG est un autoportrait, chose qui me semble impensable à faire au cinéma, mais le cinéma est fait pour penser l’impensable donc je me suis dévoué.
Le cinéma est fait de plans. En tout cas pour moi. Il y a donc des avant-plans et des arrière-plans. Avec le son aussi il y a plusieurs plans sonores, avec une technique un peu rudimentaire comme le Dolby, qui permet d’utiliser ces différences de plans, et qui n’est pas seulement là pour faire passer des bombardiers. Il permet dans certains films de mieux associer le son à l’image ou de mieux les séparer, de faire que le son, ce qui est plutôt ma tendance depuis un moment, est plus grand que l’image, que l’image est toute petite, qu’à des moments ils peuvent être synchrones, et à d’autres pas. Il s’agit de faire passer un plan géométrique tout en recherchant quelque chose de
plus romanesque, de le faire sentir historiquement. J’essaie de faire en sorte que mes films puissent être entendus par les aveugles et vus par les sourds.
André S. Labarthe : Le son est peut-être une chose plus proche du corps. Dans les films de Jean-Luc, je trouve que le corps passe beaucoup par le son. Pas seulement les mots, mais aussi les bruits, tout l’espace sonore, on a l’impression de quelque chose à l’intérieur de soi. Cela ne passe pas par une sorte d’extérieur qu’est l’image. Le son est intérieur, ce sont les choses elles-mêmes qui vous touchent, l’image n’est que l’image des choses.
J.-L. G. : Oui, on a des intuitions, des formules, il y en avait une d’André Malraux qui disait : « On entend la voix des autres avec les oreilles et la sienne avec la gorge. » Ce sont deux plans différents, et le cinéma peut faire savoir qu’ils existent.
A. S. L. : Autre chose frappe. Par rapport au cinéma classique, prétendument appelé langage cinématographique, – un jeu de raccords, un personnage entre par la droite, sort par la gauche etc. –, on a là un cinéma de montage qui pulvérise tout ce cinéma, et qui obéit au jeu de Mallarmé : trois dés roulent et une combinaison sort. Dans Allemagne 9-0 par exemple, dans le plan où l’on parle de la jeune fille décapitée à la hache, on voit une rose et on entend une machine à écrire. Trois éléments sans aucun rapport.
J.-L. G. : Ils n’ont aucun rapport pour le spectateur. Mais le rapport existe. Sinon, je ne l’aurais pas trouvé, je ne suis pas assez fort. Là, c’est Hans et Sophie Scholl, et leur petit mouvement en 1942/43 qui s’appelait la Rose blanche. Ils ont été arrêtés alors qu’ils distribuaient, à l’université, des tracts tapés à la machine. Cela s’assemble et c’est la seule manière de faire. On pourrait aussi céder au lyrisme.
A. S. L. : Mais dans une école, cela ne peut pas s’enseigner, on est dans un cinéma qu’on ne peut pas enseigner.
J.-L. G. : On peut enseigner une certaine morale. L’histoire n’est jamais seule. Elle est peuplée de plein de vous et de moi, et elle est bien embêtée, parce qu’à certains moments, elle a envie de rester seule. Je suis assez hégélien. Je pense que l’histoire est seule et que le cinéma est un de ses meilleurs représentants. Il peut la raconter, lui rendre hommage. Mais s’il la montre, trop seule, trop documentaire et pathétique, sans règle, sans le talent d’un romancier comme Dostoïevski quand il raconte certains aspects de la Russie, il est à côté. Le cinéma, pour ça, est plus facile, mais uniquement si on arrive à s’y intéresser. Cela se fait au bout d’un moment. Étant enfant, j’ai été très influencé par le
9
Romantisme allemand. C’est Novalis ou le jeune Goethe qui m’ont fait connaître Sartre. Et après, mon amie Anne-Marie Miéville m’a fait remarquer que mon père était en Allemagne ; il n’en avait jamais parlé. Alors pourquoi l’Allemagne ? Il doit y avoir des choses inconscientes. À un moment, je me suis demandé : comment se fait-il que j’ai mis Don Quichotte dans le film ? Que vient-il faire en Allemagne ? On oublie que Charles Quint était roi de Madrid. Voilà ce que j’appelle l’inconscient cinématographique.
En tant que journaliste, j’ai toujours été ému par les pays et les choses dont on ne parlait plus. Des individus, il y en a tellement qu’on ne peut pas. Je suis même ému par Tapie car on n’en parlera plus demain, ou par Chirac parce qu’il essaie et n’y arrive toujours pas, alors je me dis, pourvu qu’il y arrive quand même un peu. Mais il y a trop de monde, on ne peut pas se souvenir de chaque automobiliste écrasé. Quant aux nations, on n’arrive plus à s’en souvenir. J’ai longtemps suivi le Vietnam, et aujourd’hui on n’en parle plus. Même chose pour la Palestine. Huit jours la Somalie, puis hop, c’est fini. Quand on n’en parle plus, cela me donne envie d’y aller. En Allemagne de l’Est, il y avait tous mes ennemis du cinéma, Yves Montand – je ne sais pas qui y allait pour tourner des films d’art, Resnais, tous ces voyous. Moi, je ne voulais pas y aller. Par contre, quand la vogue du tourisme a passé, j’y suis allé. Malgré tout ce qui avait été dit, on n’avait finalement rien dit ! Pourquoi a-t-on dit que le mur de Berlin s’est effondré en deux jours ? C’est exactement le contraire, on a mis deux jours à le construire, et il a mis quarante ans à disparaître. Il suffit d’aller voir, c’est cela que j’appelle une règle de conduite, et que le cinéma peut un peu amener, mais au bout de bien des erreurs. Cela ne s’enseigne pas, mais cela s’apprend.
J’aimerais savoir si certains d’entre vous ont passé le cap de la carte de géographie dans le film des Straub. Certains ont-ils apprécié ce film ?
Jean-Marie est Alsacien, il a déserté pour aller habiter l’Allemagne, il habite l’Italie aujourd’hui, c’est un Européen complet qui a beaucoup de mal dans le cinéma, qui a une grande rigueur. En même temps, je le trouve un peu ascétique, bien qu’il soit plein d’humour. C’est ce qu’on dit souvent aujourd’hui : on se limite trop pour ne pas perdre pied, et à des moments on se limite d’une manière excessive, difficile à suivre, aussi, pour le public.
Je me souviens d’un chauffeur de taxi, qui avait vu mes films, et qui m’avait dit : « Ouhlala, moi, je ne les aime pas tellement vos films. » Et moi je lui ai dit : « Mais la manière dont vous me conduisez jusqu’à la place de l’Alma, je ne la trouve pas terrible non plus. » Nous étions quittes.
Le film de Straub m’a frappé, car je me suis dit : moi, je me sers du son pour valoriser l’image, et pour lui, l’image est juste une bonne servante qui amène un son, et n’amène pas un son d’aujourd’hui
mais un son de plus de cent ans. C’est la première fois que je vois un film avec un son d’autrefois. J’entends un son, une espèce de pensée, de sentiment, qui ont dû exister dans cette région à ce moment-là. C’est très difficile de montrer autrefois. D’en parler, c’est quelque chose, mais de montrer… Alors, si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Chez moi, ça a pris, et je trouvais particulièrement bien de montrer cet autrefois ici, à Strasbourg. Mes films, c’est du présent et des mythes. C’est tout autre chose. Du reste, Jean-Marie n’est pas pour que son film et Allemagne 9-0 passent ensemble. Alors je lui ai dit : je ne vais pas les passer ensemble, je le passerai après. Avec Straub, la bande mono est une autre manière d’utiliser le son, uniquement sur la langue et la diction.
Je n’ai pas le sentiment de savoir inventer, mais j’ai le sentiment de savoir trouver les choses, et de les assembler. Et je ne suis pas du tout gêné de faire n’importe quel film, avec n’importe quoi. Vous me proposez un lacet de chaussures et un ver de terre, vous me proposez un budget qui est conséquent par rapport à ces deux choses, et je fais le film. J’ai toujours eu le sentiment de faire les films qu’on me demandait, c’est-à-dire, d’être très sartrien : « L’homme est ce qu’il fait de ce qu’ on a fait de lui. » Les films, c’est la même chose, je n’ai jamais rêvé de faire je ne sais quoi. Les citations ne me protègent pas, ce sont des amies. Ils ont créé des choses, pourquoi ne pas les utiliser ? S’il y a des arbres, pourquoi ne pas les filmer ? Si c’est une rue, si ce sont des gens, il faut en faire quelque chose. Ce n’est pas à moi, mais je peux en faire quelque chose. Il y a peut-être des droits d’auteur, on doit pouvoir les toucher, pourquoi pas ? Mais si on me demande : « Est-ce que je peux prendre un extrait, estce que j’ai le droit ? » Je réponds : non seulement tu as le droit mais tu as le devoir de le faire. Un bout de phrase vous aide à en construire un autre. Je n’ai inventé ni le verbe, ni le complément. Alors je m’en sers. C’est une merveille que d’avoir quelques jolies phrases à sa disposition, de pouvoir siffler un air de musique, qu’il soit de Mozart, ou de Gershwin, c’est une vraie merveille de penser aux gens qui les ont faits. Et je ne vais pas citer toutes mes références dans le générique, parce qu’à ce moment-là, ça devient autre chose, ça devient une connaissance livresque. C’est en vieillissant que je commence à avoir des idées de films à moi. Alors je me dis tant mieux. Delacroix disait aussi qu’il ne connaîtrait la peinture que lorsqu’il n’aurait plus de dents.
Je ne me suis jamais plaint de ne pas avoir de public. Je me suis plaint de ne pas avoir de techniciens ou de complices pour pouvoir faire équipe. Je crois que vous en demandez trop. Si je suis le public, je ne pose pas de questions au cinéaste, je pose des questions au film. Vous voyez un garçon et une fille dans une voiture qui disent : « La lumière durera toujours. » Vous voyez une rose, est-ce que cela vous gêne ou non ? Vous
10
pensez qu’il y a quelque chose à comprendre ou simplement, vous regardez et vous trouvez peut-être la rose jolie ? Qu’est-ce qu’on appelle comprendre ? Parfois, c’est le style qui m’intéresse. Par exemple, je ne comprends pas des phrases de Levinas ou de Michel Serres, alors que Bergson, je peux comprendre parce qu’il écrit bien. Cela compte aussi. Quand on regarde la publicité, on ne comprend rien. Quand je regarde le tennis, je vois BNP, et je me demande si c’est du tennis ou si c’est de la banque. On est dans une compréhension qui nous est forgée, très policière, très médiatique. Ensuite il y a une incompréhension. Vous ne comprenez pas votre amoureuse du premier coup. Alors si on critique le film, il faut voir ce que l’on aimerait mieux comprendre, et à quel moment on a fait des fautes. Les débats devraient servir à savoir à quels endroits on ne pouvait pas faire autrement que de faire des fautes, car on est humain. On est comme ce chauffeur de taxi. Il faut parler.
La vidéo, comme elle est devenue, est faite pour les truqueurs. Il y a pas beaucoup d’honnêtes gens qui s’en servent. On peut faire des essais, du journalisme, mais le journalisme ne s’y intéresse pas. On peut faire des éditoriaux, des moments d’histoire, des recherches, des carnets de notes, des gammes qui sont tout aussi belles. Les études de Chopin valent au moins ses concertos.
Mais le cinéma a du mal, comme disait Daney, à rester en prise avec une époque qui l’a pourtant nourri et voulu. Je me souviens, on ne demandait presque rien à Rossellini ou à Nicholas Ray, car la personne ne nous intéressait pas, seuls les films. Une fois, j’ai demandé à Rossellini : « Quand on reçoit de l’argent pour faire un film, est-ce qu’il faut tout dépenser ? » Je n’en avais pas encore fait. Alors Roberto m’avait dit : « La meilleure façon, c’est de faire des films qui se passent au Moyen Âge. Tout le monde, pendant la semaine, s’habillait juste avec des sacs de pommes de terre avec deux trous pour les bras et un trou pour la tête. Ne fais surtout pas de films qui se passent le dimanche, parce que là, ils portaient des beaux costumes. Le reste, tu le gardes pour toi et ta famille. » Et c’est ce que j’ai essayé de mettre en pratique. Je suis toujours étonné par les questions des gens. Il faudrait dire, non pas. « Que pensez-vous de la Yougoslavie ? » mais : « Moi, j’ai une idée pour que le problème s’arrange. »
Si on me demande pourquoi il y a des arbres dans mes films, je réponds qu’il y en a principalement dans la région où j’habite. J’ai quitté Paris parce qu’il n’y avait plus d’arbres.
Pourquoi l’Église ? Cela vient du cinéma. Le cinéma est occidental, l’idée de l’art est occidentale, l’idée de l’image également. Et c’est venu principalement à travers l’Église. Longtemps j’ai essayé de savoir ce que pouvait dire la phrase de saint Paul : « L’image viendra au temps de la résurrection. » Alors effectivement, ce que saint Paul entend par l’image, ce n’est pas la même chose que ce qu’entend Anne Sinclair quand elle fait « 7 sur 7 ».
Hélas, on dérive vers la culture. L’Europe de la culture veut la mort de l’art. Il y avait un endroit en Bosnie, où des musulmans s’entendaient avec des Turcs et des Serbes. C’est assez rare, et c’est ce qu’on peut appeler l’art de vivre. Eh bien, l’Europe de la culture veut la mort de cet art de vivre. Aller au cinéma, c’était faire de la critique, à la différence de vous. Ensuite, en parler entre nous, c’était faire du cinéma. Alors, avant de faire un film, on avait déjà fait dix ans de cinéma. Aujourd’hui, on dérive sur la banquise culturelle et on ne fait plus de cinéma. Voilà la différence. Si j’écris un article, si je fais un dessin, ou si je fais de la vidéo, je fais du cinéma. Dans ma tête, je m’en fais constamment. Et j’ai demandé à André de venir pour avoir l’impression d’en faire en bavardant dans un bistrot, car ce soir ce qui me manque, c’est que l’on ne fait pas de cinéma. Mon idée, c’est que le cinéma s’est arrêté complètement, son destin était programmé, André s’explique très bien dans son article du Monde
Il parle de la parenthèse. Lumière, parenthèse d’un siècle, belle parenthèse, qui s’est fermée à l’époque des camps où le cinéma de fiction n’a pas récupéré son frère le documentaire. Abel n’a pas récupéré Caïn, ou inversement. Le documentaire : quelques maigres actualités qui ont sauvé l’honneur de l’enregistrement du réel, quelques maigres actualités dont on ne fait rien.
Donc le cinéma n’a servi à rien, il n’a rien fait et il n’y a eu aucun film. On a dit « plus jamais ça », mais le film de Resnais sur les camps, on ne le passe plus.
Comment se fait-il qu’entre un mauvais film norvégien et un mauvais film américain, on préfère aller voir le mauvais film américain ? Eh bien, il ne faut pas s’étonner. On vit dans ce mondelà, qui n’est pas le nôtre, pas entièrement, pas complètement. Enfin voilà, bonsoir et merci.
Cet entretien, publié initialement dans la revue LimeLight, est extrait du livre d’André S. Labarthe à paraître aux éditions Chicmedias.
11
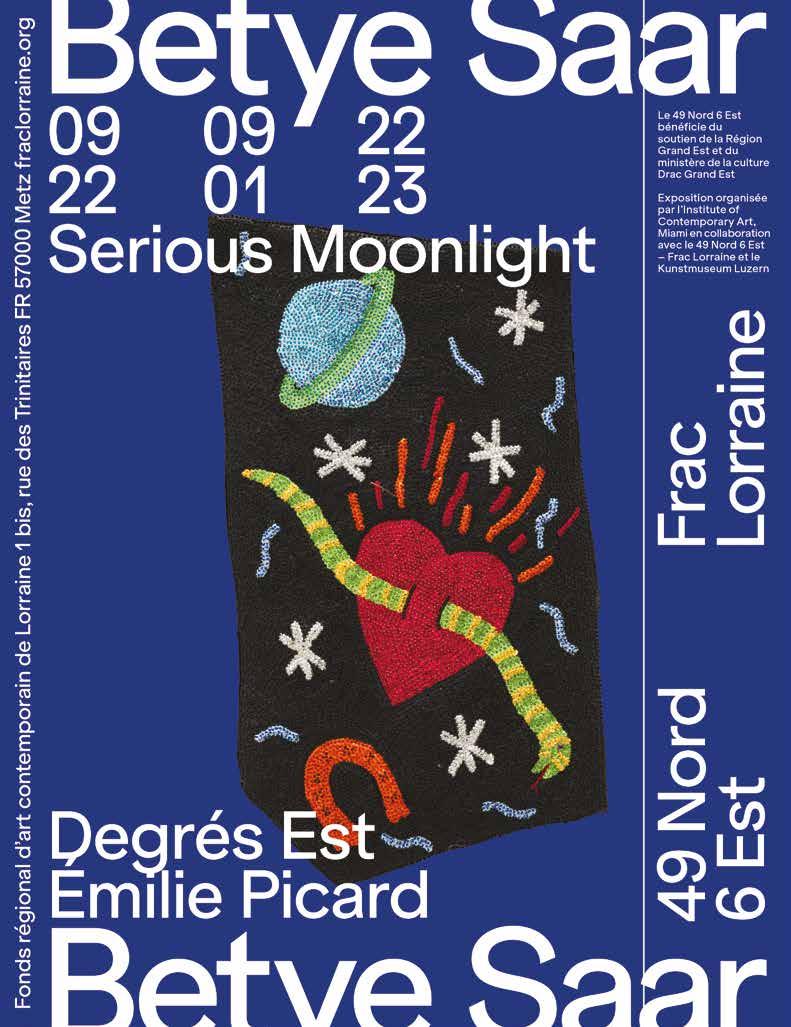
f oc- u s
focus
Ressources naturelles
On ne construira plus demain comme nous l’avons fait hier. Étalement des cités excessif, bétonisation à outrance, délires urbanistiques, problèmes énergétiques… S’ajoute aujourd’hui l’épineuse question de l’insuffisance de matériaux. Muni de son appareil, Alnis Stakle s’est intéressé aux mutations en cours dans les métropoles chinoises, répondant ainsi à la thématique d’Archifoto (co-organisé avec la MEA) : Architecture et ressources, du 23 septembre au 13 novembre. L’exposition inaugurale de la nouvelle saison de La Chambre rassemble les cinq photographes lauréats du concours. (E.D.)

www.la-chambre.org
Bonnie & Clyde
Sailor & Lula. Lee & Nancy. Serge & BB. Tout au long des douze pistes du disque de Danicher, un tandem file (le grand amour) sur les routes du soleil : Les Amants du Midi (édité par La Souterraine) quittent le Grand Est pour le sud, vivre la belle vie « sans peur du lendemain »… jusqu’au moment où l’escapade se gâte, le ciel radieux se couvre de nuages orageux. (E.D.) danicher.fr

À fond la forme !
Collection d’affiches issues du fonds du Signe à Chaumont, expo de travaux d’élèves de la Haute École des arts du Rhin, conférence organisée par L’Espace Gutenberg strasbourgeois ou en compagnie du directeur de l’Atelier national de recherche typographique de Nancy… Rencontres et expositions sont au programme de FORMAT(S) (proposé par Central Vapeur et Cercle Studio du 6 au 9 octobre), festival dédié au design graphique dans les ateliers de la COOP et autres lieux de Strasbourg. (E.D.)
formats-festival.org
 Pochette du CD
Alnis Stakle, Neither Horse nor Tiger
Pochette du CD
Alnis Stakle, Neither Horse nor Tiger
Banner, A5, FORMAT(S)
14
Objectif boule

À quoi ça sert la frite si t’as pas les boules ? Si vous aimez les parties de pétanque interminables, le rosé, la bière et les amis. Si vous rêvez de découvrir un endroit hors du temps aussi sympa qu’un camping familial en bord de mer, mais planqué le long d’une voie ferrée. Alors, vous allez adorer l’expo photo de Philip Anstett, Pierre Chinellato et Jean-Michel Hauger dans le local de l’Union bouliste mulhousienne, 29 rue des Machines à Mulhouse (ouvert les mardis et samedis de 14 h à 19 h). (P.S.)
ubmulhouse.e-monsite.com
Série limitée
Depuis 2017, le festival Microsiphon accueille des artistes illustrateurs, sérigraphes et autres graphistes de toute la France mais aussi d’Allemagne, de Belgique et de Suisse, afin de mettre à l’honneur la micro-édition sous toutes ses formes. Trois jours de rencontres et de fête avec expositions, ateliers plastiques, concerts et DJ sets dans une convivialité à toute épreuve. (A.V.)

— MICROSIPHON #6, festival du 7 au 9 octobre au centre-ville de Mulhouse et à Motoco
www.microsiphon.net
15 min chrono
« Refaire le monde », c’est le thème de la sixième édition du Festival de micro-théâtre : pendant trois jours, douze compagnies du Grand Est viendront présenter quinze créations originales de quinze minutes, pour quinze spectateurs dans un espace de quinze mètres carrés ! Soit plus de 150 représentations, avec en prime des ateliers d’initiation au théâtre, un marché de créateurs et une grosse bamboche le samedi soir, avec quatre DJ qui se succéderont non-stop jusque 3 h du mat’. (A.V.)
— FESTIVAL DE MICRO-THÉÂTRE, festival du 14 au 16 octobre à l’ancienne usine DMC, à Mulhouse
www.compagniekalisto.org
 Paul Dunca,
Photo : Pierre Chinellato
Paul Dunca,
Photo : Pierre Chinellato
Waiting © Emilia Pria focus
11 states of a hole © The Pit
15
Theo Hakola
La Maison de l’Architecture de Franche-Comté organise à nouveau des séances de ciné-concerts avec l’immense Theo Hakola autour du film de Julien Duvivier Au bonheur des dames. Après une date le 13 octobre au cinéma Eldorado à Dijon, le chanteur et son band se produiront le 14 octobre à la Filature de Ronchamp (sous la Bulle, structure gonflable pour des concerts et divers spectacles) et le 15 octobre à Métabief (dans le Haut-Doubs). (P.S.)

www.maisondelarchi-fc.fr
Rejouer Figure imposée
Coincé entre Play Blessures et Passé le Rio Grande, l’album Figure imposée de Bashung (1983) n’a pas pris une ride. Le guitariste et chanteur Pascal Jacquemin, qui a participé à la genèse de l’album dont il cosigne presque toutes les paroles, s’est entouré de son fils Basile (son partenaire dans Gram_Pass) et de la fine équipe qui accompagnait le chanteur lors de ses dernières tournées (Arnaud Dieterlen, Bobby Jocky et Yan Pechin) pour rejouer sur scène l’intégralité des titres (« What’s in a bird », « Élégance », « Imbécile »…) en invitant quelques guests : Chloé Mons, Rodolphe Burger, Fred Poulet… Mais vous savez sans doute tout ça mieux que moi. (P.S.)

Concert à l’ED&N de Sausheim (68) le 1er décembre (avec un film de Fred Poulet à base d’archives).
 Photo : Dorian Rollin
©Zélie Noreda
©Zélie Noreda
Photo : Dorian Rollin
©Zélie Noreda
©Zélie Noreda
focus
16
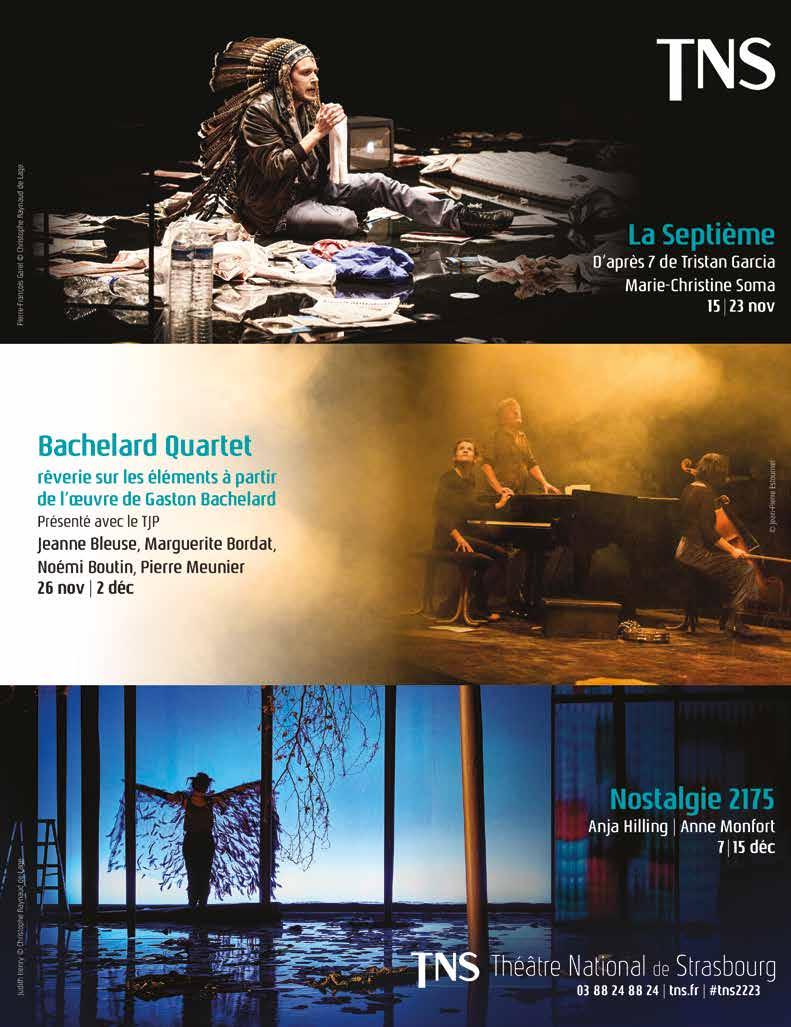
La beauté du diable
Rarissime, pas mal comme épithète en matière d’opéra. Quand les plus blasés des aficionados feuillettent les partitions avant même les premières mesures d’ouvertures. Rarissime, on apposera donc l’adjectif sur la meilleure des résurrections depuis celle des passions made in Bach. Ici, pas de bras en croix, c’est une œuvre qui ressuscite. Un opéra caché par son géniteur même. Lui est italien, compositeur et créateur en renaissance, qui vient de signer un fantasque Macbeth en 1847 et a déjà en tête quelques lignes de Rigoletto. L’autre est une œuvre contemporaine de l’époque, sonne du Strindberg mais éclos dans l’Italie du milieu du xixe . Stiffelio, il s’agit de cela, est un récit d’adultère, laissé pour mort par Verdi. Retiré de l’affiche, censuré, presque auto-détruit mais pourtant adulé pour le velouté lucide en diable de sa partition. Une histoire de pasteur révélé à lui-même par l’adultère de Lina, sa femme adorée, un récit d’homme à l’arrogance aussi ferme que le zèle, en proie à un corps défendant et à une âme qui hésite entre gris clair et gris foncé. L’Italie n’est pas prête pour de tels coins enfoncés dans la tradition catholique par le livret de Francesco Maria Piave. La partition de Verdi attendra donc 1992. Stiffelio sortira des autographes découverts dans ses archives. Verdi attendra 2021, la mise en scène efficace de Bruno Ravella et cette coproduction Opéra du Rhin-Opéra de Dijon pour voir renaître au jour ce combat entre le pardon et la vengeance dans un seul homme. Sujet rebattu pour une œuvre rare.
Par Guillaume Malvoisin
— STIFFELIO, opéra du 20 au 24 novembre à l’Opéra de Dijon, à Dijon www.opera-dijon.fr

#Shakespeare
Pour sa réouverture, le CDN Besançon FrancheComté s’engage. Sous la direction de Célie Pauthe, les jeunes comédien·ne·s de la promotion DEUST Théâtre de l’Université de FrancheComté rejoueront Comme il vous plaira , une œuvre majeure de William Shakespeare écrite aux alentours de 1599. Rosalinde, fille du duc banni, et sa cousine Célia, fille du nouveau duc, fuient l’insoutenable vie à la cour et se réfugient dans la forêt d’Ardenne. Dans ce lieu peuplé de « cerfs et de lions, de bergers et bergères, de ducs et seigneurs bannis philosophant à l’ombre des chênes », les deux cousines, pour se prémunir de toute agression, se couvrent de vêtements d’homme. Sur son chemin, Rosalinde, qui désormais se fait appeler Ganymède, rencontre un certain Jacques, poète mélancolique et « militant écologiste », et retrouve son ancien amour perdu, Orlando. La reconnaîtra-t-il ? Ou peut-être Orlando va-t-il succomber aux charmes de Ganymède, dont les traits lui rappellent ceux de sa chère et tendre disparue. Entre questionnements environnementaux et identitaires, l’œuvre originelle se fait, 400 ans plus tard et plus que jamais, l’écho de l’actualité. Climatoscepticisme, homosexualité, trouble du genre sont abordés sous le prisme de ces quinze artistes imprégnés des bouleversements socio-idéologiques de l’époque contemporaine. Comme il vous plaira [Fragments] , une comédie shakespearienne narrant les soubresauts de notre temps.
Par Lucie Chevron
— COMME IL VOUS PLAIRA, théâtre les 4 et 5 novembre, et le 10 décembre au Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté www.cdn-besancon.fr
 Comme il vous plaira [Fragments] – Célie Pauthe, en collaboration avec Marie Fortuit, sur un texte de William Shakespeare
© Klara Beck
Comme il vous plaira [Fragments] – Célie Pauthe, en collaboration avec Marie Fortuit, sur un texte de William Shakespeare
© Klara Beck
focus
18

Entrer dans la légende
Leur nom est chargé de mystère – leur musique aussi. Mené par la parolière et chanteuse Janine Cathrein, le sextet de Black Sea Dahu nous vient tout droit de Zurich, mais nous emmène loin, très loin des montagnes suisses… Quelque part, perché entre l’obscurité et la lumière, entre les profondeurs abyssales d’un océan infini et l’immensité démesurée d’une nuit sans Lune. Car avec eux, tout chamboule ‒ la folk sauvage, la voix suave, la liberté dans chaque note, la poésie dans chaque parole. Et puis la mélancolie, partout, comme une douce enveloppe pour chaque morceau de leurs deux albums – White Creatures en 2018, et le petit dernier I Am My Mother, sorti plus tôt cette année. Alternance de riffs noisy et d’émotions pures et non raffinées ‒ une caresse pour tes oreilles, un tsunami pour ton cœur, un uppercut pour ta joue droite. Et puis il y a aussi ce nouvel EP, Orbit, prévu pour la mi-novembre, un opus annoncé comme cinématographique, dans lequel la frontwoman examinera « le carnage provoqué par une vie qui l’a choisie ». Un disque qui s’annonce lourd, sur la vie, la mort, la dépression et la rédemption aussi, mais également d’une puissance émotionnelle quasi sans limites. Si vous avez des frissons le 19 novembre à La Rodia, dites-vous bien que ça ne sera sans doute pas parce qu’il fait froid.

Par Aurélie Vautrin
— BLACK SEA DAHU, concert le 19 novembre à La Rodia, à Besançon ; et le 20 novembre à La Poudrière, à Belfort www.larodia.com poudriere.com
A bigger band
Vous avez manqué leur venue lors du Festival Détonation à La Rodia en septembre ? Pas de panique, Bigger and the Damned Dozen organisent une session de rattrapage au Moloco à la fin du mois d’octobre ! Derrière ce nom de groupe façon Quentin Tarantino, il y a la rencontre entre les cinq dandys de Bigger et douze musiciens du conservatoire de Besançon, le tout sous la houlette de Larry Mullins, batteur des Stooges et membre des Bad Seeds de Nick Cave. Vous avez dit explosif ? Et encore vous serez loin du compte, tant l’armada de cordes, de cuivres, de percussions, vibraphones, castagnettes et autres gongs donne une puissance astronomique aux compos de ce groupe franco-irlandais sur lequel on garde un œil depuis la sortie de leur premier album en février dernier. Il faut dire que sur scène, les cinq potos ont pris l’habitude de sonner leur public comme des catcheurs sur un ring, avec des prestations intenses, fiévreuses et furieusement rock’n’roll… Alors avec le magicien Larry Mullins à l’orchestration et pléthore d’instrus à leurs côtés, imaginez bien que l’univers foisonnant et l’énergie débridée de Bigger prennent encore de nouvelles dimensions. Ce qui confirme, s’il le fallait encore, que l’on tient bien là un groupe à suivre de près.
 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin
— BIGGER AND THE DAMNED DOZEN, concert le 22 octobre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com
Black Sea Dahu © Paul Maerki
Bigger © Francois Guerry
focus
20

Toutouyoutou
Coaching de Valeria Giuga, compagnie Labkine, dénonce avec humour la fascination des sociétés contemporaines pour les recettes de développement personnel, orientées vers l’esprit autant que vers le corps. Dans un environnement asservi à la notion de performance où l’individu ne serait pleinement accompli qu’avec un corps harmonieusement sculpté et des pensées positives, Coaching remet en perspective l’injonction de course au bonheur, et surtout de consommation, portée par les sociétés hautement industrialisées. Le quatuor de danseurs joue avec les mots, les gestes et le public dans des costumes graphiques et colorés évoquant ceux de Philippe Guillotel dans True Faith de New Order et par métonymie ceux d’Oskar Schlemmer. Valeria Giuga a rejoint Labkine en 2016 avec un projet innovant et engagé puisant sa matière dans les sources écrites de chorégraphes célèbres et dans les principes fondamentaux du système d’analyse du mouvement développé par Rudolf Laban. Elle traite la danse comme un texte et se nourrit de partitions d’écriture chorégraphique dans lesquelles se mêlent les mots et le mouvement. Pour chacune de ses pièces, elle s’associe à un auteur contemporain, ici à la poésie contemporaine d’Anne-James Chaton, et questionne cette représentation contemporaine de la gymnastique en l’opposant à la façon dont les pédagogues allemands l’imaginaient au début du siècle dernier.
Par Valérie Bisson — COACHING, danse le 3 novembre à Viadanse, à Belfort www.viadanse.com
Poèmes (super) soniques

Cela fait déjà un petit moment que l’on entend résonner les mélodies groovy de Lewis OfMan dans toutes les bonnes soirées qui se respectent ‒ à peine majeur, le minot affichait déjà une liste de remix et autres collabs longue comme le bras, avec Keziah Jones, Vendredi sur Mer, Alt-J, Phoenix, Rejjie Snow, Lana del Rey ou The Pirouettes pour ne citer qu’eux. Rapidement, sur son front, l’étiquette du « surdoué français de l’electro » ‒ une étiquette que le compositeur, musicien, chanteur et producteur arbore toujours avec un sourire amusé joyeusement déconcertant. Aujourd’hui, à 23 ans et les sunlights braqués sur lui, le dandy cool autodidacte a (enfin) sorti un premier album, Sonic Poems, en février dernier. Un disque qui sent bon les vacances et la bamboche – mais pas que, car ici les cases explosent comme des bulles de champagne, chaque poème sonique-sonore a son propre mood, tantôt coloré, pétillant et joyeusement décomplexé, tantôt contemplatif, à la cool ou bien énervé, avec en prime, un petit côté dynamiteur pop délicieusement mutin et furieusement salvateur. Autant d’invitations frénétiques à enflammer le dance floor jusqu’au bout de la nuit – avec toute l’euphorie et les moments d’accalmies qu’une virée nocturne in Paris peut engendrer. La French Touch a finalement de bons jours devant elle.
 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin
— LEWIS OFMAN, concert le 26 octobre à La Poudrière, à Belfort www.poudriere.com
© Frédéric Iovino
Lewis OfMan © Écoute chérie
focus
22

Délicieuse étrangeté
Le Cartoonmuseum de Bâle consacre une rétrospective à l’autrice Gabriella Giandelli. Dans les années 1980, elle est l’une des figures du renouveau de la bande dessinée italienne avec ses dessins en noir et blanc et sur cartes à gratter, contant des histoires sombres où l’expressivité du trait prend déjà le pas sur la parole. Plus tard, elle élabore une esthétique qui deviendra sa marque de fabrique : des couleurs pastel contrastant avec des scènes étranges, magiques et surréalistes, remarquablement composées. Dans ses livres Interiorae (2005) et Lontano (2019), on retrouve ses thèmes de prédilection : l’isolement de l’individu au sein de la grande ville, la mélancolie, la solitude, la perte du sens des réalités. Dans son dernier roman graphique, Mirabile Bestiarium (2022), apparaissent des paysages urbains où l’homme semble avoir été brutalement éclipsé, laissant encore des traces de sa présence. Les animaux ont pris le pouvoir : cigognes de la taille d’une pièce de monnaie, escargots et chiens gigantesques peuplent désormais la ville. On retrouvera aussi au Cartoonmuseum une série de dessins du « Travel Book » réalisé pour Louis Vuitton et consacré à l’Australie. Également autrice de livres pour enfants et illustratrice pour Vanity ou The New Yorker, Gabriella Giandelli propose une poésie entre rêve et cauchemar, délicate et insidieuse.

Par Benjamin Bottemer
— GABRIELLA GIANDELLI jusqu’au 30 octobre Cartoonmuseum Bâle

Grandes rencontres
Faire se rencontrer auteurs et lecteurs sur les routes de BourgogneFranche-Comté, c’est le principe du festival littéraire itinérant Les Petites Fugues depuis plus de vingt ans. Chaque année, une vingtaine d’écrivains sillonne ainsi la région pour échanger avec le public, dans les bibliothèques et les librairies, dans les collèges et les lycées, mais aussi en maison d’arrêt, à l’hôpital ou au cœur d’espaces inattendus – comme une brasserie artisanale, une ferme, un bistrot-dortoir, d’anciennes forges… Parmi les 22 auteurs et autrices de tout bord qui partiront à l’aventure du 14 au 26 novembre prochain, on citera pêle-mêle Jean-Baptiste Andrea, Éric Pessan, Emmanuelle Favier, Guillaume Nail, Vanessa Bamberger, Thomas Flahaut, Marie Pavlenko… Avec notamment au programme de cette 21e édition un grand entretien avec Andreï Kourkov à la Maison des sciences de l’homme et de l’environnement à Besançon et une carte blanche à Agnès Desarthe sous le chapiteau de l’Odyssée du cirque. Des entretiens croisés viendront ponctuer la programmation, avec notamment des rencontres entre un auteur et son éditeur, pour tenter de « donner à voir la fabrique de l’écriture à travers ce lien si singulier ». À noter que la clôture du festival se déroulera au Musée des BeauxArts et d’Archéologie de Besançon, lors d’une grande déambulation littéraire mêlant les voix des auteurs aux collections du musée. Voilà qui donne envie de tenter le voyage…
Par Aurélie Vautrin
— LES PETITES FUGUES, festival itinérant du 14 au 26 novembre en Bourgogne-Franche-Comté www.lespetitesfugues.fr
Agnès Desarthe © Dante Desarthe
Gabriella Giandelli, « Rhabdornis inornatus », Mirabile Bestiarium, Christoph Merian Verlag, 2022
focus
KALEIDOSCOPE, exposition
au
de
www.cartoonmuseum.ch
24

Une chambre à soi
Présenté au Théâtre de la Sinne dans le cadre des Nuits de l’Étrange organisées chaque rentrée par La Filature de Mulhouse, Buchettino, fable acoustique inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault, est un classique du théâtre de l’enfance et de la compagnie Societas. Créé en 1995 par Chiara Guidi, Buchettino est une expérience sonore immersive toute particulière. Dans des conditions scéniques évoquant l’atmosphère des histoires du soir, dans la pénombre d’une chambre en bois, une conteuse, éclairée par une simple ampoule, raconte les vicissitudes de Buchettino auxquelles font écho les bruissements de la forêt, le martèlement des bottes de l’ogre, les chuchotements des enfants. Intériorité réconfortante et extérieur menaçant se répondent dans cet espace du milieu, celui du corps, des sens et surtout de l’ouïe. La chambre reproduit un mouvement émotionnel oscillant entre la statique interne de sa propre place et la dynamique externe des sons qui, par nature, traversent les murs. Écoute et obscurité créent la condition de l’intimité et établissent un sentiment unique, celui de l’« être-ensemble ». Terre du milieu, l’enfance reprend sa capacité à sentir et à expérimenter la parole aux confins du langage, juste là où elle se mêle et se soude à celle des animaux, des ogres et des esprits ; à cet endroit tout proche de la corporéité, du poids réel des choses.
Par Valérie Bisson
— BUCHETTINO, théâtre les 28 et 29 octobre au Théâtre de la Sinne, à Mulhouse


— LES NUITS DE L’ÉTRANGE, soirées du 29 et 30 octobre à la Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
Retour à Reims
Pauline Bureau signe le texte et la mise en scène de Féminines, odyssée en forme de match de foot. D’une kermesse à Reims en 1968 à la Coupe du monde de football en 1978, onze femmes vont écrire un épisode décisif, de leur vie et de l’histoire mondiale du sport, totalement passé sous silence… Récompensée par le Molière de l’autrice francophone vivante, Pauline Bureau a nourri son spectacle de témoignages d’ouvrières, secrétaires, étudiantes ou mères au foyer afin de retracer l’aventure de femmes issues de tous milieux et d’en extraire les contours d’une aventure collective sur fond d’émancipation et de lutte contre le déterminisme social. Dans les années soixante, pour la kermesse du journal L’Union, le journaliste Pierre Geoffroy fait passer une petite annonce pour un match de foot féminin. À sa grande surprise, beaucoup de femmes se présentent. Mais c’est quand il les voit jouer qu’il est le plus étonné. Il y a une liberté immense sur le terrain et sont volontaires corps et âmes. L’équipe de Reims devient équipe de France et gagnera la Coupe. Dans une mise en scène exigeante, qui ne perd pas de vue l’humour énergique et portée par un texte engagé, Pauline Bureau convoque images d’archive et procédés numériques pour emmener comédiennes et footballeuses professionnelles sur un terrain où elles se disputent le ballon et la virtuosité de leur langue.
Par Valérie Bisson
—FÉMININES, théâtre le 21 octobre à La Coupole, à Saint-Louis www.lacoupole.fr
© Marjolaine Grenier
Féminines © Pierre Grosbois
focus
26
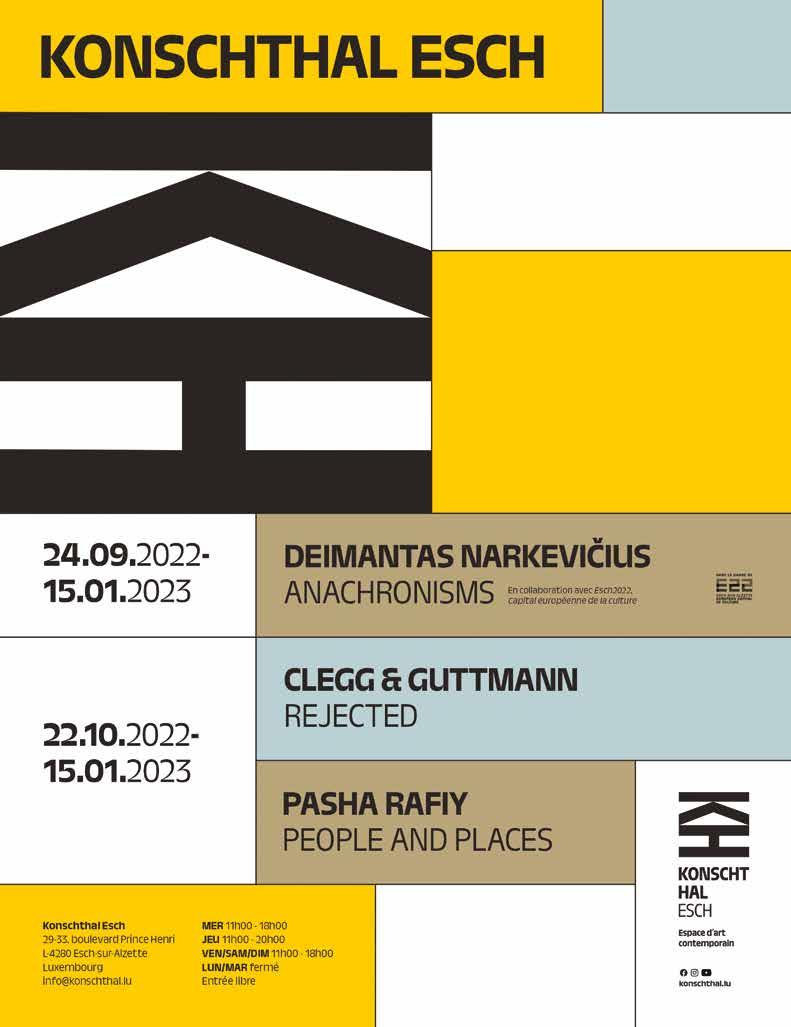
Avec tambour et clarinette
Roulement de Tambour ! L’invité d’honneur de cette nouvelle édition d’Augenblick, festival du cinéma germanophone en Alsace, n’est autre que le grand maître Volker Schlöndorff, réalisateur du Neuvième Jour, de Coup de grâce ou de Baal, personnage brechtien interprété par l’immense Rainer Werner Fassbinder ! Schlöndorff : un convive de marque – qui sera présent à Mulhouse et Strasbourg – oscarisé et césarisé. On souhaite un destin semblable aux nombreux cinéastes présents lors de cet événement porté par le RECIT, dirigé par Stéphanie Dalfeur. La compétition de longs métrages rassemble le cinéma actuel d’Outre-Rhin dans ce qu’il a de « plus original et novateur », affirme Sadia Robein, programmatrice (avec Eva Knorr). Et de citer Rimini d’Ulrich Seidl, sacrée « personnalité » qui a réalisé un alléchant film suivant « un ancien chanteur de schlager sur le déclin » fortement alcoolisé, contraint de chanter (et se prostituer) pour des touristes retraités italiens adeptes de variétoche… et de sexe tarifé. Just a gigolo ? Non, une histoire familiale poignante sur fond de chronique sociale. Parmi la sélection de documentaires, évoquons l’hallucinant Mutzenbacher de Ruth Beckermann qui filme une centaine d’hommes de 6 à 66 ans lisant un texte pornographique face caméra. « Nous nous permettons une grande liberté avec une programmation ambitieuse, qui ne met pas seulement des pointures en avant », insiste Sadia Robein. Si Douglas Sirk est mis en lumière cette année, focus est fait sur sa période la plus méconnue, soit celle de ses films allemands, avant sa carrière américaine : La Fille des marais de 1935 ou La Neuvième Symphonie beethovénienne de 1936. Nouveauté cette année : une compétition de courts métrages sélectionnés par Olivier Broche, ancien Deschiens toujours cinéphile. Notre coup de cœur : le ciné-concert haletant de Jean-Marc Foltz (clarinette) et Eliot Foltz (batterie) sur Cours, Lola, cours de Tom Tykwer. Hypnotisch !
 Par Emmanuel Dosda
Par Emmanuel Dosda
— AUGENBLICK, festival du cinéma germanophone en Alsace du 8 au 25 novembre dans les cinémas indépendants d’Alsace festival-augenblick.fr
Rimini de Ulrich Seidl
focus
28

La science des rêves

À partir de plusieurs textes de Robert-Louis Stevenson, que l’on ne connait que trop peu pour son Île au trésor, la metteuse en scène Nora Granovsky et le duo Fergessen ont imaginé un voyage électro-pop, Stevensongs, rythmé par les récits fantastiques de l’auteur écossais. Les deux musiciens compositeurs et interprètes, David Mignonneau et Michaëla Chariau, entrent en scène avec une matière puisée dans les recueils de poèmes, de correspondances et autres récits de l’écrivain-voyageur : Jardin de poèmes enfantins, Underwoods, Ballads et Chants du voyage. Chansons délicatement folk, beats synthétiques et volutes électro se superposent pour venir un peu plus faire tomber les frontières entre les représentations communes du monde réel et les contrées de l’inconscient… « Car aucun homme ne vit dans la vérité du monde extérieur parmi les sels et les acides, mais dans la chaude pièce fantasmagorique de son cerveau, là où les fenêtres sont peintes et les murs historiés... » Grand voyageur, Robert Louis Stevenson était aussi familier des contrées lointaines de l’imaginaire et cette exploration sonore parvient à aiguiser nos sens tandis que notre imaginaire peut se permettre de galoper dans des contrées sans limites. Une belle et lumineuse rencontre entre les arts scéniques, la musicalité d’une langue maîtrisée et ses résonnances exploratoires qui s’inscrit dans le cadre du salon du livre de Colmar.
Par Valérie Bisson
— STEVENSONGS, concert le 26 novembre à la Comédie de Colmar www.comedie-colmar.com
Trésors d’inventivité
Deux semaines consacrées au jazz dans toutes les directions, aux monstres sacrés, aux jeunes pousses qui réinventent tout, au dynamisme de la scène française et à nos précieux talents régionaux : voici le festival Jazzdor à Strasbourg. En ouverture, histoire de mettre tout le monde d’accord, l’équipe a convié Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke et Eric Harland, pour de purs moments d’interplay au son de la musique joueuse et voyageuse d’Aziza. Le percussionniste Kahil El’Zabar a aussi beaucoup voyagé : cet explorateur infatigable de la black music fera surgir l’Afrique en pleine lumière, du gospel au jazz en passant par le funk ou le rhythm’n’blues.
On ne ratera pas non plus la vocaliste « multi-timbrée » Leïla Martial, ici sur le FiL avec le violoncelliste Valentin Ceccaldi, ou la paire Émile Parisien / Theo Croker en sextet, qui nous a offert le superbe album Louise cette année. Il y a aussi cette soirée en forme de kaléidoscope, Black Lives : From Generation to Generation, un big band quelque part entre États-Unis, Afrique et Caraïbes pour accompagner une génération militante. Sans compter que les curiosités ne manqueront pas à Jazzdor : un hommage à Gato Barbieri, le rythme frénétique des mazurkas polonaises de Lumpeks, le trio de Roberto Negro qui fricote avec l’Ensemble intercontemporain, les loustics azimutés de Coccolite accompagnés de toutes les jeunes pousses du dispositif Jazz Migration... et en plus la moitié des soirées sont gratuites. Venez ouïr sans entraves.
Par Benjamin Bottemer — JAZZDOR, festival du 4 au 18 novembre à Strasbourg www.jazzdor.com
 FiL © Matthais-Luggen
FiL © Matthais-Luggen
focus
30


Emmène-nous, nuit
La pièce qui sera présentée au cœur de l’automne par l’Opéra national du Rhin, en coproduction avec le Deutsche Oper Berlin, prend une dimension allégorique intrigante si on se souvient qu’elle fut écrite par Franz Schreker, compositeur allemand postromantique, alors que l’Europe se métamorphosait en charnier durant la Grande Guerre. Elle fut achevée le lendemain même de l’Armistice, puis créée à Francfort le 21 janvier 1920. Elle connut un certain succès sous la République de Weimar ; elle fut donnée plus de 350 fois jusqu’en 1932, avant de tomber sous le coup de la condamnation nazie, classée au rang de la « musique dégénérée » (Entartete Musik). La mise en scène de Christof Loy, passé par le Theater an der Wien, l’Opéra de Munich ou l’Opéra royal de Stockholm, et la direction de Marko Letonja, ancien directeur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg désormais à la tête de l’Orchestre philharmonique de Brème, font revivre la quête du bijou perdu de la Reine (Doke Pauwels), bijou magique promettant beauté et fécondité. Elis (Thomas Blondelle), le ménestrel du Roi (Derek Welton), est chargé de le récupérer grâce à son instrument enchanté. Mais Els (Helena Juntunen), fille d’un aubergiste, figure complexe et intrigante, se lance également dans l’aventure. Finalement, tous deux finiront par oublier leur rivalité ainsi que l’objet de leur quête, pour s’abandonner, le temps d’une nuit, aux puissances de l’amour, qui échappent à toute logique économique et politique, à toute finalité.
« Ah, nimm uns auf, Nacht ! » Ah, emmène-nous, nuit…
Par Clément Willer
— LE CHERCHEUR DE TRÉSORS, opéra du 28 octobre au 8 novembre à l’Opéra de Strasbourg, et les 27 et 29 novembre à la Filature, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org


Ce qui finit ne cesse de commencer
Comme l’écrit Renaud Herbin, directeur du TJP à l’origine du projet global Corps-ObjetImage, dans une formule énigmatique qui sonne juste par les temps qui courent, entremêlant intimement espoir et désespoir : « Ce qui finit ne cesse de commencer. » C’est, en quelque sorte, de cela qu’il est question dans la création théâtrale qu’il propose en ce mois d’octobre, mois propice aux fragiles élans utopiques. Seul sur scène, avec un rectangle pour seul horizon, il affronte les forces invisibles qui parsèment son chemin, chemin sans commencement et sans fin. La musique d’Alice Daquet – artiste du label Tigersushi, devenue Sir Alice, autrice, compositrice et interprète à la frontière du folk éthéré et de l’abstraction électronique – et de Grégory Dargent – guitariste électronique et joueur de oud, croisant musiques improvisées, transes touareg, jazz, maqâm turc – accompagnera cette traversée errante et exaltante d’un espace étroit et pourtant infini. D’une certaine manière, c’est la ligne de démarcation entre le possible et l’impossible qui se trouve allégoriquement remise en question. Pour le personnage en scène, il s’agira d’entretenir une manière incertaine de fuir sans quitter l’ici et maintenant, d’ébaucher un commencement alors que la fin menace. Comme l’écrivait Samuel Beckett : « Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer…
Par Clément Willer
— PAR LES BORDS, théâtre du 18 au 21 octobre à la Grande scène du TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com
Le Chercheur de trésors
© Benoit Schupp
focus
»
32

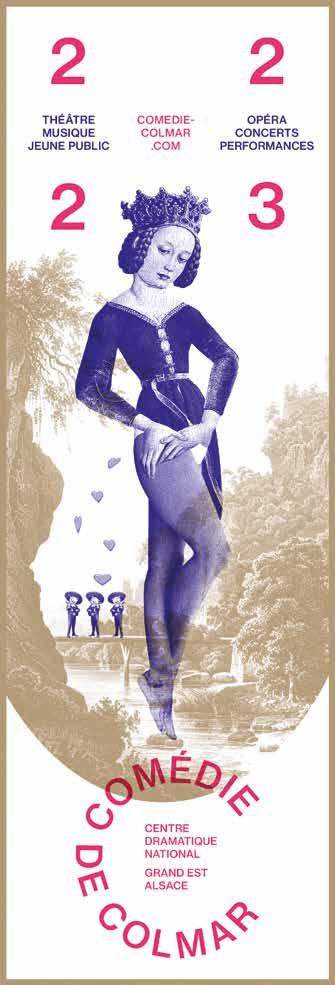
Le Corbeau et le cauchemar
« Si cette histoire vous rappelle quelque chose, fiez-vous aux apparences, elles ne sont pas toujours trompeuses. La fiction n’est jamais mieux servie que par un soupçon de réalité. » Pour leur nouvelle pièce, Anette Gillard et Sacha Vilmar – l’équipe artistique derrière le fameux festival Démostratif, transposent dans un monde onirique fait de corbeaux et de forêts de sapins le plus sordide des faits divers non résolus de ces dernières années : l’affaire du petit Grégory. Ici, nuée de vautours, oiseaux de mauvais augure et autres volatiles en danger sont réunis par une mystérieuse lettre anonyme, et se volent dans les plumes autour du terrible meurtre de l’Enfant. Qui se plait à semer la terreur dans la forêt à l’approche de l’hiver ? Lequel de leurs congénères se délecte de la boue infecte remuée par cette affaire ? Par une habile et grinçante transposition dans l’imaginaire, Adieu mes chers cons interroge notre curiosité malsaine pour le sordide et le sensationnel… Et démontre comment chaque élément – un crime contre l’innocence, une famille déchirée, un juge suicidaire, un fiasco judiciaire, une obscure vallée rurale, un mystérieux corbeau –ont fait de ce funeste fait divers une tragédie contemporaine dont les rebondissements éclaboussent encore le monde d’aujourd’hui.
Par Aurélie Vautrin
— ADIEU MES CHERS CONS, théâtre du 15 au 19 novembre au TAPS Laiterie, à Strasbourg ; le 2 mars au Diapason, à Vendenheim ; le 10 mars au Théâtre de Lunéville ; le 31 mai et le 1er juin au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.taps.strasbourg.eu theatredeluneville.fr www.theatre-manufacture.fr

Le courage des oiseaux
Ornithologue à ses heures, le chorégraphe Thomas Lebrun fait s’envoler des oiseaux… de bon augure. Quel beau programme ! On aimerait que l’aube se lève plus souvent sur des jours plus cléments. Comme celle du début du spectacle, qui découvre quatre danseurs ondulant sous une brise légère. On imagine quatre roseaux, mais ils seraient plutôt des oiseaux sur leur branche, s’éveillant à une nouvelle journée. Pour … de bon augure, Thomas Lebrun et ses compagnons danseurs se sont en effet inspirés des oiseaux dont les chants et les trajectoires, confinement oblige, peuplaient soudain à nouveau nos quotidiens dont ils avaient tristement disparu. Ils les ont longuement observés et se sont appuyés sur des musiques et chansons qui leur rendent hommage, de Rameau à Antony and the Johnsons en passant par Olivier Messiaen et Nana Mouskouri. Ces partitions délicates et (forcément) aériennes, parfois célestes et spirituelles, parfois surprenantes et décalées, accompagnent une danse fluide, simple, précise… et cocasse à ses heures. Loin de toute imitation réductrice, la gestuelle évoque ici, même à qui ne connaît pas le sujet, une légèreté joyeuse, une forme de naïveté dans toute sa beauté, sa justesse et sa nécessité. Thomas Lebrun et ses danseurs (re)nouent visiblement ici un lien fort avec la nature, et il y a dans leur présence et leurs mouvements quelque chose d’authentique, au sens non galvaudé du terme. À tel point qu’ils pourraient bien réussir à nous faire croire à des lendemains qui gazouillent.
Par Sylvia Dubost
— … DE BON AUGURE, danse du 15 au 17 novembre à Pole-Sud à Strasbourg
— JEUX DE CORPS, JEUX D’ESPRIT, conférence de Thomas Lebrun le 14 novembre à 18h30 à l’auditorium du Studium www.pole-sud.fr
 Maquette du décor © Teona Goreci
Maquette du décor © Teona Goreci
focus
34
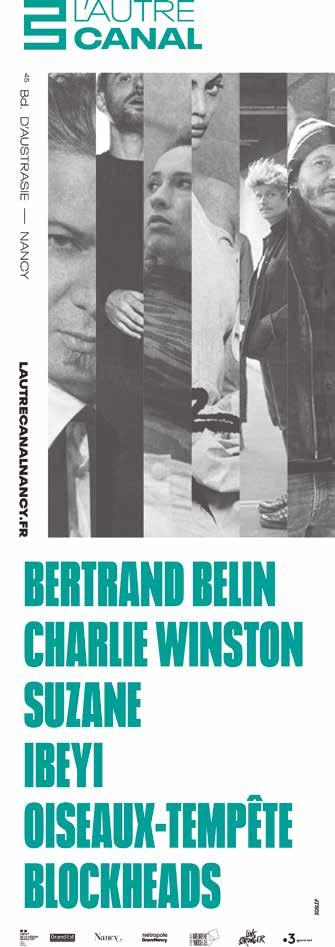

Djan’go fast !
Depuis 2016, l’équipe de l’Espace Django rebooste ce lieu culturel du Neuhof, avec une ligne artistique tournée vers les musiques dites du monde, mais génétiquement modifiées comme en atteste la nouvelle saison. Citons les metalleux togolais Arka’n Asrafokor (11.10) qui réconcilient fans de Fela et de Sepultura.

Django convie aussi bien les Sénégalais d’Orchestra Baobab qui fêtent leurs 50 piges (18.10) que les jeunes rappeuses du coin Kay the Prodigy et Allocroco (17.11). La mécanique de la codirection assurée par Benoît Van Kote et Mourad Mabrouki est bien huilée et le duo peut se féliciter de parvenir à maintenir un parfait équilibre entre diffusion d’artistes majoritairement émergents – « Nos oreilles traînent partout », s’amuse Benoît – et médiation aux petits oignons. Mourad : « Le monde actuel fait peur, mais nous maintenons le cap », en proposant des impromptus dans des cours d’école ou structures médicales et sociales. Les « concerts aux fenêtres » des immeubles ? Ils sont « devenus de véritables fêtes populaires ! » La saison est placée sous le signe de la découverte, des initiatives de sensibilisation et de l’accompagnement d’artistes, notamment ceux de la Pépinière : cette année, et pour deux ans, il s’agit de Las Baklavas (chanson polyphonique et percussive), Beatrice Melissa (electropop délicate) et PALES (post-punk agité). Nouveauté : Olivier Dieterlen et le Nouma, après quasi deux décennies, passent la main à Django qui devient antenne alsacienne des tremplins du Printemps de Bourges, les INOUÏS.
Par Emmanuel Dosda
— ESPACE DJANGO, à Strasbourg www.espacedjango.eu
focus
Archi sobre
« La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur s’est fixée pour objectif de dépasser l’entre-soi et de s’adresser au grand public, de le sensibiliser à notre métier qui consiste à la réalisation de programmes qui doivent résister au moins un demi-siècle ! » Claude Denu, président, admet volontiers qu’environ 50 % du public des Journées de l’architecture, événement transfrontalier phare de la MEA, est issu du milieu, mais que tous se mobilisent « en tant que confrères, pas concurrents ». « Chaque expérience de construction doit se faire collectivement », aime à rappeler l’équipe organisatrice d’un festival fédérateur (environ 50 000 visiteurs par an) dont le sujet s’impose comme une évidence : « Architecture et ressources », dans un contexte de réchauffement climatique où la « frugalité heureuse » deviendra inévitablement une norme. Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la ville résiliente, félicite les organisateurs de la 22e édition des JA pour le choix d’une thématique plus que jamais d’actualité, dans un monde où la « réutilisation du patrimoine bâti, l’optimisation des logements vacants par leur réaménagement et leur isolation à l’aide de matériaux biosourcés » est absolument nécessaire. Julie Wilhelm-Muller, vice-présidente de la MEA, évoque plus de 160 rendez-vous, partout dans le Rhin supérieur, convaincue qu’« un autre monde est possible, que l’architecture peut et doit nous aider à sortir des crises que nous vivons et qui nous attendent ». Les perspectives envisagées ? Elles seront exposées tout au long de la manifestation et notamment des temps forts avec les conférences de Roger Boltshauser puis de Martin Rauch (à la Fonderie de Mulhouse, le 7.10 à 18 h et 19 h) et leurs bâtisses en argile et terre battue ou la rencontre avec Tatiana Bilbao (à l’Oberrheinhalle d’Offenburg, le 11.10 à 18 h 30) célèbre pour son engagement dans la construction de logements sociaux à bas prix au Mexique.

Par Emmanuel Dosda — LES JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE, du 23 septembre au 31 octobre dans 26 villes du Rhin supérieur (en Alsace, dans le Bade-Wurtemberg et deux cantons de Bâle en Suisse)
www.m-ea.eu/ja22
Klô Pelgag © Benoît Paillé
Haus Rauch, Beat Bühler, FarbeAussen
36


TLM en parle
Auréolé du Prix de la meilleure compagnie chorégraphique 2021-2022 décerné par le Syndicat professionnel de la critique de danse en juin dernier, le CCN-Ballet de Lorraine lance sa nouvelle saison baptisée TLM – acronyme de « Tout le monde », histoire d’afficher une nouvelle fois sa volonté d’ouverture au plus grand nombre. Et pour son premier programme, il accueille deux générations de chorégraphes, deux parcours artistiques différents mais qui se sont déjà croisés, Loïc Touzé et Maud Le Pladec. Le premier, figure emblématique du milieu depuis plus de trente ans, présentera NO OCO, une pièce poétique qui bouscule profondément notre rapport au temps. « J’ai débuté ma vie avec la danse à l’Opéra de Paris, confie-t-il. J’ai quitté cette institution alors que j’étais jeune adulte avec la sensation de sortir de la forêt des mouvements et des gestes pour aller vers la danse. Rencontrer les interprètes du Ballet de Lorraine pour inventer avec eux une pièce est comme un retour dans la forêt vers la nuit de mes débuts. » En parallèle, Maud Le Pladec proposera STATIC SHOT, une pièce chorégraphique où, nous dit-elle, « tout raconte les corps », une œuvre entre installation scénique et dispositif cinématographique où mouvement et regard, emmenés par une création lancinante et entrainante, ne s’arrêtent jamais. « La danse peut raconter les changements autant que des préservations d’états », complète-t-elle. Voilà qui devrait plaire à tout le monde
Par Aurélie Vautrin
— NO OCO / STATIC SHOT, danse du 19 au 23 octobre à l’Opéra national de Lorraine, à Nancy www.ballet-de-lorraine.eu
Entrer dans la transe
En 1518 à Strasbourg, on danse : sans explication, la population se masse dans les rues, toujours plus nombreuse au fil des semaines avant de s’arrêter de manière aussi subite et inexplicable qu’elle avait commencée. Le chorégraphe Vidal Bini et la compagnie KiloHertZ s’emparent de cet épisode étrange de l’Histoire pour interroger notre rapport à la danse comme moyen instinctif d’expression, dynamique engendrant empathie et mimétisme, héritage de cultures païennes passées...
Au fil des recherches, le projet prend forme : NARR : pour entrer dans la nuit sera un spectacle participatif mêlant professionnels et amateurs. Après quatre semaines d’ateliers et de répétitions, c’est une multiplicité de corps, de mobilités, de médias qui investissent la scène afin d’exposer la richesse du sujet et ses implications concrètes et poétiques. Pour constituer la partition chorégraphique, Vidal Bini et ses interprètes ont rassemblé une collection de danses issues de différents pays et époques, opérant un mélange entre danses populaires et savantes. La création musicale suit la même logique en puisant dans des sonorités folkloriques ou actuelles. Entre rituel, rassemblement festif et œuvre contemporaine, NARR : pour entrer dans la nuit met en scène une nature profonde des corps en mouvement, pour une « chorémanie » nouvelle.
Par Benjamin Bottemer
— NARR : POUR ENTRER DANS LA NUIT, danse le 25 novembre au Carreau, à Forbach www.carreau-forbach.com

 NARR : pour entrer dans la nuit
Static Shot © Laurent Philippe
NARR : pour entrer dans la nuit
Static Shot © Laurent Philippe
focus
38


À portée d’oreille
1998. George Clooney jouait les truands enjôleurs et en cavale dans Hors d’atteinte 2022, les Rainy Days vont plus loin et adoptent pour slogan de leur nouvelle édition « Out Of This World ». Hors d’atteinte ? Non, pas du tout, le festival luxembourgeois rapproche l’infini et l’au-delà de l’audible et du visible, du bonheur du spectateur. Classe. Épiphanies sonores, créations arc-boutées sur l’inattendu, technologie domptée au service du plaisir humain. C’est complet et toujours très bien venu. Le cosmos est en point de mire et l’expérience physique en ligne de conduite. Précieux, les festivals qui révèlent, décentrent et décalent les regards. Ici, le regard est celui des deux oreilles plantées tout entières dans une programmation interstellaire. Du Noir de l’étoile de Gérard Grisey au clinquement des étoiles de Wie klingen die Sterne adressé au public jeune, de Subnormal Europe, la perf historico-media virtuose de Noa Frenkel à Zeugen où Aperghis engage des marionnettes pour être les témoins de l’âme humaine, du cinéma de Dowschenko sorti de son mutisme par l’Ensemble Musikfabrik et Alexander Popov aux Échographies orchestrales du Philharmonique du Luxembourg. Tout et chaque pierre d’angle de cette édition 2022 ramène l’œil vers le haut. Pour rapprocher l’oreille de la force créatrice. Universelle, complexe et généreuse. Tant pis pour George, tout est ici à portée de main. Simplement.

Par Guillaume Malvoisin
— RAINY DAYS, festival du 15 au 27 novembre à la Philharmonie Luxembourg www.rainydays.lu
Esthétique du crash
L’Andromaque d’Élodie Ségui est un champ de bataille : rien n’est assez solide pour résister à une passion à la fois destructrice et salvatrice.
Dans Mad Grass, les comédiens évoluent dans les décombres d’une ville post-industrielle ; dans Cuisine botanique, la tablée bien dressée devient un buffet orgiaque : chez Élodie Ségui, c’est autour de la scénographie, porte d’entrée dans son travail de mise en scène, que s’articule une véritable poétique de la catastrophe. Son adaptation d’Andromaque ne fait pas exception : le palais de Pyrrhus, parsemé des sinistres trophées de guerriers victorieux de retour de Troie, se fissure et s’effondre progressivement sur les personnages. « Je pense d’abord à créer une mécanique capable de mettre les corps face à la matière, explique cette fille de plasticiens. Ce n’est pas un décor, il faut que ça semble vivant, que ça remue les comédiens comme le public. » Si la langue racinienne est rigoureusement préservée, pas question pour les comédiens de jouer les héros grecs alors qu’un morceau de colonne s’abat sur eux. « Je ne veux pas qu’ils se “chargent” trop avec ça, je préfère qu’ils se concentrent sur leur corps et leur partenaire », indique Élodie Ségui. Depuis la création de Philtres d’amours et de Songe d’une nuit d’été, la metteuse en scène poursuit également une recherche autour de la passion. Ici, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector... le terreau de catastrophes à venir.
« La tragédie est un hommage à la passion, un moment de crise où le jour se lève à la fin », précise-t-elle. Pour Élodie Ségui, il n’y a pas de passion sans chaos : loin de la fatalité et des lamentations, parfois à la limite du burlesque, son Andromaque expose un processus de transmutation douloureux mais salvateur, subversif et libérateur.
Par Benjamin Bottemer
— ANDROMAQUE, théâtre du 15 au 19 novembre au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr
 Andromaque © L’Organisation
Le Noir de l’Étoile, Les Percussions de Strasbourg © Christophe Urbain
Andromaque © L’Organisation
Le Noir de l’Étoile, Les Percussions de Strasbourg © Christophe Urbain
focus
40
Vers nous
Dans une introspection rétrospective (ou l’inverse, selon l’humeur), les éditions Corti perpétuent la tradition ; Jean-Michel Maulpoix, Michel Butel et Mark Z. Danielewski brouillent les frontières et circulent dans un dedans-dehors mélancolique ; Brigitte Giraud, elle, retrace le drame de la vie – la sienne, les nôtres.
 Par Nicolas Querci ~ Photo : Stéphane Bouquet
Par Nicolas Querci ~ Photo : Stéphane Bouquet
À l’heure où la concentration s’accélère dans le monde du livre, menaçant la diversité éditoriale, Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz ont choisi de transmettre à titre gracieux les éditions Corti à Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, qui prendront le relais en 2023. Un geste fort et iconoclaste qui garantit l’indépendance et la pérennité de cette maison historique. Un geste qui correspond aussi à l’esprit de son fondateur José Corti (1895-1984), qui a donné la maison à Bertrand Fillaudeau à son décès.
José Corti a commencé par ouvrir une librairie à Paris avec sa femme, en 1925. Dans le même temps, il s’occupe avec Breton, Éluard et Aragon des Éditions surréalistes et publie les auteurs liés au mouvement. En 1938, il s’installe rue Médicis et crée les éditions qui portent son nom. Il publie dès cette année-là les Œuvres complètes de Lautréamont et Au château d’Argol , le premier livre de Julien Gracq qui restera toujours fidèle à Corti. Pendant l’Occupation, Corti diffuse des textes clandestins et fait paraître des auteurs juifs et anglais. Son fils, résistant, est arrêté et meurt en déportation.
Après la guerre, José Corti poursuit son activité autour des grands thèmes qui structurent son catalogue, en éditant des textes poétiques, des
essais littéraires, des classiques méconnus du romantisme européen et des « inclassables », comme La Chouette aveugle de l’Iranien Sadegh Hedayat. En 1951, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq obtient le prix Goncourt que l’auteur refuse, un an après avoir publié La Littérature à l’estomac, pamphlet où il fustige le milieu littéraire de son temps… Assis dans sa librairie, la pipe à la bouche, José Corti bâtit l’un des catalogues les plus respectés de l’édition française.
Bertrand Fillaudeau, qui a commencé à travailler avec lui en 1980, prend la suite après sa disparition et fait évoluer la maison sans en trahir l’esprit. Il crée deux collections – « Ibériques », dans laquelle il publie notamment Miguel Torga et Roberto Juarroz, et « En lisant en écrivant » –, il développe le « Domaine romantique » et accueille de nouveaux auteurs français et étrangers. Il sera rejoint en 1996 par Fabienne Raphoz, écrivaine et poétesse, qui elle aussi crée de nouvelles collections – « Merveilleux », consacrée au conte de tout lieu et de toute époque, « Série américaine », qui regroupe des poètes américains des xxe et xxie siècles, et « Biophilia », qui s’intéresse au vivant et fête ses dix ans en 2022. Elle accueille des écrivains comme Denis Grozdanovitch, Tatiana Arfel ou Marc Graciano.
EN 2023, BERTRAND FILLAUDEAU ET FABIENNE RAPHOZ PASSERONT LE TÉMOIN DES ÉDITIONS CORTI. POUR LE SEPTIÈME ÉPISODE DE LA SÉRIE CONSACRÉE AUX ÉDITEURS, ILS REVIENNENT SUR LEUR LONG PARCOURS À LA TÊTE DE L’UNE DES DERNIÈRES PETITES MAISONS « HISTORIQUES » TOTALEMENT INDÉPENDANTES. UNE HISTOIRE DE TRANSMISSIONS
43
La maison traverse l’époque et les changements qui touchent le secteur de l’édition sans rien perdre de son exigence. Aujourd’hui, elle publie une quinzaine de livres par an. Son catalogue comprend environ 900 titres disponibles – 1 200 en comptant les titres épuisés.
En 2016, Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz abandonnent la librairie – désormais louée à une librairie anglophone – pour se concentrer sur leur travail d’éditeurs. Ils s’installent sur les causses du Quercy. Depuis deux ans ils forment leurs successeurs, les écrivains Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon, qui poursuivront l’aventure avec leur goût et leur sensibilité propres. Les éditions Corti continueront de nous entraîner vers des terres inexplorées.


Bertrand Fillaudeau, comment avez-vous rencontré José Corti ?
Bertrand Fillaudeau : Tout à fait par hasard. C’était en 1980. Je faisais un doctorat en droit. Comme le droit ne m’intéressait pas beaucoup, je préparais un doctorat de lettres. Revenant de mon service militaire, j’attendais un poste dans l’enseignement l’année suivante. À ce momentlà, José Corti est tombé dans ses escaliers. Mon beau-frère, qui est médecin, habitait dans le même immeuble que lui. Il l’a soigné car Corti refusait d’aller à l’hôpital. Il avait besoin de quelqu’un pour l’aider. C’est comme ça que j’ai commencé


à travailler avec lui et sa femme. Il m’a d’abord confié des tâches pas très passionnantes mais très formatrices, le stock ou la correspondance. Au bout d’un an, sa femme m’a demandé si je voulais toujours être enseignant, ou si j’accepterais de continuer les éditions après leur mort. Abasourdi, après une semaine de réflexion, j’ai accepté. José Corti est mort en 1984, un an après son épouse. Il avait tout organisé. Il avait donné tous ses biens à l’Assistance publique, à charge pour elle de me donner la maison d’édition sans aucun frais, car je n’avais pas d’argent. C’est à ce moment-là que tout a commencé. Seul à la barre.
Est-ce que vous appréhendiez la succession ? B. F. : Quand José Corti a décidé que je prendrais la suite, il m’a présenté à certains de ses auteurs. Je connaissais Julien Gracq, qui venait régulièrement à la librairie. Un jour, Corti lui donna rendez-vous à son domicile. Quand j’y suis arrivé, j’étais dans mes petits souliers, plus qu’intimidé. Gracq ayant appris les intentions des Corti eut ces mots dont je me souviendrai toujours : « Je sais que M. Fillaudeau est un bon capitaine. Je ne sais pas si ce sera un bon général. » Tout s’est ensuite enchaîné assez tranquillement. Grâce au fonds des éditions Corti, je pouvais me permettre de commettre des erreurs, c’est-à-dire perdre de l’argent sur certains livres. Je ne me préoccupais pas du résultat, uniquement de la qualité de ce qu’on recevait.
Le fondateur José Corti [1] dans la librairie du 11, rue de Médicis [2], auquel ont succédé B. Fillaudeau [3] et F. Raphoz (ici entourée de Ianna Andréadis et Caroline Sagot Duvauroux) [4]. Photos : archives Corti, F. Raphoz et B. Fillaudeau.
31 2 4 44
Fabienne Raphoz, comment avez-vous été amenée à rejoindre les éditions Corti ? Fabienne Raphoz : À la suite de notre rencontre. Je travaillais dans une librairie, la librairie Descombes, à Genève, tout en achevant une thèse en littérature comparée avec l’idée d’enseigner. J’ai rencontré Bertrand à l’occasion d’un salon du livre « off », à Genève. J’avais choisi des textes qui me plaisaient, les éditions Corti étaient particulièrement bien représentées. Bertrand, étonné de voir autant de livres de son fonds éditorial, s’est installé derrière mon stand. Nous ne nous sommes plus quittés. En travaillant sur le conte populaire de tradition orale, pour l’université, je m’étais aperçue que beaucoup d’œuvres manquaient en France, alors qu’il existait de nombreuses collectes de contes de tradition orale au xixe siècle un peu partout en Europe. Par ailleurs, les grands classiques, comme les Grimm, n’avaient pas été édités de manière scientifique. Se rendre compte qu’un livre manque, c’est être un peu éditeur. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer la collection « Merveilleux », comprenant des collectes, mais aussi des textes littéraires illustrant le genre. Cette création permettait non seulement d’ouvrir un nouveau champ éditorial chez Corti, proche de la ligne certes, mais dont l’interdisciplinarité permettait beaucoup de souplesse. Elle me permettait aussi, à titre plus personnel, d’avoir un contact direct avec les autrices et les auteurs, naturellement plus enclins à n’avoir que Bertrand pour interlocuteur.
Qu’est-ce qui peut pousser de jeunes auteurs à envoyer des textes à Corti, une petite maison, plutôt qu’à un éditeur plus connu ? F. R. : C’est à eux qu’il faudrait poser la question. Cela étant, il y a 25 ans, je vous aurais répondu par une autre question : « Est-ce que des jeunes auteurs oseraient nous envoyer des textes ? », tant l’image de Corti était intimidante. À l’époque, je constatais que les manuscrits reçus émanaient souvent soit de personnes qui n’avaient aucune idée de ce qu’est, disons, une « ligne éditoriale », soit de personnes se réclamant du style de Gracq. Bon, je schématise un peu. Aujourd’hui un jeune auteur peut envoyer son texte par voie électronique à un bien plus grand nombre d’éditeurs. Ces dernières années, nous avons accueilli Marc Graciano, Tatiana Arfel, Julie Mazzieri, etc. dans le domaine romanesque, Caroline Sagot Duvauroux et quelques autres dans le domaine poétique. Graciano avait envoyé son premier texte chez P.O.L et chez Corti. Il nous avait « ciblés », en se doutant qu’aucun éditeur mainstream n’accepterait son texte. Je lui avais envoyé une réponse circonstanciée, comme P.O.L. C’était un « Non, mais… presque oui ». Il nous a envoyé son second manuscrit, impeccable de bout en bout.
B. F. : Nombreux sont les auteurs que nous avons accueillis et qui avaient été refusés partout. C’était le cas de Tatiana Arfel et de son Attente du soir.
Compte tenu de l’évolution des maisons d’édition, des comités de lecture et des responsables commerciaux, les grosses maisons ne prennent pas le risque d’accueillir des auteurs un tant soit peu étonnants ou détonants ; c’est ce que nous recherchons.
F. R. : Bruno Remaury aussi avait été refusé par tout le monde. J’ai édité son premier livre en 2019, Le Monde horizontal. Il est arrivé « jeune » auteur à un âge où pour la plupart, à quelque Wallace Stevens et autres auteurs tardifs près, l’œuvre est déjà derrière eux. Dès le début de son écriture, il avait en tête l’arborescence de sa « série » : une réflexion sur l’archéologie de notre modernité, sorte de livremonde. Il cumule ainsi maturité d’écriture (jamais découragé par les refus, il a au fond toujours écrit) et énergie des premières fois. Le quatrième livre de son ensemble, Le Pays des jouets , est paru en septembre.
Quels sont vos critères de choix ? B. F. : Plus que le style, j’aime lire quelque chose que je n’ai pas encore lu. Où je me dis : « Là, l’auteur a trouvé quelque chose que je ne connaissais pas. » F. R. : Je suis toujours incapable de définir ce qu’est la littérature. Mais, je crois à peu près ressentir ce qui n’en est pas pour moi. Mais « pour moi », qu’estce que ça veut dire ? Je peux apprécier un texte sans qu’il corresponde à la ligne de Corti. Si c’est un bon texte, il trouvera une maison d’accueil. S’il existait des critères absolus, scientifiques, tout le monde aimerait les mêmes textes. Par goût, je préfère les formes hybrides, les textes disons inclassables, même si je ne déteste pas qu’on fasse encore « sortir la marquise à 5 heures » pour peu qu’on la fasse déambuler sur une musique inouïe.
Le dernier livre de Graciano a paru chez un autre éditeur. Est-ce que cela signifie qu’il a quitté Corti ?
F. R. : C’est un texte que je lui avais conseillé de ne pas publier ou de revoir de fond en comble. J’ai eu une expérience d’éditrice exceptionnelle avec Marc, un vrai compagnonnage, du moins c’est ce que je ressentais de mon côté. Pour son deuxième livre, Une forêt profonde et bleue , il avait d’abord envoyé un texte de 800 feuillets. Je lui avais dit : « Il y a un chef-d’œuvre dans ces pages, à toi de le trouver. » Il m’a répondu qu’il préférait passer à un autre livre. J’ai insisté… Il a travaillé et ce livre, paru en 2015, est aussi magistral que le premier. Tous les textes qu’il m’a donnés ensuite étaient d’emblée « bons à tirer ». Le tout dernier donc, celui qui vient de paraître, sur Jeanne d’Arc, je ne savais pas par quel bout le prendre, du moins dans l’état où il me l’avait remis. Je trouvais qu’il allait, pour le coup, beaucoup trop loin dans son style, oubliant complètement le lecteur en chemin. Bref, je ne le suivais pas sur ce texte, du moins dans la version qu’il m’avait envoyée. Je me suis peut-être trompée.
45
Il a eu pour cet opus une avalanche de presse, et il a fait la une du Matricule des anges. Si je me suis un peu prise pour une Cyrano, au bas du balcon, je suis vraiment contente pour lui. Je ne sais pas s’il est définitivement parti de chez Corti, lui seul peut répondre, car chez nous, il n’y a pas de contrat d’exclusivité. J’en serais triste pour Corti, je l’avoue, Marc est un écrivain que je tiens en très haute estime. Son premier livre, Liberté dans la montagne, est devenu un classique de la maison.
Est-ce que vous intervenez beaucoup sur les textes ?
B. F. : Je suis assez radical, puisque pour moi, un auteur se doit d’assumer totalement son texte. Je fonctionne encore avec la figure très ancienne du « grand écrivain ». Je n’ai jamais touché une ligne de Claude Louis-Combet. Ni José Corti ni moi n’aurions eu l’idée de faire la moindre remarque à Gracq, puisque quand il nous donnait des textes, c’était parfait. Prenons le cas de Georges Picard, on aime ou on n’aime pas, impossible de le corriger. En revanche, je peux mettre des points d’interrogation. Je pense à Simon Berger, dont on a publié le premier roman en 2019. Dans le manuscrit initial, j’avais mis des points d’interrogation auxquels il a répondu ou pas. Il assumait ce qu’il voulait. Que l’éditeur se substitue à l’auteur est pour moi impossible.
F. R. : Chaque manuscrit arrive avec son originalité, sa singularité et son histoire. Je n’ai jamais effectué le travail à la place des écrivains. Mais je pose des questions, note quelques remarques en marge des épreuves. Pour un texte poétique, je peux demander si telle ou telle métaphore est bien voulue. Parfois c’est l’auteur qui est en demande. Par exemple, la poétesse Aurélie Foglia, non seulement attend des remarques sur le fond mais aussi sur la mise en pages concrète de ses textes, sujet qui consonne tout particulièrement avec ma propre passion pour l’utilisation concrète, quasi physique, de la page, en poésie.
B. F. : On ne réécrit jamais. Il y avait un éditeur que j’admirais beaucoup, Jean-Pierre Sicre, le fondateur des éditions Phébus, il réécrivait beaucoup en fonction de son point de vue. De Minuit à Bourgois, en passant par Verdier ou P.O.L, les maisons ont toutes des sensibilités différentes, et c’est tant mieux.
F. R. : Je pense au cas du Discours sur la tombe de l’idiot de Julie Mazzieri. En signant le contrat avec Corti, elle me dit qu’Actes Sud aurait accepté son texte, si elle avait réécrit la dernière partie, si elle avait changé la fin, un passage auquel elle tenait, à juste titre, selon moi. C’est donc une autrice et non une fabricante de livres. Elle aurait sinon accepté au seul motif d’être publiée par Actes Sud. Mais si je n’impose pas une modification, je peux à l’inverse solliciter un livre, comme je l’ai fait, par exemple, avec Stéphane Bouquet, dont la poésie est publiée chez Champ Vallon, et dont
j’apprécie l’intelligence sensible et la liberté de ton avec lesquelles il aborde également les essais, des essais de poète, notamment dans les préfaces qu’il a écrites pour des écrivains américains traduits dans « La Série américaine » de Corti ou chez d’autres éditeurs. Je me rappelle encore ce « tope-là » lancé un soir après une de ses lectures, « tope-là » devenu La Cité de paroles , publié dans la collection « En lisant en écrivant » de Bertrand.
B. F. : Ce qui arrive aussi, parfois, c’est qu’un auteur ne trouve pas un bon titre alors que le texte est excellent. Ça c’est embêtant. L’idéal, c’est que l’auteur trouve lui-même son titre.
F. R. : Au départ, le premier livre de Tatiana Arfel s’appelait Aux abris . Le titre nous semblait très mauvais. Nous avons cherché dans ses propres mots une solution et lui avons suggéré L’Attente du soir B. F. : Pour les inédits publiés après la mort de Gracq, nous avons toujours pris avec Bernhild Boie, son ayant droit, un titre issu du livre. D’autant plus que Gracq avait le don pour trouver des titres, En lisant en écrivant, par exemple. S’il l’avait proposé à un éditeur conventionnel, il aurait demandé une virgule. L’une de mes fiertés, c’est que Bernhild Boie soit restée chez Corti pour publier les inédits autorisés. Rien ne l’y obligeait. Elle a continué à nous faire confiance. C’est beau, parce que ce sont trois générations qui se succèdent : Corti-Gracq, Gracq-Fillaudeau-Raphoz, et Boie-FillaudeauRaphoz. C’est magnifique d’échapper ainsi à cette malédiction de l’argent, qui aujourd’hui s’est aggravée.
Que représente Gracq aujourd’hui pour la maison ?
B. F. : Commercialement, il se vend très bien. Intellectuellement, c’est un auteur respecté par de nombreux grands écrivains contemporains. Dans un futur éloigné, je pense que la langue de Gracq risque de poser un problème aux jeunes lecteurs.
F. R. : Sa place chez Corti est toujours importante. Et il y a aussi le regard qu’il pose sur le monde, qui n’est pas seulement un regard géographique, mais, nous dirions aujourd’hui « écopoétique » si j’ose utiliser ce néologisme récent qu’il n’aurait d’ailleurs pas forcément apprécié, lui qui se méfiait de ce qu’il appelait « l’état civil » de la littérature. Tout de même, « Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler ! », c’est de lui. Oui, les romans de Gracq sont tous situés.
Ça ne vous gêne pas que le nom de Gracq soit aussi fortement attaché à celui de Corti, au risque d’occulter les autres auteurs ?
B. F. : Fabienne utilise cette métaphore : c’est le baobab qui cache la forêt.
F. R. : Combien de fois à la librairie, j’ai entendu le couplet : « Ah ! il y a du Gracq dans ce livre… » dès que nous publiions un nouvel auteur. Si je suis fière
46
a minima de ne pas avoir terni l’image de la maison, j’éprouve néanmoins une petite tristesse à l’idée que pour un certain public, elle se résume toujours à la seule équation « Corti = Gracq », comme je le constate encore parfois.
B. F. : Très souvent, c’est vrai, on ne cite que Gracq. C’est injuste et erroné. Je suis extrêmement fier par exemple d’avoir édité Ghérasim Luca, refusé initialement par Gallimard. C’est désormais un classique du domaine poétique français du xxe siècle. En poésie, pour moi, c’est l’équivalent de Gracq. Certains écrivains importants marquent un catalogue sans avoir forcément une aura auprès du grand public. Tout dépend d’ailleurs de quel public on parle. Si je pose la question dans la rue, personne ne connaît Gracq.



La maison a aussi la réputation d’être très exigeante d’un point de vue littéraire. Est-ce que vous vous souciez de l’image de Corti ? F. R. : L’image ! Voilà bien une affaire que nous ne maîtrisons pas, que nous n’avons, il me semble, ni ternie, ni infléchie, du moins de ce point de vue-là. Nous avons toujours édité ce qui nous semblait bon, à nous, sans nous préoccuper, c’est un luxe j’en conviens, de quoi que ce soit d’autre : succès, amitié, mode… Même pour la collection « Biophilia ». Si le
vivant en général, et l’écopoétique en particulier, est un sujet d’autant plus dans l’air du temps que l’air du temps est devenu irrespirable, c’était loin d’être le cas en 2012, à sa création. Cette préoccupation, et cet amour du vivant, relève de l’évidence, pour nous.
La librairie faisait aussi partie de l’identité de Corti. Pourquoi l’avoir fermée ?
B. F. : D’abord, je commençais à être lassé par les gens qui entraient dans la librairie en demandant où était le Sénat, ou quel était le premier Gracq qu’il fallait lire… Ensuite, avec le départ à la retraite d’une collaboratrice, nous étions tous les deux seuls pour tenir la librairie tout en étant éditeur, nous ne voulions ni changer de politique éditoriale, ni n’avions les moyens d’embaucher quelqu’un. Ce n’était plus possible psychologiquement ou financièrement.
F. R. : Il y avait aussi une vraie confusion entre la librairie et les éditions Corti. Parfois, les gens ne se rendaient pas compte que nous étions une maison d’édition, comme les autres , c’est-à-dire diffusée partout en librairie, comme si les livres de Corti ne se vendaient qu’à la rue Médicis. Et puis surtout, le travail éditorial pâtissait de plus en plus de la vente en librairie. Quand on essaie de se concentrer sur des épreuves, qu’il faut envoyer un bon à tirer, etc., et que quelqu’un nous pose un manuscrit sous le nez, s’assied pour discuter, ça peut être agréable ou inconfortable selon l’interlocuteur inopiné, imprévu, mais dans tous les cas, assez peu efficace pour le travail éditorial.



B. F. : Mais il y avait bien sûr quelques miracles. Par exemple, quand on publie un écrivain qui se vend à 200 exemplaires, comme Michel FardoulisLagrange. Un beau jour, quelqu’un entre dans la librairie et s’exclame : « Ah ! ce livre-là, c’était quelque chose ! » Là, on se moque qu’il n’y ait eu que 200 lecteurs. On sait que le livre a touché une personne. Lorsque l’on n’a plus de contact direct avec les lecteurs et qu’un livre se prend un bide, on ne sait plus pourquoi ou pour qui on a travaillé.
F. R. : Bien sûr, grâce aux libraires, aux réseaux sociaux, nous avons des retours, mais rien, c’est vrai, ne remplace la petite flamme qu’on voyait s’allumer dans les yeux des lecteurs et des lectrices.
Gracq et Bachelard (ici dessiné par José Corti) font partie des tout premiers auteurs à avoir été publiés par Corti. Le fonds exceptionnel de la maison comprend des auteurs comme Leonid Andreïev ou le poète Ghérasim Luca (en haut à droite). Aujourd’hui, la maison continue de publier de nouveaux auteurs « étonnants ou détonants », comme Tatiana Arfel et Bruno Remaury (ci-dessus). Photos : Dekiss, Sarane Alexandrian, Ianna Andréadis et archives Corti.
47
B. Fillaudeau et F. Raphoz ont chacun créé leurs collections : « Ibériques » et « En lisant en écrivant » pour le premier ; « Merveilleux », « Série américaine » et « Biophilia » pour la seconde. La plus récente, « Biophilia », fête ses dix ans en 2022. Elle rassemble des classiques de l’écologie, des explorateurs, des écrivains de la nature et des contemporains (ici, Une pluie d’oiseaux de Marielle Macé, avec une illustration de Ianna Andréadis, Murmuration), et rencontre un véritable écho auprès des libraires, de la presse et du public.


Est-ce que cette fermeture était aussi liée à des questions économiques ?
B. F. : La librairie rapportait un peu d’argent. Mais pas assez pour embaucher quelqu’un pour la tenir.
F. R. : Quand Corti comptait deux salariées en plus de nous, les fins de mois étaient difficiles. Trois ans de suite, nous avons été en déficit et avons même dû renflouer momentanément les caisses de l’édition de notre poche. Mais Corti est un petit bateau…
B. F. : … oui, et en cas de tempête, on baisse la voile et on attend que ça passe. Ce qui coûte cher, aussi, ce sont les frais de traduction. Quand on a publié Esprits-frères de John Cowper Powys, par exemple, entre les droits, la traduction, l’impression, il fallait vendre 1 800 exemplaires pour rentrer dans nos frais. On en a vendu 200… C’est comme si on avait pris une voiture et qu’on l’avait jetée dans la Seine. Mais on peut le digérer. Quand on a publié l’intégrale des contes des frères Grimm, en 2009, si on n’avait pas reçu d’aide du CNL et si le livre n’avait pas eu de succès, c’était le bénéfice de trois ans qui disparaissait.


F. R. : La traduction coûtait à elle seule 30 000 euros. C’était un projet énorme. Aujourd’hui ce livre fait partie de nos meilleures ventes chaque année et le remarquable boulot de traductrice et d’essayiste de Natacha Rimasson-Fertin a partout été salué, jusqu’à Cassel, la patrie des deux frères. Mais le succès, encore une fois, nous ne pouvons pas le prévoir et je tremblais, je me disais qu’il fallait être dingue pour se lancer dans un tel projet.
B. F. : Notre principe était que, dès qu’on avait des réserves d’argent, on l’investissait dans un projet extrêmement lourd, sans se préoccuper du potentiel commercial du livre. C’est ce qu’on a fait après l’énorme succès du Manuscrit trouvé à Saragosse , dont 40 000 exemplaires ont été vendus. On s’est lancés dans la publication de l’ Anatomie de la mélancolie de Robert Burton parce qu’on savait que c’était possible. Un projet colossal, trois volumes
sous coffret, plus de 2 000 pages, traduit par Bernard Hœpffner. Leonid Andreïev, traduit par Sophie Benech, c’était cinq volumes de traductions qui coûtaient une fortune. Nous lancions donc des projets sans nous inquiéter du « marché ». Est-ce qu’il vous arrive de vous tromper sur les tirages ?

F. R. : Pour la collection « Biophilia », je ne tire jamais à moins de 2 000, 2 500 exemplaires. Avec Une pluie d’oiseaux, de Marielle Macé, d’abord tiré à 2 500 exemplaires et paru en mai dernier, on dépasse aujourd’hui les 3 000 exemplaires vendus, ce qui est exceptionnel pour un essai. La mise en place en librairie avait été très sous-estimée, donc il y a eu des réajustements énormes les premiers jours. Le tirage menaçait d’être épuisé en une semaine… J’ai téléphoné à un imprimeur capable de faire des petites quantités. Il me dit : « Avec le papier, l’Ukraine, le Covid, tout ça… c’est quatre semaines ! » Stress. Je téléphone à un autre imprimeur : « Je peux vous faire ça en une semaine. » Ouf. Mais il était très cher sur les petites quantités. Je devais tirer beaucoup pour profiter des économies d’échelle. Là, j’ai vraiment joué à la roulette. J’ai fait tirer 4 000 exemplaires de plus. Depuis lors, bien sûr, les ventes se sont calmées, mais le livre continue sa route, c’est donc l’avenir qui dira si j’ai eu raison de tirer autant.
Gracq ne voulait pas que ses livres paraissent en poche. Est-ce qu’il vous arrive néanmoins de vendre les droits de vos livres en poche ?
B. F. : C’est arrivé plusieurs fois. On a vendu les droits de L’air et les songes et L’eau et les rêves de Gaston Bachelard et quelques autres titres, pour avoir une idée concrète de la question. Le grand discours des éditeurs de poche, c’est que l’édition en grand format n’est pas stérilisée, ce qui est totalement faux. Donc il faut savoir ce que l’on veut. Si on pense que c’est un livre du fonds, comme celui de Tatiana Arfel, dont on vend chaque année
48
entre 800 et 900 exemplaires, le vendre en poche, c’est prendre le risque de perdre ces exemplaires. Après avoir fait quelques essais, je doute que ce soit une solution intéressante pour la plupart des livres que l’on publie.
F. R. : Tatiana avait envie que son livre paraisse en poche. Ce titre étant important pour Corti, je craignais qu’un éditeur de poche stérilise notre édition sans pour autant que le titre marche beaucoup mieux. Je lui ai demandé si elle était d’accord pour qu’on le sorte dans notre propre collection de poche, « Les Massicotés ». Elle a accepté. Nous gagnons tous, éditeur et autrice, moins d’argent qu’avec le grand format, mais c’est un bon compromis et le livre marche bien.
D’ailleurs, tous vos livres sont massicotés, maintenant. Alors que jusqu’à récemment, il fallait les couper soi-même, ce qui était là encore une marque de fabrique de Corti. Pourquoi avoir arrêté ?
B. F. : Jusque dans les années 1990, la question ne se posait pas, Corti se distribuait lui-même, on faisait comme on voulait. Les libraires savaient encore ce qu’était un livre non massicoté. À l’occasion d’une réédition du Rivage des Syrtes , nous avons découvert que des exemplaires étaient retournés chez le distributeur car « défectueux » par certaines enseignes comme la FNAC, Amazon ou le Furet du Nord. Une partie du tirage de nos livres allait y passer. Cette idée un peu chimérique d’appropriation du livre par le lecteur était donc devenue aberrante. On s’est dit qu’il valait mieux arrêter.
F. R. : Corti disait : « Dis-moi comment tu coupes ton livre et je te dirai quel lecteur tu es. » Du temps de Corti, c’était moins cher de ne pas massicoter. Dans les machines, le massicot était ailleurs, c’était une opération supplémentaire. Cette image de marque, à laquelle tenait Corti, répondait aussi à une logique économique. Ensuite, la tendance s’est inversée. Avec l’imprimerie actuelle, toute la chaîne est automatisée. Pour ne pas massicoter les livres, il faudrait les sortir de la chaîne, à la main. Ce qui reviendrait plus cher ou serait impossible.
Est-ce que vous vendez beaucoup de livres à des éditeurs étrangers ?
B. F. : C’est un peu le même problème que pour le poche. Les éditeurs étrangers ne s’intéressent à un livre que s’il a beaucoup de succès, ou à un auteur « classique » comme Gracq ou Ghérasim Luca. Il y a aussi des modes. En ce moment les Chinois achètent beaucoup de titres. Ils viennent d’acheter Le Marteau sans maître de René Char, paru il y a 90 ans. Nous sommes allés une fois à la Foire du livre de Francfort pour nous faire une idée. On s’est dit : « On s’est trompé de terrain de foot ! » Ce n’est pas notre métier. Peut-être que nos successeurs s’occuperont de ça mieux que nous.
Justement, comment avez-vous préparé le passage de témoin ?
F. R. : Nous aurions pu piloter encore longtemps le navire Corti. Mais nous ne sommes que deux et si l’un de nous avait été malade ou avait un accident, l’aventure Corti se terminait là… Il n’y avait pas, comme dans des structures plus grandes, quelqu’un pour prendre la suite, comme Frédéric Boyer chez P.O.L. Je voulais m’ôter cette frayeur de l’esprit. À un moment, sans que je puisse vraiment me l’expliquer, quelque chose comme un « parce que c’était eux, parce que c’était nous » sûrement, j’ai senti chez Marie de Quatrebarbes, publiée chez P.O.L, et son compagnon, Maël Guesdon, un poète que j’ai publié, une forme de compétence, d’intelligence, de sensibilité, mais aussi de sens pratique, qui correspondaient assez bien au côté un peu couteau suisse du métier d’éditeur indépendant. Je me suis réveillée un matin, certaine de mon intuition. J’ai dit à Bertrand : « Je crois avoir trouvé les personnes qu’il faut pour Corti. » Ça a été une évidence pour lui aussi.
B. F. : J’avais une autre hypothèse qui était de saborder le navire et de laisser libres les auteurs, ce qui était une très mauvaise idée. Parce qu’en fait, les auteurs libres, de toute façon, ils auraient été récupérés par les grosses maisons s’ils avaient eu du succès, tous les autres se seraient retrouvés sans éditeur. C’était une connerie monumentale. Et le nom de Corti s’arrêtait.
F. R. : Le nom de Corti qui n’est pas le nôtre… Nous leur en avons parlé il y a deux ans et demi. Il fallait que ça les intéresse aussi. Corti, c’est un cadeau qui peut être lourd, très gros, à mettre sous le sapin. Ils ont réfléchi, puis ont accepté. Je les connaissais un peu, mais, à l’époque, nous n’étions pas aussi intimes qu’aujourd’hui. C’était purement intuitif et c’était un pari un peu dingue. Aujourd’hui, ça fait plus d’un an que Marie est salariée chez Corti à plein temps. C’est elle qui reçoit les manuscrits. Maël l’a rejointe au mois de juin. On les a vus à l’œuvre. Je ne veux pas leur faire de déclaration d’amour, surtout devant témoin (ditelle en la faisant) mais je ne pensais pas que tout se déroulerait avec autant de finesse et d’intelligence de leur côté. Ce sont eux qui ont choisi les livres qui paraîtront en 2023. Nous nous occupons encore de la comptabilité, du site web, et de certaines petites choses du quotidien, mais la transmission est bien en route.
B. F. : Cette année ils participeront au bilan. Le prochain, ce sont eux qui le feront !
www.jose-corti.fr
49
LE CHEMIN VERS LA LUMIÈRE
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Pascal Bastien
Dans votre dernier recueil , vous renouez avec une approche traditionnelle de la poésie en fonction de l’émotion de l’instant. La poésie, est-ce mettre en mots quelque chose qui vous traverse ? Oui, je crois qu’on peut dire cela très simplement. C’est une forme de réactivité, mais à l’intérieur de la langue, alors que d’autres réagiront par le dessin, la photo, le chant ou la musique.
Quelle a été votre entrée en poésie ? Je baigne dans les mots depuis tout petit. Avec un père journaliste à Montbéliard – et une grand-mère institutrice – j’avais des livres à la maison. Très tôt j’ai eu envie d’écrire des poèmes...

Votre poésie est généralement émancipée des contraintes habituelles.
L’essentiel de mes livres est en prose poétique. L’exemple le plus connu est Une histoire de bleu [paru dans la collection Poésie/Gallimard, ndlr] qui continue d’exister auprès d’un public jeune, ce qui est très plaisant. Cela ne m’a pas empêché de publier il y a quelque temps des volumes en vers.
Comment en êtes-vous arrivé à la forme plus traditionnelle du recueil de la Rue des fleurs ? Après avoir écrit deux recueils de deuil, L’Hirondelle rouge et Le Jour venu sur la disparition de mes parents, j’ai ressenti le besoin de faire une pause parce que je m’étais engagé dans une voie très sombre. Je souhaitais reprendre mes anciens vers : j’ai commencé à les réunir, mais rapidement je me suis dit que ça n’allait pas. Cela me semblait trop hétérogène, trop artificiel. Alors que j’en étais à 200 pages de manuscrit, j’ai opté pour un « bouquet » qui comprenait les textes les plus concrets, les plus photographiques aussi. Le mélange de textes anciens que je retravaillais et de poèmes plus récents me permettait d’offrir un recueil susceptible d’être accueilli par les lecteurs les plus nombreux : les enfants comme les adultes.
Et pourtant dans les premières pages, la mélancolie demeure : la lumière vient progressivement, la couleur aussi. Avez-vous le sentiment de clore un cycle qui vous permet d’aller vers un ailleurs ? Je crois que c’est le mouvement de tous mes livres avec cette charge mélancolique initiale – dans un texte comme Au cimetière , j’évoque l’angoisse de la mort. Mais il y a toujours un chemin vers la lumière. Comme si l’écriture apaisait et consolait d’une certaine façon. Comme si elle avait besoin de remettre au monde des vivants celui qui a été appelé par le monde des morts. C’était le cas dans le recueil L’Hirondelle rouge. Ce titre peut paraître surprenant, mais lors d’un voyage à Barcelone j’avais découvert un carnet du peintre Miró dans
AURÉOLÉ DU GONCOURT DE LA POÉSIE 2022 POUR SON ŒUVRE, JEAN-MICHEL MAULPOIX PUBLIE UN RECUEIL SUR SA RUE DES FLEURS, À BISCHHEIM, AU NORD DE STRASBOURG.
50
une vitrine : il y était noté « le rouge des hirondelles ». Je m’étais interrogé, et après des recherches j’ai constaté qu’il avait peint des « hirondelles amour » avec la silhouette d’un oiseau rouge. J’en ai fait une image du désir : l’hirondelle amène le printemps, la vitalité et l’amour.
Avec ce rouge qui évoque la flamboyance, comme une comète.
Oui, à travers cet oiseau, on retrouve cette trajectoire qui nous permet de sortir du deuil et de l’emprise funèbre…
Cette trajectoire, vous la matérialisez également par la forme : vous partez d’une écriture sèche, âpre, et au fil des pages vous lui donnez du corps et des rondeurs.
Tout part d’une sècheresse du discours. Dans cette charpente pour laquelle j’évite tout bavardage, tout pathos ou complaisance de la plainte, je laisse miroiter de la lumière afin que le poème puisse se mettre à vivre.
Vous opérez un mouvement double : dynamique dans le constat effectué en temps réel et statique qui serait plus de l’ordre de la contemplation intérieure.
Oui, c’est un mouvement dedans-dehors. Ensemble, une vision et son écho à l’intérieur. Je me situe moins dans une logique néoromantique d’expression d’un sentiment qui partirait de l’intérieur et viendrait se poser sur un paysage. Je me sens plus proche d’une tension et d’une complémentarité entre l’extérieur et l’intérieur. Une passante dans la rue, et mon attention à la langue se conjugue pour former ce dedans-dehors du poème. Parfois, je constate des choses mystérieuses : c’est le cas dans Arrière-saison. « L’araignée tombe sans parachute / L’horloge en berne marque six heures et demie / Les ongles du calendrier brûlent / Je ne me souviens pas. » Il y a une série de décrochements assez inattendus pour moi.
Vous vous laissez surprendre vous-même ? Oui, je me laisse surprendre par les mots qui jaillissent et par les images. Tout cela révèle notre rapport au temps qui se dit de manière non pathétique, mais simplement à travers le suivi étrange d’une image.
Votre Rue des fleurs semble elle aussi double, à la fois physique, géographique, et mentale : une rue à l’intérieur de la rue.
Oui, c’est un espace mental avec ses saisons, avec ses lieux réels ou imaginaires. Il est vrai que j’ai superposé des poèmes venant d’époques différentes, notamment ceux écrits quand je vivais dans des banlieues très populaires en région parisienne, à Asnières ou à Bois-Colombes. J’ai retrouvé à Bischheim des gens qui me rappellent
des silhouettes vues ailleurs, auparavant. Cette Rue des fleurs est emblématique de la condition humaine dans son aspect le plus simple : une personne âgée, une femme avec sa poussette, on sent toutes les tensions qui peuvent naître à l’intérieur de ces existences. Si l’on peut dire, le poète résonne de cela.
Quels sont les auteurs qui vous ont nourri ? Je dirais principalement les auteurs de la seconde moitié du xixe. Ça sera Verlaine pour la musique ; Rimbaud pour les images et sa capacité à produire des visions ; Mallarmé pour la syntaxe et sa manière de rendre la chose par le seul travail de la langue, cette tension et cette sorte de discipline verbale ; Baudelaire pour la ville et le passant – la petite séquence « banlieue pauvre » de Rue des fleurs doit beaucoup à ses déambulations et cette façon de regarder les gens, d’imaginer des destinées à travers les visages, d’entrer comme il le disait dans le personnage de chacun ; et bien sûr Victor Hugo, la figure tutélaire, le grand-père de tout le monde. Par la suite, j’ai découvert des auteurs plus contemporains que j’ai eu la chance de rencontrer : Philippe Jaccottet et Yves Bonnefoy, qui ont joué un rôle essentiel pour moi.
Nous disions que le poète est traversé, la rue aussi peut être traversée Oui, c’est pourquoi j’ai adopté ce titre tout simple. Il pouvait rendre compte d’une écriture poétique résolument simple, une variété de sujets, d’un assemblage de motifs, d’une circulation parmi les saisons. Et puis, si on regarde bien, on trouve des fleurs dans le livre, de toutes sortes. Pour moi, un poème c’est comme une éclosion. De la parole qui éclot.
Dans un texte, vous affirmez qu’« écrire et disparaître » c’est une même chose.
Il y a derrière cela tout un pan de mélancolie. On sait la place que celleci tient dans la littérature et surtout dans la poésie. Et je crois que cette mélancolie va avec un rapport anticipé à la mort. Il y a un sentiment de finitude angoissé, mais qui rend les choses précieuses. Après tout, qu’estce qui fait que nous sommes sensibles à ce que nous voyons ? Comment sommes-nous traversés par l’amour ou par la tristesse ? C’est parce qu’on trouve en nous cette sensibilité au temps qui passe, au temps qui fuit avec ce sentiment de la précarité des attachements, la précarité des vies. Donc, écrire c’est entrer dans cette logique de la disparition, pas forcément pour ressasser toute la noirceur qu’elle implique, mais c’est une façon de s’absenter et de chercher dans l’obscurité – la nuit de l’ignorance de notre propre sort – une forme de plénitude.
Écrire, est-ce admettre ? Oui, c’est ce que j’appelle le consentement. Consentir à disparaître. Consentir à être éphémère.
— RUE DES FLEURS, Jean-Michel Maulpoix, Mercure de France
— JEAN-MICHEL MAULPOIX, rencontre publique le 30 novembre à la Cour des Boecklin, à Bischheim courdesboecklin.ville-bischheim.fr
51

TROP JEUNE POUR FAIRE PARTIE DU CLUB DES NOSTALGIQUES DE L’AUTRE JOURNAL, CLÉMENT WILLER NOUS FAIT PART DE SA DÉCOUVERTE DE MICHEL BUTEL (1940-2018) À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE DEUX LIVRES MAGNIFIQUES AUX ÉDITIONS DE L’ATELIER CONTEMPORAIN. NOUS DEVRIONS VIVRE LA NUIT Par Clément Willer ~ Photo : Caroline Cutaia* *Photographie réalisée en 2012, à l’occasion de l’interview de Michel Butel à retrouver dans Novo n°19. 52
Si j’essaie de me souvenir comment j’ai découvert, l’hiver dernier, les livres de Michel Butel, que Béatrice Leca décrit comme « l’homme le plus drôle et le plus désespéré du monde », « l’écrivain qui n’écrit pas », « l’écrivain qui écrit un livre en quelques jours », « l’enfant délinquant viré de toutes les écoles », « l’écrivain sauvant son journal avec des histoires parfois vraies écrites en une nuit », il me semble qu’il faudrait commencer par dire que c’était par une journée pluvieuse de janvier. Une journée pluvieuse comme aujourd’hui d’ailleurs, vendredi 16 septembre ; c’est peut-être la même journée qui revient, sous un autre visage, le temps ressemblant au fond à une spirale tramée de ratures et de retours qu’on a du mal à comprendre. Le temps qu’il faisait le jour où j’ai ouvert L’autre livre n’a pas d’importance peut-être. Mais si je pense à ma rencontre avec l’écrivain qui n’écrit pas en même temps qu’il écrit, c’est étrangement la première chose qui me vient.
Il pleut, donc, et je lis L’autre livre, paru en 1997. D’abord par obligation, puisque je vais participer au projet de réédition de ses œuvres aux éditions L’Atelier contemporain, mais assez vite cette obligation devient le contraire d’une obligation. Ma lecture cette après-midi-là est entremêlée de moments d’inattention, de ces moments d’inattention qui sont en même temps le signe, la respiration d’une attention fascinée. Les livres qu’on aime sont ceux dont la frontière avec la vie se brouille, dans l’expérience et dans la mémoire. Je lève parfois la tête, je regarde par-dessus le petit livre bleu pâle, les gouttes de pluie ruisselant sur la fenêtre, les phares des voitures dans la grisaille de la rue. Puis je me replonge dans ses pages, où on sent de la rage, mais aussi de la douceur. Il arrive qu’un passage interrompe un instant la rumeur de la pluie, suspende le temps. Comme celui-ci : « Nous devrions vivre la nuit, la nuit comme le jour. Les yeux ouverts. Lire la nuit, peindre la nuit, écrire la nuit, jouer la nuit, marcher la nuit, parler la nuit, travailler la nuit, aimer la nuit, manifester la nuit, étudier la nuit. La nuit nous est volée. Par une civilisation à nature foncièrement criminelle, qui ne commet qu’un seul crime : détruire la vie de chacun, de chacune d’entre nous. »
En lisant ce passage, je me souviens de la soirée passée à La Solidarité avec une amie quelques jours plus tôt. On avait parlé une partie de la nuit, sans voir le temps passer. Avant de se quitter, elle m’avait dit : « Le temps est passé différemment, pas vite ou lentement, mais d’une manière qui ne se mesure pas... » Ou alors peut-être est-ce moi qui ai dit ça, je ne sais plus, je retrouve seulement ces mots que j’avais notés dans mon carnet. Dans ces moments où la parole nous relie d’une façon inattendue, miraculeuse, ça n’a plus beaucoup d’importance de savoir qui a dit telle ou telle phrase ; les phrases ont l’air de surgir comme des lueurs qui n’appartiennent à personne, dans l’obscurité de
l’abîme entre nos solitudes. Les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça, j’invente quelques passages, c’est vrai. Mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut jamais dire comment ça s’est vraiment passé. Je me souviens qu’il faisait nuit quand on buvait un café, et qu’il pleuvait quand je lisais L’autre livre quelques jours plus tard. Seules certitudes.
Pourquoi parler de la pluie, au moment où la tempête des événements, qui emporte « l’ange de l’histoire » dont parle Walter Benjamin, est plus violente que jamais ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu’on a pu croire cet été qu’il ne pleuvrait plus jamais. Peut-être aussi parce que j’aime les journées pluvieuses, s’abriter chez soi ou dans un café pour écrire. Dans L’autre histoire, fable troublante qui dormait dans les tiroirs de l’écrivain à sa mort en 2018, et qui paraît aujourd’hui de manière posthume, Michel Butel m’a rappelé l’ange de l’histoire devant « la catastrophe qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines ». Cela se passe dans les jours qui suivent le 11 septembre 2001. Dans les dernières pages, Lena, intellectuelle brillante, laisse un mot à Matthias, écrivain légèrement égaré, avant de se donner la mort : « Écris notre réponse à ce qui eut lieu, Matthias, à ce qui avait déjà eu lieu, à ce qui aura encore lieu. / Écris-la / dans notre langue, / qui n’est ni la langue de Dieu, ni celle du Diable, ni celle du Bien, ni celle du Mal / mais / celle de la beauté du monde, / oui, cher Matthias, / je te le demande / écris / dans notre langue / celle qui louange / la beauté du monde / où nous nous sommes connus... » Après avoir relu ces lignes, je me mets à chercher une autre phrase encore, pour mieux comprendre ce qu’elles veulent dire, une phrase que j’avais notée dans un carnet, un petit carnet noir que je ne quitte jamais, où je recopie toutes les phrases qui surgissent comme des illuminations. C’est une phrase lue dans un numéro de L’azur de juin 1994, journal dont Michel Butel était la seule plume, sans bureaux, sans argent. C’est comme une phrase dite par un enfant, on ne sait pas très bien si elle est naïve ou lucide, porteuse d’espoir ou de désespoir : « Seuls ceux qui croient encore à la beauté du monde peuvent changer le monde. »
Je me souviens d’une dernière chose… D’être sorti le soir après avoir refermé L’autre livre, pour prendre l’air, fumer une cigarette, marcher sous la pluie, rituels d’hiver. En passant à côté de La Solidarité, je me décide à rentrer, je n’ai rien d’autre à faire. Après des heures à lire seul et à regarder par la fenêtre, ça fait du bien de retrouver cette atmosphère de chaleur humaine, fumée de cigarette, rumeur des conversations, rires. L’amie avec qui nous avions beaucoup parlé l’autre soir est là aussi ; on boit un café, puis on sort marcher dans les rues brumeuses, au hasard. Je raconte que j’ai passé l’après-midi à lire L’autre livre, à regarder la pluie par la fenêtre. Je raconte aussi que quelque chose d’étrange survient quand on écoute la pluie tomber assez longtemps ; on commence à percevoir une sorte de message indéchiffrable, dans une langue qu’on comprend sans la comprendre, une promesse d’un autre monde qui en même temps est déjà là. Je repense à une phrase dans L’azur : « La joie n’est pas de ce monde, et pourtant elle est là, une exilée. » On se tait un moment. Puis je dis que critiquer, théoriser, manifester, ça ne suffit peut-être pas… Qu’il faudrait aussi écouter la pluie, marcher la nuit sans but, pour donner une chance à un autre monde. Elle me dit : « Il faudrait inventer une douceur radicale. » On continue de marcher, en silence.
— L’AUTRE LIVRE, Michel Butel, préface de Béatrice Leca, L’Atelier contemporain
— L’AZUR, Michel Butel, préface de Jean-Christophe Bailly, L’Atelier contemporain
53
Par Antoine Jarry
Dans Feu pâle , prototype éclatant de l’œuvre postmoderne qui se joue des codes et des lectures interprétatives, Vladimir Nabokov ouvrait par ces vers d’un certain Shade : « C’était moi l’ombre du jaseur tué / Par l’azur trompeur de la vitre ; / C’était moi la tache de duvet cendré – et je / Survivais, poursuivais mon vol, dans le ciel réfléchi. » L’image d’un oiseau s’étant jeté sur une fenêtre, car trompé par l’azur qui se reflète dans une vitre, semble renvoyer à l’image même du lecteur dupé par « l’azur trompeur » d’un livre et de ses interprétations. L’ouvrage de Nabokov comprenait par ailleurs tout un système de notes, écrites par un ami de Shade, lequel va dans une deuxième partie, commenter le poème. Ce commentaire va ensuite prendre de plus en plus de place, créant tout un jeu d’échos entre le texte original et la glose. Ainsi de nombreux autres ouvrages se sont plu à jouer avec leur lecteur, tel un oiseau trompé par le dédale labyrinthique de l’œuvre. Le sens semble se projeter comme une ombre au-delà de nos pas de lecture, à l’image de La Maison des feuilles de Mark Z. Danielewski.
Ouvrage culte dès sa parution, ce roman contient en son corps même un ravissement interprétatif. Il contient en sa demeure textuelle deux récits enchevêtrés qui se répondent tout au long des pages. Tout démarre avec un premier récit, celui de Johnny Errand, lequel est à la recherche d’un appartement. C’est son ami Lude qui va lui indiquer qu’un appartement se libère dans sa résidence puisque son occupant est décédé. Ce dernier était un vieil homme prénommé Zampanò et son appartement, en plus du bazar et de la saleté dantesque, contient une thèse écrite par ce dernier autour d’un mystérieux documentaire intitulé le Navidson Record. Le deuxième récit est donc constitué par cette thèse, laquelle va se trouver parasitée par les notes nombreuses de Johnny Errand. On retrouve là notamment l’héritage nabokovien. Dans sa thèse,
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE D’UNE MAISON LITTÉRAIRE HORS NORME
IL EST DES LIVRES QUI PROPOSENT PLUS QU’UNE SIMPLE EXPÉRIENCE DE LECTURE : UNE TRAVERSÉE DANS UN MONDE ET UN UNIVERS QUI NOUS ÉTAIENT INCONNUS. LA MAISON DES FEUILLES, PREMIER ROMAN DE MARK Z. DANIELEWSKI, PARU EN 2000 AUX ÉTATS-UNIS, APPARTIENT À CETTE CATÉGORIE RARE DE LIVRES QUI CHANGENT NOTRE MANIÈRE DE LIRE ET DE CONCEVOIR LA LECTURE. LES ÉDITIONS MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE ONT LA FORMIDABLE IDÉE DE REPUBLIER CE LIVRE HORS NORME DANS UNE ÉDITION REMASTERISÉE EN COULEURS. IL EST TEMPS DE FAIRE LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE.
54
Zampanò analyse ce documentaire dans lequel on voit une famille, les Navidson, Will et Karen avec leurs deux enfants, se rendre compte que la maison dans laquelle ils viennent de s’installer tend à grandir de l’intérieur. En effet, ils découvrent d’abord que cette dernière est plus grande d’un quart de pouce à l’intérieur qu’à l’extérieur, avant d’assister à l’apparition d’un couloir, amenant ensuite toute une série terrifiante et fantastique d’excroissances spatiales. Le père, accompagné par son père et des amis va tenter d’explorer ces couloirs. Ils vont au fur et à mesure se perdre de plus en plus.
À cette déroute et cette quête répond une explosion formelle et typographique du texte qui semble contaminé par la maison elle-même. Le récit épouse dans sa chair textuelle les méandres labyrinthiques des personnages, parasitant aussi Johnny Errand dont les notes deviennent de plus en plus délirantes.
Le Navidson Record explore autant un espace physique réaliste et fantastique qu’un espace familial, aussi mental que littéraire. Avec La Maison des feuilles, la page devient le lieu de tous les possibles. À la maison, espace, semble-t-il, clos, répond autant la figure du bateau qui navigue à travers les mers que celle du monstre marin ou mythologique qu’il faut tenter de capturer. Tout le génie de son auteur est de mêler et d’enchevêtrer l’abstrait et le concret, le pageturner et l’ouvrage de thèse, les différentes typographies qui à la manière

d’un film de Cronenberg prennent vie et tentent de s’incorporer au corps physique et psychique du lecteur. Ce roman construit un espace mental proprement hallucinatoire et vous transforme en exégète nerd infatigable avec notamment cette première question : pourquoi le mot maison est-il systématiquement indiqué en bleu ? La force de La Maison des feuilles vient de sa matérialité même. Ce livre demande une attention physique tout au long de la lecture, plaçant le lecteur au centre de son dispositif. Mark Z. Danielewski affirmait dans un entretien le lien essentiel entre auteur et lecteur : « Il faut rentrer dans le livre… et rentrer dans la maison… la maison est un grand écran noir où on peut voir ses propres peurs. Les lecteurs deviennent, en fait, des co-écrivains. »
La Maison des feuilles est ce roman-demeure qui confère aux mots une forte puissance spatiale. C’est finalement la langue elle-même qui devient maison, demeure, à l’instar de la réflexion de Jacques Derrida dans Le Monolinguisme de l’autre : « Je suis monolingue. Mon monolinguisme demeure, et je l’appelle ma demeure, et je le ressens comme tel, j’y reste et je l’habite. Il m’habite. » Appelons donc La Maison des feuilles notre demeure pour y rester et y habiter quelque temps ou plus.
— LA MAISON DES FEUILLES, Mark Z. Danielwski, Monsieur Toussaint Louverture
55

56
L’AMOUR D’UN ABSENT
Par Aurélie Vautrin ~ Photos : Arno Paul
Question simple-basique, pourquoi une nouvelle mise à nue, vingt ans après À présent (Éditions Stock, 2001) ?
Pour moi, ce sont deux livres extrêmement différents. À présent a été écrit environ un an après l’accident, et c’est plutôt un livre de la déflagration. De la sidération. Qui court sur une semaine, de l’instant où j’apprends l’accident au moment des obsèques, et qui détaille ce qui se passe lorsque ce type de catastrophe surgit. Pour autant, je savais au fond de moi qu’il était tout à fait possible que j’écrive ce que j’appelle « le livre » ‒ celui qui soit à la hauteur de Claude, de l’homme, de l’histoire d’amour, de l’événement. Aussi parce que je n’arrive pas à accepter que dans notre société, une personne puisse disparaitre comme ça, d’une façon aussi violente, sans explication logique, mais qu’il nous faudrait être résilient, continuer à vivre comme si ça n’avait pas eu lieu, avec tous ces livres de développement personnel qui veulent nous faire croire qu’un deuil se fait en deux ans et qu’après c’est plié… Ça m’a pris vingt ans, mais j’ai eu besoin de mener une enquête, à la fois intime, collective, sociologique, historique. Parce qu’un accident, une mort prématurée, est pour moi toujours politique. J’avais besoin de comprendre quel était cet enchainement de causes à effets qui avait mené à la catastrophe. Car toutes nos vies sont le produit de ce que l’on a vécu la veille et l’avant-veille et dix ans auparavant… Ce qui peut constituer un destin ‒ d’ailleurs Vivre vite pose la question : « Est-ce que le destin existe ? » C’est un livre qui parle de choix, pris consciemment ou inconsciemment ‒ s’installer dans une nouvelle maison, faire des
IL Y A VINGT ANS, BRIGITTE GIRAUD PERDAIT L’HOMME DE SA VIE, CLAUDE, DANS UN ACCIDENT DE MOTO QUI RESTERA À JAMAIS INEXPLIQUÉ. TROIS JOURS PLUS TARD, ELLE EMMÉNAGEAIT AVEC SON FILS DANS CETTE NOUVELLE MAISON QU’IL N’HABITERA JAMAIS… AUJOURD’HUI, CHASSÉE DES LIEUX PAR LE PROJET D’UN PROMOTEUR IMMOBILIER, ELLE FAIT SE REJOUER L’HISTOIRE QUI FRACASSA SON EXISTENCE, OBSERVANT CHAQUE DÉTAIL AVEC LA MINUTIE D’UN CHIRURGIEN SCALPEL À LA MAIN. NE CHERCHANT NI COUPABLE, NI RÉPONSES, ELLE DRESSE AVEC DIGNITÉ LA FAMEUSE LITANIE DES « SI », LIANT D’UN FIL INVISIBLE LA GÉNÉALOGIE DE L’ACCIDENT ET LES MÉANDRES D’UNE SOCIÉTÉ EN PLEIN BOULEVERSEMENT. RENCONTRE AVEC UNE AUTRICE EN LICE POUR LE GONCOURT, LORS DE SA VENUE AU LIVRE SUR LA PLACE, À NANCY.
57
pieds et des mains pour avoir les clés à l’avance, passer un coup de téléphone à sa mère pour le lui annoncer… Quand nos existences se passent bien, on ne va pas enquêter sur la journée, pourquoi le bus était à l’heure, pourquoi on a pu prendre son train, pourquoi on a rejoint des amis dans tel restaurant… C’est seulement lorsqu’il y a cet énorme grain de sable dans la machine, qu’on est contraint, en tout cas moi j’ai eu besoin de regarder à quel moment ça avait pu « merder ». Car quand on met tout cela bout à bout, ça conduit à une généalogie, qui conduit à la catastrophe. Écrire Vivre vite fût pour moi l’opportunité d’interroger nos vies contemporaines, celles de l’extrême fin du xxe siècle avant la démocratisation des téléphones portables, celles d’aujourd’hui malmenées par le libéralisme, avec ces promoteurs qui font main basse sur des quartiers entiers de villes. Car c’est le point de départ du livre : je dois être chassée de cette maison que nous avions achetée ensemble, Claude et moi, et dans laquelle j’ai habité seule avec mon fils puisque l’accident a eu lieu trois jours avant. Quitter une maison entraîne toujours beaucoup de questions, et là, c’est encore plus fort puisque le lieu est lourdement marqué par l’absence… Tout se rejoue. D’ailleurs, c’est aussi une façon de donner une chance à l’histoire de se rejouer autrement…
L’écriture de ce livre était un passage obligatoire, nécessaire, vital ?
J’aurais pu ne pas l’écrire. C’est sûr qu’il vient de l’intérieur puisqu’il y a en son centre une chose très intime ‒ perdre l’homme de sa vie. Mais pour moi, l’intime n’a pas de sens s’il ne résonne pas avec le collectif, avec l’histoire des autres, d’une époque, d’une ville. J’ai beaucoup hésité, car je me suis demandé si j’avais le droit d’écrire sur cet homme qui n’est plus là, de m’engager en disant certaines choses, parce que Claude ne m’appartient pas. Pour moi, c’est un livre d’amour, indéniablement, même si je n’en avais pas conscience en l’écrivant. Mais cet intime résonne avec des interrogations beaucoup plus vastes, notamment cette histoire de moto fabriquée au Japon, la Honda CBR900RR Fireblade créée par Tadao Baba, interdite sur route dans son pays, car considérée comme trop dangereuse, mais en libre exportation en Europe ‒ ce qui pose donc un problème crucial et insupportable… J’avais aussi besoin d’explorer pourquoi à un moment, on doit passer un coup de fil qui aurait pu être déterminant et on ne le passe pas. Aujourd’hui, c’est une chose qui peut se régler par un SMS… On se rend alors bien compte de la différence fondamentale entre envoyer un message qui prend trois secondes, qui n’implique pas tout
son être ni la voix de l’autre, et faire irruption dans la soirée de quelqu’un, demander à son amie d’emprunter son téléphone, attendre 21 h 30 parce qu’à l’époque un coup de fil ça coutait cher… Explorer ce moment m’a permis de comprendre pourquoi encore maintenant, je ne téléphone pas. C’est assez vertigineux ce qu’engendre l’écriture… D’ailleurs au fur et à mesure de l’avancée du livre, j’ai découvert toutes ces raisons parallèles ‒ je suis chez une amie qui me parle de sa nouvelle histoire d’amour, je n’ose pas lui mettre sous le nez ma maternité heureuse, je n’ai pas envie de lui montrer que je me sens obligée d’appeler parce que j’ai un enfant, etc.
Les années 1990, c’était aussi l’avènement des « nouveaux pères »… Oui, à l’époque tous les journaux ne parlaient que de ça, cette injonction faite au père de prendre une place nouvelle. Et celle faite aux femmes de laisser les pères découvrir cette nouvelle place, sans pour autant les reprendre parce qu’ils avaient trop chauffé le biberon ou autre, et ce genre de détail me passionne. Vivre vite est un livre qui ne parle que des détails, qui pose la question du couple, qu’est-ce qu’un couple avec enfant, qu’est-ce que l’absence… Maintenant l’absence n’existe plus, on est toujours relié par les portables, les messages, les SMS. C’est compliqué notamment pour les adolescents, me semble-t-il, qui ne sont jamais confrontés à la fin de quelque chose, aux petits deuils, à la séparation d’avec les copains au début des vacances, au fait d’accepter de vivre sans l’autre, d’appréhender cette forme de solitude et de frustration.
Le lien est un thème récurrent dans tous vos livres. Vous croyez à l’effet papillon ?
Effectivement, le lien est quelque chose de fondamental chez moi, le lien amoureux, amical, familial. L’homme n’existe que parce qu’il est relié aux autres. Souvent je me suis dit que l’être humain était totalement fou parce qu’il passait sa vie à essayer de tisser des liens, tout en sachant que ces liens vont se modifier, et la plupart du temps disparaître. Pendant l’écriture de ce livre, je me suis beaucoup intéressée à ce duo d’artistes suisses, Peter Fischli et David Weiss, d’ailleurs je leur avais consacré un chapitre avant de le retirer. Ils ont travaillé toute leur vie sur le « cours des choses », Der Lauf der Dinge, il y a des vidéos sur YouTube si vous voulez. Ils faisaient des expérimentations avec les objets à portée de main dans leur labo on fait rouler une bille, qui va actionner un petit clapet, qui va actionner une turbine, qui va mettre en route autre chose… Ce fameux effet domino. J’ai voulu en quelque sorte que le livre fonctionne
58
de la même façon, que l’on se rende vraiment compte de cette cause à effet. Si nous avions accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère, l’accident n’aurait pas eu lieu. Si je n’avais pas changé le jour de mon déplacement à Paris. Si je n’avais pas voulu acheter absolument cette maison qui visiblement n’était pas pour nous. Et pourquoi une décision prise dans un pays situé à dix mille kilomètres de mon centre de vie va venir percuter mon existence. Je sais que ces questions sont totalement paradoxales. Mais c’est ce qui m’intéressait justement, les paradoxes. Pourquoi cette folie immobilière de vouloir toujours mieux ; normalement trouver un lieu c’est pour se mettre à l’abri, alors qu’ici, cette recherche effrénée du lieu idéal nous a exposés au danger. C’est totalement insupportable quand on s’en rend compte, mais l’écriture m’a permis d’accepter, ou du moins de comprendre ce paradoxe, comprendre ce qui nous fait courir, de façon quasi névrotique.
Vous concluez un chapitre par cette phrase : « Il n’y a que de mauvaises questions. » Qu’avez-vous voulu dire par là ? (Silence.) Refaire l’histoire après coup, je sais très bien ça ne va pas en changer l’issue. Cette phrase, c’est parce que ces questions peuvent sembler incongrues, presque malvenues, mais je ne voulais aucunement régler des comptes, ni avec moi-même, ni avec les autres. Un livre ne doit pas être un règlement de comptes, c’est ma conception de l’écriture. Pour autant, j’avais besoin d’explorer toutes ces situations, y compris d’aller presque jusqu’à la folie : m’imaginer que si Stephen King était mort dans le grave accident qu’il a eu deux jours avant, peut-être que Claude se serait rappelé que l’on était mortel… Et quand je vais jusqu’à me demander s’il avait écouté tel morceau de Coldplay plutôt que celui de Death in Vegas qui dure plus longtemps… Évidemment que ça aurait changé quelque chose. Mais je ne peux pas me faire l’économie de cette question. Je suis assez obsessionnelle comme si j’avais besoin d’aller épuiser le sujet. Chaque question peut générer de la douleur, mais ce livre n’est pas là pour ça, il est là juste pour en finir avec les questions. Je sais bien que chaque interrogation ne va pas me donner une réponse, mais elle va me permettre d’explorer notre époque, le fait d’être mère, d’être amoureuse, le balancier provinceParis, le changement de classe sociale… Avec de l’humour aussi, je l’espère, car j’ai aussi cherché à me moquer de moi-même, à développer de l’ironie, parce qu’on est parfois flamboyant, et parfois minable, et l’écriture offre l’occasion de se regarder de tous les côtés.
Est-ce aussi un livre sur la culpabilité ? Ne vous sentez pas obligée de répondre à ma question si elle vous dérange… (Long silence.) Dans l’écriture, je ne l’avais pas envisagé comme ça. Mais c’est en tout cas un livre dans lequel je peux regarder certaines personnes, notamment moi, sous un jour qui ne me plaît pas forcément. Ce désir névrotique de maison, ce fameux coup de fil qui n’est pas passé… J’ai essayé après coup de les ancrer dans des faits de société. Pour autant, le livre se termine par une scène que je n’avais pas vue venir ‒ il faut dire qu’il y avait à l’origine deux cents pages supplémentaires sur les « vingt ans après l’accident », pages que j’ai retirées juste avant de signer le bon à tirer avec mon éditrice en me disant qu’elles n’avaient pas leur place ici. Mais c’était impossible de finir sur l’accident, pour moi comme pour le lecteur, j’ai donc gardé une scène a priori anodine qui figurait dans la seconde partie. Et à la relecture, je me suis rendu compte que dans cette séquence, la fille ‒qui est moi ‒ dit « pardon » à plusieurs reprises… Et ça je ne l’avais pas vu. Du tout. Alors oui… C’est un livre sur la culpabilité, mais où personne n’est désigné coupable.
Parler de l’intime en littérature, c’est libérateur ?
À dire vrai, je ne vois pas ce qui dans l’écriture ne serait pas intime. Quand on écrit un roman comme Un loup pour l’homme qui parle de la guerre d’Algérie et met en scène des enjeux politiques, c’est selon moi aussi intime qu’un livre où le « je » est censé être moi. Je pense que c’est probablement valable pour tous les écrivains. On ne peut écrire qu’à partir de quelque chose qui vous est indispensable ‒ tous mes livres mettent en scène des questionnements qui sont de réels questionnements liés à mon existence. Cela apparait peut-être moins directement quand il s’agit de romans, mais jusqu’à présent j’ai écrit pas mal d’histoires qui mettent en scène le deuil,
—
L’intime n’a pas de sens s’il ne résonne pas avec le collectif, avec l’histoire des autres, d’une époque, d’une ville. —
59
Une année étrangère, Marée noire , même Avoir un corps… Finalement, je pense que l’intime est une fausse question.
Comment trouver les mots pour retranscrire tout cela d’ une manière littéraire sans avoir le sentiment de trahir la réalité ?
Cela prend beaucoup de temps ! J’attendais de trouver ce qui allait mettre le feu aux poudres, propulser l’écriture. Ce fût le promoteur immobilier. De manière générale, j’essaie toujours d’aller à la justesse. L’écriture n’est jamais liée à l’émotion. Jamais. J’ai besoin d’être à distance, et à bonne distance, parce qu’un texte littéraire publié n’est pas un journal intime, c’est une (re) construction, un réagencement de la réalité, de la pensée. Alors évidemment qu’il y a de l’autocensure, dans la mesure où écrire c’est choisir ce qu’on garde, et je pense que ce n’est pas un mal, je ne suis pas d’accord avec l’idée de déverser des choses qui n’ont pas leur place dans un texte : je suis pour garder peu de mots, mais qui ont du sens dans la construction littéraire.
Vous parlez également beaucoup de musique dans Vivre vite, quelle place a-t-elle dans votre vie ?
Elle est fondamentale. La littérature et la musique, ce sont mes deux pôles, mes sources d’énergie. C’est aussi un lien évident avec l’avant, la vie avec Claude. Longtemps après l’accident, c’était toujours impossible pour moi d’en écouter, je n’étais pas capable d’être reliée de façon aussi intime, forte ‒ on voit bien dans quel état la musique peut nous mettre. Aujourd’hui, je collabore avec pas mal de musiciens, je continue d’aller beaucoup aux concerts. C’est une façon de vivre, et faire revivre d’une certaine manière.
Vous écoutez quoi en ce moment ?
Beaucoup de choses très différentes ! Mansfield. TYA, Mendelson, Csaba Palotaï, ou Tindersticks, d’ailleurs ils sont en concert ici bientôt. J’écoute aussi beaucoup Les Marquises, qui sont chez moi en répétition en ce moment, c’est un duo popélectro planant originaire de Lyon…
Enfin, la question habituelle du début du mois de septembre, nous sommes en pleine rentrée littéraire, avec l’annonce des premières listes des futurs prix, comment appréhendez-vous cette période ?
Ça fait trois ans que je n’ai pas publié, donc c’était bien de faire une pause ! Car oui, c’est une période qui fragilise beaucoup : on est dans un monde qui fait des sélections, des classements, et ce n’est jamais agréable d’être choisie, puis jetée, puis abandonnée. C’est fou, ça reconnecte à des sensations de l’enfance, « on aime plus lui que moi », tellement archaïque, ça infantilise beaucoup. Et en même temps quand ça se passe bien, c’est aussi très joyeux ! Comme c’est un livre très particulier, je suis peut-être doublement sensible cette année… Enfin je peux vous dire que l’on en parle beaucoup entre écrivains, et pour résumer je dirais que globalement, c’est une semaine où l’on ne va pas très bien. (Rires.)
— VIVRE VITE, Brigitte Giraud, Éditions Flammarion

60
La nuit venue
Le théâtre puise dans les ténèbres. Dans le noir du TNS, Iphigénie dit non. L’Opéra-Théâtre messin brille des rayons de la lune. Élise Vigier dédouble Anaïs Nin dans les miroirs du Théâtre Dijon Bourgogne. Et le Maillon plonge dans une balade aussi protéiforme qu’inspirante menée par L’Amicale de production.
 L’équipe de l’Amicale en promenade durant un « collegium ».
L’équipe de l’Amicale en promenade durant un « collegium ».
EN NOVEMBRE, LE THÉÂTRE DU MAILLON, À STRASBOURG, DÉDIE UN TEMPS FORT À L’AMICALE DE PRODUCTION. UNE STRUCTURE SINGULIÈRE, NOURRIE PAR LES ÉCHANGES ET LA QUESTION DU DÉPLACEMENT. L’AMICALE DE PRODUCTION, PAYSAGE ARTISTIQUE EN MOUVEMENT Par Caroline Châtelet
62
Atypique dans le champ du spectacle vivant, l’Amicale l’est pour plusieurs raisons : son histoire, sa structuration et son fonctionnement, comme pour les objets qu’elle produit. Et la journaliste pourrait ajouter à cette liste de singularités les interviews que les artistes de l’Amicale donnent… car lors de l’entretien réalisé en septembre avec Sofia Teillet et Antoine Defoort, il fut autant question – même subrepticement – de jeux de société, de gouvernance partagée, d’horizontalité, de décisions collégiales, de marches en forêt que de prototypages ou d’enjeux de création. Le tout avec une langue inclusive et mâtiné d’un humour pincesans-rire auquel il est difficile de résister (citons la réponse d’Antoine Defoort à une question : « C’est pas faux », sur laquelle renchérit immédiatement Sofia Teillet par « C’est très vrai »).
Lors de ce rendez-vous, donc, l’équipe se trouvait à Bruxelles pour deux jours de travail collectif (précisons qu’aujourd’hui l’Amicale compte sept artistes associé e s en production déléguée –Antoine Defoort, Julien Fournet, Sofia Teillet, Samuel Hackwill, Ina Mihalache, Lorette Moreau et Sébastien Vial – et six accompagnateur ice s de projets associé e s : Célestine Dahan, Kevin Deffrennes, Salomé Dollat, Thomas Riou, Yulia Sakun et Marine Thévenet). Ces journées font partie de rencontres régulières pour penser les œuvres et leur mise en œuvre. Car en tant que structure coopérative (au statut de SCIC, société coopérative d’intérêt collectif), l’Amicale dispose de diverses instances de gouvernance. Si certaines sont constantes dans le fonctionnement de ces sociétés, d’autres relèvent de son histoire propre. Créée en 2010 par Antoine Defoort, Julien Fournet et Halory Goerger, la structure existe initialement sous la forme classique d’association. Pour autant, dès le départ le trio a le désir d’autres formes, d’autres schémas de production et de diffusion. C’est après le départ d’Halory Goerger – parti créer sa compagnie –que Defoort et Fournet passent à la SCIC. L’occasion de s’ouvrir à d’autres artistes et d’expérimenter en développant des outils de gouvernance. Qu’il s’agisse des collégiums, des symposiums coopératifs ou artistiques, des courroies, etc., tous ces dispositifs déploient les enjeux de l’Amicale : penser l’esthétique et l’économie de la production de spectacles vivants autrement. Soit à travers la mutualisation, le partage de la gouvernance, l’entraide artistique, les liens étroits entre création et production. Le tout en essayant d’échapper ne serait-ce que pour partie à la concurrence induite par le fonctionnement du système théâtral français. Et s’il est inhabituel d’aborder les questions de fonctionnement et de production avec des artistes, le faire avec l’Amicale
permet de confirmer un pressentiment : celui que tout s’articule et se nourrit et que le sens du projet se niche, aussi, dans les interstices et détails. Soit du quotidien administratif le plus prosaïque aux laboratoires de recherches artistiques partagés ; de l’humour et de l’atmosphère amicale revendiquée –comme éprouvée – à la particularité des créations. Ces spectacles où le dérisoire côtoie le savant, où l’économie de moyens scéniques n’oblitère pas la poésie, le Paysage #2 permettra de s’y plonger. Première du genre à permettre d’appréhender la multiplicité des univers de l’Amicale, cette programmation réunira spectacles, arts visuels, performance, informatique, philosophie, ou, encore, métaphysique… Autour de l’Amicale et de ses alentours, rencontre avec Antoine Defoort et Sofia Teillet.
Qu’est-ce que la structure en coopérative imprime à vos travaux respectifs ? Antoine Defoort : Parmi les formats que nous mettons en œuvre, il y a des formats d’entraide artistique, formels comme informels. Il y a, par exemple, les symposiums artistiques qui sont les plus formalisés et durent en général deux jours. Nous y venons avec des projets en cours d’écriture, des problématiques identifiées ou pas et nous mettons tout cela en partage avec les membres de la coopérative. L’invitation est large – elle s’étend aux équipes techniques, administratives, etc. –, ce qui est chouette car ce sont des moments où chacun · e peut recueillir des retours, réfléchir
—
La coopérative est une tentative d’échapper à la concurrence qui se trouve naturellement dans l’écosystème théâtral, comme à une certaine pression économique. —
63
à plusieurs. En tant que participant c’est hyper agréable de se familiariser avec le projet d’un autre, de le connaître. Et c’est toujours gai de se mettre au travail d’un projet qui n’est pas le sien.
Sofia Teillet : Il y a un vivier de compétences très différent au sein de cette coopérative, ce qui permet d’échanger avec des personnes ayant des compétences que l’on n’a pas soi-même. Très clairement, cela m’a permis de développer De la sexualité des orchidées – chose que je n’aurais jamais faite s’il n’y avait pas eu la coopérative. Pendant des années, ce spectacle a existé sous une forme très courte, que je jouais dans des bars au chapeau. Et dès que je pensais à le développer plus avant, j’abandonnais l’idée en pensant aux diverses démarches (monter une compagnie, écrire des dossiers, etc.). Avec De la sexualité…, j’ai participé à plusieurs symposiums artistiques où j’ai pu tester des parties du projet.
Et puis nous faisons attention à la relation entre l’artiste et le·a producteur·rice La relation est très soignée, ce qui est assez rare. La production atteint l’artistique de façon nette – chose à laquelle nous n’avons pas forcément l’habitude de réfléchir dans les autres cadres de production que je connais. Le fait de prendre soin de ce lien change le projet.
Y a-t-il des difficultés que vous avez appris à résoudre ?
A. D. : Notre modèle n’étant ni celui d’une compagnie ni celui d’un collectif : il y a ce fameux truc où nous ne rentrons pas vraiment dans les cases des subventions. C’est parfois un petit peu galère – il faut alors adapter le dossier pour qu’il corresponde aux critères requis, alors que nous serions tout à fait légitimes à obtenir des financements sur la base de notre fonctionnement. Heureusement, nous avons des relations de confiance avec nos tutelles qui comprennent la spécificité de notre projet, comme l’aspect vertueux de la mutualisation et du regroupement.
S. T. : Que veut dire une décision collective et comment mettre en œuvre cette prise de décision ? Cette question qui renvoie à ce qu’est le collectif et la coopérative est aussi passionnante que chronophage. Si elle n’est pas un problème, elle reste une difficulté avec laquelle composer…

A. D. : Il y a un point d’équilibre à trouver entre le choix de l’horizontalité, toutes les valeurs positives qui y sont associées et l’efficacité.
S. T. : C’est toute la question du temps que ça prend. À certaines périodes, j’ai pu parfois avoir l’impression de plus travailler à réfléchir à ce qu’était la coopérative qu’à mon propre spectacle. Là ça devenait un problème, car la coopérative est censée être là pour m’accompagner, m’aider dans l’élaboration de mon spectacle.
A. D. : La coopérative est une tentative d’échapper à la concurrence qui se trouve naturellement dans l’écosystème théâtral, comme à une certaine pression économique. Pour autant, ce n’est pas une baguette magique. Nous n’échappons ni à la question de l’argent, ni au fait qu’il faut faire des choix. Parfois, les relations avec les personnes diffusant et programmant recréent artificiellement une forme de concurrence entre les projets de la coopérative. Si nous nous en dépatouillons plutôt bien, nous savons à l’Amicale ne pas être complètement protégés des contraintes du milieu.
Qu’est-ce qui réunirait vos démarches esthétiques et formelles ?
A. D. : Ah, ça tombe bien parce que nous avons refait la liste de ça autour de la pizza ce midi !
Sofia Teillet, De la sexualité des orchidées © Anna Basile
64
S. T. : Pas moi – je vous ai entendu la faire, mais j’étais à l’autre bout de la table…
A. D. : Alors, il faut savoir que formaliser la ligne esthétique de l’Amicale, formuler ce qui nous rassemble est une question que nous nous posons un peu en rigolant de loin en loin. Si nous avons parfois joué au jeu de lister tout ça, ce n’est pas une réponse définitive… 1. Il y a la bonne ambiance et le jeu, le caractère ludique. Ces éléments se retrouvent dans la façon dont nous travaillons, à l’intérieur des projets comme à l’extérieur. D’ailleurs, cette question de l’intérieur et de l’extérieur – qu’on l’appelle « méta », distanciation brechtienne, le fait de montrer la représentation en train de se faire, le travail sur les outils – nous réjouit et nous amuse.
2. Il y a la mise en scène de la connaissance, qui souvent se retrouve au centre des objets créés. C’est l’idée de s’emparer d’un objet du champ du réel et d’essayer de le décortiquer d’une façon ludique.
3. Il y a la question des formats, et de la logistique de la monstration. Cela signifie s’amuser à mettre des « ou pas » dans tout ce qui définit un spectacle et l’expérience du public : un spectacle, c’est venir dans une salle – ou pas – un certain temps – ou pas –regarder des gens – ou pas – préparer des trucs – ou pas – et les montrer – ou pas. Cette démarche fait que nous nous retrouvons avec des spectacles radiodiffusés, ou dans des piscines à balles avec des citations de philosophie, ou avec des ateliers pâte à modeler et pliage d’origamis, etc.
S’il fallait prolonger cette liste, j’ajouterais que les spectacles de l’Amicale travaillent la fragilité, l’accident avec des dispositifs scénographiques souvent modestes et peu dispendieux…
A. D. : Il y a peut-être ce truc qui nous rassemble, mais c’est un équilibre. Nous aimons bien quand il y a à la fois quelque chose de fragile, de délicat, de simple, de pas prétentieux – qui pourrait confiner au désinvolte – mais tout cela ne tient que parce qu’il y a une autre jambe (à l’opposé). Il y a dans les projets d’autres endroits où nous allons en profondeur, où nous essayons d’avoir une grande rigueur et de produire des formes bien fichues, très structurées. Dans un texte de com’ nous disions il y a quelque temps « le j’en foutre côtoie le bien foutu ». Cet équilibre est important.
S. T. : Cette recherche d’équilibre définit assez bien mon travail. Pour De la sexualité…, j’ai lu des textes de sciences – qui n’est pas mon domaine –, j’ai mené des recherches rigoureuses, parfois ardues et tout l’enjeu était de les rendre joyeuses. Le propos des recherches scientifiques est fascinant, drôle, émouvant, alors que la littérature scientifique ne l’est pas du tout. Je me suis donc emparée de
mon outil de comédienne pour traduire dans un style drôle et enlevé ce qui me fascinait dans cette littérature.
Il y a également dans vos travaux un déploiement particulier de la pensée. Cela peut évoquer les associations libres, ou une écriture rhizomatique…
A. D. : Ami·e·s il faut faire une pause de Julien Fournet est, peut-être, le spectacle qui répondrait le plus justement à cela, car il aborde la façon dont la pensée se met en mouvement. Julien évoque différents types de pensées : la pensée cascade, la pensée liane, la pensée par sauts et gambades, etc. Il file la métaphore de comment les différentes étapes de la marche et du paysage renvoient à diverses étapes du processus de pensée dans le cadre d’un événement culturel en particulier. De manière métaphorique et philosophique, le spectacle s’interroge sur ce qu’est un événement culturel. Qu’est-ce qu’en être partie prenante ? Comment cela peut-il changer la vie ?
L’idée de la marche résonne d’ailleurs avec vos travaux…
S. T. : Pour moi, oui. Toute la durée des répétitions, j’ai lu des textes et sortais régulièrement marcher et fumer pour me les formuler seule. Le travail a été fait de ces allers et retours entre la position de lecture et la position en mouvement permettant de faire émerger la pensée. A. D. : C’est pareil pour moi, sauf que je ne fume pas... J’écris et m’enregistre beaucoup en marchant et j’ai du mal à travailler l’écriture et les idées sans cela. Ayant développé qui plus est un rapport un peu mystique à la forêt, j’y vais beaucoup marcher, car c’est là que je travaille super bien. Et puis il se trouve que Un faible degré d’originalité est aussi un spectacle filant la métaphore de la marche. Je représente les droits d’auteur comme un massif montagneux et j’emmène le public y faire une petite randonnée. Si ce massif a l’air austère, on peut en fait y observer de fabuleux paysages.
— PAYSAGE #2, 10 JOURS AVEC L’AMICALE, théâtre, performance, installation, conférence du 8 au 19 novembre au Maillon, à Strasbourg www.maillon.eu
65
BOULEVERSEMENTS
Par Sylvia Dubost
Petit rappel pour démarrer sur de bonnes bases : Iphigénie est la fille d’Agamemnon, roi de Mycènes. C’est lui qui dirige les troupes grecques contre la ville de Troie. Car tous les rois grecs ont prêté le serment de défendre collectivement, si besoin était, l’un des leurs. En l’occurrence Ménélas, dont la femme, Hélène, a été emmenée par Pâris, le fils du roi de Troie. Les voilà, donc, dans la baie d’Aulis, sur leurs navires, et il n’y a pas de vent. Si l’on en croit Calchas, le devin, les dieux sont en colère et pour les apaiser, il faut un sacrifice. Celui d’Iphigénie. Ça, c’est le mythe, dont Euripide tire sa tragédie. Tiago Rodrigues, auteur, metteur en scène et nouveau directeur du festival d’Avignon, opère de ce texte antique une relecture subtile. « Les dieux sont des histoires que l’on raconte aux Grecs pour justifier ce qu’ils ne comprendraient pas autrement », lance Agamemnon au début de sa pièce. Dès lors, si les dieux sont absents, ce sont bien les hommes qui décident en leur âme et conscience, et sont maîtres de leur destin. Si la marche du monde est sous leur responsabilité, qu’adviendra-t-il d’Iphigénie ? Les paradoxes de l’âme humaine s’invitent alors dans la tragédie. Le sens s’épaissit et les pistes se multiplient. Dans sa mise en scène, Anne Théron, artiste associée au TNS, fait entendre toute la richesse de la pièce et la beauté de la langue, à qui elle offre un écrin de ténèbres et des acteurs somptueux.
Qui est Iphigénie ? Que représente-t-elle ? Dans le mythe, c’est la jeune fille sacrifiée pour que les Grecs puissent partir faire la guerre et anéantir les Troyens. Dans la tragédie d’Euripide, c’est la victime qui accepte d’être sacrifiée pour obéir aux dieux, au père, pour soutenir les Grecs. Ce que Tiago Rodrigues a fait, et c’est colossal, c’est qu’il repart du canevas d’Euripide, mais qu’Iphigénie dit non. Elle va mourir, mais elle dit non au fait qu’on se souvienne d’elle. Elle veut arrêter le cycle. Et ça change tout. Elle va mourir de son plein gré, mais interdit qu’on la touche, qu’on l’approche et exige qu’on l’oublie. Elle ne
veut plus avoir affaire à ce monde de mensonges et de meurtres. C’est une très grande pièce féministe, révolutionnaire. Quand je l’ai lue pour la première fois, j’ai été bouleversée, et j’ai mis du temps à comprendre pourquoi. Elle ouvre la porte sur un autre possible, sur un autre futur. C’est énorme. Même si cela n’empêche pas la tragédie… Iphigénie va mourir pour que cela ne recommence plus. J’ai toujours été dubitative quant aux adaptations, mais là il s’agit d’une relecture absolue et politique.
Maintenant que les dieux ont disparu, comment se transforment les personnages ?
Quand on dit que les dieux n’existent pas, cela signifie que les personnages ne sont plus ces figures articulées par une autre volonté. Tous deviennent actifs, même ceux qui interviennent de façon brève. Et c’est encore plus fort pour les femmes, car elles étaient au service des hommes et des dieux. Ici, ce sont des femmes qui disent non : c’est d’une radicalité absolue. Iphigénie devient une jeune femme d’aujourd’hui qui fait ses choix, alors que jusqu’à présent, elle était soumise à d’autres volontés que la sienne.
Mais on reste quand même, en termes de tragédie, entre deux impossibles : Agamemnon par exemple ne peut pas refuser de faire la guerre et ne peut pas tuer sa fille. Tous sont des acteurs agissants de l’histoire, mais la tragédie se répète toujours, on ne peut y échapper…
DANS SON IPHIGÉNIE, TIAGO RODRIGUES TRANSFORME LA TRAGÉDIE ANTIQUE EN UNE PIÈCE POLITIQUE D’UNE MAGNIFIQUE INTELLIGENCE. SA MISE EN SCÈNE, ANNE THÉRON FAIT ENTENDRE TOUTE LA FORCE DE CE TEXTE QUI SUGGÈRE QUE, PEUT-ÊTRE, PLUS RIEN NE SERA JAMAIS COMME AVANT. ENTRETIEN.
DANS
66
Quelle différence faites-vous entre une figure et un personnage ?
Une figure est articulée par des forces et se situe dans la dimension symbolique. Un personnage, c’est un système organique, mental, émotionnel. C’est un quidam à qui on va donner un visage, une mémoire…
La mémoire est un sujet important dans le texte et le spectacle, cette mémoire qui nous conduit à répéter les mêmes actions…
La mémoire est une force, c’est un savoir, c’est tout ce que nous avons acquis. Le problème, c’est qu’elle est souvent utilisée pour la vengeance, qu’elle devient une arme. C’est aussi l’enfant de la souffrance. Ça fabrique des individus qui accumulent les traumas Et s’il n’y a pas de travail sur la mémoire, il ne peut pas y avoir de résilience. Dans Iphigénie, il y a la mémoire du serment des rois de s’associer pour faire la guerre lorsque l’un d’entre eux est menacé. Faut-il le respecter ou le contextualiser ? Il y a la mémoire de la conquête, de l’honneur, la mémoire politique… Mais les réponses ne sont pas toutes prêtes. Il s’agit de participer à une grande œuvre qui propose une autre gestion de la mémoire, pour qu’elle ne soit pas une entrave mais nous nourrisse.

Dans quel état mettez-vous le spectateur ? Avec mon gang, c’est-à-dire toute l’équipe artistique, on ne délivre pas des objets clé en main. Avec les informations dramaturgiques qui lui arrivent, le spectateur doit faire un chemin personnel. Ce que je voulais partager, et ça a été très fort, c’est mon bouleversement, cette sensation d’être déplacée à l’intérieur de moi-même. Je me suis demandé si j’aurais la force de le faire. À Avignon [le spectacle a été présenté durant le festival en juillet 2022, ndlr], c’était magnifique, il y avait des gens très émus, sans doute parce qu’on assiste à ce désir, à cette nécessité de faire autrement. Je ne savais pas toujours quoi répondre…
Le mot-clé de ce spectacle, c’est « bouleversement »… Oui. Un mot polysémique, qui signifie changer les choses, et là il y a une proposition. Le Festival d’Avignon m’avait demandé de faire une vidéo de présentation. Comme j’étais sur d’autres projets, je l’ai faite à la dernière minute, le soir. À ce moment-là un sentiment très fort m’a traversée. J’ai parlé des femmes qui disent non, à la mémoire qui fait faire n’importe quoi, à la guerre. Et le lendemain matin, Poutine envahissait l’Ukraine…
Anne Théron © Jean-Louis Fernandez
67
Ça m’a complètement bouleversée. Le discours de Clytemnestre prend alors une force incroyable : estce que cette guerre est juste ? Qui en a décidé ? C’est une jeune fille qu’on tue, ce n’est pas abstrait ! Le texte devient alors saisissant…
Partager le bouleversement, c’est extrêmement délicat… À quoi avez-vous fait particulièrement attention ?
Ce qui tue un texte, c’est de le jouer. Il y a une phrase de Thomas Bernhardt qui m’obsède : « Contentez-vous de dire le texte, mais dites le bien ! » Le texte comme une partition, dont l’acteur est le sublime interprète. Glenn Gould ne joue pas Bach, il est la musique. Il ne faut pas jouer Agamemnon, il faut être Agamemnon, être plein de cette parole, la faire entendre. Le théâtre est l’endroit de la parole, c’est pour cela que j’en fais. Il y a des textes qui ne cessent de parler, qui ne sont jamais épuisés. Et celui-ci est un des très grands de Tiago.
Tous les comédiens sont en scène tout le temps : pourquoi ? Est-ce que cela marque une responsabilité collective ?
C’est un collectif, c’est très clair. C’est lui qui raconte l’histoire. Et c’est ensemble que les hommes n’arrivent pas à échapper à cette fatalité.
Mais être sous le regard des autres en permanence, c’est très compliqué pour les comédiens. Quand est-on comédien ? Quand est-on personnage ? Comment être tout le temps « in » mais sans être actif. Thierry Thieû Niang a imaginé comme une chorégraphie collective, qui fabrique du lien entre tous. Ces comédiens d’horizons différents ont trouvé une vraie harmonie.
Deux acteurs portugais incarnent les personnages d’Iphigénie et Achille, et on entend bien que le français n’est pas la langue. Quelles pistes cela ouvre-t-il ?
J’aime travailler avec des gens qui viennent d’ailleurs, qui n’ont pas du tout les mêmes backgrounds. Cela fait partie de mes grandes joies, et cela me nourrit.
J’aimais qu’Iphigénie soit l’étrangère, qu’elle parle une autre langue que ces gens-là. C’est un peu simpliste mais cela marche tellement bien sur le plateau que cela porte forcément une vérité. Dans son histoire avec Achille, je voulais que le portugais soit la langue de l’amour, leur langue commune. Dans un sens littéral, presque lacanien, ils parlent leur propre langage.
Vous avez respecté l’unité de temps, l’action se déroule l’espace d’une nuit… pourquoi la nuit ? La pièce d’Euripide se déroule de jour, mais j’avais besoin d’être dans un quasi noir et blanc. Je ne pouvais pas imaginer la mer Méditerranée : on n’est quand même pas au Club Med ! Et puis la nuit porte conseil [rires]. J’aime créer des espaces hors temps, hors lieu, plus proche du rêve et du cauchemar que de ce qu’on appelle la réalité.
L’unité de temps, c’est la pression de la tragédie : ça va vite, on n’a pas le temps de le régler. Il y a dans le texte un suspense que j’ai trouvé passionnant. Le chœur dit dès le départ : « Parce que nous pouvons nous fier à la tragédie. Elle finit toujours mal. » Pourtant, on ne peut s’empêcher, jusqu’au bout, d’espérer que cela finira bien…
— IPHIGÉNIE, théâtre du 13 au 22 octobre au TNS à Strasbourg www.tns.fr

 Iphigénie © Jean-Louis Fernandez
Iphigénie © Jean-Louis Fernandez
Iphigénie © Jean-Louis Fernandez
Iphigénie © Jean-Louis Fernandez
68
Par Benjamin Bottemer ~ Portrait : Romain Gamba

L’OPÉRA FAIT MAISON
LIEU DE CRÉATION, L’OPÉRA-THÉÂTRE DE METZ INAUGURE SA NOUVELLE SAISON SOUS LES AUSPICES DE LA LUNE, À LA CROISÉE DES PRATIQUES, LE REGARD TOURNÉ VERS L’AILLEURS MAIS AUSSI VERS LE MONDE. Opéra-théâtre, Metz Métropole © Christian Legay 69
Il n’y a pas de plus vénérable institution culturelle à Metz : inauguré en 1752, il est le plus ancien théâtre de France encore en activité. Installé sur l’île du Petit-Saulcy, surplombé par la cathédrale SaintÉtienne, l’Opéra-théâtre et sa salle à l’italienne accueillent l’art lyrique, le ballet et le théâtre. Disposant de ses propres ateliers et des artistes permanents de son chœur et de son corps de ballet, c’est une entité quasi anachronique à l’heure des coupes budgétaires et des sorties de crises à répétition. Son directeur Paul-Émile Fourny se réjouit des bonnes ventes de la billetterie en ce début de saison « normale » (enfin !) et de la fidélité du public, qui ne s’est jamais démentie. Il présente cette nouvelle saison qui s’annonce, avec une création mondiale et de multiples productions : l’avenir de la maison et d’un art qu’on a voulu trop vite ranger dans la catégorie « ringard » mais qui selon lui a plus que jamais des choses à dire sur le monde actuel.
Les spectacles de cette saison nous emmènent vers des destinations, des atmosphères et des univers très différents, jusqu’au merveilleux et au fantastique. La proposition est-elle de nous faire voyager ?
Pour moi, l’opéra est si international, ses thèmes si universels, que le voyage s’impose de lui-même. Je parlerais plutôt d’une volonté d’attiser la curiosité. Chacun a son propre imaginaire, mais en spectacle
vivant on doit faire le choix de proposer sa propre lecture d’une œuvre. Et si faire rêver les gens est aussi notre objectif, les rêves ne sont pas tous beaux !
Vous avez choisi la Lune comme « fil conducteur » de cette saison. Comment ce thème est-il abordé ? On peut en avoir différentes perceptions : la Lune est l’astre de la nuit, où il se passe des choses merveilleuses et atroces. Nous avons d’une part deux créations où la Lune est au cœur du sujet : Le Voyage dans la Lune d’Offenbach et Il mondo della luna de Haydn. Mais on la retrouve aussi en filigrane ailleurs : dans Coppélia, c’est à la tombée du jour que les poupées s’animent ; dans Rusalka, on retrouve un air très célèbre baptisé « La Prière à la Lune » ; Enigma met en scène une rencontre nocturne de bout en bout.
Enigma est le grand projet de création de cette saison, un opéra adapté d’une pièce d’ÉricEmmanuel Schmitt proposée également dans sa version théâtrale. Qu’est-ce qui vous a attiré vers cette œuvre ? Nous avions surtout envie, avec l’Opéra de Montréal, de travailler sur la composition de Patrick Burgan, d’après le texte d’Éric-Emmanuel Schmitt Variations énigmatiques . Il m’a semblé intéressant de montrer la version théâtrale et la version lyrique, qui n’a jamais été montée. J’ai mis en scène les deux versions car je viens du théâtre et que j’ai cette culture de naviguer entre différentes disciplines, ce qui n’est pas toujours bien accepté en France. Je cherche toujours à lier art lyrique, théâtre et danse à l’Opéra-théâtre, c’est l’une de nos spécificités.

Les publics lyrique, théâtre et danse se croisentils à l’Opéra-théâtre ? C’était l’ambition lorsque je suis arrivé en 2011, et je crois que la mixité s’est développée. On s’est efforcés de décloisonner en arguant que c’est l’émotion qui prime, pas la forme. L’opéra avait ses clichés : ça ne joue pas, c’est du sport vocal... la musique y est toujours centrale, et la technique vocale fait beaucoup pour transmettre les émotions, mais aujourd’hui les chanteurs jouent et peuvent faire passer des choses physiquement.
Un autre cliché consiste à dire que l’opéra est un monde réservé à l’élite et qui ne s’adresse pas à la jeunesse. Qu’en pensez-vous ? Je suis fier qu’un quart des places achetées le soient par les moins de 25 ans, qui viennent voir du lyrique alors qu’avant ils étaient très tournés vers le théâtre et la danse. L’opéra a souvent été traité de ringard, mais dans la salle, sur la scène et chez les auteurs, l’opéra d’aujourd’hui ne manque pas de dynamisme, de jeunesse, ni de propos contemporains. Il continue à être un miroir de la société.
Paul-Émile Fourny
70
La moitié des spectacles présentés sont des productions, en comptant les coproductions on atteint la quasi-totalité de la programmation. Une démarche qui définit l’Opéra-théâtre avant tout ?
Oui, nous sommes avant tout une maison de production, en cela nous faisons figure d’exception. Nous avons un corps de ballet, un chœur et nos propres ateliers pour les décors et les costumes, ce qui est de plus en plus rare. Depuis mon arrivée, nous réalisons également une nouvelle création tous les deux ans. Notre rôle est aussi d’aider les théâtres ne disposant pas de ces outils pour pouvoir livrer des visions nouvelles des œuvres par différents metteurs en scène, directeurs musicaux et chorégraphes internationaux, ce qui est primordial.
Pouvez-vous évoquer quelques spectacles emblématiques de cette saison ?
Il nous a paru important de confier la mise en scène, la direction musicale, les costumes et les décors de Madama Butterfly , une histoire où le machisme est à son apogée, à une équipe italienne entièrement féminine. Xynthia aborde l’opéra d’une façon totalement différente, en termes de placement des chanteurs notamment, autour du thème de l’eau et de son devenir, le tout avec une démarche écoresponsable. On peut aussi parler de Coppélia, un grand ballet pour les fêtes de fin d’année, et d’une nouvelle version du Sacre du printemps , si prenant et bouleversant qu’il reste toujours irrésistible, précédé de La Maison de Bernarda Alba : deux chorégraphies de Ralf Rossa, qui vient de nous quitter.
On retrouve aussi la comédie musicale Frankenstein Junior de Mel Brooks. Son succès vous incite-t-il à vous tourner davantage vers ce genre de propositions ?
En termes de comédie musicale, nous avions déjà créé My Fair Lady ou L’Auberge du Cheval-Blanc . Personnellement, je suis assez fan du genre, même si c’est très compliqué à monter : il faut du rythme, beaucoup de costumes et de changements de décor, on ne peut pas se permettre d’être cheap ! Nous avons montré Frankenstein Junior quatre fois la saison passée et il était encore très plébiscité, nous l’avons donc reprogrammé.
À partir de 2025 et pour deux saisons, de grands travaux sont prévus à l’Opéra-théâtre. Comment allez-vous vous adapter ?
Cette période va nous amener à sortir des murs de l’Opéra, à mener une réflexion globale sur la ville et les environs. C’est très excitant ! Nous pourrons imaginer des choses à l’Arsenal, mais aussi à la Boîte à Musiques où un répertoire lyrique peut être donné : la musique de Piazzolla par exemple y aurait toute sa place. Il y a aussi la basilique
Saint-Vincent toute proche. On pense également à une tournée internationale pour le ballet, qui s’est naturellement renouvelé en dix ans : ce serait une première pour nos danseurs. Tout ceci pourrait constituer un détonateur, une occasion d’exporter ce que l’on a acquis, et nous permettre de renouveler notre image sans perdre de vue notre mission lyrique ; et surtout la volonté de défendre l’émotion sous toutes ses formes.
— MADAMA BUTTERFLY, opéra les 2, 4 et 6 octobre

— FRANKENSTEIN JUNIOR, comédie musicale les 28, 29 et 30 octobre
— ENIGMA, opéra les 18, 20 et 22 novembre
— VARIATIONS ÉNIGMATIQUES, théâtre les 1er, 2 et 3 décembre
— COPPÉLIA, ballet les 21, 22, 23, 26, 31 décembre et le 1er janvier
opera.eurometropolemetz.eu
 Frankenstein Junior © Luc Bertau
Le Sacre du printemps, final © Raymond Veber
Frankenstein Junior © Luc Bertau
Le Sacre du printemps, final © Raymond Veber
71

ÉLISE VIGIER DOUBLE JE
Par Nathalie Bach ~ Photo : Christophe Raynaud de Lage
REPRÉSENTÉES DANS ANAÏS
NIN AU MIROIR, LES MILLE VIES DE LA CÉLÈBRE DIARISTE
Vous dites comme tout le monde et c’est vrai, on ne peut que constater l’incroyable engouement qui perdure pour cette auteure mais aussi sa réduction à une littérature dite érotique et qui passe d’ailleurs souvent par le biais du masculin. Eh bien, moi, je n’avais même pas lu les nouvelles érotiques, enfin, c’est la dernière chose que j’ai lu d’elle ! C’est tout de même incroyable de voir à quel point on enferme quelqu’un qui passe quasiment tout son temps, par sa vie et son écriture, à échapper à tout cloisonnement. Ça se concrétise particulièrement dans ses nouvelles par ce qu’on pourrait appeler un réalisme magique. Et elle est absolument géniale, elle essaie tout le temps de transformer la réalité, d’en faire une expérience et que cette expérience devienne possiblement fictionnelle. Elle travaille sur le temps, sur le fait de n’être jamais figée. L’érotisme, Anaïs Nin le pose à plein d’endroits mais il n’est pas que sexuel.
Contrairement à ce que le titre pourrait laisser présager, ce n’est pas un texte d’Anaïs Nin qui est donné ici, mais celui d’Agnès Desarthe. Une façon de convoquer Anaïs Nin autrement, d’aller jusqu’au bout de sa multiplicité ou d’embrasser au mieux son œuvre ? J’ai rencontré l’œuvre d’Anaïs Nin, que je ne connaissais pas, enfin comme tout le monde, par L’Intemporalité perdue et autres nouvelles qu’elle a écrit vers 25 ou 26 ans et Agnès Desarthe en a fait la traduction. Je lui ai demandé d’en faire une adaptation et très vite, effectivement, nous avons eu envie d’entrer dans la multiplicité et les reflets d’Anaïs Nin, c’est l’inverse d’un biopic en fait. C’est plus la rencontre avec des Anaïs Nin d’un instant, et finalement dans ce texte il y a autant d’Anaïs Nin que d’Agnès Desarthe.
À peu près à la même époque en France, il y a Pauline Réage avec une écriture également très puissante. Histoire d’O est une sorte d’enfermement sexuel et bourgeois qui tranche avec l’ouverture au monde d’Anaïs Nin. On a pu reprocher à cette dernière son narcissisme mais est-ce que ce ne sont pas justement des ombres portées à l’universel ?
Sa curiosité immense fait d’elle une sorte de radiographe comme si les autres s’imprégnaient sur elle, au sens photographique du terme. Elle est un espace de rencontre, de disponibilité avec son corps, sa tête, son imaginaire avec l’autre mais aussi de la nature, à la magie. Je pense que là où elle dérange, c’est qu’elle ne lâche pas son sujet, elle fonctionne comme les oiseaux dont elle parle souvent, comme si elle était au-dessus de ce qu’elle étudiait.
FRANCO-AMÉRICAINE SE RÉUNISSENT À TRAVERS UNE AUDACIEUSE MISE EN SCÈNE D’ÉLISE VIGIER.
73
Anaïs Nin, c’est soixante-trois ans d’écriture journalière ininterrompue, 35 000 pages manuscrites, dans la littérature diariste sa vitalité est sans équivalence. Une sorte de vertige qui relève presque d’un esprit quantique. Vous avez eu à cœur de restituer cette densité dans une forme théâtrale vraiment à part, comment la définir ? Je crois qu’on ne peut pas la définir, (rires) disons que c’est une sorte d’ovni ! Il y a par exemple des numéros de magie, de cabaret, parce qu’il y a plein de nouvelles qui se passent dans les loges d’un théâtre, c’est l’époque des music-halls, les années 1930. Ce sont des acteurs en train de répéter une pièce sur Anaïs Nin, en 2022, à tel point qu’elle est là, comme un fantôme et elle les interroge. Mais je pense qu’avant tout, ce spectacle est un voyage sur l’imaginaire parce qu’au théâtre il n’y a aucune limite. Elle a cette phrase magnifique : « Avoir de l’imagination, c’est s’assoir dans le métro en face d’un homme qui porte un chapeau gris, regarder ce chapeau gris et que ce gris vous rappelle le gris des rochers de Majorque et celui de l’écorce des vieux oliviers, ce même gris que portent les Espagnols à la corrida, et donc, avoir de l’imagination, c’est voyager tout autour du monde parce que l’homme assis en face de vous dans le métro porte un chapeau gris. N’avoir aucune imagination c’est regarder pendant vingt minutes le chapeau gris et remarquer qu’il est taché. » Chez Anaïs Nin, tout est sensuel, physique, comme si les mots avaient à voir avec le corps, ce qui est le fait même des comédiens. Avec ces nouvelles, j’avais envie de travailler sur la réalité mais par un autre angle.
« Ce fantastique dont on s’aperçoit toujours plus qu’il est en réalité tout le réel », disait Artaud. Dans le cas de Nin, il est difficile de faire abstraction d’un état de dissociation permanent, jusqu’à consigner une vie « normale » dans un cahier vert et ce qu’elle ne voulait pas forcément mettre au grand jour dans un cahier rouge. Comment ne pas évoquer sa relation incestueuse avec son père et ses liaisons avec ses deux psychanalystes. Elle avait l’écriture mais le miroir a-t-il suffi ? Pendant qu’elle est en train d’écrire ses nouvelles fantastiques, elle a cette phrase : « Si je n’avais pas créé mon propre univers, je serais morte dans celui des autres. » Il y a chez elle cette nécessité absolue à être
dans l’écriture tout en ne revendiquant pas d’en faire œuvre ou tout du moins une grande œuvre et c’est un espace que j’ai essayé de garder. Elle est là où elle est au moment où elle est. Elle dit d’ellemême qu’elle ne sait pas si elle arrivera à écrire des romans, et qu’avec ses journaux elle est dans l’art mineur et que cela lui plait.
Le prix littéraire Anaïs Nin, créé en 2015, a été décerné pour la première fois à Virginie Despentes pour le premier tome de Vernon Subutex . On peut se dire qu’Anaïs Nin est féministe, mais le revendiquait-elle ?
Dans Les Roses rouges , elle dit ne rien vouloir attendre, vouloir tout, tout de suite, l’incandescence, le feu. Dans plusieurs de ses conférences, elle parle beaucoup d’une femme qui serait une nouvelle femme, totalement libre, qu’elle y travaille pour l’avenir en sachant qu’elle-même ne le verra pas. Tout cela sans forcément de clivage avec ou par les hommes. C’est totalement féministe, mais pas féministe contre.
D’une certaine façon, cela fait lien avec le dernier ouvrage de Despentes.
Oui, ce que Virginie Despentes y dit, c’est qu’il n’y a pas de féminisme qui rendrait tout clair d’un côté et haineux de l’autre, mais un endroit certes toujours complexe mais plus libre qui permettrait peut-être à chacun d’exister. En ce sens, elle rejoint Anaïs Nin. Je trouve que toutes ces matières permettent vraiment d’y travailler.
Féministe, quel sens a ce mot pour vous ? J’ai été élevée par une féministe, très active, j’ai vraiment été baignée dans ce milieu. Aujourd’hui je me sens dans une zone de féminisme que j’aurais beaucoup de mal à définir, j’aurais du mal à mettre des mots dessus à part bien sûr être libre, avoir les mêmes droits, etc… Pourtant une définition arrêtée ne me satisfait pas complètement. Mais on voit bien qu’il faut absolument continuer à militer, que rien n’est jamais gagné. Je crois que, quels qu’en soient les mouvements, le mot même de féminisme doit continuer, il signifie que quelque chose est toujours en train de se penser.
— ANAÏS NIN AU MIROIR, théâtre du 18 au 21 octobre au Théâtre Dijon Bourgogne
www.tdb-cdn.com
— L’érotisme, Anaïs Nin le pose à plein d’endroits mais il n’est pas que sexuel. —
74
les bougies
La musique se fête et avec elle les dix ans d’October Tone –une décennie à carburer à fond ; les trente ans du Noumatrouff et sa brochette de piliers ; trente ans de fanzines musicaux collectionnés par Renaud Sachet ; les presque quarante du toujours prodigieux festival Météo ; et les vingt-cinq de l’intemporel Ici d’ailleurs !
Soufflez
Par Sylvain Freyburger ~ Photo : Philippe Schweyer

LA BOÎTE À SOUVENIRS DU NOUMATROUFF
CLÉO SCHWEITZER Auteure du livre Les 30 ans du Noumatrouff (Médiapop Éditions)
Ton premier souvenir : La première visite de cette ancienne usine qui deviendra le Nouma, il y avait encore de vieux registres de compta, un toboggan pour marchandises et autres détails qui rappelaient le passé industriel du lieu... Nous avons retroussé nos manches, nettoyé, peint, arraché de la moquette, trouvé de vieux meubles pour leur redonner une nouvelle vie : l’économie du recyclage, on ne faisait que cela !
Ton meilleur souvenir : Les soirées Bêtes de Scène !
Avec des stands, des concerts, des associations qui présentaient des projets, des artistes qui faisaient chavirer le public, des nuits d’été à Mulhouse inoubliables grâce à une mobilisation de bénévoles incroyable qui transformait la cour du Nouma en la plus belle terrasse de la ville.
Ton pire souvenir : Le cambriolage jamais élucidé du Noumatrouff, nous n’avons jamais su ce qu’il s’était vraiment passé cette nuit-là…
Ton souvenir le plus insolite : Le spectacle de la Tribu Pyrophore au champ de foire à Dornach, du théâtre de rue puissant et militant que j’avais programmé dans le cadre d’un Bête de Scène !, le public était scotché par le spectacle et nous aussi !
Ton dernier souvenir en date : Cette période de pandémie qui a contraint les lieux tels que le Noumatrouff à appliquer des protocoles impossibles... Et voir revenir peu à peu le public, si heureux de pouvoir se retrouver dans une salle de concert, debout, sans masque, au milieu des autres. Nous avions presque oublié combien c’est essentiel de vivre des expériences collectivement et que la musique live reste indispensable à l’humanité.
FANFAN Créateur présumé du nom Noumatrouff
Ton premier souvenir : La fameuse première réunion de la fédération Hiéro dans la cour du futur Nouma où il fallait trouver un nom !
Ton meilleur souvenir : Le concert de Violon Profond où le chanteur a littéralement vomi en jet sur le public !
Ton pire souvenir : Les concerts de la petite salle avec la vieille sono qui cramouillait de manière assez insupportable !
Ton souvenir le plus insolite : Le concert de Gonzales et Feist un lundi de Pâques où on était maximum une quarantaine et où il a joué au piano n’importe quel morceau que la salle lui proposait !
Ton dernier souvenir en date : Les soirées Rock After Work des saisons dernières, gratuites, un encas servi toujours bon et un groupe de rock toujours excellent !
KEM LALOT Programmateur de 1994 à 2000
Ton premier souvenir : En tant que spectateur, c’était le concert de Tool, en 92 ou 93… En tant que programmateur, Tri Yann, en 94 ! Ce n’est pas celui dont je suis le plus fier artistiquement, mais ça fait partie de la diversité de la programmation… Et on a affiché complet, pour un début, c’était encourageant.

Ton meilleur souvenir : Il y en a énormément, mais je choisirais une date organisée par le Nouma à la Salle des fêtes de Kingersheim pour des raisons de place. C’était Fugazi, le 6 octobre 95, un groupe rare qui a ramené un millier de spectateurs !
Ton pire souvenir : Dans la petite salle, le concert de Raggasonic, complet longtemps à l’avance… 500 personnes en plus ont essayé d’entrer, dont une centaine se sont vraiment accrochés, ont tenté de passer par la fenêtre des toilettes ! On en rigole maintenant, mais sur le coup on faisait pas les malins.
Ton souvenir le plus insolite : Le collectif Plasma programmait des artistes expérimentaux. Il y a eu une soirée avec le collectif autrichien Synthesis, qui faisait de l’electro martiale et lancinante tout en diffusant des images en accéléré. Ça produisait des sensations assez fortes, il y a eu des malaises dans la
30 ANS DE SOUVENIRS EN 5 QUESTIONS, TEL EST LE DÉFI AUQUEL ONT ACCEPTÉ DE SE PRÊTER UNE BROCHETTE D’HABITUÉS EMBLÉMATIQUES DE LA FAMEUSE SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DE MULHOUSE.
Last Train lors des 20 ans du Noumatrouff le 27/10/2012. 77
salle, moi j’ai trouvé ça génial ! Et pendant Bêtes de Scène !, on avait pour tradition de s’asperger avec des seaux d’eau à la fin du festival… C’est ainsi que j’ai aspergé un DJ qui devait jouer dans la soirée, en le prenant pour quelqu’un d’autre ! Ça va, il l’a bien pris !
Ton dernier souvenir en date : C’était dans le cadre du festival GéNéRiQ, début 2020, ça ne s’était d’ailleurs pas passé au Nouma mais délocalisé à la Cité du Train avec Inspector Cluzo, c’était très bien.
JOAN SPIESS Dessinateur
Ton premier souvenir : Mon premier souvenir du Nouma remonte à avant le Nouma… Cet espace s’était appelé pour une courte période « atelier Stakhano » et nous y avons construit le « schoffmobil » avec Louis Perrin.
Ton meilleur souvenir : Sloy qui a joué pour mon anniversaire.
Ton pire souvenir : Le jour où j’ai déchiré ma carte de membre de la fédération Hiéro Mulhouse.
Ton souvenir le plus insolite : Un groupe de metal nordique qui a déclenché une fausse bagarre histoire de provoquer la dispersion de quelques relous qui voulaient entrer à l’œil. Efficace !
Ton dernier souvenir en date : Bizarre, je ne m’en souviens pas, il doit être loin.
LAST TRAIN Groupe rock
Ton premier souvenir : On avait été invité, à jouer en première partie du groupe My Fancy Zoot qui sont devenus des amis depuis. C’était un accomplissement de pouvoir enfin jouer dans cette salle après avoir fait tous les bars du Haut-Rhin !
Ton meilleur souvenir : On avait achevé notre tournée en décembre 2015 à Mulhouse, c’était aussi notre centième date de l’année. Les gens étaient tous à fond, que ce soit la Radio Eponyme [ partenaire de cette soirée Locomotiv’, ndlr ] ou le public, on en avait oublié la fatigue, ça a été encore plus beau !
Ton pire souvenir : On a tourné plusieurs clips dans les locaux du Nouma. Pour celui de Leaving You Now, Jean-Noël [chanteur du groupe, ndlr] avait 40 degrés de fièvre et s’est retrouvé à tourner des plans en boucle jusqu’à tard dans la nuit. Il délirait à moitié quand on l’a ramené chez lui.
Ton souvenir le plus insolite : Notre dernier passage ici était le jour de l’anniversaire de JeanNoël. On a pu fêter ça en loge après le concert. Il y avait nos familles, son grand-père et des amis et leurs enfants un peu partout, je ne m’imaginais pas vivre ça ici plusieurs années auparavant.
Ton dernier souvenir en date : On est passés à l’automne 2021 pour notre dernière tournée, c’était la première fois qu’on faisait le Nouma complet. Se rendre compte qu’on fait maintenant partie des groupes qu’on allait voir plus jeunes, ça nous a remplis de reconnaissance.
ALEXIA GREDY Chanteuse (en concert au Noumatrouff le 20 octobre avec Terrenoire)
Ton premier souvenir : C’était pour voir le groupe Dolly, j’avais 14 ans et avec mes copines c’était notre premier concert !
Ton meilleur souvenir : Le premier forcément ! Je me souviens surtout de l’entrée dans la salle : la musique forte et jouée pour la première fois, les basses qui font bondir le cœur.
Ton pire souvenir : J’ai été bénévole au Noumatrouff à 17 ans, je m’occupais du vestiaire et j’adorais ça mais parfois les gens un peu ivres en fin de soirée étaient difficiles à gérer…
Ton souvenir le plus insolite : J’y ai rencontré mon premier amoureux à un concert d’Enhancer, un groupe de metal français, quand j’avais 15 ans.
Ton dernier souvenir en date : Il y a quelques mois j’y suis retournée avec les journalistes de France 3 Alsace. Rien n’a changé, la petite cabine où je faisais le vestiaire est toujours au même endroit.
JESERS Rappeur/chanteur/slammeur (en concert au Noumatrouff en décembre pour le festival Locomotiv’)
Ton premier souvenir : Je faisais partie du groupe Napo’n’co, on a fait l’inauguration du Nouma dans la petite salle et on a pu voir ce qu’il y avait à côté, dans ce qui allait devenir la grande salle : c’était quelque chose de très très abandonné ! Comme quoi on peut faire des miracles…
Ton meilleur souvenir : Il y en a plein… En 2003, j’ai joué avec La Vieille École lors du tremplin des Eurockéennes, ma famille était là, et Kem nous a annoncé qu’on avait remporté le tremplin… Ce qui nous paraissait inaccessible est devenu d’un coup accessible !
Ton pire souvenir : J’en ai pas !
Ton souvenir le plus insolite : C’était lors d’une soirée avec Tété, on s’était déjà croisé à Montréal, il m’a demandé si j’acceptais qu’il m’interviewe pour sa “TéTV” ou quelque chose comme ça… Je suis fan de son écriture, c’était étonnant et insolite !
Ton dernier souvenir en date : Il y a une semaine, pour une répet’ !
www.noumatrouff.fr
78
Par Valérie Bisson
Comment t’est venue l’idée d’une telle exposition ? J’ai recommencé à écrire et éditer des fanzines en 2018, Langue Pendue d’abord, puis Groupie en 2020 pendant le premier confinement, les deux sont très liés puisqu’ils parlent de musique en français. J’ai proposé cette exposition à la médiathèque Malraux avant le Covid et cette idée a été reprise pour les Médiathèques en débat. Pour moi, cela a été l’occasion de me replonger dans les fanzines du début des années 90, ceux que je lisais et aussi ceux que je fabriquais, je me suis dit que ça pouvait être un fil, cette histoire particulière des fanzines musicaux entre les années 1990 et 2020.

DANS LA LIGNÉE DE LA DEUXIÈME ÉDITION DES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DU FANZINE AU CONFORT MODERNE DE POITIERS QUI A EU LIEU CET ÉTÉ, RENAUD SACHET, ARTISAN DE FANZINES DEPUIS L’ÂGE TENDRE, SE PENCHE D’ENCORE PLUS PRÈS SUR LE SUJET EN ORGANISANT UNE RÉTROSPECTIVE DU FANZINE MUSICAL DES ANNÉES 1990 À 2020 À LA MÉDIATHÈQUE OLYMPE-DEGOUGES. L’OCCASION DE REVENIR SUR CE QUI EXISTE ENVERS ET CONTRE TOUT. MUNDANEUM
Années 1990-2001. Guiding Star, Super G, Scool ! et Tchatchouka, Renaud Sachet 79
Comment s’organise l’exposition ?
Il y aura entre 120 à 150 fanzines proposés à la lecture, ils seront consultables dans une sorte d’espace-salon, on ne souhaitait pas les garder sous vitrines. C’est mon fonds personnel et j’ai récupéré aussi des archives chez des copains. Il y a un fonds de fanzines graphiques à la médiathèque Malraux au Centre de l’illustration, on en présentera qui ont un lien avec la musique et je serai sur place deux heures par jour pour guider et proposer des cheminements à travers la collection ; il y aura aussi la projection du passionnant documentaire Fanzinat de Laure Bessi, Guillaume Gwardeath et Jean-Philippe Putaud-Michalski qui revient, par de multiples interviews, sur la scène du fanzine en France, avec un focus particulier sur les années 80 et 90. Il y aura aussi un concert de Joni Île dont j’ai édité une K7 ainsi qu’un atelier fanzine animé par Papier Gâchette. J’ai tiré le fil de tout l’environnement du fanzine des années 90, ceux qu’on s’échangeait par courrier, qui étaient influencés par la presse, les fanzines anglo-saxons


et Les Inrockuptibles bien sûr, Bernard Lenoir à la radio, autant de phares pour toute une génération. Il y avait aussi tout un environnement de presse alternative qui naissait, Ritual, Another View, L’Indic, Magic … Je tire le lien jusqu’à aujourd’hui. En refaisant un fanzine en 2018, j’ai reconnecté avec des jeunes ou des gens de mon âge qui continuent à écrire et à fabriquer.
En tant qu’acteur, artisan de cette pratique, et amateur, voire collectionneur, quel regard portestu sur cette impulsion d’autodétermination nécessaire au geste simple du « faire soi-même » ? Arrivé à Strasbourg en 1989, j’allais rue des Juifs faire mes photocopies, j’y passais mes après-midis avec mes sacs remplis de journaux, et je découpais, collais, je jouais sur les différents formats. On ajustait la mise en page de façon très patiente et on venait ensuite avec notre maquette, puis on sortait le fanzine, 20 exemplaires qu’on distribuait aux copains et par la poste… On avait un rapport actif à ce qu’on faisait, on était investis à notre passion qui nous permettait d’échanger des infos sur la musique, notre truc. Le fanzine ne s’arrête évidemment pas à la musique, il y a des graphzines, les fanzines politiques… Le fanzine, c’est avant tout un espace de liberté, une marge, on y est actif. On est vivants, on peut y exprimer ce qui nous agite.
Tu te souviens de ce qui te motivait ? Je ne pouvais pas simplement être spectateur, j’avais besoin d’être en lien avec ce que j’aimais. Il y a aussi la notion de partage, avec cet objet, on
—
La marge, c’est ce qui fait tenir ensemble les pages du cahier. —
J.-L. Godard
Années 1990. Happy, Frédérick Paquet / Bonjour chez vous, Jacques Speyser / Anorak City, Fabien Garcia / Onion’s Soup, Martial Solis
Années 2020. Coolax / Le Gospel, Adrien Durand / Wi-Fi, Adèle Duhoo / Labels pop moderne, Section 26
80
cherchait le contact avec ceux qui avaient le même centre d’intérêt, une sorte de réseau avant l’heure.
Les gens avec qui je suis en contact aujourd’hui sont ceux que j’ai rencontrés à l’époque ; Frédérick Paquet ou Martial Solis qui ont des magasins de disques à Paris et Bordeaux, les membres de Section 26, les organisateurs de concert… Cela permettait d’entrer en contact et d’échanger avec des gens passionnés par la même chose que toi. Il y avait vraiment cette idée de réseau social, un jeu d’échange d’adresses, de contacts dans toute l’Europe. Il y avait toujours une partie annuaire à la fin du fanzine. Avec ce réseau, arrivaient aussi des choses concrètes, les concerts, les groupes, les interviews, c’était ce qu’on appelait un peu avec dérision « l’Internationale Pop ».
Le fanzine, tu es tombé dedans quand tu étais petit ?

Évidemment, cette pratique est très liée à l’adolescence, mais peut-être aussi à la magie des possibles du monde de l’enfance. Quand j’ai commencé à écrire pour Section 26 , j’avais une série qui s’appelait Papivole qui reprend des entretiens de plein de gens qui travaillaient pour la presse musicale, des photographes, illustrateurs, maquettistes, journalistes, et j’y raconte comment mon premier rapport à la musique est passé par l’écrit : mon frère lisait Best et Rock & Folk, mon père m’achetait le NME et le Melody Maker et comme la musique n’était pas facilement accessible à l’époque, la presse parlait de tellement de choses que notre curiosité musicale passait d’abord par la
lecture, il fallait d’abord s’imaginer la musique ! Au lycée, je faisais un fanzine qui s’appelait Everyday Is Like Sunday, d’après un titre de Morrissey, et j’y écrivais sur les disques. Il y avait aussi un air du temps punk mais pas très politisé, plutôt dans le sens du geste romantique et de l’imitation, cela me donnait une légitimité pour faire, ma façon à moi d’être punk.

— MÉDIATHÈQUES EN DÉBAT, du 13 au 24 novembre, dans les médiathèques de Strasbourg et de l’Eurométropole www.mediatheques.strasbourg.eu
exposition de fanzines du 19 au 29 novembre à la Médiathèque Olympe-de-Gouges, à Strasbourg
concert de Joni Île le 19 novembre à la Médiathèque Olympe-de-Gouges
— FANZINAT, sortie le vendredi 7 octobre projection-rencontre le 26 novembre à la Médiathèque Olympe-de-Gouges www.fanzinat.fr
Années 2020. Langue Pendue 1, 5, 6 et 7, Renaud Sachet Années 2020. Groupie 5, Renaud Sachet
81
ROCKAMBOLESQUE
Par Emmanuel Dosda
Vous souvenez-vous des premiers pas d’October Tone (OT) ?
Au début, il s’agissait d’une poignée de personnes issues de groupes qui se sont unis pour se sentir moins seuls, faire évoluer leur condition au sein d’une scène musicale non connectée, aux contours flous. Personne n’avait réellement de compétences, mais la volonté – voire la frustration – et les bonnes rencontres créent un excellent carburant.
La structure souffle sa dixième bougie. Qu’est-ce qui a évolué ? Certaines choses n’ont pas bougé : le travail d’arrache-pied, l’ultra-flexibilité, le suspense jusqu’à J-1. En 10 ans, l’aura perçue par le public est bien plus importante, tout comme la reconnaissance par nos pairs artistiques, mais aussi les institutions, à Strasbourg et bien au-delà.
Qu’est-ce qu’October Tone ? Un label, un collectif, un club select, une secte dont les membres sont accoutrés d’extravagante manière ?
Tout d’abord, un collectif d’artistes composé de membres des groupes Hermetic Delight, Amor Blitz, 100%Chevalier, Pauwels et Spiders Everywhere. Avec le temps, certains artistes se sont entièrement tournés vers leur musique tandis que d’autres ont commencé à mener une vie schizophrénique avec un pied dans la structure et l’autre dans les projets musicaux. Deux événements se sont produits et ont transformé October Tone : des personnes « extérieures », comme Florence Collin – pierre angulaire d’OT – ont rejoint le navire et fait
 Photomontages réalisés par Louis Cauwelier
Photomontages réalisés par Louis Cauwelier
NE PAS ÔTER À OT CE QUI APPARTIENT À OCTOBER TONE : SI LA SCÈNE MUSICALE GRANDESTIENNE EST AUJOURD’HUI SI EXCITANTE, C’EST BEAUCOUP GRÂCE AU LABEL INDÉPENDANT STRASBOURGEOIS QUI DÉFEND BANG BANG COCK COCK, HERMETIC DELIGHT, AMOR BLITZ, T/O, KG OU LAVENTURE. ENTRETIEN AVEC ATEF AOUADHI, MANAGER/MUSICIEN, À L’OCCASION DE 10 ANS DE FOLIES ET DE GRANDEURS.
82
bouger les lignes. October Tone a alors commencé à accompagner des artistes qui ne faisaient initialement pas partie du collectif, comme T/O. Les activités se sont dessinées plus clairement et October Tone est devenu éditeur de disques, importateur et exportateur de concerts. En 10 ans, nous formons une famille, avec ses histoires, ses secrets… Par la force des choses, nous sommes devenus sélectifs : impossible de tout défendre, malgré la qualité de certaines propositions reçues. Une secte ? Non ! Enfin, pour rigoler, parfois… surtout avec Bang Bang Cock Cock (BBCC) et son gourou, Adrien.
Quelle esthétique défendez-vous, au juste ? Quel rapport entre les beats forts et sales de KG, le rock raëlien de BBCC, l’electro-gothique de Töfie et la pop biscornue de T/O ?

Une justesse, une sincérité et une audace. OT ne recense aucun artiste jouant uniquement pour le fun, prenant la chose à la légère : c’est un sacerdoce !
Impossible pour vous de travailler avec des gens qui n’envisagent pas la musique comme une absolue nécessité ?
Nous n’avons jamais vraiment réfléchi à nos algorithmes de sélection, mais systématiquement il a fallu de belles rencontres sur le plan humain pour que la magie opère. Lorsqu’on regarde dans le rétroviseur, force est de constater que les groupes se donnent toujours à fond, ils ont tous cette façon d’habiter la scène qui donne envie de faire communion.
La Flopée est un super-groupe qui mêle presque tous les artistes OT. Peut-on voir cette formation récente comme une sorte d’exercice de team building, pour souder l’équipe ? De l’extérieur, ce n’est pas du tout étonnant d’imaginer ça ! Mais de l’intérieur, ce n’est vraiment pas le cas. La Flopée est née en dehors d’October Tone, et parce qu’elle regroupait un bon bout de la famille, il était impossible de ne pas considérer apporter notre soutien. N’empêche, le résultat est là : ça soude les équipes, il y a de nouvelles amitiés entre les groupes et ça fait un bien fou !
Vous revendiquez votre côté Peter Pan : l’équipe d’OT refuse de grandir et plane au-dessus d’un monde plutôt sombre, l’observant de haut avec des yeux espiègles écarquillés, du fard doré sur les paupières. Le plus difficile dans cette aventure de 10 ans : garder votre âme d’enfant ou gagner en pragmatisme ?
Le plus difficile ? Sans hésiter, garder notre âme d’enfant. C’est impressionnant de regarder ses camarades devenir des vétérans. Mais une des missions les plus importantes d’October Tone aujourd’hui est de choyer ses membres dévoués qui vont avoir besoin d’améliorer leur qualité de vie et de sommeil si le label veut souffler ses vingt bougies !
— 10 ANS D’OCTOBER TONE, présentation début septembre de la programmation et live à L’Orée 85, à Strasbourg (en cours de confirmation)
— LA HOULE, HERMETIC DELIGHT, RACHID BOWIE, soirée de rentrée le 17 septembre à La Poudrière, à Belfort
— BBCC, IPPON, TBC, concert le 14 octobre au Grillen, à Colmar (avec Hiéro)
— BLEU NUIT, GUT MODEL, À TROIS SUR LA PLAGE, concert le 27 octobre au Point Ephémère, à Paris

— OCTOBER TONE PARTIES : LAVENTURE, LA FLOPEE, KG, BERNARDINO FEMMINIELLI, LES CLOPES, ET DE TRÈS NOMBREUX AUTRES ARTISTES ET SURPRISES, concerts les 28 et 29 octobre au Molodoï, à Strasbourg
— BABA ROGA, HASSAN K, GUEST, concert le 4 novembre au Noumatrouff, à Mulhouse (programmation en cours)
— CARTE BLANCHE A OCTOBER TONE, concert le 5 novembre à La Laiterie, à Strasbourg (programmation en cours)
www.octobertone.com
Sélection de pochettes des sorties October Tone :


Amor Blitz, Ta jalousie est un drone T/O, Ominous Signs Fun Fun Funeral, Everything is ok Hermetic Delight, F.A. Cult BBCC, Altered States of Consciousness Kevin Diesel, G H S T KG, Ein Mann Ohne Feind



83

À LA FIN AOÛT, LE FESTIVAL MÉTÉO AFFICHE LA COULEUR. INDISCIPLINÉE À PRÈS DE QUARANTE ANS, LA PROGRAMMATION MULHOUSIENNE RESTE TOUJOURS AUSSI PENCHÉE SUR L’EXPÉRIMENTATION GÉNÉREUSE. VIVACE PRODIGE. BEAU QUELQUESTEMPS,FANTÔMES Par Guillaume Malvoisin ~ Photos : Alicia Gardès 84
La vie d’abord. C’est toujours très vivant, Météo. Organique, brûlant et aussi impatient qu’un Primoz Roglic en début de Vuelta cycliste. Au cours du temps, et sans doute un peu plus depuis l’install’ du festival à Motoco, friche de briquettes rouges et d’esprits laborieux, posée en bordure de ville à Mulhouse. Autre temps, autres mœurs. Ce qui s’invente ici est de l’ordre de l’urgent et de l’impalpable. Certes, mais toujours aussi vivant. Avec la vie qui déborde. Sans faille ni négociation. Le trio Vincent Courtois / Robin Fincker / Daniel Erdmann donne dans la même gamme. Pas de négo, continuons le combat de l’invention in situ. Avec tout ce que le blues et les ostinatos contemporains connaissent de lyrisme et de fantômes. D’urgence aussi, on le disait plus haut. Une urgence qui provoque et protège. Sonore, physique et toujours un peu garce. Cette urgence, on l’a entendue tout au long du reste de la semaine. Dans la resucée Tie-Dye du prog’ selon Kim Myhr comme dans le grain minimal semé par les mains assurées de Lise Barkas, Maria Laurent ou Tizia Zimmermann. Dans la gueule ouverte d’Audrey Chen, sublime hurleuse noise, comme dans les frappes sournoises et efficaces des lads mancuniens de Prangers. Dans la classe magistrale de The Punk and The Gaffers comme dans les infinis sans fond de Ghosted, ébats tournés vers le seul débat possible : « avec ou sans nous ? ». La musique, jouée à Météo, explose dans sa densité désarmante. Le geste, bébé,
tout est dans le geste. Jamais efficace. Mais pensé, pesé, exécuté mille fois auparavant et joué pour les mille fois prochaines. Cette musique a été gravée, certes. Mais la voir advenir en live restera un satané plaisir, une communion parfaite. Comme s’il fallait reconstituer de petites nations, de petites commus éphémères misant sur le mouvement des cœurs et des corps. Voir une réussite comme Baraque à Free, peut aider à piger le truc du commun et de l’urgence à se savoir jouir en faisant société. Entendre la nouvelle d’une disparition aussi malvenue que soudaine aussi. Cette semaine de fin août 22, l’ombre d’un chien à tête de pigeon est venue salement planer sur le festival. Il y a des partis pris proches du scandale, et Jaimie Branch, streetmadone trompettante , l’avait en elle le scandale. Elle a bougé de là, s’est envolée puis a disparu des radars, avec trompette et fracas. Quelques notes suraiguës ont été soufflées de colère et de tristesse par un Rob Mazurek en larmes. En duo puis, le lendemain, en solo. Quelques larmes ont été versées, le silence est advenu. La vie a poursuivi. Sans rien devoir au hasard. Ni au destin d’ailleurs. La mort n’est qu’une anecdote. Ce dernier jour de festival n’y changera rien. Depuis Primoz Roglic, le cycliste a bouffé du bitume, la Vuelta s’est finie sans lui. À chacun ses absents, à chacun ses fantômes.

www.festival-meteo.fr

85
À une époque où tenir sur la durée est particulièrement difficile, Ici d’ailleurs vient de passer le cap des 25 ans ! Quel est votre secret de longévité ?
Disons qu’on a simplement eu le nez - ou la chance - de faire nos premiers pas avec Yann Tiersen. C’est vraiment ce qui nous a permis de tenir jusque-là. Sans ça, avec la direction éditoriale du label qui a toujours été un peu exigeante, on aurait sans doute rencontré d’énormes difficultés. Mais c’est ma culture musicale… Signer des artistes qui ont un potentiel à passer sur NRJ, je n’aurais pas su faire de toute façon ! Aussi parce que j’appréhende la musique comme quelque chose d’intemporel. Elle peut vieillir dans sa sonorité, sa manière d’être enregistrée, les instruments utilisés, mais elle ne doit pas perdre son authenticité ni sa valeur. C’est le cas pour Yann Tiersen par exemple : ses premiers albums ont gardé la même fraicheur qu’à leurs sorties.
Beaucoup de choses ont dû changer depuis vos débuts, dans le bon sens comme le mauvais, quel bilan en tirer ? Que c’est toujours compliqué ! (Rires) De s’adapter, de rester à la pointe, de ne pas se cristalliser dans une manière d’être et de penser en rejetant toutes les nouveautés d’une société. Il faut savoir évoluer, s’entourer de collaborateurs plus jeunes qui apportent un autre regard ‒ ça ne veut pas dire mettre au placard les plus anciens, simplement savoir garder une certaine fraicheur d’esprit. Je ne supporte pas le côté « c’était mieux avant », ce n’est pas vrai, aucune période n’a été mieux ni moins bien, chaque période apporte quelque chose. Par exemple le numérique : on peut vite dire que c’est nul, pourtant le streaming a ses avantages, c’est moins élitiste, moins d’investissement, et si l’on a un minimum de curiosité, c’est la possibilité de découvrir des artistes du monde entier, même d’un groupe installé sur une petite île au milieu de l’océan. Cet accès libre, c’est une chance inouïe d’échapper plus facilement à la pointe de l’iceberg des musiques diffusées sur les médias. Parce qu’il est désormais beaucoup plus facile de creuser et d’être surpris. Évidemment, la contrepartie, c’est une concurrence énorme qui demande plus de pugnacité, mais dans le fond la musique a toujours été mise en difficulté par les avancées technologiques. C’est difficile, oui, c’est indéniable, mais c’est aussi excitant.
Même 25 ans après ?
Je ne cacherai pas que ça dépend des jours… Aussi parce qu’il y a 25 ans, il n’y avait pas cette facilité d’enregistrement, de diffusion. Aujourd’hui, l’offre est pléthorique… Si bien qu’il y a deux ans, j’ai eu un effet de saturation – trop de musiques, trop de choses à écouter. Il a fallu que je prenne du recul. J’ai passé plusieurs mois à ne plus rien écouter de neuf, de manière à libérer mon disque dur personnel, à retrouver le goût.
En quoi le rôle d’un label indépendant a évolué depuis tes débuts ?
Je dirais que la jeune génération sait appréhender de manière très intéressante le milieu de la
Par Vautrin
MENDELSON, CHAPELIER FOU, BRUIT NOIR, YANN TIERSEN, MATT ELLIOTT… LE CATALOGUE D’ICI D’AILLEURS A LE MÊME EFFET CHEZ LES PURISTES QU’UNE BOITE DE GRANOLA DANS UNE COUR DE RÉCRÉ. POUR FÊTER AVEC LUI LES VINGT-CINQ ANNÉES DE RÉSISTANCE D’UN LABEL INDÉ DÉCIDÉMENT PAS COMME LES AUTRES, NOUS AVONS RENCONTRÉ SON MAITRE D’ŒUVRE, STÉPHANE GRÉGOIRE, QUI, MALGRÉ QUELQUES CRAMPES PARFOIS, GARDE LE POING TOUJOURS BIEN LEVÉ. JUSQU’À L’AVANT-GARDE
Aurélie
~ Photo : Arno Paul
86
musique. Les artistes qui arrivent aujourd’hui ont à la fois le côté créatif et le côté gestion globale –une vision un peu businessman… Certains diront « capitaliste ». Avant, être dans l’indé, c’était avoir ce côté artiste maudit, « c’est difficile mais on ne va pas céder aux sirènes des majors, la compo il n’y a que ça qui compte ». Cette génération est plus apte à se dire : « Ma musique, je vais savoir la vendre sans que ça paraisse honteux, sans avoir la sensation de me salir les doigts. » Je le dis souvent aux artistes qui se lancent : il faut comprendre dans quel business on est, cette fameuse « industrie du disque » – d’ailleurs, ça a toujours été un terme péjoratif.

Mais « business » n’est-il pas encore plus péjoratif ? Non, je ne pense pas. On peut être très concerné par la qualité et ne pas assouplir son regard musical, rester dans sa trajectoire artistique, tout en sachant la valoriser. Savoir comment communiquer, se présenter, pour qu’une musique difficile d’accès de prime abord trouve son public. Et face à la multiplicité de l’offre, beaucoup de jeunes artistes comprennent le fonctionnement du système sans pour autant avoir une démarche putassière. Ils considèrent mieux ce qu’ils ont à offrir et comment le mettre en place avec les outils imposés. Par exemple, on peut ne pas aimer Bandcamp ou Facebook, mais on peut aussi comprendre que sans ça, c’est compliqué de s’exposer aujourd’hui. Ce n’est pas une manière de se prostituer, c’est simplement apprendre à valoriser son travail –parce que ça reste un travail. Et il y a toujours des milliers de façons de le développer.
Tu restes assez optimiste sur le milieu musical, en fait ! Je m’attendais à plus de cynisme. (Rires) C’est vrai qu’on a un label assez sombre avec pas mal d’artistes torturés, mais je n’ai pas du tout une vision passéiste, je ne suis pas du tout nostalgique. Au contraire, on est toujours tourné vers le futur : le problème va justement être de réussir à s’ancrer dans le présent – parfois j’ai l’impression de me réveiller et de ne pas avoir vu passer ces 25 années. Je passe mon temps à réfléchir à demain, aux prochaines sorties, aux prochaines tournées. C’est, je crois, la plus grande difficulté dans ce métier, vivre le présent.
Il y a dix ans, tu disais : « La contre-culture est la culture de demain, il faut juste qu’elle soit filtrée pour qu’un public plus large puisse se sentir concerné à un moment donné. » Est-ce que la contre-culture d’hier est devenue la culture d’aujourd’hui ? Oui, en grande partie. Des sonorités qui étaient à l’époque considérées comme underground sont aujourd’hui présentes partout. Par exemple la
techno, qui a été décriée pendant très longtemps –maintenant, on trouve de l’électro jusque dans des domaines dits de variétés. Mais on ne s’en aperçoit pas forcément, parce que c’est fait de manière discrète, ou enjolivée pour plaire au plus grand nombre. En tout cas, c’est la raison pour laquelle il faut savoir garder de jeunes labels pour proposer des musiques hors normes, des sons de traverse. Je suis un peu dans l’attente à l’heure actuelle, je me demande par exemple ce qui va remplacer le rap.
Alors, selon toi, quelle pourrait être la contreculture actuelle qui deviendrait la culture de demain ?
Je pense qu’il n’y aura pas de nouveau genre pour le moment, plutôt des sous-genres, des variations, mais ce qui est sûr, c’est que l’on tend vers encore plus de mixité et de mélange. La mondialisation de la musique dont on parlait tout à l’heure permet un brassage beaucoup plus évident, et on se retrouve avec des générations qui s’intéressent à tout – mes fils écoutent autant de la new wave pure et dure des années quatre-vingt que du rap ultra actuel. Ça va de plus en plus brasser, se mélanger, pour arriver à une mixité de plus en plus assumée – n’en déplaise à certains nationalistes. Avec également l’intégration de sonorités traditionnelles, ancrées dans un pays, une culture, mais parfaitement mélangées à ce qui vient d’ailleurs. Les genres seront d’ailleurs de plus en plus difficiles à qualifier parce qu’il y aura comme une absorption.
87
Parlons de genre, justement. La marque de fabrique Ici d’ailleurs, c’est de porter des genres musicaux réputés « invendables ». Tu le vois toujours comme un acte de résistance ? Oui, d’ailleurs je l’ai toujours revendiqué. Quand on signe Matt Elliott, Mendelson ou Michel Cloup, des musiques qui sont – dans un certain sens –vouées à l’échec parce que trop compliquées ou pas formatées pour la radio, il y a une démarche politique. C’est choisir de ne pas s’inscrire dans ce qu’attendent la bien-pensance et les médias, c’est vouloir bousculer les choses, et le revendiquer. Si l’on écoute l’ensemble de ce que l’on a sorti depuis 25 ans, je crois qu’on peut parler de côté non consensuel. (Rires) On ne fait pas de la musique punk, mais au fond c’est ce qu’on est, ce qu’on défend. Des esprits libres qui ne veulent pas se plier à ce qui est demandé.
Garder cette intégrité dans le monde dans lequel on vit, j’imagine qu’il y a un petit côté Radeau de la méduse… Est-ce que tu t’es déjà demandé si ça valait vraiment le coup ? Ça vaut toujours le coup. Je pense qu’il y a deux catégories de personnes – ceux qui ont peur et n’oseront jamais, et ceux qui ont un peu peur mais qui osent quand même. Quand on voit le nombre de gens qui se privent de faire quelque chose, de changer de métier, de vie, parce qu’ils ont peur de se retrouver sur le trottoir, ils passent fondamentalement à côté de quelque chose. Maintenant évidemment, si on reprend la première question de l’interview, chez Ici d’ailleurs on a eu la chance d’avoir un élément porteur qui nous a permis de faire tenir le reste. Mais ce n’est pas pour autant que l’on s’est dit : « Il faut faire des choses plus populaires ou moins tristes. » Même si l’on savait qu’on allait sûrement dans le mur, il y avait toujours cette volonté de défendre les artistes, de garder une lignée. Même pour un échec financier – avoir ne serait-ce qu’un seul groupe qui nous dit : « Ce disque-là, que vous aviez sorti, m’a beaucoup servi », ça vaut toutes les réussites. C’est ce que la plupart des gens devraient penser. Que ça vaut le coup de ne pas plier le dos. De prendre le risque.
On a toujours mis les labels indépendants en guerre ouverte contre les majors. Est-ce qu’aujourd’hui, les choix de ces majors ont des incidences directes sur le travail des labels indé ? La musique que l’on défend n’intéresse pas les majors, donc on peut dire qu’on travaille en parallèle, avec des manières de faire très différentes. Je n’ai jamais voulu rentrer dans le débat « les majors c’est de la merde », mais en ce moment j’avoue que je grince des dents face à leur stratégie autour du
vinyle : cette volonté de délibérément saturer les chaines de production et d’augmenter les prix pour le faire passer en produit de luxe, c’est une manière de détruire le marché. Alors que le vinyle représente la majorité des ventes des disquaires et que la jeune génération commençait à s’y intéresser ! Résultat, les gens vont se tourner vers leur abonnement Spotify parce qu’ils n’auront plus les moyens de dépenser des sommes astronomiques pour des vinyles. La période actuelle d’inflation grandissante met déjà la culture en difficulté, alors si en plus il y a cette augmentation délibérée des prix des majors, ça va dégouter une grande partie des gens. Je suis inquiet pour la place qui va être laissée pour la culture.
Le terme de survie te semble adapté par les temps qui courent ? Oui. Beaucoup de labels sont tenus par des gens qui font ça sur leur temps libre, juste pour pouvoir défendre des artistes qu’ils admirent. Pour nous, le terme serait peut-être un peu excessif, mais c’est clair que depuis trois ans c’est compliqué, on est obligé d’être plus prudent, de limiter les signatures, d’être attentifs sur les investissements. Il faut bien se rendre compte que sans les aides gouvernementales, on ne pourrait pas du tout produire. On est véritablement sous perfusion. Et si les choses perdurent, cela peut devenir assez vite catastrophique pour un certain nombre de labels indépendants. Aujourd’hui, sur dix sorties qu’on va faire, huit nous feront perdre de l’argent, une sera à peu près équilibrée et une seule nous en fera gagner. C’est à peu près pareil pour l’ensemble des labels indépendants. On est dans du développement artistique, alors globalement on perd chaque jour de l’argent. Et avant d’en gagner, c’est difficile, encore plus avec une musique non consensuelle.
Doit-on alors s’attendre à un lissage encore plus fort de la culture ? Personnellement, je crois que cette volonté d’uniformisation a toujours existé. Lisser, projeter une musique pour qu’elle plaise au plus grand nombre. Parce qu’encore une fois, le milieu musical reste une « industrie » – c’est un terme horrifique, mais qui veut bien dire ce qu’il veut dire. Et pourtant, d’un autre côté, c’est justement ça qui va générer une envie de se battre, de résister, de continuer à créer une contre-culture. Il y aura toujours des gens qui iront à l’encontre de cette culture de masse – ça restera un faible pourcentage, mais il existera. Parce que les choses intéressantes se créent toujours dans l’extrême. Et qu’aller jusqu’au bord permet de générer l’inattendu.
icidailleurs.fr
88
Visions de liberté
Antoine Compagnone revient sur l’évolution dans le temps du Festival du Film Italien de Villerupt, à l’âme toujours intacte. En dépliant les réalités, Sarah Leonor nous confronte aux invisibles. La programmation – désobéissance incarnée – du festival Entrevues voit double avec en invités d’honneur Rabah Ameur-Zaïmeche et Emmanuelle Cuau, de quoi présager de beaux jours au déploiement collectif de son équipe artistique.
ITALIE ET D’AILLEURS
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
Antoine Compagnone fait ses bagages : dans quelques jours, il se rendra à la Mostra de Venise. Il y découvrira les films qui viendront boucler la programmation du festival qu’il dirige depuis bientôt vingt-cinq ans. En tout, 78 films seront à l’affiche de cette 45 e édition. De la sélection, l’homme ne lâchera rien avant l’annonce officielle prévue le 15 octobre prochain. Mais il conte volontiers la longue histoire d’un festival qui a acquis ses lettres de noblesse dans une ville où il n’y a « ni casino, ni lac, ni montagnes... mais une âme ». En 1976, grâce à une poignée de jeunes passionnés désireux de recréer un petit bout d’Italie pour les expatriés, une première édition a lieu entre les murs de la MJC de Villerupt. C’est au même endroit qu’est installé le bureau d’Antoine Compagnone, décoré d’affiches de films et de photos-souvenirs. Mais pour le directeur du Pôle de l’image, né de la professionnalisation du festival, pas question de trop regarder en arrière. Car ce sont les images de la société actuelle, projetées sur grand écran, qui font de la « Petite Italie » une réalité encore vivace à Villerupt.
Dans quelles conditions avez-vous rejoint l’équipe du festival, avant d’en devenir le délégué général en 1998 ?
Au début, j’avais juste envie de participer à l’aventure. Je suis arrivé comme bénévole en 1981, de barman à projectionniste j’ai fait un peu de tout. Quand j’ai réorganisé les archives, j’en ai profité pour regarder énormément de films, pour me faire une culture du cinéma italien, que je n’avais pas. Mais le cinéma a toujours tenu une place dans ma vie : mon papa m’emmenait voir des westerns et des péplums, dont je suis toujours fan. Mon éducation à l’image, c’était tout le contraire du cinéma d’art et essai !
Comment la sélection a-t-elle évolué au fil des éditions ?
En 1976, le Festival a été pensé surtout à destination de la communauté italienne, qui représentait 60 % de la population de Villerupt. Beaucoup de gens ne connaissaient plus l’Italie. On était alors surtout dans la nostalgie : on passait les films de Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Mario Brenta ou Luigi Comencini, la grande période de la comédie et du néo-réalisme. Puis est venue la crise au début des années 1980, avec la télévision de Berlusconi, qui a fait beaucoup de mal au cinéma italien. Le festival était alors à un tournant, d’autant qu’il est passé de 5 000 spectateurs lors de la première édition à 40 000 six ans plus tard. C’était très lourd pour les bénévoles.
Comment l’organisation a-t-elle passé ce cap difficile ?
Après une pause entre 1983 et 1986, une nouvelle équipe s’est constituée et a fait le pari de montrer
Festival du film italien de Villerupt, Hôtel de ville © Delia Pifarotti
DEPUIS SA CRÉATION EN 1976, LE FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT A ÉVOLUÉ, ATTIRANT UN NOUVEAU PUBLIC DANS CET EX-FIEF DE L’INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE ET DE LA COMMUNAUTÉ ITALIENNE. TOUT EN VEILLANT À PRÉSERVER SON ÂME.
D’ICI
90
un cinéma différent, avec de jeunes réalisateurs émergents : Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni, Nanni Moretti ou encore Paolo Sorrentino, qui livraient leurs premiers films et n’étaient pas connus. Ça a été dur de convaincre, à la reprise il n’y avait plus que 15 000 spectateurs, il a fallu des années pour revenir à une fréquentation importante. Mais nous sommes alors devenus, à mon sens, un vrai festival de cinéma.
Que voulez-vous dire ?
Au départ, on avait une image de fête populaire. Lorsque l’on s’est axés sur la découverte, toute une génération avait disparu, notamment parce que la crise du cinéma italien a coïncidé avec celle de l’industrie sidérurgique : beaucoup de monde est parti travailler à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer, ça a été très dur pour la ville. Notre pari en termes de programmation a été gagnant, en attirant un public différent : les cinéphiles et les intellectuels venus de Metz, de Nancy, du Luxembourg voisin... En 1998, on a été assez mûrs pour se professionnaliser.
Le cinéma populaire a-t-il encore sa place à Villerupt ?
Oui, c’est en mêlant films populaires et films d’auteur que nous avons pu atteindre 40 000 spectateurs. On propose des films grand public, des drames, du cinéma d’art et essai et même des comédies à l’italienne, sur des sujets tragiques, un genre auquel se consacrent à nouveau certains réalisateurs. Pour notre sélection, je ne sépare pas les genres, c’est un tout et c’est ce qui fait que nous sommes appréciés et regardés. Y compris par les professionnels et les autres événements, qui veulent savoir ce qui se fait dans le cinéma italien.
Plus largement, quel est l’état du cinéma italien de nos jours ?
Le contexte est encore compliqué, avec le développement des plateformes pendant la crise sanitaire... En termes d’esthétiques et de thèmes, il y a très peu de films politiques comme dans les années 1960 et 1970, mais c’est aussi le cas en France. Ce que l’on constate aussi, c’est que les jeunes réalisateurs ont une culture de plus en plus mondialisée : hormis la nationalité de leur auteur, certains métrages n’évoquent pas du tout l’Italie, ou sont joués en anglais ; ce qui n’est pas très bon pour un festival comme le nôtre, où la langue est importante. On voit aussi de plus en plus de jeunes Italiens d’origine africaine à l’écran. Et davantage de réalisatrices.
Justement, l’édition 2022 consacre les réalisatrices d’aujourd’hui, avec une sélection d’une dizaine de films.
Uniquement des films récents, de 2010 à nos jours. Villerupt accueille et récompense des réalisatrices depuis longtemps. On retrouvera ainsi des films
déjà primés chez nous : Corpo celeste d’Alice Rohrwacher, Le ultime cose d’Irene Dionisio ou Fiore gemello de Laura Luchetti. On peut également citer Valeria Golino, dont nous présenterons Miele, ou encore Laura Samani avec Piccolo corpo. De plus, un hommage sera rendu à Lina Wertmüller, disparue en 2021 et déjà invitée à Villerupt. Les réalisatrices sont encore minoritaires en Italie, mais elles livrent à chaque fois des films très forts.
Cette année, un nouveau lieu accueillera des projections : l’Arche, qui recèle notamment deux salles truffées de technologie, l’une de 660 places, l’autre de 140 places et entièrement dédiées au cinéma. Villerupt s’est-elle transformée grâce à son festival du film ?
Le festival a été l’une des raisons de la construction de l’Arche. En 1976, on transformait déjà la salle de l’Hôtel de ville, devenue mythique ; d’ailleurs on ne la remplace pas pour autant, elle constitue toujours le cœur du festival ! En plus, nous avons un cinéma mobile, la salle historique du Rio à la MJC, une chapelle à Audun-le-Tiche et deux salles au Luxembourg, à Dudelange et Esch-sur-Alzette. Le Luxembourg est un pays important, car il y a là-bas une nouvelle immigration italienne, avec beaucoup de jeunes qui se déplacent à Villerupt. Mais pour certains de la nouvelle génération, comme les étudiants, c’est difficile de venir, car il faut qu’ils puissent se rendre sur place. Nous n’avons ni gare ni hôtel, peu de transports et de restaurants... or une ville de festival a aussi besoin de ce genre d’infrastructures. On peut espérer qu’avec l’aménagement de la friche de Micheville, qui accueillera 5 000 nouveaux habitants, cela va se développer.
L’an dernier, vous avez attiré 30 000 spectateurs malgré les restrictions. Le festival est-il désormais assez implanté pour résister aux crises ?
Il faut toujours batailler, par exemple dans les négociations avec les diffuseurs, car ce milieu est aussi un business. Néanmoins, ce qui fait la force de Villerupt, c’est qu’il y a une histoire et une âme. Certaines municipalités ont créé des festivals de cinéma de toutes pièces, en posant juste de l’argent sur la table, et on peut voir que ça ne marche pas. Notre credo, c’est qu’il faut se rappeler de son passé mais sans tomber dans la nostalgie. Nous continuons d’avancer avec cet état d’esprit, et le public nous suit visiblement sur ce chemin.
— FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT, festival du 28 octobre au 13 novembre à Villerupt www.festival-villerupt.com
91

PRÉSENTÉ EN AVANT-PREMIÈRE AU FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL, LE FILM-DOCUMENTAIRE CEUX DE LA NUIT DE LA RÉALISATRICE SARAH LEONOR RETRACE LE PARCOURS DES EXILÉS DANS LE TERRITOIRE DU COL DE MONTGENÈVRE À LA FRONTIÈRE FRANCO-ITALIENNE ; LÀ OÙ SE CONFRONTENT DEUX RÉALITÉS : LE JOUR, LE TOURISME, LA RENTABILISATION DE LA MONTAGNE ET LA NUIT AU DESTIN FRAGILE, CELUI DE MILLIERS D’HOMMES, FEMMES, ET ENFANTS QUI FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE AU PÉRIL DE LEUR VIE, CEUX QU’ON N’A PAS VUS, QU’ON NE VOIT PAS, QU’ON NE VERRA JAMAIS. SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS Par Valérie Bisson ~ Photo : Renaud Monfourny 92
Ton film parle du passage de la frontière par les migrants ; pourquoi avoir choisi la montagne comme lieu de passage ?
Pour des raisons intimistes et autobiographiques. J’étais au courant de cette réalité, du fait que les migrants passaient la frontière francoitalienne, d’abord entre Nice et Vintimille – où le passage est vite devenu impossible, puis via la vallée de la Roya, un peu plus au nord, une région plus montagneuse où, là aussi, les forces de l’ordre ont bloqué l’accès, et enfin, à partir de 2017, par le col de l’Échelle et le col de Montgenèvre. C’est-à-dire en pleine montagne, à 1800 mètres d’altitude. Ma cousine, accompagnatrice en montagne et enseignante, habite Briançon et s’est impliquée un temps dans le mouvement des maraudeurs qui arpentent la nuit, côté français, les pentes de ces deux cols, viennent en aide aux exilés égarés et transis de froid, et contribuent à les mettre à l’abri au chaud. Elle m’a fait part de ce qu’elle vivait au quotidien et j’ai pu avoir un retour direct qui ne passait pas par les médias.
À cela s’est ajoutée une motivation toute personnelle parce que le paysage de la montagne est celui de mon enfance. […] Quand on grandit dans l’Est, le massif vosgien fait une sorte de frontière naturelle avec le reste de la France, en face se trouve la Forêt-Noire et pour aller vers le sud, on traverse les Alpes. J’ai toujours associé le franchissement d’une frontière avec le franchissement d’un massif montagneux. Cela me semblait évident. Je garde aussi de mon enfance une familiarité avec ce territoire des Alpes, dans les années 1980, époque d’opulence et de consommation, j’ai pu y faire beaucoup de ski et profiter des infrastructures qui rendaient la montagne accessible au citadin. La montagne m’a aussi constituée physiquement, même si je me suis détournée de cette manière de la pratiquer, elle m’a beaucoup marquée. Au moment de la mort de la jeune Nigériane Blessing Matthew, poursuivie par la police et tombée dans la Durance, mes balades dans ces paysages appelaient des souvenirs d’enfance et le décès dramatique de cette jeune migrante. La mort et l’enfance dans un même paysage a probablement été le point de départ… Je me suis accrochée là, je ne suis pas allée voir ailleurs.
Comment as-tu eu connaissance de cet événement ?
Par la presse. L’autre événement qui a fait lien a été le happening de Génération Identitaire, en avril 2018, pendant lequel une frontière fictive entre la France et l’Italie a été déployée au sommet du col de l’Échelle, alors que la vraie ligne de frontière n’est pas du tout là, elle est au pied du col. Génération Identitaire avait décrété cette frontière interdite aux migrants, à renfort d’hélicoptères et de convocation des médias. Une sorte de milice s’était auto-organisée, avait investi la montagne, ce qui m’avait profondément choquée. Ce groupuscule instituait une nouvelle frontière, la déclarait fermée de surcroît, et les autorités laissaient faire. Seuls les maraudeurs, mais aussi les associations solidaires des exilés, dont la plus engagée, Tous Migrants, ont réagi en organisant une manifestation dès le lendemain au col de Montgenèvre. Là, en revanche, des manifestants ont été arrêtés, certains ont été inculpés, des procès ont suivi.
Les membres de Génération Identitaire, eux, n’ont été poursuivis que six mois après.
Un mois après, en mai 2018, a eu lieu le décès de Blessing Matthew.
Quand est née ta décision d’en faire un film ?
J’ai compris qu’il y avait matière à un film quand j’ai vu les signes dans le paysage, les vêtements des exilés, les traces de leur passage, qui semblaient invisibles aux touristes venus faire du golf, du vélo, profiter de la montagne en été et de tout ce que la région apporte. Cette société de loisirs venait effacer la présence de ceux qui mettaient leur vie en jeu en passant la frontière. C’est ce hiatus qui m’a donné envie de réaliser un film ; comment montrer ça, comment le faire comprendre, comment le faire vivre, comment le rendre visible puisque l’expérience même
du franchissement nocturne de la frontière était difficile à filmer voire impossible ? À moins de faire le flic, de prendre des jumelles à visée nocturne et de pratiquer l’affût à la manière d’un chasseur, autant de métaphores ne me rendant pas très à l’aise et qui n’ont pour moi rien à voir avec l’acte de filmer.
Combien de temps as-tu passé en immersion ? J’ai fait quatre ou cinq voyages qui duraient de dix jours à deux semaines à différentes saisons. Au fur et à mesure, je précisais les choses que je voulais filmer et je repartais toujours avec une idée plus nette de ce que je cherchais à capter, que ce soit en termes de lumière, de saison ou de paysages.
J’ai réalisé des entretiens avec des maraudeurs d’horizons différents, plus ou moins politisés, plus ou moins préparés à se retrouver face aux forces de l’ordre. Certains ont pris peur face à l’ampleur de la répression, et pour des raisons de sécurité personnelle, ont décidé de se retirer. D’autres, au contraire, se sont radicalisés en découvrant combien leur action, qu’ils considéraient comme légitime, était réprimée. Tous m’ont parlé de l’expérience de sortir la nuit après le boulot, dans la neige, par des températures polaires, dans des conditions assez difficiles, à attendre et à scruter l’obscurité. Chacun avait une façon très personnelle d’en parler et comme j’ai mené ces entretiens à un moment où les tensions avec les forces de l’ordre étaient au plus haut, j’ai choisi de ne pas les filmer et je leur ai promis de ne pas garder leur voix. Ils pouvaient donc s’exprimer sans se sentir en danger. Mais c’était aussi pour moi une contrainte qui m’invitait à trouver une forme particulière au film, au-delà de la forme documentaire classique. Ces entretiens ont constitué la base documentaire à partir de laquelle j’ai élaboré les portraits-paysages du film.
Un des préceptes du guide veut que quand quelqu’un est en danger en montagne, il faut l’aider. Cette dignité a été omniprésente dans tes rencontres ?
Oui et cela prouve bien qu’il ne s’agit pas que de militantisme. C’est un truc de base, on ne laisse pas les gens mourir dans la montagne, ni dans la mer, c’est lié à ces endroits extrêmes. La militance vient après. La dignité c’est aussi celle des jeunes exilés que j’ai rencontrés, ils m’ont stupéfaite par leur intelligence et leur lucidité. Ils m’expliquaient que si je les filmais, ils auraient leur image sur Internet toute leur vie et que d’une manière ou d’une autre ils resteraient des victimes. Leur détermination à avoir un destin, à étudier et à travailler est très loin de l’image d’exilé victime qu’on a l’habitude de nous faire voir.
La seule exilée que je filme est une jeune femme qui est passée par Nice et a son titre de séjour, elle avait moins de réticences à être filmée. J’étais obsédée par le destin tragique de Blessing, et j’ai
93
rencontré Eunice, nigériane comme Blessing, et c’était comme si je devais conjurer la mort de Blessing en allant vers elle, et en lui demandant d’apparaître dans le film. Sans lui demander de raconter son passé ou son futur, elle était juste là, une présence pure qui ne se justifie pas, c’était pour moi une évocation de tous ces exilés avec qui j’avais discuté et qui disaient n’aspirer qu’à la tranquillité.
Comment se laisse-t-on traverser par la vie des autres ?
Le film pose ces questions, il fait voir, comme le ferait un géologue, toutes ces traversées du paysage : l’histoire de Blessing, celle du randonneur qui passe sur ce chemin, qui tombe nez à nez avec deux exilés, et qui en est bouleversé, les militaires des années 1890 qui venaient au secours des Piémontais pris dans les tempêtes… le territoire lui-même a été traversé par les exilés. Quant aux gens, certains ont quand même eu à se défendre lors de leur procès, la plupart ont été relaxés mais cela a pris deux ans de leur vie, je pense au texte de Stig Dagerman, Le condamné à mort, même graciés cela a marqué leur vie alors qu’au départ, ils étaient juste sortis en montagne pour aider des personnes en danger, pour empêcher que des gens meurent.
D’autres n’arrivent pas à s’arrêter, ils cumulent travail, maraudes, fatiguent et finissent parfois par craquer. Ils réalisent que ça ne s’arrêtera jamais et que, quoi qu’ils fassent, ça ne changera pas la face du monde mais que s’ils ne sont pas là, les gens risquent de mourir ; cela les envahit complètement. J’ai fait moi-même des maraudes et j’ai ressenti ce qu’ils me disaient, quand tu ramènes quelqu’un dans un refuge afin qu’il se réchauffe et qu’il finit par te dire qu’il y en a d’autres dehors, par -10 °C, mais que l’on ne parvient pas à les retrouver, c’est difficile de trouver le sommeil. Les gens sont hantés par ceux qu’ils n’ont pas retrouvé, ils se demandent : « Est-ce qu’on va retrouver leur corps à la fonte des neiges ? », ce genre de choses qui deviennent vite envahissantes.
Peux-tu nous parler du chemin que tu fais caméra à l’épaule vers la tombe de Blessing ?
Ce n’est pas un plan facile. Il est long et n’avait lieu d’être que dans cette longueur puisque c’était la seule manière de raconter la distance qui nous sépare, Blessing et moi, les migrants et nous tous. Je demande au spectateur de faire cet effort, ce chemin de trois minutes vers elle, c’est la moindre des choses à mes yeux. Le plan échappe au cadre esthétique du film, c’est une déchirure voulue dans cette construction en portrait-paysage. Il empêche aussi le spectateur de ronronner. Souvent on trouve une forme, on s’y rattache, on s’en accommode. Je voulais briser cela.
Tu le fais à d’autres moments, avec des images de cours d’eau ou d’autres, presque fixes, de la montagne, toutes portées par un son omniprésent très fin et très puissant…
L’idée de départ, c’était de restituer les sensations de l’exilé qui marche sur ces chemins, qu’est-ce qu’il voit, qu’est-ce qu’il entend ? Le son est devenu très important, il permet d’être en immersion, et d’entrer dans le vécu. J’avais cette obsession : la réalité de ce qui se passe la nuit est dans les replis du paysage le jour. Le son était aussi une manière de faire entrer le spectateur dans ces replis. Et dans ces replis du paysage, il y a des couches du passé qui émergent, à travers les archives filmiques de ce même paysage, à d’autres époques. En cours de montage, j’ai découvert le travail de deux musiciens contemporains, Pali Meursault et Thomas Tilly (radioglaces.net), qui ont fait des captations sonores de différents glaciers alpins et ont créé une carte interactive à partir de laquelle on peut réécouter leurs compositions. J’ai trouvé ça extraordinaire, ils composent à partir de sons captés à l’intérieur d’un glacier et font sentir toute la fragilité de cet univers. J’avais envie d’avoir des sons de cette montagne qui bouge, qui s’écroule, et ils ont accepté de faire entendre certains de leurs sons dans mon film, notamment des chutes de sérac, tout ce qui pour moi racontait un effondrement. Grâce à ces sons et aux images d’archives, j’ai pu travailler une dimension plus métaphorique du montage. Le paysage finit par parler et donne à voir l’intériorité de personnages dont on ne voit jamais le visage. Les images d’archives deviennent une projection de leur esprit.
Il y a peu de ces images mais elles deviennent intenses parce qu’elles sont relayées par ce plan sonore disséminé dans le film, plan sonore qui apparait et disparait, qui m’a beaucoup servi pour raconter la fragilité des destins humains et leur impermanence, leur finitude. J’ai monté le film en combinant toutes ces matières, un son appelait une image d’archive, leur association m’amenait à retravailler un aspect du texte, et ainsi de suite. Ce n’était pas un travail linéaire.
C’est la première fois que tu travailles ce type de narration ?
Oui complètement, j’aime bien cette idée de fragments et de mise en relation de choses qui à priori n’ont rien à voir les unes avec les autres. J’ai travaillé à l’instinct, en faisant confiance au processus ; il y a un chemin, des choses s’y passent, c’est une démarche qui vient de soi. Pendant la construction du film, différents éléments se sont agrégés et sont entrés en résonnance, c’était une vraie bulle d’air et de liberté pour moi. J’ai construit ce film avec beaucoup de joie, je faisais tout toute seule, je testais, j’avançais à tâtons, avec pour objectif de donner à ressentir les choses plus qu’à les expliciter. Dans ce sens mon film n’est pas militant, il donne à voir et à faire ressentir une réalité et raconte comment cet état de fait nous traverse, je voulais renverser les choses et raconter comment les exilés nous tendent un miroir, comment on se détermine par rapport à ça, et ainsi interroger ce que « faire société » veut dire.
— CEUX DE LA NUIT,
Sarah Leonor, sortie officielle le 14 décembre
—
La réalité de ce qui se passe la nuit est dans les replis du paysage le jour. —
94
 Par Nicolas Bézard ~ Photo de l’équipe artistique : Léa Rener
Par Nicolas Bézard ~ Photo de l’équipe artistique : Léa Rener
La direction artistique d’Entrevues est désormais incarnée par un collectif. Pouvez-vous nous en dire plus ? Anna Tarassachvili : Nous avons appris assez soudainement qu’Elsa Charbit quittait son poste de directrice artistique du festival. Nous devions rebondir vite, et l’idée d’une direction collective s’est naturellement imposée. En soi, il ne s’agit pas d’un bouleversement radical. Les personnes en place depuis longtemps comme Cécile Cadoux et moi-même gardons nos domaines d’expertise,
mais nous avons eu envie d’intégrer et de mettre en avant d’autres visages, familiers ou non du festival, tout en veillant à conserver l’identité propre à Entrevues. Pour ce qui concerne la compétition, Victor Bournérias, qui faisait partie de l’équipe en 2018, intègre le comité de sélection, et nous accueillons trois nouvelles personnes : Paola Raiman, Claire-Emmanuelle Blot et Vincent Poli qui ont déjà une expérience de la programmation dans d’autres festivals. Dans le cas du volet hors compétition, outre Charles Herby-Funfschilling qui travaille sur la programmation ainsi que sur les questions de coordination, nous avons fait appel à des programmateurs associés tels que Mathieu Macheret, critique de cinéma et ancien collaborateur d’Entrevues, ou Laurence Reymond, productrice et programmatrice qui pilotera la section Cinéma & Histoire consacrée aux femmes cinéastes dans la contre-culture américaine des années 1980.
La particularité du festival est d’associer deux équipes, l’une basée à Paris et l’autre à Belfort.
A. T. : Il faut mettre en lumière le travail que le bureau belfortain fait à l’année avec Cinémas d’Aujourd’hui, auprès d’un public plus local incluant les scolaires. Mais j’insiste sur le fait que nous sommes une seule et même équipe dont les membres se répartissent dans deux endroits différents. À Paris ou à Belfort, tout le monde a son mot à dire sur les choix de programmation.
Ce principe d’une direction collégiale est-il amené à durer dans le temps ?
A. T. : L’avenir le dira. Cette année est une sorte de laboratoire. Nous allons expérimenter ce nouveau fonctionnement en nous laissant la possibilité de le réajuster dans le futur. Mais pour le moment, tout se passe de façon fluide et évidente.
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 36 ANNÉES D’EXISTENCE, ENTREVUES, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BELFORT, TENTE L’AVENTURE D’UNE DIRECTION ARTISTIQUE COLLÉGIALE. ÉCHANGE SUR CETTE ÉVOLUTION ET TOUR D’HORIZON DE L’ÉDITION À VENIR AVEC ANNA TARASSACHVILI, CÉCILE CADOUX ET CHARLES HERBY-FUNFSCHILLING, MEMBRES DE LA NOUVELLE ÉQUIPE ÉLARGIE. DÉSOBÉISSANCE COLLECTIVE
96
Justement, qu’est-ce qui change lorsqu’il n’y a plus une unique personne pour statuer ?
Cécile Cadoux : La responsabilité devient multiple. Personne n’a un droit supérieur sur quelqu’un d’autre. Parce que le temps était compté suite au départ d’Elsa, nous nous sommes vus dans l’obligation d’agir rapidement, de façon collégiale, et à notre grande surprise, le processus de décision s’en est trouvé facilité alors même qu’il y a plus de personnes à consulter.
A. T. : Ce nouveau fonctionnement nous responsabilise toutes et tous dans nos fonctions et nos champs de compétences, mais au fond, je me demande si le collectif n’assouplit et ne libère pas davantage la parole. Il y a une véritable émulation au sein de l’équipe. Par exemple, nous nous sommes toutes et tous retrouvés sur le choix de nos invités d’honneur, Emmanuelle Cuau et Rabah Ameur-Zaïmeche. Cette ligne artistique que nous avons en partage facilite grandement le travail, comme une boussole qui nous indiquerait toujours la bonne direction.
Cette ligne, peut-on la rappeler ?
C. C. : Entrevues a eu et aura toujours deux jambes, la compétition internationale avec des premiers,
deuxièmes et troisièmes films et une programmation hors compétition mêlant cinéma contemporain et films du patrimoine. Depuis qu’il existe, le festival œuvre à créer des ponts entre réalisateurs confirmés et débutants, à encourager des formes cinématographiques innovantes, marquées par l’audace.
L’audace, premier critère de sélection des films ? C. C. : Pas forcément. Nous ne sommes pas dogmatiques. Nous avons la chance de pouvoir sélectionner des choses très variées, et s’il est vrai que nous défendons les écritures novatrices, des films plus classiques ont également toute leur place à Belfort. C’est un équilibre à trouver au sein de la sélection, qui fait d’ailleurs la beauté de ce travail de programmation. Une sélection, cela se construit avec les films disponibles à un moment donné, selon les subjectivités de chacun, dans le respect d’un esprit présent depuis la création du festival en 1986. J’aime bien l’idée que cet esprit dépasse le cadre même des comités responsables du choix des films, et qu’à la fin demeurent des œuvres, des palmarès, des cinéastes aujourd’hui consacrés et que Belfort a contribué à faire connaître.

97
C’est le cas de Rabah Ameur-Zaïmeche et d’Emmanuelle Cuau, qui cette année feront l’objet de deux rétrospectives.
Charles Herby-Funfschilling : Absolument. Ce sont deux cinéastes qui comptent pour nous car leurs premiers films ont été sélectionnés à Belfort. Rabah Ameur-Zaïmeche s’est intéressé à la question du collectif, à la possibilité de faire du cinéma avec très peu de moyens, en dehors des circuits de production habituels. Son cinéma envisage une utopie du collectif contre certaines formes d’oppression, dans différents territoires et à différentes époques, sur un fond politique assez prononcé.
A. T. : Emmanuelle Cuau n’a réalisé que trois longs métrages, mais c’est une artiste prolifique qui a beaucoup écrit pour les autres. Sur le scénario de Secret Défense de Jacques Rivette par exemple, où sur celui de L’Homme des foules de John Lvoff.
C. H-F. : En regard du travail de Rabah qui a produit son premier film avec trois fois rien, et qui continue de développer une manière contrebandière de faire du cinéma, Emmanuelle s’inscrit dans une économie plus traditionnelle, mais avec une vraie exigence artistique. Elle vient d’un paysage qui nous est cher. Elle était proche de Robert Bresson, qui l’avait d’ailleurs fait tourner dans son dernier film, L’Argent.
La dimension politique du cinéma de Rabah Ameur-Zaïmeche entre en résonance avec la thématique choisie pour votre transversale : la désobéissance.
C. H-F. : Nous proposons une histoire subjective de cette notion de désobéissance au cinéma, dans laquelle Rabah a toute sa place en effet. L’idée est celle d’une trajectoire qui partirait de la sphère intime, des récits d’émancipation personnelle, pour aller vers quelque chose de l’émulation collective. En présentant des œuvres censurées ou des films collectifs, nous voulons montrer qu’il est possible d’inventer d’autres façons de faire du cinéma dans des contextes hostiles, comme c’est le cas actuellement de Jafar Panahi en Iran. Nous montrerons Zéro de conduite de Jean Vigo, un grand classique de la désobéissance scolaire, mais également des manières plus pop d’être désobéissant comme But I’m a Cheerleader de Jamie Babbit. Le public pourra découvrir des raretés, notamment un long métrage de Joaquim Lopes Barbosa, Laissez-moi au moins grimper aux palmiers, tourné au Mozambique en 1972, époque où ce territoire était encore une colonie portugaise. Le réalisateur a tourné avec l’aide des locaux, mettant en scène la tentative de révolte d’un esclave, mais le film a été interdit par la censure, puis jeté aux oubliettes pendant des décennies.
A. T. : La désobéissance est en quelque sorte le fil conducteur de cette 37e édition. On la retrouve dans la section Cinéma & Histoire qui propose un voyage à travers les États-Unis raconté du point de vue de femmes qui ont filmé les marges. Nous présenterons neuf films dont la trilogie de Lizzie Borden, cinéaste américaine et figure majeure de la contre-culture new-yorkaise dans les années 70 et 80.
Nous apprenons ce jour même la disparition de Jean-Luc Godard, dont les films sont régulièrement programmés à Belfort. N’est-il pas celui qui a questionné et incarné le mieux cette idée de désobéissance ?
A. T. : Sans aucun doute. Jean-Luc Godard était le plus libre et le plus désobéissant de tous les cinéastes. L’annonce de son décès nous plonge dans une grande tristesse.
C. H-F. : Il avait une histoire particulière avec Entrevues. André S. Labarthe et lui étaient proches, Labarthe l’ayant filmé dans un entretien très beau avec Fritz Lang intitulé Le Dinosaure et le Bébé . Comme vous le dites, il incarne la désobéissance et c’est ce qui rend complexe la manière de lui rendre hommage, parce que l’entièreté de sa filmographie est désobéissante. Il n’a jamais cessé de déconstruire ce qu’il avait précédemment édifié. Grand artisan de la Nouvelle Vague, il l’abandonne pour filmer mai 68, et au moment où il sent que mai 68 va péricliter, il part pour inventer quelque chose de totalement nouveau au côté d’AnneMarie Miéville, s’intéressant à la question de la Palestine, pensant de nouvelles façons de faire du cinéma collectivement. Dans les années 1980, après un détour iconoclaste par l’Art Vidéo, il revient à des fictions de grande ampleur picturale pour terminer récemment par Le Livre d’image qui est le chef-d’œuvre que l’on connaît, et c’est absolument extraordinaire de constater à quel point il restait le plus jeune des réalisateurs. Jean-Pierre Léaud a dit de lui qu’il était un génie au sens kantien du terme, et il a raison : Godard a su avant tout le monde ce que pouvait devenir le cinéma politiquement, et c’est ce qui en fait le plus grand désobéissant de l’histoire du cinéma.
— ENTREVUES BELFORT, festival du 20 au 27 novembre, à Belfort www.festival-entrevues.com
98
DÉS[OBÉ]IR
Par Emmanuel Abela
À LA QUESTION DE LA DÉSOBÉISSANCE AU CINÉMA : SALUTAIRE !
Dès le plus jeune âge, la désobéissance est un acte de foi. Elle forge l’esprit contre l’adversité, elle interroge la limite et exclut toute rémission possible. Elle est un passage à l’acte, ponctuel ou plus récurrent, qui dit non à la norme, non à la règle, non à la préciosité de l’injonction. Elle est également un refus de la convenance, des veules satisfactions et des sourires complices du devoir accompli. Qui s’y adonne finit au mieux au coin – dos à la société bien-pensante –, au pire au pilori voire au peloton d’exécution. Le désobéissant est désigné, écarté, puis puni. Je me souviendrai à jamais de cette image d’un gamin sous le préau qui martelait le mur face à lui de son seul bras valide, laissant flotter dans le vide la manche inutile de sa chemise blanche : avait-il désobéi, lui aussi ? Avec des sanglots déchirants, il criait à l’injustice ! Peut-être aurait-on dû lui organiser sur le champ une projection privée de Zéro de conduite de l’inestimable Jean Vigo. S’en serait-il senti soulagé ? Il y a de fortes chances, dans la mesure où ce drôle de film s’attache à tous les désobéissants de la Terre, volontaires ou involontaires qui, un jour, ont enfreint les satanées lois du monde. Il aurait compris dès lors que la désobéissance est un dépassement, un pas de côté, ce cheminement à la marge qui ouvre tant de perspectives à celui qui s’y livre.
Dans Zéro de conduite, qui demeure une étrangeté encore irrecevable aujourd’hui pour la société – Dieu qu’on aurait besoin d’un coup de pied dans la fourmilière ! – , la subversion est poussée à son paroxysme, y compris formel : montage saccadé, réalisme exacerbé, scénario débridé, rythme effréné avec des gamins qui se prennent au jeu et n’en font qu’à leur tête au grand désarroi d’une équipe technique déboussolée. Jean Vigo, l’anarchisme en héritage, Jean Vigo l’enchanteur, Jean Vigo le sublime, obtient réparation pour tous ceux qu’on aura tenté d’écraser un jour. « Monsieur le professeur, je vous dis merde ! », comme parade à toute forme d’emprise. Ce « merde », comme un écho qui traverse les générations pour nous parvenir avec sa force inaltérable.
Mais Jean Vigo fait mieux que cela encore : il inscrit le désir au plus profond de nos âmes. Une pulsion de vie irradiante qui traverse chacune de ses images et dont on trouvera une résonance, là aussi, dans une filmographie de la désobéissance. Avec en vrac Le Petit Fugitif de Morris Engel et Ruth Orkin en 1953, À bout de souffle du déjà regretté Jean-Luc Godard ou Les 400 Coups de François Truffaut, mais aussi la plupart des films de John Cassavetes qui semble faire du cinéma de Vigo l’une de ses entrées les plus

insoupçonnées. Jusqu’aux tentatives aventureuses de Vanishing Point de Charles Robert Carner – hymne à la vie motorisé – ou plus récemment de cette autre étrangeté, But I’m a Cheerleader de Jamie Babbit, dans lequel désobéissance rime avec résistance dans le cadre d’un camp de reconditionnement d’une jeune femme soupçonnée d’être homosexuelle. À la fin, c’est la vie qui l’emporte. La mort parfois aussi, mais qu’importe ! Dans tous ces exemples, désobéir c’est vivre, désobéir c’est jouir. Nulle désobéissance sans désir.
C’est peut-être là le message le plus vibrant de Jean Vigo : libérer la pensée et l’acte à chaque instant, ne pas s’appesantir sur les conséquences ; rien n’empêche jamais d’aller au bout d’une intention. C’est en cela que Vigo est à rapprocher de Marcel Duchamp ou des surréalistes, et par la suite des avant-gardes qui visaient à la destruction de l’establishment, non sans une dose de candeur et de romantisme : fluxus, le pop ou le punk. Il est leur figure tutélaire, celui qui assène cette vérité sans fin : désobéir à en mourir.
LA DÉSOBÉISSANCE AU CINÉMA :
Zéro de conduite de Jean Vigo
Vanishing Point de Richard Sarafian
Afrique 50 de René Vautier
At Least Let Me Climb the Palm Trees de Lopes Barbosa
I Don’t Want to Be a Man de Ernst Lubitsh
But I’m a Cheerleader de Jamie Babbit Night Moves de Kelly Reichardt…
Zéro de conduite
UNE BELLE PROGRAMMATION DE FICTIONS ET DOCUMENTAIRES S’ATTACHE
99
Par Caroline Châtelet
Né en 1966 à Beni Zid en Algérie, Rabah AmeurZaïmeche arrive en France deux ans plus tard. C’est en 2001 qu’il réalise Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe ? Primé au festival Entrevues et prenant pour cadre la cité des Bosquets à Montfermeil (où le réalisateur a grandi), ce premier film raconte l’histoire de Kamel, condamné à une double peine. À travers le récit de son impossible réinsertion se dessine le portrait d’une petite communauté, comme est mise au jour la violence née du racisme latent et de la relégation perpétuelle subis par les habitants des banlieues. Fait avec les moyens du bord, mettant en scène la famille du réalisateur (comme luimême), ce film puise pour partie dans ses études en anthropologie. Dans ce cinéma au scalpel et à hauteur d’hommes, qui explore souvent toute la complexité de l’appartenance à une double culture, l’économie de moyens n’empêche pas la puissance. Autant de qualités que Rabah Ameur-Zaïmèche a déplié au fil de ses œuvres : Bled Number One (2006), Dernier maquis (2008), Les Chants de Mandrin (2012), Histoire de Judas (2015), Terminal Sud (2019). Ayant RÉEL
 Christmas In July - Ad Vitam, Ramzy Bedia
Christmas In July - Ad Vitam, Ramzy Bedia
LES CINÉMAS DU
POUR CETTE ÉDITION 2022, ENTREVUES DÉDIE SES FABBRICAS À RABAH AMEUR-ZAÏMÈCHE ET EMMANUELLE CUAU. DEUX CINÉASTES QUI TRAVAILLENT UNE ŒUVRE EXIGEANTE, CAPTANT AU PLUS JUSTE LES MOUVEMENTS INTIMES DE LEURS PERSONNAGES – COMME LES TERRITOIRES DANS LESQUELS ILS S’INSCRIVENT.
100
fondé en 1999 la société Sarrazink Productions, c’est au sein de cette dernière qu’il a produit et réalisé les six films précités, ainsi que son septième, Le Gang des bois du temple. Ce dernier, qui sortira en salles en 2023 (et sera projeté en avant-première à Belfort), se déroule dans une cité de Clichy-sousBois et promet de travailler avec les codes du film noir. Pour citer Rabah Ameur-Zaïmèche, « Quand les brigands ne sont pas forcément ceux que l’on croit, il arrive qu’un ange fasse sauter un rouage des rapports de domination où l’argent est roi, et libère un espace poétique dans l’engrenage fermé des déterminismes et des destins. »

Emmanuelle Cuau, quant à elle, est née en 1964 à Roubaix d’une mère comédienne et d’un père (entre autres) réalisateur de films documentaires, enseignant en cinéma et membre du comité de rédaction de la revue Les Temps modernes. Sœur de la comédienne Marianne Denicourt, Emmanuelle Cuau s’oriente vers la réalisation et entre à l’âge de dix-neuf ans à l’IDHEC (école ancêtre de la FEMIS). Elle qui a fait ses débuts au cinéma très jeune – adolescente elle se retrouve, en effet, sur le tournage de L’Argent de Robert Bresson et y fait même une figuration – réalise son premier court métrage, Offre d’emploi en 1993. Deux années plus tard suit son premier long, Circuit Carole (avec Bulle Ogier et Laurence Côte). Aussi émouvant qu’implacable, ce récit de l’éloignement progressif d’une jeune femme d’avec sa mère met à nu l’intrication possible entre solitude et bascule dans la folie. Suivront deux téléfilms (De mère inconnue en 1999, Tu seras un homme, mon fils en 2000), un court métrage (Les Galons du sergent en 2015) et deux autres longs ( Très bien, merci en 2007, Pris de court en 2015, réunissant notamment Virginie Efira, Gilbert Melki et Marilyne Canto). Il se déploie à travers cette filmographie en pointillés une façon d’observer des mécaniques sociales et intimes. Dans des cercles restreints (souvent familiaux), dans des espaces souvent privés (des appartements), des hommes et des femmes se retrouvent enferrés involontairement dans des situations inextricables, où se creuse leur solitude. Avec précision et sensibilité, Emmanuelle Cuau –qui a également travaillé comme scénariste – capte tous les soubresauts, mouvements intérieurs et contradictions humaines de ses personnages.
La Fabbrica voit double
En quelques années, le dispositif de la Fabbrica est devenu incontournable. Car en permettant de se plonger dans l’univers d’un cinéaste par ses films, par des échanges avec ses collaborateurs comme par les œuvres qui ont pu l’influencer, ce rendez-vous ouvre le champ et permet d’initier des dialogues
inattendus. Gageons qu’avec le doublement de cette programmation, les échanges se révèlent encore plus stimulants. Autour de ces Fabbricas consacrées à deux cinéastes précédemment primés et régulièrement revenus à Entrevues, rencontre avec le chargé de programmation et de coordination Charles Herby-Funfschilling.
Comment leurs deux œuvres dialoguent-elles ? Qu’est-ce qui fait, d’une part, leur singularité respective et existe-t-il, d’autre part, des points de jonction ?
Dire qu’il y a des points de jonction me semble difficile. Néanmoins, je dirais qu’il y a chez l’un et chez l’autre une volonté de travailler du côté du réel. Pour Emmanuelle Cuau, cela passe par un travail de recherche très fourni. Sa mère Denise Zigante était comédienne et son père Bernard Cuau était philosophe et collaborait aux Temps modernes. Je trouve cela beau, car l’on retrouve dans son cinéma le goût de la littérature. Par ailleurs, elle a collaboré avec les réalisateurs Jacques Rivette (en tant que scénariste) et Robert Bresson qui sont tous deux des cinéastes ancrés dans un territoire. On sent qu’elle vient de cette tradition-là, il y a quelque chose d’écrit dans la manière de construire avec des comédiens un réalisme relié à une époque et un espace. Rabah Ameur-Zaïmeche, lui, travaille du côté du réel en collaborant notamment avec des comédiens non professionnels. Il travaille également avec des comédiens professionnels venant du théâtre ou du cinéma – par exemple Ramzy Bedia, Slimane Dazi, Régis Laroche dans Terminal Sud (2019). Mais il y a sa « bande » de
Terminal Sud, Rabah Ameur-Zaïmeche © Sarrazink productions
101
cinéma, une équipe avec laquelle il a grandi et construit ses premiers films. Un autre point de jonction entre leur cinéma pourrait être que ce sont deux cinéastes qui, s’ils n’ont pas rejoint les mêmes systèmes de production, font tous les deux un cinéma dans une économie assez réduite.
Dans un entretien donné à la revue Vertigo en 2010, Rabah Ameur-Zaïmèche déclare : « Le cinéma, pour moi, c’est quelque chose de scientifique ; pas en tant que démarche savante et prétentieuse, mais comme recherche empirique, expérimentale. (…) La caméra est comme un microscope : on place des êtres devant, on observe leurs rapports, et on les expose. » Sans vouloir rabattre le cinéma de Rabah Ameur-Zaïmeche sur celui d’Emmanuelle Cuau (ou l’inverse), cette démarche d’entomologiste n’est-elle pas commune à tous deux ? C’est intéressant, car Rabah Ameur-Zaïmeche vient quand même de la sociologie, il a fait des études en sciences humaines et dit lui-même être touché par le cinéma documentaire de Robert Flaherty. Il y a dans son travail quelque chose de ce cinéma d’analyse. Mais il cherche, aussi, à construire une fiction avec ses personnages, ce n’est pas qu’un cinéma de la distance. Emmanuelle Cuau se situe peut-être dans une tradition plus romanesque – sur la construction de l’identité, de soi, sur l’élaboration des rapports de pouvoir dans les relations de travail, ou des liens au sein d’une famille. Si Rabah Ameur-Zaïmeche s’attache à révéler ces rapports,

il les inscrit dans des territoires plus vastes où peuvent se croiser des personnages antagonistes, ne partageant pas forcément les mêmes croyances ni le même domaine de travail.
Vous évoquez les territoires. Quid de la façon dont ces deux réalisateurs saisissent les paysages – intimes comme géographiques – dans lesquels évoluent leurs personnages ?
Ce sont deux cinéastes avec une grande puissance plastique et qui proposent en même temps une vision assez métaphorique d’un endroit (qu’ils le connaissent au préalable ou qu’ils l’aient traversé en repérages). Dans Circuit Carole – film au titre parlant –, tout est construit autour de cet endroit [circuit de motos et de karts situé à Tremblay-en-France, ndlr]. Le reste des lieux se réduit à l’appartement où vit Bulle Ogier, qui interprète la mère de Marie. Le circuit devient une image mentale, celle qui poussera Bulle Ogier dans la folie. À travers ce lieu est développée l’idée de tourner en rond, de prendre le risque et tout le film se construit autour de cela. Quant à Rabah Ameur-Zaïmèche, si je prends l’exemple de Dernier maquis (2008), il se déroule dans cet atelier envahi de palettes rouges. Cela produit des images extrêmement fortes. À partir de cet espace en chantier, Rabah Ameur-Zaïmeche parvient à construire tout un territoire. En se limitant à quelques plans, avec parfois quelques plans d’ensemble, le film nous fait entrer dans un univers très puissant.
Virginie Efira, Pris de court, Emmanuelle Cuau © Carole Bethuel
102
Décloisonnés
La LAW s’empare de nouveaux territoires – terrestres comme numériques, le Consortium donne sa chambre à l’Américaine Tschabalala Self, et le Frac Alsace déborde merveilleusement, enseveli sous le puzzle sacré de Charlemagne Palestine.
LUXEMBOURG ART WEEK, LA RUÉE VERS L’ART
 Par Mylène Mistre-Schaal
Par Mylène Mistre-Schaal
L’ENTHOUSIASME DYNAMISENT INCONTESTABLEMENT LA SCÈNE ARTISTIQUE DU GRAND-DUCHÉ.
Huit ans déjà ! Quels sont les temps forts ou nouveautés qui feront le sel de cette édition 2022 ?
En 2021, nous avons changé de lieu pour nous installer au cœur de la ville [sur le Champ du Glacis, ndlr], dans un espace de 5 000 m² mieux articulé et nous offrant des conditions plus professionnelles : ce fut un upgrade qualitatif considérable ! Cette année, notre principal objectif est d’asseoir cet acquis pour proposer les meilleures conditions aux exposants et au public.
Sinon, cette édition se singularise par la mise en place de partenariats avec de nombreuses institutions, des conférences sur les thématiques importantes, des journées professionnelles avec des colloques et des tables rondes : en bref, une programmation super dynamique avec la quasi-totalité des acteurs luxembourgeois !
Vous multipliez d’ailleurs les collaborations avec les institutions culturelles locales et notamment avec le Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain. En parallèle de son exposition monographique au Casino, l’artiste Adrien Vescovi proposera une installation spécialement pensée pour la LAW. Quelle forme prendra cette intervention et comment s’intègrera-t-elle à la scénographie de la foire ? Le travail d’Adrien Vescovi joue sur la temporalité de la trace, sur les effets de texture. Ses compositions, souvent monumentales, combinent des draps recyclés, teints, puis délavés par le temps. Elles questionnent le processus de fabrication de l’œuvre et réveillent le potentiel poétique des
matériaux. Pour la LAW, Vescovi occupera l’espace lounge avec un agencement de plusieurs pièces majeures. Son installation donnera une atmosphère absolument inédite à cette partie de la foire, tout en permettant au public d’entrer au cœur de son univers.
Adrien Vescovi pratique un art environnemental, presque écologique, qui entre particulièrement bien en écho avec la thématique que vous donnez à cette 8e édition : les enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux de notre époque. Selon vous, quelle place l’art et la culture doivent-ils prendre face aux crises que nous traversons ?
Je dirais sans hésitation aucune que la culture est la valeur cruciale de notre civilisation, de notre « être ensemble ». Sans cette valeur culturelle, ce besoin d’exprimer notre diversité, notre individualité et notre sensibilité, je ne saurais pas vous dire ce qui définit l’humanité ! La liberté et la créativité sont essentielles pour éviter la stagnation qui, très souvent, va de pair avec la régression et ses pires dérives.
EN HUIT ÉDITIONS, LA LAW (LUXEMBOURG ART WEEK) A SU SE TAILLER UNE PLACE À PART SUR LA CARTE EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN. RENCONTRE AVEC ALEX REDING, GALERISTE ET FONDATEUR DE CETTE JEUNE FOIRE DONT L’EXPANSION ET
104
Vous prenez également le tournant des nouvelles technologies à bras le corps en proposant un espace visant à informer le public sur l’art numérique et les NFT. L’avenir des galeries d’art est-il sur nos écrans ?
Le monde se digitalise et, évidemment, les artistes s’interrogent sur l’impact de cette digitalisation avec des propositions très variées. Mais je ne crains pas du tout pour l’avenir des galeries d’art. Vous savez, le schéma du galeriste dans sa galerie qui attend que le client vienne à lui peut très bien coexister avec ce nouveau monde. À chacun de voir à quel point il veut s’investir dans l’un ou l’autre. Finalement, vouloir acheter et posséder une œuvre non physique que l’on peut regarder sur son écran plutôt qu’un tableau, c’est un choix individuel !
Cette année la LAW accueillera le chiffre record de 80 galeries, locales et internationales. Pouvezvous nous donner un aperçu de la diversité, tant géographique que stylistique, des galeries présentes ? Évidemment, l’un de nos objectifs est de représenter la scène artistique locale auprès du public luxembourgeois. En tant qu’organisateur,
j’ai également à cœur de cibler les pays limitrophes avec lesquels nous avons tissé une relation de confiance. Il y aura donc une belle représentation de galeries belges, allemandes et françaises. On pourrait presque parler d’une grande région, qui de Bruxelles à Paris, en passant par Francfort ou Cologne, se retrouve au Luxembourg !
L’idée est également de rassembler des galeries d’expression et de styles divers. La section « Take off », dédiée à la jeune création, propose des formes d’art plus expérimentales et plus populaires comme le street art. Elle se prête aux achats plus spontanés.
La « Main section », offre quant à elle une sélection d’art contemporain plus pointue. On y trouve des pièces historiques des années 1950-1960 par exemple, très recherchées par les collectionneurs purs et durs. Chaque année, nous nous efforçons d’offrir des choix variés, susceptibles d’enthousiasmer nos différents publics !
— LUXEMBOURG ART WEEK, foire du 11 au 13 novembre à Luxembourg-ville, au Luxembourg www.luxembourgartweek.lu
 Ceysson & Bénétière, Luxembourg Art Week 2021 © Sophie Margue
Ceysson & Bénétière, Luxembourg Art Week 2021 © Sophie Margue
105

« FAIRE DE LA PLACE » À TSCHABALALA SELF Par Martial Ratel ~ Photos : Vincent Arbelet RENCONTRE AVEC L’ARTISTE AMÉRICAINE TSCHABALALA SELF ET FRANCK GAUTHEROT, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION MAKE ROOM, AU CONSORTIUM.
Qui est Tschabalala Self et pourquoi avoir choisi de l’exposer ?
Franck Gautherot : Tschabalala est une artiste née en 1990 et, malgré son jeune âge, elle a une carrière américaine et internationale importante. Elle est née à Harlem, a étudié à Yale, d’où elle est sortie diplômée en 2015. Elle a participé à des expositions personnelles ou collectives dans un certain nombre de musées ou de galeries. Elle a obtenu une visibilité très rapide. Elle a devant elle, possiblement, 50 ans de carrière ! Au Consortium, c’est la première exposition institutionnelle en dehors d’un musée aux États-Unis. On pense que c’est le bon moment pour l’exposer. Tschabalala était venue il y a un an pour repérer les espaces. On a pris le temps ensemble d’identifier les œuvres à montrer et elle a choisi d’en faire de nouvelles.
Make room, pourquoi ce titre et quel est le lien entre les œuvres exposées ?
Tschabalala Self : La plupart des pièces de cette exposition s’intéressent à la chambre. C’est un titre à double sens avec l’idée de faire un espace ou de « ranger » la chambre. C’est un terme américain pour dire « faire de la place ». Ce qui m’intéresse ce sont les dynamiques et les barrières de personnages archétypaux, l’homme et la femme, seuls ou ensemble dans un environnement particulier.
Dans ton travail transparaît l’idée de stéréotypes masculin/féminin sans qu’on ait pour autant l’impression que tu les critiques systématiquement.
T. S. : Personnellement, je ne vois pas de stéréotypes dans mon travail même si je comprends bien que les spectateurs puissent avoir ce genre d’interprétation. Pour moi, je dépeins des scènes comme j’imagine qu’elles sont « expérimentées », vécues. Parfois, les gens parlent de l’exagération qui existe dans ce travail et cela pourrait référer à un biais culturel, comme un stéréotype, mais en réalité la distorsion qui existe dans mon travail est plus liée aux expériences vécues et à ma représentation.
En plus des peintures, il y a ce mobilier très coloré particulier.

F. G : Tschabalala a travaillé sur une sorte de spectacle, qui a été donné plusieurs fois pour le festival new-yorkais Performa. Elle a dessiné, écrit le texte, le script, conçu la mise en scène, conçu les costumes et le décor. C’est une œuvre d’art totale ! Le mobilier faisait partie de cette histoire. L’histoire, c’est un couple qui a des rapports conflictuels et qui est observé par un autre couple. Ce deuxième couple prend à son tour la place du premier et a aussi ces rapports conflictuels. C’est l’histoire universelle du rapport entre les hommes et les femmes.
En plus de la peinture sur toiles, tu utilises une technique très originale : tu couds directement sur la toile. Comment en es-tu arrivée à utiliser cette technique ?
T. S : Je récupérais différents matériaux qui avaient des textures différentes et que je voulais intégrer à mon travail. Je suis arrivée à cette technique après avoir étudié, il y a quelques années, la technique de la collagraphie, une technique d’impression intermédiaire entre le collage et la gravure. Ça m’a appris à faire mes propres matrices. Après le travail avec les matrices, je me suis intéressée à comment intégrer ma peinture sur des assiettes. Et finalement, je voulais une transition de ces travaux vers des toiles. Je voulais aussi faire davantage d’expérimentations au niveau de l’échelle. Donc je me suis finalement concentrée sur la fabrication des assiettes et réciproquement la fabrication d’assiettes s’est reflétée dans la peinture.
Est-ce qu’on peut parler de technique domestique que tu améliorerais ?
T. S. : Ce n’est pas quelque chose que je visai. Je ne peux pas dire que j’ai vu une machine à coudre et que j’ai voulu l’intégrer dans mon travail, même si la machine à coudre pouvait être un élément de mon quotidien. C’est quelque chose de moins conscient, en rapport à la sphère domestique ou à une activité féminine. C’est lié à un contexte culturel, les femmes afro-américaines utilisent cette technique, et cela se retrouve aussi dans ma peinture.
— MAKE ROOM, exposition jusqu’au 22 janvier au Consortium muséum, à Dijon www.leconsortium.fr
107

CCCCCHARRRLEEEWWWWORLLDDDDD AAAAA GGGESSAAMMMTTTKKKUUNSTTWERKKK ?????????? CHAIM MOSHE, ALIAS CHARLEMAGNE PALESTINE, IMMENSE REPRÉSENTANT DE L’AVANT-GARDE ARTISTIQUE DU NEW YORK DES SEVENTIES, S’EMPARE DE L’ESPACE DU FRAC ALSACE AVEC UNE INSTALLATION AU NOM À RALLONGE OÙ SE CÔTOIENT 1 001 PELUCHES ET GRIGRIS BAIGNÉS DANS UNE ATMOSPHÈRE MYSTIQUE ET D’OBSÉDANTES NOTES DE PIANO DE SA COMPOSITION. DIVINS DOUDOUS Par Emmanuel Dosda Kunsthalle-Wien © Maximilian Pramatarov 108
Face à l’artiste culte, ce jour-là en short/t-shirt, deux casquettes superposées sur le crâne, double paire de lunettes accrochées à leur cordon et duo de foulards autour du cou, je me suis risqué à poser la question qui fâche : pourquoi celui qui, dès la fin des années 1960, fréquenta Tony Conrad, Philip Glass, Terry Riley ou La Monte Young, exècre le terme « minimaliste ». Ce sacré Charlemagne, dos voûté comme Quasimodo (la comparaison ne le dérange pas : il fut carillonneur dans une église de la Cinquième Avenue dans les sixties), avance son visage à quelques centimètres du mien et éructe dans un mélange de franglais et de néologismes inspirés du yiddish dont il a le secret : « À qui ça ferait plaisir d’être réduit à une être “minimaliste” ? C’est ridicule : on peut me dire que je suis crazy, funny, sexy, mais surtout pas minimaliste ! » Charlemagne Palestine agite les bras, citant le Gesamtkunstwerk wagnérien et évoquant la notion de maximalisme dont il se réclame. Le regard redevenu doux, il s’assied dans une moelleuse chaise de bureau à roulettes, sa « Director’s chair », et glisse dans son antre saturé de peluches du sol au plafond tout en lançant quelques directives à ses assistants, dont le fidèle Lionel Hubert, fasciné depuis vingt ans par cet artiste recycleur né en 1947, « actif en permanence, passant de projet en projet. Il réemploie d’anciennes pièces, en génère d’autres et invente de nouvelles formes sans arrêt ». Le bouillonnant Charlemagne acquiesce, satisfait : l’espace vitré du Frac qu’il nomme affectueusement « l’aquarium » rassemble « 40 ans de travail » !
Felizitas Diering, directrice de l’institution, insiste : « Il ne s’agit pas d’une rétrospective, ce mot est funèbre, mais plutôt d’une sorte de puzzle qui se compose de très nombreux éléments, même certains conçus par d’autres », comme les membres du Caksis, canoë club de Sélestat ayant customisé un kayak trônant dans l’expo. « Il a travaillé comme à son habitude, en tenant compte de l’architecture et des qualités du lieu, sans cimaises », métamorphosant le Frac en vaste cathédrale où règnent le spirituel et l’art. L’un étant indissociable de l’autre pour le New-Yorkais.
Partout, les peluches de sa collection personnelle ou chinées chez Emmaüs Scherwiller semblent nous scruter d’un œil espiègle. Suspendues, rangées dans des valises ou collées sur des toiles comme des touches picturales créant des tableaux 3D, elles sont rigolotes, mignonnes, flashy, mais inspirent un inattendu respect, voire de la crainte, comme des statuettes vodous. Surtout son God Bear , ours mutant à trois têtes et deux corps inspiré par le dieu Ganesh. Cette passion pour les doudous qui habitent son « bordel sacré » lui vient de l’enfance. Il nous questionne quant à notre attachement au lapin de notre jeunesse (et écoute la réponse avec réel intérêt) avant de confier cette histoire : « Vers l’âge de dix ans, ma mère a décidé malgré moi de jeter tous les teddy-bears et autres animaux qui m’accompagnaient depuis toujours. Mon père – très cartésien – les a tous mis dans le coffre de la voiture, direction la déchèterie, mais les a ramenés à la maison : ils lui avaient parlé ! » Artiste animiste, Charlemagne confère une puissance magique à son bestiaire qu’il considère comme un ensemble de divinités, dont les plus importantes sont le Blind Monkey ou son grand copain King Teddy . Ses peluches sont mystérieuses, bavardes, conseillères, héroïques parfois, tels ces oursons en parachute

 Charlemagne in Charleworld © Agnès Gania
Nounours, FRAC Alsace
Charlemagne in Charleworld © Agnès Gania
Nounours, FRAC Alsace
109
commémorant le débarquement. Six mois de préparatifs ont été nécessaires pour transformer le Frac en caverne alibabesque féérique peuplée par ces amoncellements de nounours et poupons, Dingo et Mickey, Pikachu et autres manchots rafistolés. Des manchots ? Pardon, des empereurs…

Toujours, le plasticien/musicien investit un lieu donné afin de concevoir un Charleworld rempli à ras bord, résolument « maximaliste », expansif : son univers esthétique, art voulu total, n’est pas



envisageable sans la musique de celui qui étudia les chants indiens, joue sur des instruments électroniques ou du gamelan indonésien, imagina des synthétiseurs d’un troisième type comme The Spectral Continuum Drone Machine et poursuit sa quête du Golden Song, le son pur, la « sonorité d’or » grâce aux notes répétitives de son piano et bourdonnements persistants conduisant à la transe. Ces performances sont des rituels mystiques et ses installations des univers excentriques composés de jouets devenus fétiches tribaux. Il y flotte un parfum d’enfance et des effluves de clou de girofle. À quelques heures du vernissage, l’artiste désigne son piano recouvert de peluches parmi guirlandes de tissu, boules à facettes, bestioles abimées par le temps et ex-voto usés. Charlemagne le chaman, chantre de l’artisanat, songe à sa proche performance musicale qui, enregistrée, fera office de BO à l’expo. « Bien sûr, je me produirai un whisky à la main : c’est avec un petit verre que je joue le mieux ! » À 75 ans, l’éternel gamin n’est pas près d’arrêter de jouer : « Lorsque je serai mort, des vers viendront me dévorer et ils deviendront créateurs à leur tour », assure-t-il. La relève est assurée.
— CCCCCHARRRLEEEWWWWORLLDDDDD AAAAA ??????????, exposition jusqu’au 13 novembre au Frac Alsace, à Sélestat frac-alsace.org
Nounours, FRAC Alsace
Avec l’aimable autorisation du Jewish Museum NY
CAPRI Dusseldorf, 2018 © Udo Siegfriedt
Bruxelles, 2018
GGGESSAAMMMTTTKKKUUNSTTWERKKK
110
i ns -i t u
Adrien Vescovi, jours de lenteur
Paysages à la douceur de l’arrière-saison, sédimentations comme des collines, abstractions colorées aux tons suaves… les œuvres d’Adrien Vescovi invitent au voyage immobile. Composées à la machine à coudre ou comme des draps suspendus aux balcons des villes méditerranéennes, ses créations textiles vadrouillent de l’ocre au rouille en passant par le vert tendre. Au Casino Luxembourg, l’artiste marseillais propose une œuvre monumentale intérieure et plusieurs tableaux extérieurs, qui s’offrent au souffle des éléments et aux aléas du temps. (M.M.S.)

Du 1er octobre au 29 janvier
Au Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, à Luxembourg-ville www.casino-luxembourg.lu
Adrien Vescovi, vue d’atelier, 25/06/2022, Marseille © Adrien Vescovi
in situ
112
Deimantas Narkevičius Anachronisms
Deimantas Narkevičius est l’un des artistes lituaniens les plus prolifiques de sa génération. Entre fiction et documentaire, il se sert du médium filmique pour raconter l’ère post-communiste dans son pays. Des images sur fond de guerre froide qui créent une iconographie singulière mâtinée d’idéologies et de propagande. Composés à partir d’extraits de films d’archives retravaillés, les films de Narkevičius s’apparentent à des documentaires historiques trafiqués où l’ironie démonte l’utopie. (M.M.S.)

Jusqu’au 15 janvier
À la Konschthal Esch, à Esch-sur-Alzette www.konschthal.lu
Karl Marx Monument (Chemnitz), 2007 © Deimantas Narkevičius
in situ
113
Raoul Hausmann et Peter Rösel Die Sonne scheint
Des œuvres qui se font écho, des motifs qui se croisent ou se répondent, des accointances picturales… la Galerie Hervé Bize orchestre la rencontre de deux artistes : le dadaïste Raoul Hausmann et le plasticien contemporain Peter Rösel. Nénuphars aux feuilles taillées dans le vert d’anciens uniformes de police, paysages photographiques à perte de vue, huiles sur toile frôlant l’abstraction, poésie sonore ou installations, ces deux touche-à-tout partagent un goût certain pour l’exploration physique et mentale du monde. (M.M.S.)
Du 29 septembre au 17 décembre À la Galerie Hervé Bize, à Nancy www.hervebize.com
 Peter Rösel, Water Lilies Pink, 2020 © Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Galerie Hervé Bize, Nancy (photo Adam Reich)
Peter Rösel, Water Lilies Pink, 2020 © Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Galerie Hervé Bize, Nancy (photo Adam Reich)
in situ
114
Betye Saar, Serious Moonlight
Plasticienne touche-à-tout, Betye Saar fait partie de la tribu des artistes engagées. Cheminant de la sculpture à l’aquarelle en passant par les arts textiles, l’artiste étatsunienne s’est affirmée dès les années 1960 comme une figure incontournable du Black Arts Movement. Ses œuvres métissent les techniques et touchent du doigt un certain mysticisme où cœurs enflammés, gris-gris, dés à jouer et ombres portées forment une ritournelle enchantée. (M.M.S.)
Jusqu’au 22 janvier Au 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, à Metz www.fraclorraine.org
 Betye Saar, Shadow in Brandywine Studio, Philadelphia, 1987,1988. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Roberts Projects, Los Angeles. Photo : Robert Wedemeyer.
Betye Saar, Shadow in Brandywine Studio, Philadelphia, 1987,1988. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Roberts Projects, Los Angeles. Photo : Robert Wedemeyer.
in situ
115
SurréAlice.
Lewis Carroll et les surréalistes

Irruption d’un merveilleux sous hallucinogène, distorsions et changements d’échelle à gogo, animaux parlants et exploration des méandres labyrinthiques de l’imaginaire… Alice au pays des merveilles avait tout pour entrer au panthéon des surréalistes ! De Dalí à Max Ernst en passant par René Magritte, Meret Oppenheim ou Claude Cahun, « SurréAlice » invite à se promener dans une collection d’images marquées par l’héritage de Lewis Carroll, où jeux de cartes, bestioles fantastiques et culte de l’étrange ont toute leur place. (M.M.S.)
Du 19 novembre au 26 février Au MAMCS et au Musée Tomi Ungerer, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu
Jiří Trnka, Falling Alice, collection privée © Avec l’aimable autorisation des ayants droit
in situ
116
Au Bonheur

Une jupe abat-jour pour aller danser, une lampe délicieusement lippue, des créations à la beauté composite et quelques accessoires décoratifs style nouille : la dernière exposition du CEAAC fait la fête aux objets ! En compagnie d’une vingtaine de plasticiens, l’institution strasbourgeoise renoue avec la fonction première du bâtiment qui l’abrite : la vente au détail de porcelaines, poteries, verreries, articles de ménage et luminaires. Au-delà du clin d’œil à Émile Zola, « Au Bonheur » dépoussière notre petite mythologie des objets du quotidien et joint l’utile à l’agréable (M.M.S.)
Du 1er octobre au 8 janvier Au CEAAC, à Strasbourg www.ceaac.org
Marianne Marić, Lamp-girls © Avec l’aimable autorisation de l’artiste
in situ
117
Fabienne Verdier
Le chant des étoiles

Calligraphe de talent et sinophile avérée, Fabienne Verdier nous enchante depuis des années avec ses arabesques à la force expressive singulière. À Unterlinden, elle touche le cosmos du doigt et saisit le murmure des étoiles avec une série de toiles spécialement conçues pour le Musée. Entre spontanéités abstraites, aurores boréales et constellations, elle déploie une aura mystique qui résonne divinement bien avec les collections de l’institution colmarienne. (M.M.S)
Du 1er octobre au 27 mars
Au Musée Unterlinden, à Colmar www.musee-unterlinden.com
Dara Reaksmey 2022, Rayon / lumière d’étoile, photographie : Inès Delieman Fabienne Verdier, ADAGP, Paris,
in situ
,
©
2022 118
Anaïs Boudot, reliques des jours

Qu’il s’agisse du regard doré d’un chat perché, de portraits d’anonymes, de solides maisons du Perche ou de la hampe bourgeonnante d’une fougère, les clichés d’Anaïs Boudot ont quelque chose d’ensorcelant. Reliques des jours rassemblant plusieurs séries qui se jouent des allers-retours entre argentique et numérique et mettent à l’épreuve notre rapport à la photo souvenir. Le grain singulier de ces petites images sur verre leur donne un charme intemporel et brouille les pistes entre l’exceptionnel et le quotidien. (M.M.S.)
Jusqu’au 30 octobre À La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
Les Oubliées, Persona © Anais Boudot
in situ
119
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Avec un titre qui évoque instantanément les marionnettes, « Trois p’tits tours et puis s’en vont » fait de l’art un spectacle vivant. En six propositions artistiques d’une grande variété, elle convole de la Commedia dell’arte au cabaret dada en faisant un détour par le pantomime. La sérénade kitsch d’Aurore-Caroline Marty invoque tragédie grecque et polystyrène tandis que Chloé Serre imagine le décor d’un concours canin étrangement humain. On y verra également une comédie musicale mettant en scène des bactéries géantes et des marionnettes anarchistes au grand cœur. (M.M.S.)

Jusqu’au 15 janvier
Au Crac Le 19 - Centre régional d’art contemporain, à Montbéliard www.le19crac.com
Aurore-Caroline Marty, Sérénades (détail), 2020
in situ
120
Anatomie comparée des espèces imaginaires
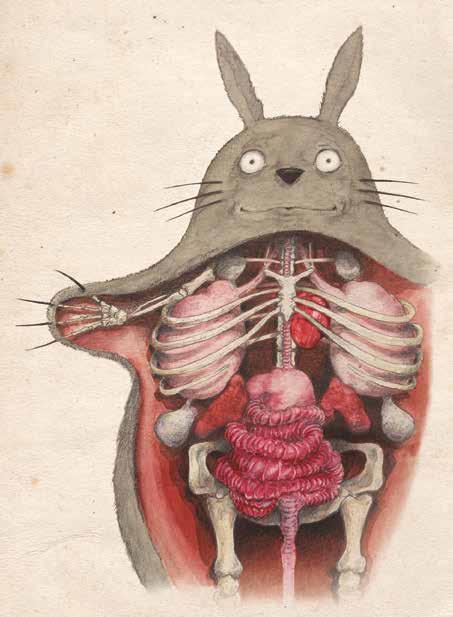
Quand la science de l’évolution et la culture geek se rencontrent au musée, il y a de quoi faire chavirer les cœurs en manque de pop culture. Chewbacca et paléontologie, anatomie des dragons et X-mens passés sous les radars de la biologie, « Anatomie comparée des espèces imaginaires » mélange les référentiels pour mieux décortiquer nos mythes contemporains. Au carrefour de la recherche et du fantastique, cette exposition emprunte des voies originales et mixe sci-fi, heroic fantasy, comics et sciences sous la houlette d’un paléontologue et d’un illustrateur spécialisé. (M.M.S.)
Jusqu’au 12 mars
Au Musée du Château des ducs de Wurtemberg, à Montbéliard www.montbeliard.fr
Totoro © Arnaud Rafaelian
in situ 121
La Beauté du Diable
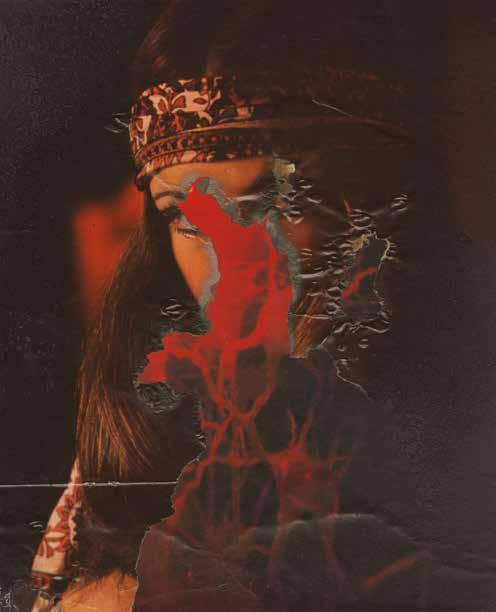
Ange déchu ou tentateur machiavélique, le diable et ses métamorphoses n’ont cessé de fasciner l’histoire de l’art. Au Frac Franche-Comté, le malin instille le venin de sa dangereuse beauté et convoque quelques-uns de ses disciples contemporains (une trentaine d’artistes). Parmi eux, le photographe Andres Serrano et son transgressif Piss Satan, l’univers en demi-teintes de la peintre néerlandaise Iris van Dongen ou les vénéneuses séries noires d’Annette Messager titillent l’oxymore et prennent un malin plaisir à l’esthétisation du mal. (M.M.S.)
Du 16 octobre au 12 mars
Au Frac Franche-Comté, à Besançon www.frac-franche-comte.fr
Secret Hell © Julien Langendorff. Photo : D.R.
in situ
122
Roland Topor “Oh la la”
Avis d’humour noir au Consortium Museum ! Touche-à-tout savamment provoc’, Roland Topor pose ses valises à Dijon le temps d’une rétrospective focus sur ses dessins et peintures. Entre poésie grinçante, absurdité confondante et accointances surréalistes, son univers peuplé de corps hybrides et de situations tragicomiques réveille nos rétines et nos esprits avec la même énergie que de son vivant. (M.M.S.)
Jusqu’au 22 janvier Au Consortium, à Dijon www.leconsortium.fr
 Roland Topor, En soi-même, 1996. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Anne Barrault, Paris.
Roland Topor, En soi-même, 1996. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Anne Barrault, Paris.
in situ
123
Territories of Waste.
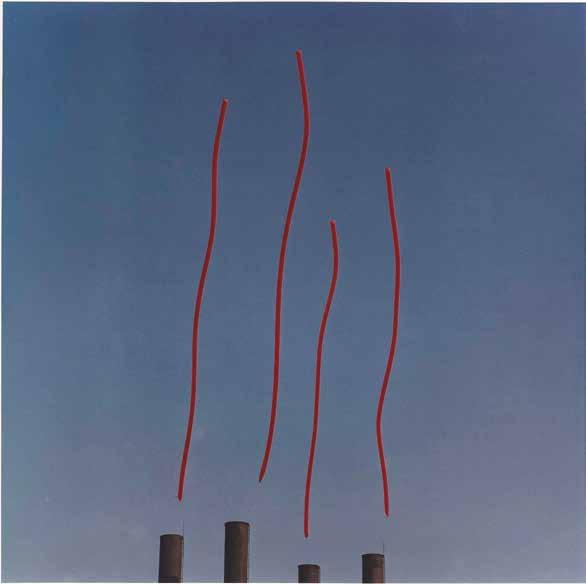
On the Return of the Repressed
Microplastiques, métaux lourds, pesticides… les déchets ont imprégné le vivant jusqu’à la moelle. Enfouis, cachés ou déplacés vers d’autres latitudes ils sont la part refoulée de nos sociétés de consommation et laissent des cicatrices dans nos paysages. En 25 propositions artistiques, le Musée Tinguely envisage le rebut et ses conséquences comme un territoire d’expression. Du Junk Art des années 1960 aux réflexions plus contemporaines, les œuvres convoquées offrent un panorama contrasté pour mieux dénoncer, démontrer et démonter la destruction environnementale en cours. (M.M.S.)
Jusqu’au 8 janvier
Au Musée Tinguely, à Bâle www.tinguely.ch
Otto Piene, Black Stacks Helium Sculpture, 1976 © 2022 ProLitteris, Zürich; Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis
in situ
124

CHRONIQUE
DU TEMPS QUI PASSE
Par Nicolas Comment NOUS PARLE DE SES RENCONTRES.

ÉPISODE 10
Je ne suis pas un « portraitiste ». Pas plus que je ne me serai dans ces colonnes senti journaliste, je n’ai cherché de toute ma vie de photographe à couper les têtes ou collectionner les masques. Je n’ai jamais tenu d’herbier ni punaisé les papillons. Et si, adolescent, j’ai pu commencer des « albums Panini », c’était sans les terminer. Pourtant j’ai le sentiment que ces chroniques écrites à l’invitation de la revue Novo – en grande partie durant les confinements de 2020 et 2021 – sont bel et bien des « portraits ». Fruits de rencontres artistiques pour la plupart hasardeuses, ils et elles forment devant ma mémoire une sorte de petite constellation : carte en points à relier ou guirlande électrique clignotant dans la nuit tombante comme le profil du temps qui passe.
J’ai toujours été déçu – j’allais dire « confondu » devant les photographies de Baudelaire. J’ai beau y voir le visage de Baudelaire, quelque chose me crie dans l’image que ce n’est pas lui. Ni les yeux « couleur de tabac d’Espagne », ni la « fleur bleuâtre que veloutait la poudre de riz, avec les nuances vermeilles des pommettes », la bouche aux « sinuosités mobiles, voluptueuses et ironiques comme les lèvres des figures peintes par Léonard de Vinci » n’y sont visibles. Que j’ouvre alors les merveilleuses pages que Théophile Gautier lui consacre dans sa préface aux Fleurs du Mal , et je le retrouve, l’être, le poète… Alors ? Est-ce le fait que « Ces choses, parce qu’elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai […] » comme l’écrivait Baudelaire à propos de la peinture dans l’article Salon de 1859 ? La célèbre photographie
Rodolphe Burger, Strasbourg, 2005
NICOLAS COMMENT
126
bougée de Rimbaud par Carjat est, on le sait, fautive – les témoins, tel son ami Ernest Delahaye, disent tous que Rimbaud ne s’y ressemble pas. Floutée, grainée, surexposée, les défauts même de cette image semblent pourtant qualifier l’art de Rimbaud. Il existe en effet une seconde photo de Carjat, nette cette fois et jugée plus ressemblante : là non plus on n’y voit pas Rimbaud. Simplement l’enveloppe d’un adolescent boudeur, quelconque. Ni l’être, ni la Lettre. Car si le « poète est toujours exact » comme l’affirme Cocteau dans ses Portraits et souvenirs, son image est souvent « un mensonge qui dit la vérité ».

Ces « Exercices d’admiration », comme les nomma Cioran, ont été écrits au fil de la plume, sans prétexte d’actualité, ni hiérarchie. Sans ordre d’importance, et j’allais dire sans choix sinon celui « forcément capricieux 1 » du hasard ou des
1 Cioran, Exercices d’admiration
souhaits jamais autoritaires du directeur de la publication ou du rédacteur en chef de Novo. Car nombreuses furent les rencontres artistiques dont je n’ai pas parlé dans ces chroniques. En premier lieu, Rodolphe Burger et sa « dernière bande » que j’eus la chance de côtoyer durant plusieurs années mais dont il y aurait trop à dire tant fut riche et chorale cette rencontre… Dans son sillage : Olivier Cadiot, Pierre Alféri, Jean-Luc Nancy, Rachid Taha, James Blood Ulmer ou bien encore l’actrice Jeanne Balibar que je suivis dans son quotidien pour illustrer la pochette et le livret de son album Slalom Dame (2006). Jacques Higelin dont j’ai déjà livré le souvenir dans un livre paru en 2019 aux éditions Hoëbeke / Gallimard, etc. Quant à Philippe Katerine, photographié à moitié nu pour les besoins d’un film de Thierry Jousse sur lequel j’étais photographe de plateau, je ne le « rencontrai » pour ainsi dire pas, enfermé qu’il était dans son rôle principal (j’ai observé ce matin mes planches-contacts : je n’ai photographié que le personnage qu’il jouait).
Jeanne Balibar, Paris, 2005
127
Peu parlé des écrivains : Chloé Delaume et Yannick Haenel avec lesquels j’ai collaboré dans le cadre de mes albums comme avec le poète contemporain Patrick Bouvet. Des cinéastes : Alain Cavalier armé de sa petite caméra Sony Hi8 à l’Université Lumière, Philippe Grandrieux et ses séminaires aux BeauxArts de Lyon, ceux du vidéaste Thierry Kuntzel apparaissant un beau matin sur les pentes de la Croix-Rousse avec ses citrons, sa vodka et ses merveilleuses notes sur la vidéo… Des danseuses : Zula – capitaine « Pony Girl » –, Charlotte aka « Baby Light » ou Sophie évoluant en cinémascope sur la scène du Crazy Horse « dans la nudité et dans la gravité »1. Des éditeurs – Patrick Le Bescont, MarieLaure Dagoit, Bruno Chibane, Stan Cuesta, Philippe Schweyer, des producteurs – Jean-Louis Piérot, Marc Collin, Pierre Darmon, rencontres essentielles mais qui m’auraient obligé à trop parler de moi… Quid des portraitistes eux-mêmes ? Les photographes : Willy Ronis, Denis Roche, Richard Dumas ou Bernard Plossu qui compta tant et compte toujours à mes yeux ; ami néanmoins maître – déjà évoqué dans mon livre Journal à rebours (1991-1999) paru aux éditions Filigranes, en 2019. Enfin tous les artistes de ma génération, croisés trop récemment pour leur dédier une chronique… Car si je fais ici semblant de me souvenir, je n’ai bien sûr aucune mémoire sinon celle d’une « boîte noire ».

 Philippe Katerine, Paris 2009
Jean-Louis Piérot,
Philippe Katerine, Paris 2009
Jean-Louis Piérot,
2008 128

 Chloé Delaume, Rome, 2012
Jacques Higelin, Sainte-Marie-aux-Mines, 2006
Chloé Delaume, Rome, 2012
Jacques Higelin, Sainte-Marie-aux-Mines, 2006
129


 Bernard Plossu, Paris, 1999
Denis Roche, chez lui à la Fabrique, Paris, 2006
Willy Ronis, Auvers-sur-Oise, 1999
Bernard Plossu, Paris, 1999
Denis Roche, chez lui à la Fabrique, Paris, 2006
Willy Ronis, Auvers-sur-Oise, 1999
130
Du plus loin que je (re)tourne ce « jet de projecteur qui se promène à la surface de cette nuit accumulé derrière chacun de nous et qui se fixe sur un visage, un acte, un lieu significatif 2 […] », mon tout premier contact extérieur avec « le monde de l’art » fut une femme, résistante et féministe : Edmonde Charles-Roux.
À Mâcon, où s’était réunie l’Académie Goncourt à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Alphonse de Lamartine, l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris nous reçut un soir de 1990 en tailleur Chanel et collier de perles « gauche-caviar ». La salle de la mairie était sombre et les ors craquelés de la République, éteints. Dans cette pièce obscure où Lamartine pénétra en son temps nous étions entrés – Bruno, Mohammed et moi-même – pour vérifier à quoi pouvait bien ressembler la présence physique d’un « cénacle littéraire » dans notre petite ville de province. Brillant Mohammed qui m’apprit tant de la poésie marocaine – notamment d’Abdellatif Laâbi – que je photographierai un jour à Marrakech en mémoire de nos années de lycée… C’était l’automne, le brouillard était lourd sur la sous-préfecture et pesait comme un couvercle. « Crottés, hirsutes, menaçants » – pas encore « grunge » (toujours de la « New Wave » des adeptes) – nous nous présentâmes donc à Edmonde Charles-Roux qui nous accueillit chaleureusement : je revois encore briller sur son plastron les deux C croisés du mot « ChiC » tandis qu’elle nous écoutait décrire notre mouvement poétique « infraréaliste » nommé « FOUTOIR ! » (Aussitôt né qu’avorté et dont ne subsiste que quelques lettres sans orthographe). La Dame nous présenta alors « en jeunes poètes » à François Nourrisier et à Hervé Bazin assis tous les deux dans l’alcôve, Vipère au poing. Le simple fait qu’elle nous ait alors considérés fut comme si elle nous tirait de l’étang, nous les poisseux poissons tout à coup dorés au sortir de la vase : vairons hameçonnés par nos écouteurs de walkman qui chaque soir écoutions les Nuits magnétiques ou l’émission d’Alain Veinstein Du jour au lendemain avec l’espoir de sortir du trou où nous nous trouvions, d’entrer en contact avec le jour.
Promesses de l’aube…

 1 Colette, à propos de Joséphine Baker, 1936.
2 Jean Cocteau, Souvenirs et Portraits
Abdellatif Laâbi, Marrakech, 2014
Patrick Bouvet, Paris, 2010
1 Colette, à propos de Joséphine Baker, 1936.
2 Jean Cocteau, Souvenirs et Portraits
Abdellatif Laâbi, Marrakech, 2014
Patrick Bouvet, Paris, 2010
131
Ce matin, tandis que je tapote sur mon laptop cette ultime Chronique du Temps qui passe , une phalène se cogne à l’abat-jour de ma lampe et je songe à Jean-Luc Godard qui a choisi d’éteindre la sienne mardi dernier, en appuyant doucement sur l’interrupteur.
J’écris sur une table de jardin branlante, dans une vieille bicoque, au fin fond de la Creuse, un chaton ronronnant sur mes genoux. Face à moi, de grands chênes noirs se détachent sur un ciel fauve, pareil à la robe de ces vaches, limousines, qui ruminent mollement au pied de la colline. Silence plus que parfait. Au dessus de l’étang, une légère bruine s’évapore à mesure que la lumière du jour point. À l’étage tout le monde dort. Personne à l’horizon.

Contre l’ampoule, le papillon de nuit vient de griller dans un bruit de papier qu’on froisse.
 Zula, Saint-Tropez, 2021
Yannick Haenel, 2015
Zula, Saint-Tropez, 2021
Yannick Haenel, 2015
132

 Paysage, Plateau de Millevaches, 2005.
Jean-Luc Godard, Lyon, 1996
Paysage, Plateau de Millevaches, 2005.
Jean-Luc Godard, Lyon, 1996
133

JOSEPH MAMIE — L’Européen veut pouvoir toucher. L’air de ses tableaux est épais. — Henri Michaux, Un barbare en Asie N’ACHETEZ JAMAIS VOS LUNETTES EN SUISSE Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoît Linder 134
Joseph Mamie rit beaucoup, malgré son récent dégât des eaux. Joseph est né à Bâle, a été à l’école à Bâle, y a travaillé, y mourra certainement. La vie semble réglée comme un coucou suisse ; à l’évidence, la proximité est affective.
Tout domicile est un sépulcre. Ici, il est impeccablement garni. Le relief y côtoie le plat.
Les toiles répondent aux céramiques, le mobilier design se mêle d’une touche orientale sans oublier le folklore suisse alémanique. Même la femme de ménage devient curator en improvisant l’orientation qu’elle donne aux sculptures. L’art semble être une sorte de dérangement, il trouble une mécanique bien huilée. La consommation est un mode de relation au monde, une manière d’être toujours alerte.

En continuant sa collection, Joseph maintient un dialogue avec sa femme défunte. Elle était psychiatre. « Je suis le dernier patient de ma femme » , plaisante-t-il. Il trouve aujourd’hui les mots justes. Et la déclaration d’amour n’a pas de fin.
Cette rencontre d’ailleurs s’est créée en achetant une toile. L’histoire est longue, chevaleresque et pleine de hasards.
L’ouverture et la curiosité font la survie. L’arrivée de nouvelles informations ressemble souvent à une fin en soi. Le Covid a réussi à convertir Joseph au rock, lui qui n’écoutait que du classique, se met à écouter Michka Assayas sur France Inter. Il fait toujours du fitness, malgré des vis dans le dos. Il aime découvrir, mais est parfois lent à se décider. La pensée et le sentiment sont souvent fondés sur l’ambivalence. Il faut, selon lui, voir et revoir, attendre pour mieux se décider. L’acte d’achat est une sorte de nuit de noces. Joseph Mamie est un homme du deuxième rendez-vous.
Nous parlons du lien parfois malsain de la finance et de l’art. On évoque de moins en moins la qualité, l’appartenance, le bel ouvrage au profit d’un simple placement. L’argent est cette expérience de l’impossédable. On paie pour se confronter à son désir. Et on finit par s’y perdre. Mais à Bâle, même les milliardaires prennent le tram.
Joseph a beaucoup voyagé, notamment en Asie. Londres le laisse froid, car il lui manque un centre. Il aime Berlin, a envie de Dresde et Leipzig. Économiste de formation, il a passé 35 ans dans la finance internationale. Sa première paye lui a servi à acheter un saphir étoilé – ainsi que les boutons de manchette assortis - chez Gübelin, diamantaire à Lucerne.
Il n’aime pas les habits d’intérieur, mais cuisine très bien. Le balcon est rempli d’épices, de la sarriette à la sauge en passant par les piments. Il aime spécialement le steak tartare et n’hésite pas à manger des intestins de chevreuil quand les coutumes l’y invitent.
Sa mère était maîtresse d’école ménagère. Femme instruite qui lui a fait découvrir la Grèce classique, le petit bateau sur Le Pirée, le canal de Corinthe.
Femme de tête, à l’ancienne : « Si tu veux la femme, l’enfant sera protestant. » Pas de sentiments mystiques pour Joseph, on s’arrête à l’esthétique. Son nom catholique correspond d’ailleurs à un cardinal de Fribourg.
Joseph Mamie a une petite peur du vide et du dévoilement, ou rêve d’aller vite à l’essentiel – mais lequel ? En demandant régulièrement : « Qu’est-ce que vous voulez savoir ? »
L’essentiel se trouve dans ces étuis de lunettes posés sur un bout de guéridon. Joseph Mamie est obsédé par les bons accords – une ligne sur un visage, les formes, une hauteur de canapé. L’harmonie au milieu de la confusion générale. La tâche de l’artiste étant de rétablir l’harmonie dans la dissonance.
135
JOE STRUMMER
HORS CHAMPS
Par JC Polien
Virgin, qui à l’époque éditait un magazine papier glacé pour lequel je collaborais, m’a chargé de l’une des rares rencontres professionnelles où j’ai été véritablement impressionné. Il faut savoir que j’ai grandi avec The Clash ! Et l’album London Calling était mon album de chevet.
Mon expérience m’avait appris l’humilité et surtout, j’avais retenu que, pour réussir mes images, je concentrais toujours en moi-même une forme de neutralité. J’avais besoin d’y adjoindre une sorte d’absence d’émotion. Cependant, je dois admettre ici sincèrement qu’une fois confiée cette mission inespérée, je m’en étais retrouvé tout chose, et j’avais réellement éprouvé de l’appréhension.
Comble du trouble, depuis quelque temps, il me manquait une dent de devant, ce qui n’échappait à personne lorsque je me mettais à parler. Évidemment, ce fut la première chose que Joe Strummer a vue lorsque nous nous sommes rencontrés, ce 15 septembre 1999.
«
Oh, tu t’es cassé une dent ! », me dit-il, et tout en retroussant sa lèvre supérieure, il m’a lancé : « Moi aussi ! Pareil ! »
Si étonnant que fût ce premier échange, j’avoue que Strummer m’avait mis à l’aise et qu’il a contribué à cet instant précis à toute la fluidité de la séance, même s’il m’avait pas mal chambré, ce jour-là. Il avait rendez-vous avec un plateau TV à la suite de notre séance. Seulement, quand son attachée de presse lui a fait savoir qu’ils avaient du retard sur le timing, Joe Strummer l’a gentiment envoyée balader, lui disant en substance : « Sorry, moi je m’amuse et c’est moi qui décide quand j’arrête ! » Je peux aisément dire que j’étais plutôt flatté qu’il veuille ainsi continuer avec moi.
Il ne m’était donné que douze vues à faire avec lui, et je tiens à ce que l’on n’oublie pas qu’à cette époque de l’argentique, on avait des boitiers plutôt lourds et difficiles à gérer.
En tous cas, me concernant, je savais déjà que j’avais glané avec lui toute la matière voulue pour une belle « manchette » dans le magazine !
Pour la douzième et toute dernière prise de la série, je lui ai tout simplement dit de faire absolument tout ce qu’il voulait…
C’est alors qu’il a reculé de deux pas et qu’il a pris son élan pour sauter ! Évidemment, la photo aurait pu être floue… Mais, en réalité, elle fut publiée partout.
Cet instant volé authentique et immémorial reste pour moi tout autant captivant que surprenant. Il a cristallisé toute l’inconnue que pouvait figurer l’argentique et ses effets. Et cette image représente vraiment pour moi cette envolée de culture musicale, voire politique à laquelle je me suis toujours identifié.
Enfin, sentimentalement, je tiens également au souvenir de cette rencontre tant elle souligne, avec la personnalité libre et extravagante qu’était celle de Joe Strummer, toute la part humaine qui se puisse vivre avec un être, au-delà des apparences. Une rencontre pour moi qui demeure à jamais marquante.
Et de préciser pour finir qu’en quittant la séance, il m’a juste dit : « Maintenant, rends-moi mon portefeuille !

»
136
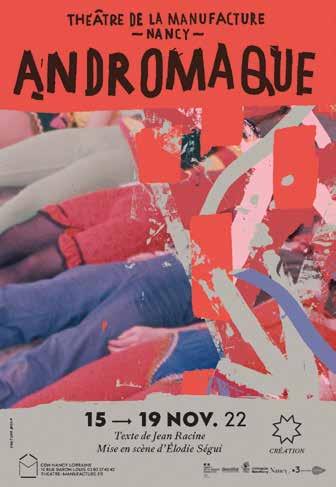


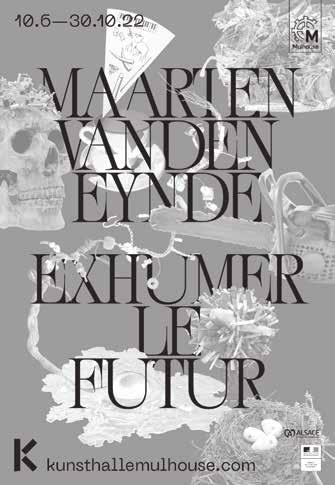
REGARD N° 16

Il y a cette ville dont le nom Se termine en O Pas loin du volcan Et très au-dessus Du niveau de l’eau
Le furtif d’une voix Craquant la peau profonde Des premières fois
Vers le bleu d’une maison Un soleil hors saison Des fruits que je ne connais pas
Il y a mon air de rien Sur le seuil brave des adieux Humant ces heures sans lendemain
J’irai ailleurs compter mes pas Un à un dans le chemin précieux Rien ne m’ira mieux Et rien d’autre ne m’attend Que le sang chaud du monde
Par Nathalie Bach ~ Photo : Michel Grasso
138

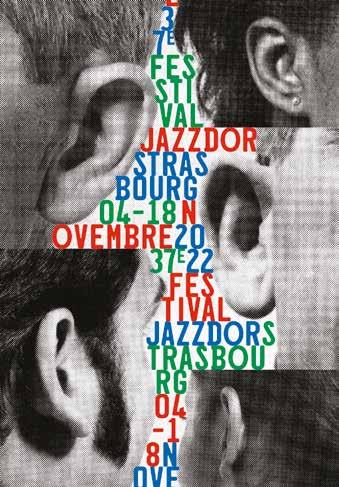
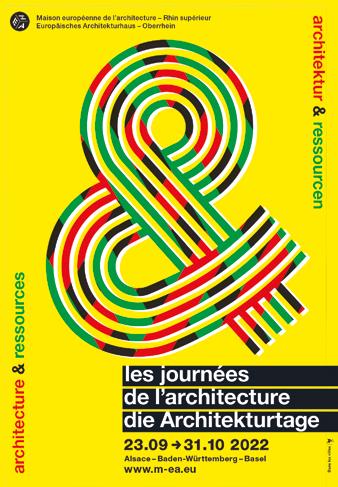

LE PRÉSENT IMPOSSIBLE
De Dominique Ané avec des dessins d’Edmond Baudoin – L’Iconopop
Alors que le chanteur Dominique A nous semble presque un ami intime à force d’écouter ses chansons (son dernier album frise le sublime), l’écrivain ‒ ici le poète ‒ Dominique Ané se dévoile peut-être encore un peu plus à travers ses livres. Le dernier en date, un recueil de poèmes inédits illustré par Edmond Baudoin, ne surprendra pas les familiers de son univers, mais leur donnera sans doute le sentiment d’accéder sur la pointe des pieds à ses pensées les plus personnelles. L’auteur le confesse luimême : « Il n’y a guère que sur moi que je peux me permettre d’écrire n’importe quoi. » (P.S.)
COMÉDIE NEW-YORKAISE
De David Schickler – Éditions de l’Olivier


À l’instar de James Salter dont à plusieurs endroits ici on retrouve le génie de la prose, David Schickler est un conteur exceptionnel. Peinture de New York au tournant du millénaire, portrait de trentenaires perdus dans les dédales d’un labyrinthe amoureux, chronique mordante de la quête du bonheur, Comédie new-yorkaise est un faux recueil de nouvelles et un vrai roman choral. On y entre comme on pousse la porte d’un tailleur dont les vêtements auraient la réputation d’aider les gens à devenir eux-mêmes. Dans le monde de Schickler, les femmes mènent la danse et sentent le shampoing à la framboise tandis que les hommes parlent à des ascenseurs, portent un SIG chargé sur la poitrine ou dégustent de la Jell-O dans le creux des clavicules de leur partenaire. C’est tour à tour sexy, sombre, drôle, déjanté, et cela procure un plaisir qu’il est rarement admis d’atteindre dans une vie de lecteur. (N.B.)
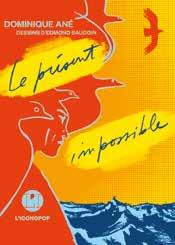
LES SABLES
De Basile Galais – Actes Sud

À CONTRE-COURANT : L’ÉPOPÉE DU LABEL 4AD De Martin Aston – Allia
Si Allia a l’habitude de nous gâter avec des gros pavés consacrés à la musique, le livre de Martin Aston (on lui doit Pulp consacré au groupe éponyme) mérite d’être salué dignement (832 pages pour 30 euros !). À travers le parcours de Ivo Watts-Russel et de 4AD, son label créé à Londres en 1980, c’est toute une histoire (souvent chaotique) de la musique (de Bauhaus aux Pixies en passant par Nick Cave, Cocteau Twins et Dead Can Dance), du graphisme (ah les pochettes signées Vaughan Oliver !) et des relations humaines (forcément compliquées) que décortique l’auteur avec un luxe de détails impressionnant. (P.S.)
« Mais comment dire ce que l’on ne sait pas soimême, ce qui n’a pas de nom, ce qui n’est peutêtre qu’un rêve, une folie ? » Voilà le doute qui agite les différents personnages de ce premier roman lorsqu’ils se retrouvent confrontés à des événements mystérieux, dont la véracité même est incertaine, des événements qui font naître en eux des émotions confuses et qui bouleversent leur conception du monde. L’intérêt du livre ne vient pas de la résolution du mystère, personne ne sachant ce qui se passe réellement, mais des transformations qui s’opèrent en chacun. L’auteur abuse parfois des ciels gris, des lumières obliques, des immeubles en béton, mais il a un réel talent pour dépeindre les atmosphères changeantes de la cité portuaire dans laquelle se déroule l’histoire et décrire l’expérience sensible des personnages. On peut rester à quai ; on préfère se laisser emporter. (N. Q.)
lectures
140



JENNYLEE
Heart Tax / Jennys Recordings

Depuis quelques mois, la bassiste de Warpaint distillait des singles en édition limitée, apaisant d’une part notre impatience face au retour du groupe et faisant espérer d’autre part un second projet solo de Jennylee. On a eu droit au deux, Warpaint a signé un retour sublime et Jennylee a compilé tous ces singles et ses productions des deux dernières années dans un album qui assoit sa crédibilité solo. Si elle fait la part belle à son instrument, la jeune femme fait montre d’un éclectisme assumé dans lequel elle excelle. Comble de la joie pour les fans, elle convie ses copines de Warpaint sur « Clinique », un morceau rock un peu dark où une fois de plus sa basse invoque ce petit truc en plus, cette magie. (C.J.)

CARAMBOLAGE
Tapete Records
À l’aube des années 1980, Britta Neander, passionnée par la batterie, n’a pas l’intention de former de girl band. Le destin en décide autrement et ce sont deux musiciennes qui la rejoignent pour former Carambolage, groupe essentiel qui par sa soif d’expérimentation et de liberté est parvenu à créer un son distinctif entre comptines no wave, « female punk » et réminiscence psyché. Finalement, en créant leur propre salle de répétition loin des hommes, dans un silo à grains, elles ont participé grandement à lancer une philosophie DIY et féministe reprise des années plus tard par des mouvements tels que les riot grrrls. (C.J.)
 TY SEGALL Hello, Hi / Drag City
TY SEGALL Hello, Hi / Drag City

Avec lui, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre : du bon très souvent, de l’insignifiant parfois. Mais là, avec une approche acoustique intimiste, le trublion de la pop réduit ses compositions à leur simple expression charnelle, ne se privant pas de rajouter une touche d’électricité à l’ensemble pour taquiner l’édifice instable. On se surprend à fredonner ses ritournelles angéliques comme une évidence dans ce qui s’apparente à un bien étrange classique : beau et incertain, enthousiaste et tendrement mélancolique. Un petit chef d’œuvre – osons le mot ! – de poche, à ranger au côté des grands disques des idoles Marc Bolan période Tyrannosaurus Rex ou du méconnu Roy Harper. (E.A.)
FLAVIEN BERGER
Tout le monde aime Jeanne / Pan European Recordings
Flavien, aurait-il tout compris ? Serait-il le dernier à le faire ? Quoi qu’il en soit, un frisson traverse notre corps à l’écoute de la moindre oscillation électronique produite par ses doigts agiles. Là, l’influence des pionniers, Fiorenzo Carpi, compositeur célèbre du Pinocchio de Comencini ou François de Roubaix, fait encore son œuvre dans ce disque marin, fluide et ondulant. Au moment, où l’on redécouvre Le Mépris, on se prend à rêver non pas d’un contrechamp, mais d’un sous-champ en dessous du niveau de la mer captant les sons étouffés du dehors. Comme si l’Italie tout entière nageait à nos côtés… Sublime, absolument sublime. (E.A.)
sons
142




ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer
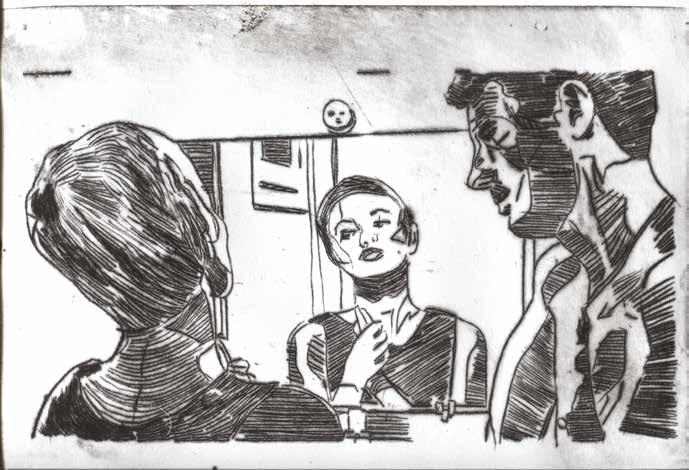
Pour finir en beauté, énumérons les morts qui peuplent ce numéro 66 de Novo : Jean-Luc Godard, André S. Labarthe, Michel Butel, Claude, Jaimie Branch, Joe Strummer, Jean-Paul Belmondo… De quoi nous faire chialer comme Anna Karina dans Vivre sa vie de Godard en couverture de Novo ? Certainement pas. Tous ces morts sont bien vivants. Il suffit de lire les pages qui précèdent ou mieux encore, de lire Vivre vite de Brigitte Giraud, de revoir certains films de Godard, de réécouter n’importe quel album de The Clash, de se repasser les épisodes de Cinéastes de notre temps , de feuilleter un vieux numéro de L’Autre Journal ou d’ouvrir au hasard le magnifique L’Autre Livre de Michel Butel. En 2012, alors qu’il venait de lancer la revue L’Impossible , j’avais demandé
À bout de souffle par Henri Walliser
à Michel Butel « Maintenant que L’Impossible existe, est-ce que tout est à nouveau possible ? » Je le revois encore me répondre : « Malheureusement non… Il est impossible que je retrouve tous mes amis morts. » Au lieu de s’appesantir, il avait enchaîné : « Je voudrais que les gens comprennent que les enfants ont besoin d’au moins autant d’espace et d’air que les tigres et les lions. Enfermer les enfants dans une salle de classe, c’est terrible. Si on met les enfants à la campagne, alors là ils courent comme des sauvages, ils se dépensent physiquement et pas en tensions, en mauvais rêves. Les enfants sont incarcérés dans les appartements, il n’y a pas que les labradors qui ont besoin de bouger… » Retourner en enfance et courir comme des sauvages : un beau programme avant d’être complètement à bout de souffle.
144






