Châteaux, vignes et grandes familles

Nobles vignerons dans leurs charmants châteaux : un tour de SuisseAndreas Andreas Z’Graggen Markus Gisler
Châteaux, vignes et grandes familles
Nobles vignerons dans leurs charmants châteaux : un tour de Suisse
Préface: Pourquoi ce livre … 4
Introduction: Talentueux artistes de la conservation 6
Introduction: Des choses merveilleuses à découvrir 8
VAUD 11
Famille de Saussure 12
Famille de Luze 23 Famille Chamorel 29 Famille de Marginac 39 Famille de Cormis-Chiesa 52 Famille Gautier 63 Famille de Mestral 70
BERNOIS EN TERRE VAUDOISE 93
Berne conquiert le Pays de Vaud 94 Famille de Buren 97 Famille de Watteville 107 Famille von Erlach 117 Famille Ris-von Fischer 129
Famille Frick-von Mülinen 141 Famille de Wurstemberger 151
GENEVE 155
Famille Micheli 157 La Rome des Protestants 170 Famille van Berchem 173
NEUCHÂTEL 183
Famille de Chambrier 185 Famille de Coulon 199 Famille de Montmollin 212 Famille de Pourtalès 231
VALAIS 243
Roi du Simplon 244
Famille de Werra 247
Famille de Wolff 254 Famille de Rham 259
Famille Zen Ruffinen 267
TESSIN 275

Famille Gianini 277
SUISSE ALEMANIQUE 287
Famille Angehrn 289 Famille Meier-Kesselring 295 Famille von Meyenburg 305 Famille Bodmer 320 Famille von Blarer 332 Famille Thormann 343
GRISONS 351
Le vin au pays de Heidi 352 Famille von Salis 354 Famille von Sprecher 379 Famille von Gugelberg 392 Famille von Tscharner 405 Famille von Planta 417 Famille von Toggenburg 419
Littérature 444
Illustrations 446
Les auteurs 447
PRÉFACE
POURQUOI
CE LIVRE
Des centaines d’années durant, les territoires de l’ancienne Confédération helvétique ont été régis par quelques rares grandes familles. En 1798, cette confédération d’états s’effondre. Mais alors, contrairement à la France, la vie de ces aristocrates locaux n’est pas mise en danger : leurs privilèges leur sont simplement retirés et ils peuvent même conserver leurs biens ! Dans mon livre consacré à la « Noblesse en Suisse », paru en 2018 aux éditions NZZ Libro, je m’étais demandé ce qu’il était advenu de ces familles. Mon constat : elles sont toujours là ! Bon nombre d’entre elles ont réussi, au fil du temps, à préserver leurs châteaux, souvent somp tueux et leurs vastes domaines. Quelques vignobles avaient même grandi, là où la terre était accueillante. Et ces vignobles existent toujours … Je suis un buveur de vin curieux : je me suis alors interrogé, combien de ces propriétaires de vignobles aristocratiques existent encore en Suisse, qui sont-ils, comment vivent-ils et quels sont leurs vins ?

Nous nous sommes mis à leur recherche et avons « découvert » 36 familles. Par « nous », j’entends aussi mon ami et co-auteur Markus Gisler. Journaliste comme moi, il est un connaisseur de vin enthousiaste et un excellent photographe. Avec moi, passionné de châteaux et curieux de tout ce qui touche à la noblesse, la combi naison était optimale …
Pendant près de deux ans, nos recherches nous ont conduits à travers toute la Suisse, de Thurgovie à Bâle, Zurich et Berne, de
Neuchâtel à Genève, du Valais au Pays de Vaud ou encore au Tessin : puis un voyage de retour via les Grisons et le Tyrol du Sud. Souvent, nous avons plusieurs fois rendu visite à « nos » familles et à leurs viticulteurs – lorsqu’ils ne vinifient pas eux-mêmes leur raisin. Nous avions toujours une question à poser ou quelque chose à photographier … J’avais déjà eu l’occasion, pour la rédaction de mon livre sur la noblesse, de visiter plusieurs de ces familles : j’ai partiellement repris ces portraits, avec l’autorisation de la maison d’édition NZZ Libro – que je remercie chaleureusement.
Mais nos remerciements communs s’adressent avant tout à nos « victimes ». Des personnes qui ne sont pas d’intérêt public. Il est d’autant plus étonnant dès lors qu’elles nous aient si généreusement ouvert les portes de leurs châteaux, palais et manoirs privés, qu’elles se soient laissées longuement questionner et que nous ayons pu profiter de leur charmante hospitalité. Et de leurs excellents vins, nota bene !
Enfin, nous souhaitons exprimer notre vive gratitude à notre éditrice, Annette Weber et à toute son équipe de la maison d’édi tion Weber. Dès le départ, Annette a été enthousiasmée par notre projet : avec patience, elle a supporté le fait que nous n’étions peut-être pas toujours, les auteurs les plus faciles
…
Z’GraggenAu printemps 2019, autour d’un verre de vin, mon ami Andreas Z’Graggen m’avait parlé de son idée d’écrire un livre dans le pro longement de son ouvrage « Adel in der Schweiz » ; il m’avait demandé si j’étais intéressé à l’accompagner comme photographe J’ai spontanément accepté et nous avons commencé à planifier. Mais il s’est rapidement avéré que ce travail ne pouvait se faire sans de vastes recherches et sans une répartition des tâches, même pour l’écriture.
L’histoire m’a toujours passionné et un événement-clé a tout par ticulièrement éveillé mon intérêt. Il y a de nombreuses années, j’avais, par hasard, feuilleté une vieille Bible quelque peu restaurée dans une brocante zurichoise : et j’y avais lu la note de page suivante : « Getruckt zu Zürych bey Christoffel Froschower im Jar als man zalt MDLXXX ». Il s’agissait d’une réimpression très tardive de la célèbre Bible de Zwingli de 1531. Cet achat avantageux a déclenché chez moi d’intensives recherches et j’ai commencé à me plonger dans l’histoire de la Réforme. L’offre d’Andreas de rechercher autour d’anciennes familles et de leurs châteaux était d’autant plus allé chante qu’il me chargeait également de rédiger les textes consacrés à leurs vins.
Au fil de nos recherches et plus nous apprenions de l’histoire de ces propriétaires de châteaux, s’est alors dessinée l’image d’une noblesse extrêmement interconnectée de quelques centaines de familles ayant régné sur la Suisse depuis le haut Moyen-Âge jusqu’à
la Révolution française : un kaléidoscope de châteaux fascinants, de propriétés et de maisons de maître. Nous avons rencontré des œnologues et des viticulteurs engagés qui s’investissent corps et âme pour la qualité de leurs vins. Rien d’étonnant : les étiquettes de leurs vins arborent châteaux et armoiries familiales, leurs signes d’identification originels. Ils mettent donc tout en œuvre pour être à la hauteur de la réputation de leur famille et pour transmettre, à la génération suivante, « la maison et ses secrets ». Réjouissant par ailleurs de constater, dans la plupart des cas, que la nouvelle géné ration s’y engage déjà avec force et passion.

J’ai été particulièrement touché par l’ouverture d’esprit avec laquelle les propriétaires de ces domaines privés nous ont accueillis. Bien sûr, ils habitent des maisons impressionnantes : mais on sentait toujours le poids et la responsabilité de pouvoir préserver ce dont ils avaient hérité. Il faut leur être reconnaissant de l’attention et des soins qu’ils portent à leurs bâtisses, toutes classées monuments historiques. Ils contribuent à la conservation de quelques-uns des plus beaux biens culturels de ce pays.
Zurich, en octobre 2021 Markus Gisler
TALENTUEUX ARTISTES DE LA CONSERVATION
Nous n’avons peut-être pas réussi, dans ce livre, à dresser le portrait de toutes les familles suisses qui possèdent un majestueux domaine, font du vin et sont la descendance de nobles dynasties. Il est possible que nous ayons oublié quelqu’un … Nous pensons néanmoins que notre ouvrage, « Châteaux, vignes et grandes familles » offre un aperçu tout à fait représentatif des événements politiques, économiques, culturels (et œnologiques !) qui ont marqué notre pays pendant des centaines d’années.
Mais notre ouvrage ne raconte pas uniquement le passé. « Nos » familles sont encore bien vivantes, elles ont eu la gentillesse de nous faire partager un peu d’un monde toujours vivant, un monde de traditions vécues, d’intérieurs élégants, d’édifices impression nants, de jardins enchanteurs. Ce monde n’est, certes, pas acces sible au public : il n’en est que plus passionnant !
Il est impressionnant de constater comment les propriétaires de tous ces châteaux, palais, demeures seigneuriales et manoirs privés parviennent, dans la plupart des cas, à conserver leurs biens de la plus belle des manières. Une démarche qui coûte beaucoup d’argent mais qui est aussi imprégnée d’un engagement personnel. Comme le dit Thierry de Marignac du Château de Crans : « Une telle maison détermine la manière dont on vit. Il faut aimer ça ».
Le sien est d’ailleurs, sans conteste, l’un des plus élégants de Suisse, tout comme les châteaux Pictet-Lullin, La Bâtie, Trévelin et bien sûr, notre héros en titre, le château de Vullierens, tous situés dans le canton de Vaud. Sans oublier les châteaux genevois du Crest et des Bois ainsi que le charmant château de Souaillon, situé à SaintBlaise dans le canton de Neuchâtel, ou encore les impressionnants châteaux de Bothmar, Salenegg et Reichenau dans les Grisons.
Le château de Vufflens est époustouflant. Qui regarde la photo de cette bâtisse ne croit pas, un instant, qu’il se trouve en Suisse. A Morcote, au milieu des vignes, il y a un château qui remonte à l’époque romaine alors que, le Girsberg dans le Weinland zurichois, le château habsbourgeois de Brunegg en Argovie, le château à douves de Hagenwil ou l’incontournable Tour de Goubing de Sierre, sont des témoins du Moyen Âge, des témoins d’une époque révolue. Tous pourraient raconter des histoires sans fin narrant des événements heureux et tragiques dont leurs murs ont été les témoins au cours des siècles. A l’instar de la bâtisse de Neu-Süns dans le Domleschg : le donjon de cet ancien château-fort de montagne ne tient plus qu’à moitié debout … L’autre moitié a été incendiée au début du XVe siècle par des paysans rebelles.
Nous aimerions tout particulièrement mentionner une propriété : le Domaine de la Lance à Concise, dans le canton de Vaud. Ni château, ni demeure seigneuriale, mais une chartreuse située dans un cadre extrêmement romantique au bord du lac de Neuchâtel. La Lance appartient à la famille de Chambrier, chambellans des princes de Neuchâtel durant des générations. Il n’y a probablement personne en Suisse qui possède, au cœur de sa maison, un cloître gothique aussi intact.
Ces familles n’ont pas acquis pouvoir et richesse de manière différente qu’aujourd’hui. Et en des temps particuliers – par la politique, la guerre, les mariages. L’engagement politique permet tait d’accéder à des postes de pouvoir, le service militaire à l’étranger permettait de gagner l’argent nécessaire. Ou alors on faisait carrière en se mariant à des familles socialement mieux placées. Et pour rester au sommet, pour conserver ses acquis, on s’isolait du bas de l’échelle sociale.
Déjà à l’époque, image et prestige étaient importants, au mieux exprimés par une forteresse, un château, un palais ou une demeure seigneuriale et complétés par un titre de noblesse. Un titre que l’on obtenait en faisant la guerre pour des princes étrangers ou, tout simplement, en l’achetant. Car tous les rois et empereurs, les papes et les tsars, tous étaient, en raison de leurs guerres inces santes, généralement en mauvaise posture financière et avaient besoin d’argent. La plupart des seigneurs dont ce livre dessine les portraits, pourraient, si la Constitution ne l’interdisait pas en Suisse, se nommer junker, chevalier ou baron, comte ou même marquis. Certains d’entre eux appartiennent même à l’ancienne noblesse et ont reçu leur titre à une époque où la Confédération helvétique n’existait pas encore. Comme les de Mestral, von Erlach, von Salis ou von Toggenburg.
D’autres familles ont réussi leur ascension dans l’ombre de l’Eglise, comme chanoines, prieurs, abbés ou même évêques. Les von Blarer, par exemple, sont sans doute la famille la plus catholique entre le Rhin et la Reuss, si l’on en juge par le nombre de ses dignitaires ecclésiastiques. Puis les Zen Ruffinen de Loèche qui comptent deux princes-évêques parmi leurs ancêtres. Ou encore les Angehrn à Hagenwil avec deux princes-abbés et une abbesse.
De nombreux aristocrates genevois et neuchâtelois décrits dans cet ouvrage, ont connu un autre type de carrière. Eux ont siégé dans d’importantes fonctions et se sont engagés dans le service étranger. Ils ont également compté d’éminents scientifiques,
comme les de Saussure et les Gautier. Mais avant tout, ils ont été de prospères hommes d’affaires. La plupart d’entre eux sont arrivés en tant que réfugiés religieux dans une Genève devenue protestante. Les Micheli et les Turrettini de Lucques, par exemple. Ces deux familles ont connu une grande prospérité comme banquiers, commerçants et industriels. Plus tard, après la sup pression de la liberté de religion par Louis XIV, des huguenots de France s’installèrent d’abord à Genève, puis à Neuchâtel, pays réformé également. Parmi eux, les de Coulon, les de Luze et les de Pourtalès, tous anoblis par le roi de Prusse.
Au début, ils faisaient du commerce et produisaient des textiles, comme les indiennes, des étoffes de coton imprimées selon le modèle indien. Puis ils se lancèrent dans la finance et sont deve nus ainsi banquiers. Jacques-Louis de Pourtalès en est un exemple.
Au milieu du XIXe siècle, il n’était pas seulement considéré comme le plus riche des Neuchâtelois, mais aussi comme l’homme le plus fortuné entre le Jura et les Alpes. Grand bienfaiteur, de Pourtalès a financé, de ses propres deniers, tout un hôpital qui deviendra, plus tard, l’Hôpital cantonal de Neuchâtel.
D’autres patriciens étaient également des hommes d’affaires très prospères. Le Bernois Beat von Fischer était le plus grand entre preneur postal de l’époque de l’Ancienne Confédération. Les von Meyenburg eux aussi étaient d’importants entrepreneurs postaux à Schaffhouse. Antoine Saladin, originaire de Genève, a fondé l’entreprise française Saint-Gobain – qui pèse aujourd’hui plusieurs milliards de francs et dont on se souvient bien, dans notre pays, depuis sa tentative de rachat de Sika. A Zurich, ce sont les Werd müller qui ont réussi dans le commerce de la soie, puis les Escher, cofondateurs de la fabrique de machines Escher, Wyss & Cie. Les deux familles étaient propriétaires de la Schipf à Herrliberg, le plus beau domaine viticole sur les bords du lac de Zurich. Et puisque nous sommes à Zurich, n’oublions pas non plus les Bod mer, des Walser immigrés du nord de l’Italie. Eux aussi sont devenus un grand nom dans le métier de la soie. Un Bodmer a même été considéré comme le Zurichois le plus riche – ce qui veut dire quelque chose !
Les aristocrates grisons ont parfaitement réussi à rester au sommet. Ni la perte de leurs lucratives terres de sujétion comme la Valteline, ni le déclin de leur Etat des Trois Ligues, ne leur ont fait beaucoup de mal. Les familles autrefois les plus importantes des Grisons, les von Salis et les von Planta, les von Sprecher, les von Tscharner et les von Gugelberg, sont toujours bien là et continuent à occuper leurs châteaux et leurs domaines. Et à produire d’excellents vins !
L’histoire des comtes de von Toggenburg est un peu particulière. Famille la plus importante de Suisse orientale à la fin du MoyenÂge, elle s’est officiellement éteinte avant de renaître, deux géné rations plus tard, dans les Grisons. Aujourd’hui, la famille produit du vin en Toscane.
Il est très étonnant de voir comment les Bernois ont survécu dans le canton de Vaud. En 1536, cette région, qui appartenait alors à la Savoie, a été conquise par Berne et est devenue une colonie. Elle le restera pendant plus de 260 ans, lorsque les Français vinrent libérer le canton de Vaud. Que s’est-il alors passé pour les Bernois ? Rien. Ils ne furent pas tués, leurs biens, souvent considérables, ne furent pas confisqués. Et c’est ainsi que les von Büren, von Wat tenwyl, von Erlach ou von Fischer logent toujours dans leurs domaines – et leurs vins n’ont rien à envier à leurs camarades de l’aristocratie grisonne. A Berne, en revanche, il n’y a plus de vignerons d’origine noble depuis longtemps. A une exception près : la famille patricienne Thormann a récemment fait replanter un vignoble sur les terres de sa campagne Bürenstock, non loin du musée Klee, presque au cœur de la ville de Berne. Tout comme le pédiatre Thomas von Salis, presque au même moment, sur le versant sud de son château de Brunegg.
Autre point commun entre les Grisons et Berne : tant dans les seigneuries grisons que sur la Côte, c’est une femme de la noblesse qui conduit la production du vin. Helene von Gugelberg à Maien feld et Coraline de Wurstemberger à Mont-sur-Rolle, issue d’une famille bernoise. Toutes deux sont des vigneronnes passionnantes et entreprenantes, tout comme Gaby Gianni. Son domaine viticole à elle, Castello di Morcote, est sans aucun doute le plus beau du Tessin avec une vue à couper le souffle sur les montagnes du sud du Tessin et le lac de Lugano. Mais ces paysages de rêve ne suffisent pas à Gaby Gianni : elle entend aussi créer le meilleur vin du sud du canton !
Et qu’en est-il du Valais, la plus grande région viticole de Suisse, avec son histoire tout imprégnée de celles de familles aristocra tiques ? Aujourd’hui, quelques noms sont encore actifs dans le vin, comme les Zen Ruffinen et les de Wolff. Ou encore Xavier de Werra, de Loèche. Il a certes vendu récemment son domaine Chai du Baron mais repart à zéro. Selon la devise sous laquelle nous aurions aussi pu placer notre ouvrage, « Châteaux, vignes et grandes familles » : « Ce n’est pas parce qu’on porte un nom ancien que l’on ne peut plus rien entreprendre. »
DES CHOSES MERVEILLEUSES À DÉCOUVRIR
Un grand engagement en faveur de leurs vignes et de leurs vins : voilà le dénominateur commun de tous ces propriétaires de châ teaux, de manoirs et de domaines que nous avons visités. Une part importante des propriétaires de domaines viticoles décrits dans ce livre gagnent leur vie en tant que viticulteurs et vinificateurs, certains d’entre eux avec beaucoup de succès, comme Thierry Grosjean au château d’Auvernier dans le canton de Neuchâtel, Johannes Meier au château de Bachtobel dans le canton de Thur govie, les Grisons père et fils von Tscharner au château de Reiche nau ou encore Gaby Gianini du Castello di Morcote. D’autres confient le travail dans les vignes ou dans la cave à des spécialistes. Dans tous les cas, ils sont fiers de leurs vins, sur l’étiquette desquels figure souvent leur château. Dans ces familles établies de longue date, le sens de la tradition est très marqué : il s’agit, en effet, de préserver ce qui a été hérité et de le transmettre si possible au sein de la famille. Voilà pourquoi toutes ces familles sont particulière ment attachées à leur « terre ». Elles en prennent soin. Pas étonnant dès lors qu’un grand nombre d’entre elles s’engagent dans la culture biologique. Avec son domaine de plus de cinquante hectares à Auvernir, la famille de Montmollin est même le plus grand domaine viticole de Suisse certifié Bio-Suisse.
Tous ces viticulteurs répondent à la demande croissante d’aliments bio produits de manière durable. L’offre de vins bio augmente en conséquence. Pour le Prix suisse du vin bio 2021, 90 producteurs ont envoyé plus de 450 vins pour une dégustation à l’aveugle. Par rapport à 2014 – première année où le prix a été décerné - cela correspond à une offre multipliée par sept ! La station de recherche suisse en agriculture, Agroscope, qui cultive des cépages résistants aux champignons, appelés Piwis, que de plus en plus de viticulteurs se consacrent à cultiver, a largement contribué à ce succès.
La viticulture biologique demande beaucoup plus de travail que la méthode de culture classique avec des produits de protection synthétiques. Au lieu de trois ou quatre traitements, les viticulteurs bio doivent pulvériser jusqu’à vingt fois leurs souches d’herbes non invasives pour obtenir un effet protecteur suffisant. Voilà pourquoi aussi, pour des raisons de coût, certains viticulteurs hésitent encore à se convertir à l’agriculture biologique.
Mais même dans la culture traditionnelle, la conscience écologique augmente. Autrefois, les feuilles de vigne et les raisins verdâtres étaient monnaie courante en raison de l’utilisation abondante de cuivre contre le mildiou. Aujourd’hui, le cuivre n’est plus utilisé
qu’en très petites quantités. En outre, Agroscope mène des recherches intensives sur un substitut au cuivre.
Si nous avons volontairement renoncé à évaluer les vins, nous pouvons cependant constater que, dans la plupart des cas, la qualité est excellente ; certains vins font partie des meilleurs de Suisse. Ce que certains connaisseurs de vin observent ne nous a pas échappé. L’écart de prix entre la Suisse alémanique et la Suisse romande est parfois considérable. C’est particulièrement vrai pour le pinot noir, le cépage rouge le plus planté en Suisse. Une expli cation, la demande : ce qui est vrai pour la bière – le client préfère les brasseries locales ou régionales – l’est aussi pour le vin. Qui recherche un vin local, l’achètera également, dans la mesure du possible, dans sa propre région ou dans une région proche.
En Suisse romande, les surfaces cultivées sont importantes et la demande dépasse souvent l’offre. Par contre, en Suisse alémanique l’offre est relativement plus restreinte. Une autre raison explique ces différences de prix : la réticence des viticulteurs romands envers les vins à dominante boisée. Les barriques françaises, coûteuses, sont beaucoup moins utilisées en Suisse romande pour l’élevage des vins rouges, en particulier du pinot noir, que dans la Bündner Herrschaft, en Thurgovie ou sur les rives du lac de Zurich, ce qui se répercute sur les coûts de production.
Parlons encore du fossé viticole qui sépare la Suisse romande de la Suisse alémanique – comme le rösti … On ne peut que regret ter la réserve des buveurs de vin alémaniques à l’égard du chas selas. Bien qu’il existe, depuis longtemps, d’excellents chasselas, et qui plus est bon marché, le Gutedel – comme ce cépage se nomme en allemand – a du mal à s’imposer dans le nord et à l’est du pays. Dommage, car le bon est si proche ! Une situation qui a, à notre avis, une double raison : d’une part, il manque, en Suisse alémanique, l’envie de découvrir des nouveautés de son propre pays. Et d’autre part, la commercialisation des vins romands en Suisse alémanique a encore un beau potentiel d’aug mentation. Cela se voit bien sur les étiquettes … Le design romand, souvent coloré et opulent, ne semble pas du tout compatible avec l’esthétique des étiquettes de Suisse alémanique, à la tendance sobre et dépouillée.
Combler ce fossé ? Nous espérons que notre livre y contribuera un peu … Car il y a des choses merveilleuses à découvrir dans les deux parties du pays.

CHÂTEAU DE VUFFLENS 12
DOMAINE DE LUZE LA MOTTAZ 22
CHÂTEAU DE TRÉVELIN 28
CHÂTEAU DE CRANS 38
CHÂTEAU DE LA BÂTIE 52 CHÂTEAU PICTET-LULLIN 62 CHÂTEAU DE VULLIERENS 70
APERÇU VAUD
CHÂTEAU DE VUFFLENS FAMILLE DE SAUSSURE


UN CHÂTEAU DE L’IMAGINAIRE

Avec la cathédrale de Lausanne et le couvent de Romainmôtier, le Château de Vufflens fait partie des monuments historiques les plus importants du canton de Vaud. Mentionné pour la première fois en 1096, Vufflens est alors un allod, c’est-à-dire une propriété libre et héréditaire de la famille du même nom. Mais dès 1175, elle perd les droits sur sa propriété, seigneurie et château, d’abord au profit de l’évêque de Lausanne, puis des comtes de Genève, des seigneurs de Cossonay et enfin de la famille de Duin. En 1385, Jaquette de Duin est mariée à Henri de Colombier et c’est ainsi que commence l’histoire récente du château de Vufflens.
Originaire de Colombier, un petit village au nord de Morges, aujourd’hui commune d’Echichens, Henri fait construire l’im mense château entre 1415 et 1430. Avec toutes ses dépendances, ses fossés, ses remparts et ses murs d’enceinte, il était sans doute encore plus impressionnant autrefois. Mais même ainsi, les plus de 2000 mètres carrés de bâtiments sont suffisamment remar quables. L’immense château de Vufflens se dresse, visible de loin, sur une douce colline à quelques kilomètres au nord-ouest de Morges. Il se compose essentiellement de trois parties : la partie ouest avec son donjon de 55 mètres de haut et de 144 mètres carrés, au milieu d’une quadrangulaire avec des tours, une cour généreuse, entrée et liaison entre les parties ouest et est, le palais ou aile d’habitation, lui aussi entouré de murs et de tours. Le donjon, aujourd’hui en grande partie inutilisé, se compose d’une cave, d’une immense cuisine, d’une salle et de la tour proprement dite, qui n’a apparemment jamais été aménagée. La partie est, dont l’intérieur a été entièrement réaménagé au 19e siècle, contient, sur différents étages, les pièces d’habitation et les chambres à coucher élégamment aménagées de la seigneurie. Depuis une grande terrasse orientée vers le sud, la vue est fantastique sur un charmant paysage parsemé de vignobles, avec, en arrière-plan, l’imposant Mont-Blanc.
Les châteaux forts du nord de l’Italie
Le monumental château de Vufflens, avec ses tours, ses chemins de ronde et ses mâchicoulis - ouvertures dans les murs pour jeter des objets ou de la poix sur des ennemis montant à l’assaut - est construit en briques. Une construction sans aucun doute influencée par l’archi tecture des châteaux forts du nord de l’Italie. Il y a une bonne raison à cette influence... Henri de Colombier y était chef d’armée pour le compte de la Savoie. Son père, Humbert de Colombier, est déjà au service de la Savoie en tant que bailli du canton de Vaud, une Savoie dont le ter ritoire s’étendait jusqu’aux portes de Berne. Extrêmement proche du
comte Amédée VIII de Savoie, Henri de Colombier est alors son plus fidèle confident. Henri sauvegarde le Piémont aux Savoyards, dont le cœur du pouvoir se trouvait de l’autre côté des Alpes, à Chambéry. Et ce, après divers conflits armés avec Filippo Visconti, duc de Milan.
En 1428, de Colombier arrange le mariage entre le duc et Marie, la fille d’Amédée. Chargé de mission pour Amédée, il se rend à Constan tinople, à la cour de Paris, au Concile de Constance et le représente lors d’un pèlerinage à Jérusalem. En témoignage de sa confiance, Amédée VIII le nomme son intendant. Le puissant et redoutable Henri de Colombier ne pouvait se contenter du modeste château que son épouse lui avait apporté en mariage. Il le fait démolir et à sa place, construit, avec l’aide de maîtres d’œuvre italiens, le monumen tal château de Vufflens. A la fin de sa vie, tombé dans le mysticisme, Henri quitte sa famille et ses biens pour se retirer de l’autre côté du lac Léman, à Ripaille près de Thonon pour mener une vie d’ermite. Décédé en 1438, Henri de Colombier se fait enterrer dans le couvent de Monthéron près de Lausanne, détruit pendant la Réforme, dans une tombe préparée de ses propres mains.

Son bienfaiteur, Amédée VIII, nommé premier duc de Savoie en 1418 par le roi allemand et futur empereur Sigismond, était marié à Marie de Bourgogne, fille du roi de France Jean le Bon et arrièregrand-tante de « notre » Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Amédée devient pape en 1439 sous le nom de Félix V - comme dernier antipape de l’Église catholique. Il démissionne dix ans plus tard et travaillera comme évêque de Genève jusqu’à sa mort.
Les de Senarclens - ancêtres du Prince Charles Après le décès d’Henri de Colombier, Vufflens passe à son fils Richard. La famille s’éteint en 1544. Quatorze ans plus tôt, les Bernois avaient mis le feu au château à l’occasion d’une expédition guerrière en faveur de Genève. Après la conquête du canton de Vaud par Berne, Vufflens tombe sous sa souveraineté et change par la suite plusieurs fois de propriétaire, jusqu’à ce que le château passe en 1641, par mariage, à la famille de Senarclens. Les de Senarclens, attestés depuis la fin du 12e siècle en tant que petits nobles fidèles de la Savoie, comptaient parmi les familles les plus influentes du Pays de Vaud sous la domination bernoise.
Au 19e siècle, ils sont anoblis en tant que barons aux Pays-Bas et en Hesse. Survient alors un incident généalogique un peu particu lier … A la cour du duc de Hesse-Darmstadt, August Ludwig von Senarclens était engagé comme maître d’écurie. A plusieurs reprises apparemment, il engrosse l’épouse du duc, impuissant. Un fils issu de cette « relation » reçoit le nom de Battenberg, qui deviendra Mountbatten en Angleterre.
Et comme la mère de feu Philippe, l’époux de feu la Reine Elisabeth II, s’appelait Mountbatten (Battenberg), lui et tous ses descendants, jusqu’aux enfants de Harry et Meghan, sont originaires du canton de Vaud. Marie, une sœur de ce Battenberg, et donc fille du baron de Senarclens, a épousé un Romanov et est ainsi devenue tsarine de Russie. Le village de Senarclens se trouve à onze minutes en voiture de Vufflens – que le monde est petit !

SCIENTIFIQUES ET ACTEURS CULTURELS
Henri, dernier propriétaire de Vufflens de la famille de Senarclens, est décédé en 1860. Sa veuve, qui comme beaucoup de ses prédé cesseurs avait entrepris de coûteuses rénovations au château, lègue Vufflens à ses filles. L’une d’entre elles épouse Jules Faesch, un ingénieur qui avait notamment développé des turbines pour Niagara, la première grande centrale électrique du monde. Leur fille marie à son tour Ferdinand de Saussure. Depuis, Vufflens est propriété des de Saussure. Aucune autre famille aristocratique n’a produit autant de scientifiques et d’hommes de culture que les de Saussure de Genève.

Les de Saussure sont originaires de Saulxures en Lorraine. Le duc de cette ville, que les Saussure servaient comme fauconniers, les anoblit en 1503. Pour des raisons religieuses – comme huguenots, ils étaient persécutés - la famille émigre à Lausanne et à Genève, où ils sont admis au droit de cité en 1556 et 1636.
Ils font rapidement carrière, obtiennent des seigneuries judiciaires et des postes importants. Théodore devient maire de Genève, son fils Nicolas siège au Conseil des Soixante. Il est le père d’Horace-Bé nédict, sans doute le plus important des de Saussure.
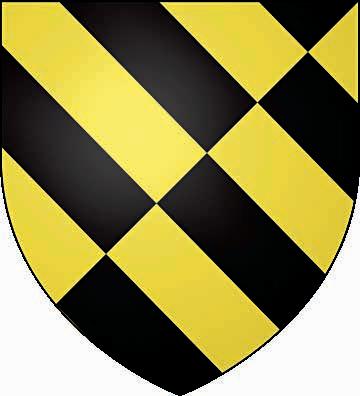
CHÂTEAU DE VUFFLENS

La plupart d’entre nous l’ont probablement déjà eu entre les mains : son portrait a été le sujet du billet de 20 francs suisses, monnaie en circulation de 1979 à 1995. Influencé par le naturaliste bernois Albrecht von Haller et le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, Horace-Bénédict de Saussure devient, à 22 ans déjà, professeur de philosophie à l’Académie de Genève. Glaciologue, chercheur dans le domaine de la physique de l’atmosphère, il est considéré comme le fondateur de la géologie alpine. De Saussure parcourt les Alpes, en particulier le massif de Chamonix. En 1787, il est le deuxième homme à escalader le Mont Blanc. Un an plus tôt, la première ascension, avait été réalisée à son initiative. Grâce à ses recherches, Horace-Bénédict de Saussure a pu prouver que le Mont Blanc est le plus haut sommet des Alpes. Il a développé divers instruments comme l’électromètre ou le cyanomètre pour mesurer l’intensité de la couleur bleue du ciel. Son nom a été donné à une plante des Alpes (saussurea), au minéral saussurite, à un cratère lunaire, à la rue de Saussure à Paris. Au cœur de Zermatt, une pierre commé morative rappelle que de Saussure a été l’un des fondateurs du tourisme alpin. Horace-Bénédict de Saussure était marié à une petite-fille d’Ami Lullin, de la famille de banquiers genevois du même nom, financiers d’un Louis XIV toujours en proie à des difficultés financières.
Sa fille Albertine s’est également mariée dans la bonne société genevoise : son mari était le neveu de Jacques Necker, ministre des finances du Roi de France Louis XVI. Grâce à son père, Albertine Necker de Saussure était exceptionnellement cultivée pour l’époque. Elle parlait grec et latin, anglais, allemand et italien et s’y connaissait en sciences naturelles. Elle était étroite ment liée à la tante de son mari, la célèbre Madame de Staël, de son vrai nom Anne-Louise-Germaine, baronne de Staël-Holstein. Les deux femmes tenaient chacune un « salon » près de Genève, un lieu de rencontre des Lumières pour les grands esprits euro


péens. Ses enfants devenus grands, Albertine Necker de Saussure écrit des études très remarquées sur des sujets pédagogiques et sur l’éducation des femmes. Cette féministe précoce se demandait publiquement si « la femme (...) est exclusivement faite pour plaire à l’homme » ? La condition préalable à une vie autodéterminée en tant que femme est une bonne éducation générale. Voilà pourquoi, dans ses écrits, elle demande que les femmes soient formées aux langues, aux sciences naturelles et aux arts. Albertine Necker de Saussure s’éteint en 1841.
D’autres descendants d’Horace-Bénédict font également honneur à la famille : son fils Nicolas Théodore a réalisé une œuvre impor tante sur la physiologie des plantes, a été professeur à l’Académie de Genève et, comme son père, membre de la célèbre société savante londonienne Royal Society. Son petit-fils Théodore de Saussure, président de la Société des Arts de Genève, a dirigé le groupe « Art moderne » pendant l’exposition nationale de 1883 et a écrit des drames historiques. Son frère Henri, un entomologiste de renom mée mondiale, a été promu à la Légion d’honneur française. Le fils de ce dernier, René de Saussure, mathématicien et linguiste, a travaillé au développement de la langue artificielle espéranto et a créé une monnaie correspondante, appelée « spesmilo ».
Ferdinand, un autre fils d’Henri, est un de Saussure qui arrive au château de Vufflens par sa femme. Né en 1857, il fut, avec son arrière-grand-père Horace-Bénédict, le plus remarquable de la famille. Après son doctorat à Leipzig, il enseigne l’histoire et la comparaison des langues indo-européennes à l’Université de Genève. De Saussure a fondé la linguistique moderne et le struc turalisme, l’approche scientifique et philosophique qui part du principe que des structures systémiques sont à la base de toute pensée et action humaine. Ferdinand de Saussure est devenu célèbre comme explorateur de l’indo-germanique, langue originelle com
A gauche : Horace Bénédict de Saussure (1740 1799)
Au milieu : Albertine Necker de Saussure (1766 1841)
A droite : Ferdinand de Saussure (1857 1913)

mune au grec, au latin et au sanskrit de l’Inde ancienne. L’œuvre principale du modeste Ferdinand de Saussure, « Cours de linguis tique générale », ne sera publiée qu’après sa mort en 1913 par d’anciens étudiants. Sur le mur du magnifique hôtel particulier de la famille de Saussure, au cœur de la vieille ville de Genève, deux portraits, ceux d’Horace-Bénédict et de Ferdinand de Saussure, en sont les seuls ornements.
Aujourd’hui, le Château de Vufflens, utilisé comme résidence d’été occasionnelle par leurs familles, appartient à deux frères, Philippe et Jacques de Saussure. Tous deux ont suivi un double cursus universitaire. Philippe, qui traite dans son cabinet genevois des patients souffrant de troubles psychosomatiques, est juriste et médecin de formation. Jacques de Saussure, lui, a étudié les mathé matiques et l’informatique à Lausanne, Zurich et Genève et est diplômé de la Business School du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge, aux États-Unis. Comme son père, il a été partenaire de la Banque Pictet, la plus grande banque privée de Suisse avec 660 milliards de francs d’actifs sous gestion. Le secret du succès de la banque fondée en 1805 est sa culture d’entreprise basée sur la tradition et des valeurs claires. Et, selon Jacques de Saussure : « Il faut simplement être meilleur que les autres ». Né en 1952, Jacques de Saussure a quitté son poste d’associé de la banque pour des raisons d’âge mais siège toujours au conseil d’adminis tration. Père de trois enfants, il est marié en secondes noces à Iman Makki, originaire du Liban et biochimiste de formation. Jacques de Saussure dit de sa famille : « Nous avons des racines qui remontent loin dans l’histoire. Il faut les connaître pour se comprendre soimême. Mais mes ancêtres n’étaient pas pour autant des traditio nalistes bornés, ils étaient avant tout des scientifiques aux horizons larges, ouverts à la nouveauté et tolérants ».
LA BRANCHE AMÉRICAINE
Outre la Suisse, il existe des de Saussure en France et aux Etats-Unis, qui sont issus de la branche vaudoise de la famille.
Trois frères de Saussure sont morts en se battant aux côtés des Etats-Unis pendant la guerre d’indépendance. Henry William de Saussure est emprisonné pendant le siège britannique de Charleston, en Caroline du Sud. Il étudiera plus tard à l’Université de Princeton et s’engagera dans le Parti fédéraliste. En 1795, le président George Washington nomme Henry William de Saussure directeur de la United States Mint, qui deviendra la Réserve fédérale américaine.
De Saussure, maire de Charleston, est l’un des fondateurs de l’Université de Caroline du Sud à Columbia. On baptisera l’établissement DeSaus sure College en son honneur. Il est également éditeur. Le quotidien « Charleston Courier », qu’il fonde en 1803, existe toujours sous le nom de « The Post and Courier ».
Son fils William Ford de Saussure est diplômé de l’Université de Harvard et sera également maire de Charleston. En 1852, il devient membre du Sénat américain. Ses descendants entre tiennent encore des contacts informels avec leurs parents suisses.
VINIFIÉ PAR BOLLE, COMMERCIALISÉ PAR C-D-C
L’attribution des vins du Château de Vufflens peut rapidement prêter à confusion. La bâtisse est en effet située dans la commune de Vufflens-le-Château, raison pour laquelle les étiquettes des vins du village portent le nom de Vufflens-le-Château, tandis que les vins du château proprement dit s’appellent tout simplement Châ teau de Vufflens.

Le vignoble de la famille de Saussure s’étend sur huit hectares. Il est loué à la société Bolle de Morges, qui peut se prévaloir d’une longue et riche tradition (elle appartient désormais au groupe Schenk). Trois hectares de la surface totale sont consacrés au chasselas, le reste étant réservé aux cépages rouges. Le raisin est stocké dans l’imposante cave du château. Bolle produit cinq vins différents à partir de sept cépages, pour lesquels il n’utilise que les meilleurs terroirs. Les autres raisins servent pour des vins plus simples qui ne sont pas commercialisés sous le label Château de Vufflens. Sur les cinq vins, quatre sont des monocépages : un chasselas, un pinot noir - élevé dans de grands fûts de bois (foudres) -, un merlot qui vieillit dix mois en barriques françaises, ainsi que le rosé, également issu du pinot noir, appelé ici Œil de Perdrix, comme à Neuchâtel.
Le pinot noir provient des clones bourguignons 707 et 715, qui produisent des baies lâches et qui ne sont donc pas très productifs. Ce qui est une bonne chose, car la faible quantité de raisin que produisent ces clones donne des vins aromatiques. Cette quantité varie selon le millésime entre 550 et 600 grammes par mètre carré. La seule cuvée rouge du château est composée de gamay, riche en fruits et en tanins, assemblé avec du gamaret, du garanoir et du galotta. Pendant la macération, le chapeau est foulé quotidienne ment. L’élevage dans les grands foudres produit un vin très har monieux grâce à une aération très fine mais constante.
La répartition des différents cépages sur l’ensemble du domaine a été judicieusement pensée en fonction de la nature du sol. Sous la couche supérieure, plutôt sableuse, issue des dépôts glaciaires, on trouve un sous-sol calcaire qui confère aux vins une belle minéra lité. Rémy Reymond, « maître de la vigne », constate d’ailleurs : « Selon le type de sol, le même cépage donnera des vins complète ment différents à quelques centaines de mètres de distance ».
Toutes les bouteilles portent au col la banderole de l’association de promotion des terroirs Clos, Domaines & Châteaux (c-d-c), qui
Dans les caves du Château de Vufflens. De grands foudres et des barriques françaises.

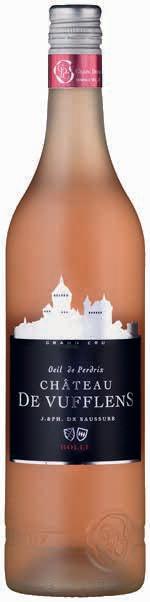
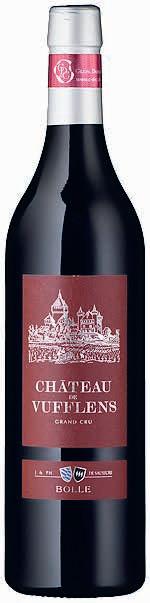
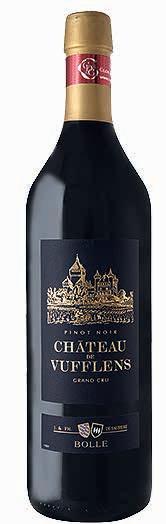
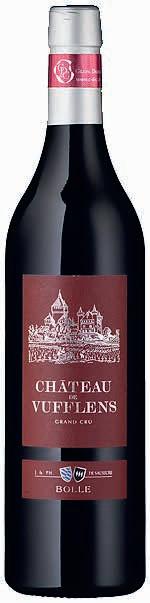
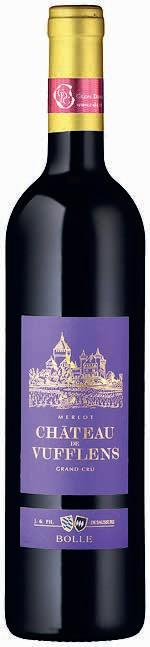
groupe 25 châteaux et domaines viticoles du canton de Vaud. L’organisation - cofondée par le Château de Vufflens - a édicté des règles de qualité claires et contraignantes, lesquelles sont réguliè rement contrôlées par des comités spécialisés. Une commission de dégustation doit même donner son aval avant la mise en bouteille. Parmi les dispositions relatives à la qualité figure notam ment une limitation des quantités : le rendement au mètre carré doit être inférieur d’au moins dix pour cent à la quantité autorisée par la loi. Le rendement au mètre carré des cépages blancs ne doit en outre pas être supérieur à celui des rouges. La viticulture doit enfin répondre aux normes de la production intégrée et le certi ficat de Vitiswiss est obligatoire. Cette association, dont les membres se trouvent principalement en Suisse romande et méridionale, s’engage en faveur du développement durable de la viticulture suisse. Les vins du Château de Vufflens sont proposés par différents négociants en vins.
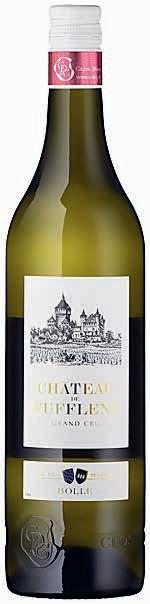

DOMAINE DE LUZE


DE MARCHANDS DE TISSUS À VITICULTEURS
La famille de Luze est originaire de la Charente, dans l’ouest de la France. En 1685, le roi catholique Louis XIV supprime la liberté de culte. Comme les de Pourtalès, les de Coulon et de nombreux autres Français protestants, les de Luze émigrent dans la partie francophone de la Suisse actuelle. Jacques de Luze, un marchand de draps, s’installe à Neuchâtel où il épouse une bourgeoise d’Auvernier ; il sera naturalisé en 1691. Il avait appris aux Pays-Bas la fabrication des étoffes de coton imprimées, appelées indiennes. Il mettra son savoir-faire au service de Jean Labram, qui en lance la première production neuchâteloise à Pré-Royer. Jean-Jacques, le fils de Jacques de Luze, ouvre ensuite sa propre manufacture au Bied, près de Colombier. La fabrication de ce type d’étoffes étant interdite en France à partir de 1686 favorisa les importations clandestines à partir de Genève et de Neuchâtel. Les fabricants d’indiennes mettent ainsi en place un commerce lucratif qui ne tardera pas à faire des émules dans la partie germanophone de la Confédération. Les de Luze sont surtout actifs dans le commerce. Ils fournissent aux manufactures les matières premières telles que le coton, les couleurs et le caoutchouc, puis reprennent aux pro ducteurs d’étoffes la marchandise finie et la commercialisent. En 1759, la France rouvre ses frontières, ce qui accentuera encore la demande d’indiennes. A cette époque, il existe une dizaine de manufactures à Genève et à Neuchâtel, qui emploient jusqu’à 10 000 hommes, femmes et enfants. Les de Luze en possède une. Elle assure à la famille une prospérité considérable pendant plusieurs générations.
Les de Luze font rapidement partie des milieux aristocratiques de Neuchâtel. Le petit-fils de l’immigré Jacques, Jean-Jacques de Luze-Warnery, y sera banneret, une fonction honorifique à laquelle est liée l’attribution du titre de baron héréditaire par le roi de Prusse Frédéric le Grand. La fille du baron Jean-Jacques de Luze, Rose Augustine, épouse en 1769 son cousin JacquesLouis de Pourtalès. Ce dernier a fait son apprentissage dans l’entreprise de Luze, Chaillet et Pourtalès. Il deviendra plus tard le plus riche des Neuchâtelois. Le fils de Rose Augustine et de Jacques-Louis, Louis de Pourtalès, deviendra militaire et homme politique et sera considéré à son époque comme l’homme le plus puissant de la principauté, au point d’être surnommé « le Grand


Pourtalès ». Lui aussi a été formé dans la manufacture de son oncle au Bied. La Prusse accordera à Pourtalès le titre héréditaire de comte.
La demande d’indiennes diminue sensiblement à partir de 1790 ; les guerres et le protectionnisme font chuter les exportations qui, dans les meilleures années, représentaient jusqu’à 95 pour cent de la production totale. Les de Luze transfèrent la fabrication d’étoffes imprimées à Thann, en Alsace, et certains membres de la famille devront trouver de nouvelles occupations.
Emigré à Bordeaux
C’est ce que font Alfred de Luze et son frère Philippe, fils de Charles-Henri de Luze et d’une baronne de la famille de banquiers von Bethmann à Francfort, où les deux garçons ont grandi. En 1817, ils quittent Bordeaux pour New York où ils fondent une société d’importation. Alfred revient à Bordeaux où il s’établit comme négociant en vin en 1820, à l’âge de 23 ans seulement. Deux ans plus tard, il crée le Cognac de Luze, encore en vente aujourd’hui, qui deviendra l’une des eaux-de-vie les plus prisées.

La marque est passée entretemps dans les mains d’une autre famille française. L’exportation de vins de Bordeaux et de cognac
à New York chez son frère fera la fortune des deux de Luze. Francis, l’un des fils d’Alfred, reprend l’entreprise de vin et de cognac florissante de son père. Marié à sa cousine aristocrate Marie de Mandrot de Morges, Francis décide en 1862 de proposer son propre vin du Bordelais. A Soussans, une commune de l’ap pellation Margaux, il acquiert un domaine viticole de 32 hectares qu’il baptise Château Paveil de Luze. Toujours propriétaire de cette superbe propriété, la branche française de la famille continue de vinifier sous ce nom, et ce depuis six générations.
L’un des frères aînés de Francis de Luze, William, épousera éga lement une femme de Morges, Elise de Venoge. Cette noble dame apporte dans son mariage le charmant Château d’Echichens ainsi que l’élégant manoir de La Mottaz à Chigny. Les deux propriétés sont situées au-dessus de Morges. C’est ici, à La Mottaz, qu’habite le baron Charles-Henri de Luze, arrière-arrière-petit-fils d’Alfred de Luze, qui s’était jadis installé dans le Bordelais.

Il possède les vignes du Château d’Echichens, que sa mère avait vendu, ainsi que les vignes autour de La Mottaz. Comme son père, Charles-Henri est avocat au barreau de Lausanne. Il préside également le Conseil communal de Chigny et, passionné de chasse, la Fédération des sections vaudoises de la Diana.

LES VINS DE MONSIEUR LE BARON

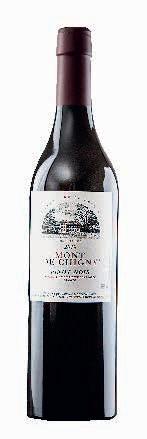

Charles-Henri de Luze possède sept hectares de vignes autour de sa maison de maître « La Mottaz » à Chigny, au-dessus de Morges. Ces parcelles, plantées de chasselas et de pinot noir, sont louées au groupe Bolle, qui transforme les récoltes en ses propres vins dans son Domaine du Plessis à Vufflens-le-Château. Bolle fait partie du groupe Schenk, de loin le plus grand groupe viticole de Suisse. Un nombre limité de bouteilles, un chasselas et un pinot noir, sont étiquetées « Mont de Chigny, Domaine de Luze, La Mottaz » et livrées à Charles-Henri de Luze à titre de réserve du château pour son usage privé.

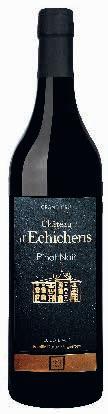
Le véritable siège familial des de Luze, originaire de Neuchâtel, était l’élégant Château d’Echichens, également situé près de Morges. La mère de Charles-Henri de Luze vendra certes le château, mais le baron de Luze gardera pour lui les neuf hectares de vignes qui en font partie. Ces vignes sont cultivées par la famille Duruz à Monnaz, non loin de là. Celle-ci livre le raisin à la coopérative Cave de la Côte à Tolochenaz, qui vinifie quatre vins différents sous l’appella tion Château d’Echichens : deux blancs, le chasselas et le viognier, ainsi que deux rouges, un pinot noir et un assemblage puissant de galotta, diolinoir et gamaret, élevé pendant 24 mois dans de grands fûts de bois.
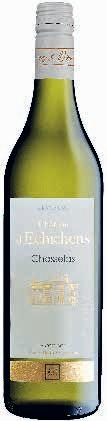
Pierre, Chantal et Arnaud Duruz du Domaine Les Tilleuls à Monnaz cultivent les vignes du Château d’Echichens dont le raisin est vinifié par la Cave de la Côte.
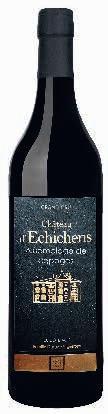

Le Château Paveil de Luze dans le Margaux appartient à la branche française de la famille.


CHÂTEAU DE TRÉVELIN FAMILLE


