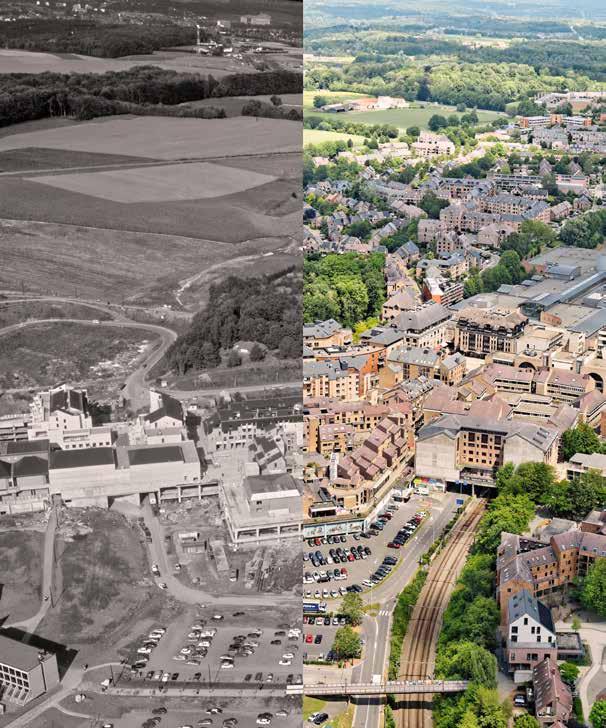explorer
Quand l’agriculture urbaine s’enracine L’idée d’encourager l’agriculture urbaine dans les projets immobiliers sous forme de charge d’urbanisme fait son chemin. Le ministre de l’Aménagement du territoire y est notamment favorable. De son côté, une spin-off de Gembloux Agro-Bio Tech tente d’implanter le concept auprès du privé et du public. Des projets existent, notamment à Ottignies-LLN. Texte : Xavier Attout – Photo : Green Surf et Equilis
12
Q
ue ce soit des fruits et légumes produits en toiture d’un immeuble, un potager en intérieur d’ilots voire des activités agricoles le long de chantiers, les possibilités pour implanter des projets d’agriculture urbaine dans les développements immobiliers ne manquent pas. De plus en plus de promoteurs ou de pouvoirs publics semblent intéressés par cette démarche. Et pas uniquement dans une vue de marketing environnemental ou pour vendre plus aisément leurs logements. « Il est évident que certains pourraient utiliser cette démarche à cette fin, explique l’ingénieure agronome Candice Leloup, qui a cofondé Green SURF en 2017 (Green Solution for Urban and Rural Farming), une spin-off de l’ULiège spécialisée dans l’agriculture urbaine. Mais pour que des projets réussissent, chaque cas est spécifique et il faut bien étudier toutes les composantes d’un dossier. Sans cela, cela ne fonctionne pas. Car tant la gestion de ces espaces que le cout sont des données à prendre en compte sérieusement. » Green SURF propose des services d’accompagnement de projets d’agriculture urbaine tant auprès des pouvoirs publics que des promoteurs privés. Un modèle qui se développe de plus en plus pour répondre aux enjeux de la transition et pour permettre le développement de villes nourricières sans épuiser les ressources foncières. « Il y a une multitude de possibilités en la matière, poursuit Candice Leloup. Dans certains cas, la
rentabilité et la productivité seront essentielles alors que dans d’autres il s’agira de projets non-lucratifs où l’objectif est surtout social et environnemental. Tant les modes de culture (pleine terre ou hors sol, hydroponie ou aquaponie) que les dimensions (à l’échelle d’un bâtiment, d’un quartier, d’une ville) sont variables. Sans parler du fait qu’un potager peut être individuel, collectif ou professionnel. »
Des questions terre à terre Alors qu’elle essaime à Montréal ou dans certaines villes françaises, l’agriculture urbaine perce doucement en Wallonie. Si les circuits courts et les commerces de proximité sont à la mode, il existe encore de multiples possibilités de développement. D’autant que ce type d’agriculture permet de diversifier la production par rapport à l’agriculture conventionnelle. « Il s’agit en effet d’horticulture, de maraichage voire de petit élevage. Il faut donc faire des choix. Ces deux types d’agriculture sont donc complémentaires. Il ne faut pas les opposer. L’important est de retrouver un certain équilibre entre les deux. Cela va en tout cas permettre d’améliorer l’attractivité de la ville. » Parmi les freins, on peut avancer la méconnaissance de cette activité, la gestion et le cout de l’investissement. « Notre priorité reste de sensibiliser privé et public sur les avantages de l’agriculture urbaine. La conception et la gestion sont deux éléments à ne pas négliger. La gestion