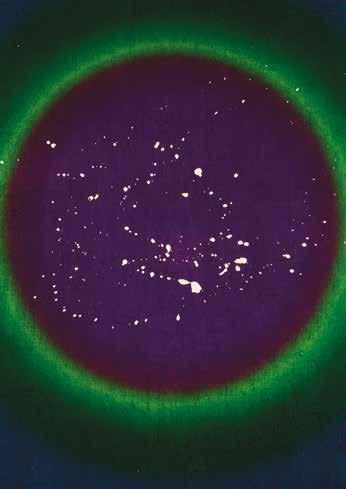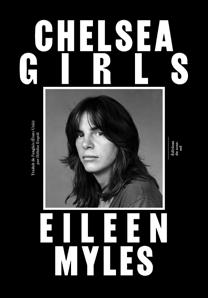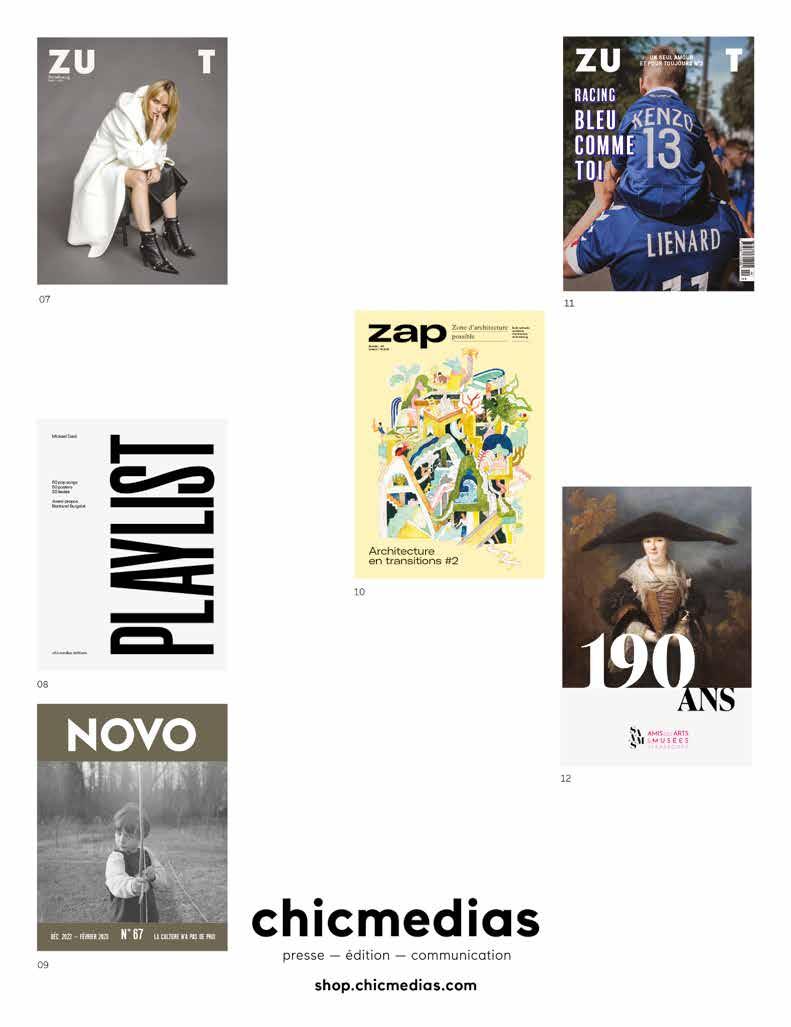

Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer Relecture : Manon Landreau Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Florence Manlik, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
Anne Immelé. Justin, parcelle N°100, 2005. Série Jardins du Riesthal. Livre chez Médiapop Éditions Exposition à la galerie Madé, Paris 6e jusqu’au 13 janvier 2023
IMPRIMEUR Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : décembre 2022 ISSN : 1969-9514 – © Novo 2022
Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 € Hors France : 5 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
FRANÇOIS TRUFFAUT 9-12
FOCUS 13-30
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
ÉCRITURES 31-47
Les Éditions La Contre Allée 32-39 , Grégoire Bouillier 40-43, Blutch 44-47
SCÈNES 49-59
Célie Pauthe 50-51, Kaori Ito 52-53, Mathias Moritz 54-55 , Thomas Jolly 56-57, Philippe Schlienger 58-59
SONS 61-79
Joe Strummer 62-67, Nadine Khouri 68-71, David Demange 72-73 , Mouse DTC 74-75, Fred Poulet 76-77, Théo Ceccaldi 78-79
ÉCRANS 81-88
Camille Auburtin 82-83, Jordan Tetewsky 84-88
ARTS 90-110
Regionale 90-91, Les Portes du Possible 92-93, Art brut 94-95 , Fabienne Verdier 96-97, ter Bekke & Behage 98-99 , Dominique Petitgand 100-101, SurréAlice 102-103 , Adrien Vescovi 104-105, Le Beau Siècle 106-107 , Réceptacle et Horizon 108-109, Erwin Heyn 110
IN SITU 112-123
Les expositions de l’hiver
CHRONIQUES 124-138
Gilles Weinzaepflen 124-128, Stéphanie-Lucie Mathern 130-131 , Nathalie Bach 132-133, Myriam Mechita 134-135 , Louis Ucciani 136-137, JC Polien 138
SELECTA
Livres 140 Disques 142
ÉPILOGUE 144
SOMMAIRE OURS PROLOGUE
7
WWW.NOVOMAG.FR 5

UN SANGLIER AU FOND DE LA GALAXIE
J’aurais dû être couché de bonne heure, mais mon TER était immobilisé depuis des heures en rase campagne après avoir heurté une famille de sangliers. La contrôleuse qui avait passé la soirée à courir d’un bout à l’autre du train pour distiller des infos contradictoires au compte-gouttes, est venue s’asseoir en face de moi. D’un geste las, elle a enlevé ses chaussures avant d’allonger ses jambes sur la banquette. Elle semblait au bout du rouleau.
— J’en ai marre de ce boulot. Comment faitesvous pour rester aussi zen ?
— Je regarde des documentaires sur la Voie lactée.
En fait, je commençais à avoir l’habitude de passer mes nuits dans le train. Les incidents se multipliaient depuis quelques mois.
— Dans les autres wagons, les passagers sont en train de péter les plombs. J’ai failli me prendre un coup de boule en empêchant un passager d’ouvrir la porte.
Elle parlait avec un accent que je n’arrivais pas à identifier. Plutôt que de casser du sucre sur le dos de la SNCF, j’avais envie de parler du Big Bang.
— Vous intéressez-vous aux étoiles ?
— Quelle drôle de question ! Vous êtes au courant que ça va très mal sur Terre ?
Cela faisait un moment que l’humanité me déprimait profondément.
— Bien sûr, mais ça me détend d’imaginer ce qui se passait il y a 30 milliards d’années.
— Qu’est-ce que vous imaginez ?
Elle a remué mollement les jambes pour chasser la fatigue emmagasinée tout au long de la journée.
— Il y a 30 milliards d’années, il se passait des choses passionnantes. Avez-vous entendu parler de la matière noire ?
— Non, mais j’ai parfois des idées noires.
— Savez-vous que le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres ?
— Merci pour l’info, mais ça ne change rien à ma vie.
Elle a remué ses belles jambes. Ce devait être épuisant de passer ses journées debout dans un train.
Ce qui est encore plus dingue, c’est que la lumière du soleil met à peine 8 minutes à arriver jusqu’à nous.
— 150 millions de kilomètres en 8 minutes, ça fait à peu près du 300 000 kilomètres par seconde.
Elle était à l’aise en calcul mental. Elle n’avait sans doute pas été à l’école en France.
Par Philippe Schweyer
— L’étoile la plus proche de nous, Proxima, se trouve à quarante mille milliards de kilomètres. En fait, on la voit comme elle était il y a quatre ans.
— Il y a quatre ans, je ne me voyais pas du tout quitter mon pays.
— La lumière des autres étoiles de notre galaxie met des milliers d’années à nous parvenir. Il y a des astres qui n’existent plus lorsque l’on commence à les étudier.
— Si ça continue, la Terre n’existera bientôt plus non plus.
— Oui, mais si on observe ce qui se passe ici depuis une autre galaxie, ça n’a plus aucune importance.
— Malheureusement, on ne vit pas dans une autre galaxie.
Elle a remué les jambes avec une certaine agressivité.
— J’essaye de prendre du recul.
— Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir se permettre de prendre du recul.
Elle semblait vraiment à cran. Une fois encore elle a remué les jambes. Par la fenêtre, j’ai vu un sanglier s’enfoncer dans la forêt tête baissée.
— J’aime mieux penser au début de l’univers qu’à la fin du monde…
— Il y a des gens qui n’ont pas le choix. L’astronomie est un loisir de petit-bourgeois.
Elle a fermé les yeux. Je me suis approché de la vitre pour tenter de voir ce qui se passait dehors, mais il faisait affreusement sombre. J’ai remarqué une larme qui coulait lentement le long de sa joue. Elle a remué les jambes. On entendait des cris à l’autre bout du train. Elle a rouvert les yeux et a remis ses chaussures pour aller voir ce qui se passait. Avant de m’abandonner, elle a soupiré :
— Moi aussi, j’aimerais vivre sur une autre planète.
J’avais envie de lui demander de quel pays malade provenait son drôle d’accent, mais je n’étais pas de la police. J’ai collé mon front contre la vitre. Le sanglier est ressorti de la forêt. Il a levé la tête vers les étoiles, puis il s’est approché en zigzaguant sur le ballast pour venir me fixer droit dans les yeux à travers la vitre. On aurait dit qu’il voulait me dire quelque chose d’important, mais j’étais incapable de deviner ce que c’était.
7
 Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny

FRANÇOIS TRUFFAUT, FRAGMENTS D’UNE VIE
Avec une approche intime de l’œuvre du cinéaste, Anne Terral nous livre le plus beau livre qu’on puisse écrire sur François Truffaut. Sous la forme d’une magnifique déclaration d’amour. 9
En quoi la découverte des films de Truffaut à la télévision durant l’enfance et l’adolescence vous a-t-elle particulièrement marquée ?
Avec Truffaut, j’ai découvert le « vrai » cinéma, au sens où la rencontre qui s’est faite peu à peu avec ses films durant mon enfance et mon adolescence m’a alors permis de vraiment comprendre ce qu’était un film d’auteur et une œuvre de cinéaste… J’habitais à la campagne, près de Toulouse, et même si on allait souvent au cinéma, je me souviens qu’il y avait aussi à la télévision, dans les années 1980, des rediffusions avec des cycles entiers consacrés à des réalisateurs : une aubaine ! On pouvait alors voir tous les films d’un cinéaste sur plusieurs semaines. C’était idéal pour saisir toute la cohérence et la complexité d’une filmographie.
Bien sûr, cette découverte s’est déroulée sur plusieurs années et j’ai en quelque sorte grandi en même temps que les personnages des films de Truffaut : j’ai vu pour la première fois Les 400 coups vers l’âge de 9 ans, je pense, puis ce fut L’Argent de poche, L’Enfant sauvage, Jules et Jim et bien sûr la série des Doinel…
Qu’y trouviez-vous de singulier ?
J’étais très sensible et très empathique, et les thèmes abordés par Truffaut dans ces films-là résonnaient profondément chez moi. Tout me parlait et m’émouvait : l’enfance maltraitée, le manque d’affection, la solitude, le mensonge, le secret, mais aussi les troubles, le désir et l’amour bien sûr. Je crois que la dose exacte de gravité et de légèreté choisie par Truffaut pour évoquer ces sujets qui lui tenaient à cœur faisait absolument écho chez moi. Le fameux message que transmet l’instituteur incarné par Jean-François Stévenin à la fin de L’Argent de poche est un exemple même de ce qui pouvait me bouleverser à l’époque, et toujours aujourd’hui d’ailleurs. La force et l’intensité de ses mots, le ton exact qu’il employait pour les dire, les nuances de sa voix, je les entends encore… « Parce que la vie est ainsi faite qu’on ne peut pas se passer d’aimer et d’être aimé… »
Un chapitre est consacré à la diffusion de La Chambre verte alors que Truffaut vient de mourir, un dimanche. Vous écrivez : « regarder [son] film est donc un vrai bouleversement. » En quoi cette diffusion a-t-elle été déterminante pour vous ? Oui, un peu plus tard, entre 14 et 16 ans, j’ai vu les films plus sombres et plus dramatiques de Truffaut, Les Deux Anglaises et le Continent, L’Histoire d’Adèle H., La Chambre verte, La Femme d’à côté… La beauté et la puissance de ces œuvres, où la dépression, la maladie, le deuil, la trahison ont la part belle, m’ont
encore une fois touchée au cœur. Et en effet La Chambre verte a joué pour moi un rôle clé. Je ne sais pas quand exactement a été rediffusé ce film que j’ai vu à la télé à l’âge de 14 ans, mais en tout cas, c’était quelques jours après la mort de Truffaut, en octobre 1984. Dans La Chambre verte, adaptée de plusieurs nouvelles d’Henry James, le personnage de Julien Davenne, joué par Truffaut lui-même, n’accepte pas la mort de sa femme, il refuse de l’oublier, il refuse d’oublier « ses morts », ceux qui ont compté dans sa vie et il leur voue même un culte ardent. Ce film à la fois très mélancolique et très fervent vient dire tout haut, de façon pudique mais ferme, le caractère complètement inacceptable de la mort. Or, à peine quelques années auparavant, quand j’avais neuf ans, la mort de mon père m’avait moi aussi brutalement confrontée à cet inacceptable. Et le fait qu’un cinéaste en parle ainsi à travers un personnage, et proclame le scandale absolu qu’est la mort a été quelque chose de bouleversant pour moi, oui : un adulte osait enfin dire et montrer dans un film ce que je ressentais et m’efforçais de dissimuler – la douleur terrible, la révolte, la colère inouïe –, au moment où, autour de moi, on m’encourageait à être dans l’acceptation de ce qui est. Je crois qu’à partir de ce moment-là, j’ai compris à quel point le cinéma pouvait être un véritable allié dans ma vie, comme un ami sur qui compter. Même si le cinéaste que j’admirais le plus venait justement de mourir…
Vous avez opté pour cette forme des 24 images/ seconde, et donc 24 courts chapitres comme autant d’instantanés. D’où vous est venue l’idée ? À vrai dire, je crois que j’ai d’abord cherché le titre que je pourrais donner à ce projet et celui qui m’est venu a ensuite imprimé sa forme au texte. Cette expression de « 24 images/seconde », qui est donc la vitesse de défilement d’une pellicule 35 mm dans un projecteur, m’a semblé parfaite pour plusieurs raisons : elle permet d’évoquer, certes, la matérialité du procédé cinématographique, mais aussi la grande intensité qui sous-tend la plupart des longs métrages de Truffaut – il voulait que ses films donnent l’impression d’avoir été tournés avec 40 degrés de fièvre ! –, une ferveur qui m’a vraiment marquée au moment où j’ai revu toute sa filmographie en quelques jours.
Et puis ces « 24 images/seconde » faisaient aussi joliment écho à cette réplique des Deux Anglaises : « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. » Cette phrase, elle évoque à mes yeux les blessures cachées, les fragilités, les amours déçues, les moments décousus d’une existence où le vide peut venir s’immiscer… Faire un film a peut-être été, pour François Truffaut, un merveilleux moyen de « recoller » les morceaux de la vie, de sa vie, grâce
10
à l’unité quasi parfaite que représente un long métrage, le temps de 90 minutes et plus… Alors, à mon tour, j’ai eu envie d’écrire chacun de ces fragments de vie comme des unités qui pouvaient se suffire à elles-mêmes (chapitres choisis de l’existence totalement romanesque de Truffaut, dialogues imaginaires, scènes dans les coulisses, gros plans sur certains films…). 24 séquences, 24 ambiances, 24 images… Et avec l’enchaînement logique de la chronologie, s’est dessinée une façon un peu singulière, entre fiction et réalité, de raconter Truffaut en fondu enchaîné. J’y ai pris grand plaisir !
Vos choix semblent instinctifs et surtout sensibles, c’est ce qui fait le charme de votre ouvrage. Comment avez-vous procédé pour effectuer ces choix de films et d’extraits, en sachant que votre approche ne se veut pas systématique.
Comme vous le dites, j’ai simplement écouté mon instinct, un instinct guidé par ma mémoire bien sûr, enfin disons par la mémoire des émotions ressenties lors de ma toute première rencontre avec les films de Truffaut, lors de leur visionnage initial. Oui, c’est en quelque sorte l’enfant puis l’ado que j’ai été qui a fait cette sélection ! À cette époque, certains films de Truffaut ( Tirez sur le pianiste, Fahrenheit 451, La Peau douce, Une belle fille comme moi, Vivement dimanche !) ne m’avaient pas émue autant que d’autres. Même si j’ai saisi par la suite tout leur intérêt, toute leur force, je me suis sentie incapable d’écrire longuement à leur sujet, ces films-là n’ayant pas assez imprimé leur marque dans ma mémoire sensible de jeune spectatrice. J’ai donc délibérément décidé de peu les évoquer, préférant me consacrer à tous les films qui m’ont impressionnée, inspirée, accompagnée (Les 400 coups, L’Enfant sauvage, Les Deux Anglaises et le Continent, L’Histoire d’Adèle H., L’Argent de poche, La Chambre verte, La Femme d’à côté… ). Je ne me suis pas posé davantage de questions à ce sujet car ma posture a dès le départ été celle de la fiction – ce texte dans sa forme première était destiné à devenir une « fiction radiophonique » pour France Culture et le réalisateur Pascal Deux s’en est magnifiquement emparé en 2018, à ma grande joie. J’avais décidé d’écrire une sorte de célébration truffaldienne par petites touches impressionnistes, avec une dimension de confidence intime, qui prendrait avant tout sa source dans mon expérience personnelle de spectatrice, et non pas un « livre de plus » sur Truffaut, et encore moins une biographie exhaustive – Antoine de Baecque et Serge Toubiana l’ont déjà fait, avec virtuosité !
Vous n’évoluez pas en spécialiste de Truffaut et ne manifestez pas de volonté d’exposer de points de vue très particuliers. Pourtant, votre livre a cette force incroyable qui fait que connaisseurs et néophytes se laissent embarquer. J’imagine que ça n’était pas la moindre des finalités. Oh, merci pour ce que vous me dites là ! Si ce livre vous semble « tout public », alors j’ai atteint mon but, car c’est exactement ce que souhaitait Truffaut pour ses films : qu’ils soient populaires et puissent émouvoir le plus grand nombre ! Non, je ne suis donc pas une spécialiste de Truffaut, même si je commence quand même à bien connaître son cinéma ! Je suis une simple fan, une fan passionnée par la complexité de l’œuvre qu’il a créée, et je crois que cette force que vous évoquez, cette force que mon livre peut avoir, elle est tout simplement liée au fait que j’ai voulu écrire une déclaration d’amour et non, comme je le disais, une biographie « officielle » de Truffaut. Oui, c’est vraiment ce que j’ai voulu faire, une déclaration d’amour. Et je suis heureuse si cela permet au lecteur d’entrer ainsi plus facilement dans l’univers de ce réalisateur. Cette force, elle est peut-être liée aussi à ma volonté de saisir et de raconter au plus près toute l’humanité de ce cinéaste, une qualité qui, selon moi, explique précisément pourquoi son œuvre nous touche. Parce que Truffaut ne nous parle que de ce qui nous constitue profondément : le désir dans tous ses élans les plus absolus (du désir d’émancipation au désir amoureux en passant par le désir de création…), et la perte dans toute sa dimension tragique (séparation amoureuse, dépression, deuil…). Nos existences balancent constamment entre ces deux pôles, non ? Et l’œuvre

11
François Truffaut interprétant le rôle de Julien Davenne dans La Chambre verte
Truffaut ne nous parle que de ce qui nous constitue profondément. —
de Truffaut ne donne à voir que ça, que ce soit avec des personnages aussi complexes que Marion dans La Sirène du Mississippi ou Mathilde dans La Femme d’à côté, ou encore avec L’Homme qui aimait les femmes : le film s’ouvre sur l’enterrement de Bertrand Morane, et vient retracer toute l’existence passionnée et obsessionnelle de ce personnage on ne peut plus humain. On le sait, Truffaut est un grand explorateur du sentiment amoureux, le sentiment amoureux dans son intimité et sa violence la plus extrême, et en cela, je crois que son œuvre, d’une puissance singulière, ne peut que nous embarquer elle aussi !
Sur la question de l’écriture, une chose m’a troublé : d’un point de vue formel, j’entendais étrangement la voix de Perec, le Perec cinéaste justement et voix off d’Ellis Island par exemple. Grâce à vous, j’établis un lien entre les deux figures, Truffaut et Perec, sur les questions de la mémoire, du deuil et bien sûr de la mélancolie, sans compter que les deux carrières suivent des lignes quasi parallèles jusqu’à la disparition tragique et précoce de l’un et de l’autre. Étonnante votre remarque… Perec est en effet l’un de mes écrivains préférés, mais jusqu’à présent, je n’avais jamais consciemment établi de lien entre Truffaut et lui. Vous avez raison, ils sont contemporains, ont disparu précocement, emportés par la maladie, et ils ont tous deux abordé des thèmes similaires, avec une même pudeur d’ailleurs, une réserve et beaucoup de tact quant aux sujets qui leur importaient le plus… Peut-être se sont-ils rencontrés au fameux Moulin d’Andé où chacun s’est souvent rendu ? Je ne sais pas… Je les imagine facilement en train de discuter à bâtons rompus en fumant cigarette sur cigarette !
Les différentes scènes entrevues dans l’immeuble où habitent bon nombre des enfants de L’Argent de poche me font d’ailleurs penser à la structure de La Vie mode d’emploi !
En tout cas, si la forme de mon texte vous a fait penser à Perec, j’en suis ravie, honorée même. Je partage avec lui le goût des contraintes, même si je
suis loin d’être aussi douée ! En réalité, cette forme, avec des phrases plutôt courtes comme une prose poétique, où alternent parfois des répétitions en leitmotiv, elle s’est dessinée en cours d’écriture, lorsque j’ai eu besoin de respirations : il y a une grande intensité dans la vie de Truffaut ainsi que dans les films sur lesquels j’ai choisi de m’attarder, et cette tension quasi constante peut se révéler presque étouffante (je pense aux Deux Anglaises, à Adèle H. entre autres…). J’ai, de ce fait, ressenti la nécessité, dans l’écriture même, de revenir souvent à la ligne, de faire des pauses, de m’offrir et d’offrir au lecteur des moments de respiration… Petit à petit, mon texte, que j’avais au départ commencé à écrire de façon assez classique, d’un seul tenant, s’est structuré ainsi, s’est fissuré, s’est allégé aussi je pense. D’ailleurs, Pascal Deux, quand il a réalisé la mise en ondes de cette fiction radio, a su très bien restituer cette forme poétique et ces respirations à travers le rythme donné à l’ensemble et via la voix des comédiens.
Tiens, vous m’avez donné envie de relire Un homme qui dort et de revoir le film si particulier que Perec a tiré de son propre texte, avec l’aide de Bernard Queysanne, et que scande la voix quasi hypnotique de Ludmila Mikaël. Truffaut et Perec avaient également en commun une passion pour la voix off. S’il n’avait pas disparu si tôt, Truffaut, qui aimait tant adapter des œuvres littéraires, aurait peut-être un jour réalisé un long métrage à partir d’un des livres de Perec, qui sait ? L’imaginer me réjouit ! Je penche pour W ou le Souvenir d’enfance, entre autobiographie, exploration des ombres de la mémoire et dénonciation ardente de l’injustice. Et vous ?
— FRANÇOIS TRUFFAUT EN 24 IMAGES / SECONDE, Anne Terral, Médiapop Éditions
12
—
u s
f oc -
Le nombril de l’architecte mâle
Est-il, aujourd’hui encore, plus facile pour un homme blanc vêtu de noir de passer à la télé ou de s’adresser aux médias que pour une jeune femme en t-shirt clair ? Que font les architectes à la télévision ? questionne l’universitaire strasbourgeoise Sophie Suma. Dans son essai, elle interroge la vision patriarcalo-archétypale de la cité moderne contrariant la ville inclusive idéale. (E.D.) www.editions205.fr

Urgence photographique
Jusqu’au 29 janvier, La Chambre strasbourgeoise dévoile l’autre visage – kaléidoscopique – d’un pays malheureusement mis sous les feux de l’actualité. « Paysage présage » rassemble une quinzaine d’artistes et collectifs ukrainiens : l’exposition collective commissionnée par Kateryna Radchenko est une réponse pacifiste et photographique à la guerre déclenchée par la Russie. (E.D.)
www.la-chambre.org
Le sauvage recadré
Dans les photographies de Mélina Farine, la nature surgit au sein d’environnements urbains ou artificiels. « Les étendues » explore un avenir dystopique dans lequel toute idée de nature serait reléguée et condamnée à une simple fonction décorative. L’utilisation du verre et du métal rappelle l’architecture des serres des jardins botaniques : une mise en abyme de ces dispositifs de monstration et de conservation qui interroge aussi ceux du médium photographique. (B.B.)

— LES ÉTENDUES, exposition jusqu’au 7 janvier à la galerie Octave Cowbell, à Metz
www.octavecowbell.fr

focus
Les étendues © Mélina Farine
© Polyakov 14
Sophie Suma
La classe américaine
Après un long séjour australien, le songwriter JJH Potter débarque en Alsace avec une poignante poignée de chansons folk réunies sur l’album Low Tide et sa zéniphique pochette signée Marie-Pascale Engelmann. D’intimes confessions qui nous font oublier, un instant, que les temps sont durs. Une touchante collection de ballades façon americana. (E.D.)

diese14.com
Digital natives
Mêlant art, création et réalités numériques, Multiplica ouvre les points de vue sur la technologie. En décuplant les possibilités créatives du digital, le festival luxembourgeois n’hésite pas à emprunter les sentiers de l’expérimental ou de l’obsolescence. Sur trois jours, la programmation mêle performances audio-visuelles, DJ sets, workshops et expo. On y retrouve Andrea Mancini avec un soundscape tellurique où l’organique et le digital se répondent, le bruxellois Alexander Francis amateur de sons aussi profonds que décalés ou les Alive Paintings à la vibe très postmoderne d’Akiko Nakayama. (M.M.S.)

— MULTIPLICA, DIGITAL ARTS AND REALITIES, festival les 24 et 26 février aux Rotondes, à Luxembourg www.multiplica.lu
Morrissey l’insoumis
Après Paul Weller et Damon Albarn, Nicolas Sauvage s’attaque à un autre monument de la pop, Morrissey, sans doute le plus clivant des trois. Si ces dernières années, Moz fait malheureusement plutôt parler de lui pour de mauvaises raisons, le livre de Nicolas Sauvage (324 pages !) est une mine d’infos exceptionnelle pour tous ceux qui s’intéressent à un chanteur hors norme qui depuis la séparation des Smiths en 1987, n’a cessé de chercher à se renouveler sans jamais se renier. Recommandé aux fans les plus fidèles… comme aux anti-Morrissey. (P.S.)
— MORRISSEY L’INSOUMIS, Nicolas Sauvage, préface de Bertrand Loutte www.camionblanc.com

focus
© Axel Vanlerberghe
Andrea Mancini, Minerals © Yves Conrardy
15
© Renaud Monfourny
Take me to the river
Zone tampon, frontière naturelle, axe de circulation et colonne vertébrale d’une région, le Rhin rassemble dans son lit bien des enjeux. Jusqu’à l’été 2023, un cycle transfrontalier de 38 expositions vogue sur les eaux du fleuve le plus fréquenté d’Europe et croise les perspectives allemandes, françaises et suisses. De Bingen à Laufenburg, c’est l’occasion d’en savoir plus sur l’or blanc du Rhin dans les salines de Schweizerhalle, de faire connaissance avec Johann Gottfried Tulla, ingénieur et dompteur de crues à Andlau, ou de plonger dans les archives photographiques de la centrale hydroélectrique de Kembs. Les paysages rhénans et leur mythologie nimbée de brume sont également au cœur de plusieurs accrochages, dont une immersion littéraire et musicale au Nibelungenmuseum de Worms. Sur ses flots, ponts, barques à fonds plats, installations hydro-électriques ou piscicoles brassent les activités humaines, les échanges et les conflits. De la forteresse Vauban de Huningue à la conquête de Heidelberg en passant par l’Alsace face au nazisme, « Der Rhein – Le Rhin » n’élude aucun des tumultes traversés par ce « fleuve des guerriers et des penseurs », comme l’appelait Victor Hugo. Une manifestationfleuve tant par la variété des thématiques abordées que par l’hétérogénéité des institutions impliquées !
Par Mylène Mistre-Schaal
—LE RHIN, cycle d’expositions jusqu’à l’été 2023 dans 38 musées en Allemagne, en Suisse et en France www.dreilaendermuseum.eu

focus
16
Salle de commande de la centrale de Kembs, 1933 © Musée Electropolis - centrale hydroélectrique de Kembs
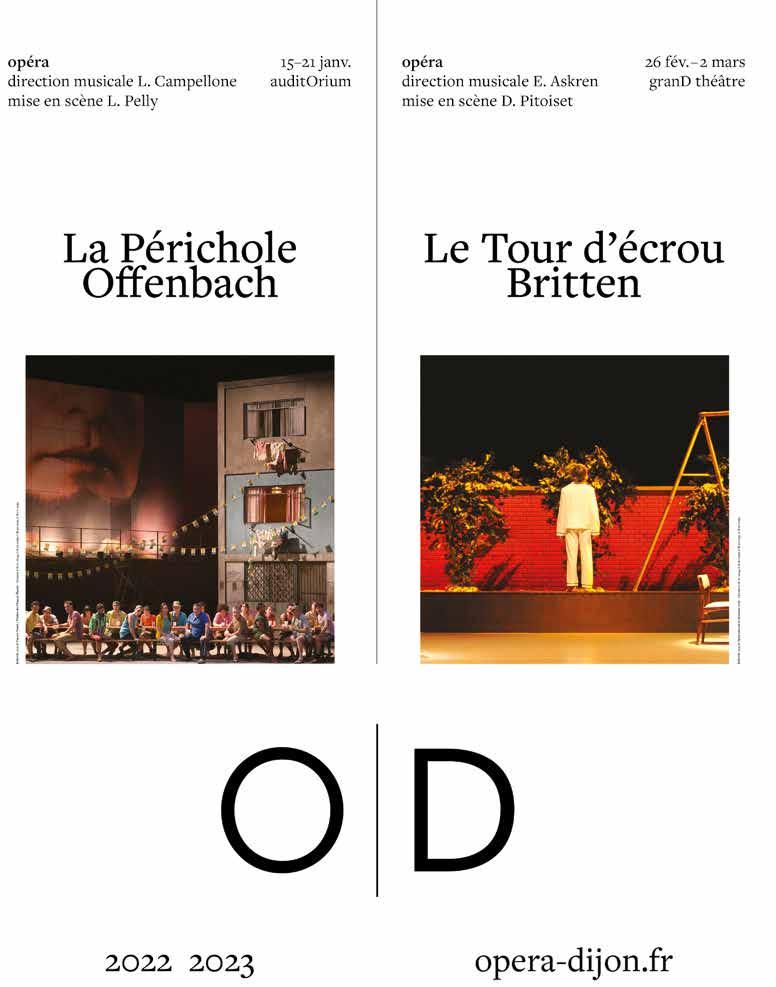
Pour un petit Tour
Screw ya, let’s faire un Tour. Ce pourrait être un résumé punko-Delpech de l’état d’esprit de Benjamin Britten à la mise en chantier du Tour d’écrou. Il rencontre « l’étrange histoire » d’Henry James, The Turn of the Screw, dans les années 1930 et devient fasciné par cette petite chose splendide, irrésolue et pleine d’ombres épaisses. Un clair-obscur, confortable et menaçant pour lui, homosexuel dans l’Angleterre puritaine du début du XXe siècle. Il y trouve un écho à ses obsessions qui s’éclairciront dans son futur Billy Budd, par exemple, opéra christo-maritime créé d’après la nouvelle de Melville en 1951. Un an plus tard, c’est La Fenice de Venise qui frappe à sa porte et lui passe commande d’un opéra de chambre, à créer durant l’été 1954. Après l’océan, les remous intimes, Britten refait un tour d’écrou et livre une partition pour 13 musiciens, elle aussi pleine de non-dits et d’ombres censées abriter un autoportrait aussi fidèle que discret. Autoportrait lancé à la cantonade par un narrateur hors pair, cantonade embarquée dans les remous qui ballottent Mrs Grose, jeune gouvernante happée par les ténèbres et deux fantômes occupant un manoir anglais au XIXe siècle. De cette autre nuit du chasseur, Dominique Pitoiset, l’actuel taulier de l’Opéra national de Dijon, en co-production avec l’Opéra de Bordeaux tire un huis clos, à sa façon. Plein d’ombres dramatiques, de chaussetrappes kafkaïennes, d’innocences perdues et de déments dilemmes.
Par Guillaume Malvoisin
— LE TOUR D’ÉCROU, opéra les 26 et 28 février et le 2 mars à l’Opéra de Dijon, à Dijon www-opera-dijon.fr
Le
prince, le serpent et la Reine de la Nuit
Sur la fascinante affiche annonçant La Flûte enchantée à l’Opéra du Rhin, œuvre de l’illustratrice Laura Junger, on entrevoit, au cœur d’un buissonnement coloré de fleurs et d’animaux, un arbre qui nous regarde de ses mille yeux… On dirait qu’il prend vie, nous envoûte et nous appelle dans l’univers du dernier grand opéra de Mozart, bouleversant les frontières entre existences humaines, animales et végétales. Il suffit, pour se faufiler dans ce monde magique, de suivre les pas du prince Tamino, s’éloignant du monde humain et de ses repères rassurants, après sa rencontre avec un serpent géant. Mises en scène par Johanny Bert (passé par le Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon ou le Théâtre de la Ville à Paris) et en musique par Andreas Spering (passé par les Opéras d’Essen, Göteborg, Hanovre ou Copenhague), les aventures de Tamino (Eric Ferring et Trystan Llŷr Griffiths) préfigurent avec plus d’un siècle d’avance une certaine esthétique surréaliste, celle d’Alice aux pays des merveilles, par exemple, dont on avait pu voir une très belle interprétation l’hiver dernier à l’OnR. Ainsi le jeune prince fait-il la rencontre étrange de la Reine de la Nuit (Svetlana Moskalenko et Marie-Eve Munger), comme Alice faisait celle de la Reine de Cœur. Reine de la Nuit qui pleure l’enlèvement de sa fille et nous berce de son air mélancolique, jurant de la retrouver : « Hört, hört, hört, Rachegötter, hört der Mutter Schwur… » Écoutez, écoutez, écoutez, dieux de la vengeance, écoutez le serment de la mère…

 Par Clément Willer
Par Clément Willer
— LA FLÛTE ENCHANTÉE, opéra du 8 au 18 décembre à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg, et du 5 au 8 janvier à la Sinne, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.theatre-sinne.fr
focus
The Turn of the Screw (détail), Eric Pape
18
Laura Junger (détail)
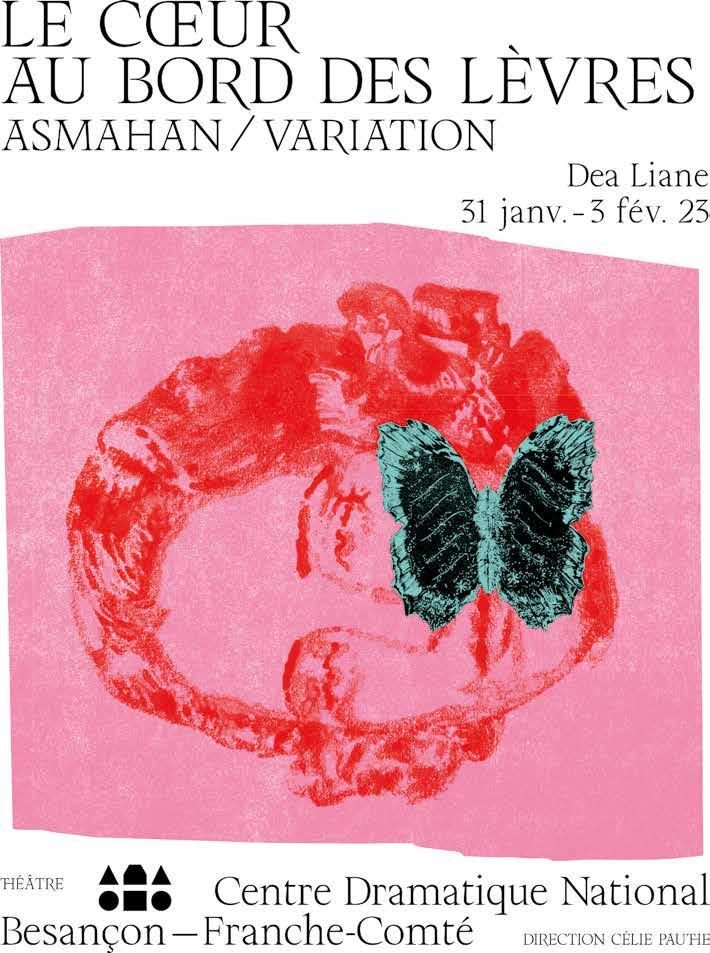
Orchestral Version
« Réorchestrer son répertoire avec l’apport d’instruments acoustiques et créer de nouveaux morceaux mêlant le langage des musiques actuelles et celui des musiques classiques », c’est l’excitant défi proposé chaque année par le Moloco et la Poudrière… Et après Silly Boy Blue et Zerolex, c’est au tour du beatmaker-rappeur-producteur toulousain Al’Tarba de s’y coller le 9 décembre prochain. Accompagné par des membres de son crew Swift Guad et Vîrus, de la chanteuse de flamenco Paloma Pradal, et de cinq musiciens de l’École supérieure de musique BourgogneFranche-Comté, Al’Tarba revisitera donc son répertoire abstract rap hip-hop à grand renfort de clavecins, violons et autres violoncelles… Voilà qui promet donc un mélange relativement étonnant et follement curieux, qui sera suivi par la suite d’un live solo du Toulousain l’occasion pour lui de présenter son nouvel album La fin des contes, sorti en mai dernier.
Par Aurélie Vautrin
— AL’TARBA ORCHESTRAL

PROJECT,
concert le 9 décembre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com
Le bal des actrices
Avec quatre comédiennes, Émilie Capliez, metteure en scène et codirectrice de la Comédie de Colmar, rend hommage aux actrices de cinéma, icônes, héroïnes et miroirs de notre société. Marilyn, Romi, Gena, Delphine (Seyrig), Adèle (Haenel), Chantal (Akerman), Naomi (Kawase) et bien d’autres encore… Dans le texte de Pauline Peyrade, commandé par Émilie Capliez, se croisent comédiennes et réalisatrices qui ont chacune forgé notre imaginaire. Elles sont tour à tour (et parfois en même temps) des personnalités singulières et fascinantes, renvoient à des archétypes et des stéréotypes, par ce qu’elles ont réalisé, ce qu’elles ont traversé, ce qu’elles ont porté. Endossées par quatre comédiennes de parcours et d’âges différents, elles traversent le plateau comme des étoiles, et l’on reconnaîtra (ou pas, et cela n’ôtera rien) avec délice des scènes et figures mythiques de l’histoire du cinéma. Écrit à partir de scènes de films, d’archives et de témoignages, Des femmes qui nagent est d’abord conçu comme un montage, un cut-up théâtral où les saynètes se percutent, s’éclairent, s’augmentent. Une écriture qui évoque le surréalisme avant de basculer dans le réalisme et de suivre, comme contrepoint à la vie face caméra, une ouvreuse pour qui le cinéma est le théâtre d’un quotidien tout sauf glamour.
À travers cet hommage aux actrices, c’est évidemment de la femme dont il est question, de la façon dont on la regarde, ce qu’on attend d’elle, ce qu’elle croit qu’on attend d’elle, et ce que tout cela dit de nous.
 Par Sylvia Dubost
Par Sylvia Dubost
— DES FEMMES QUI NAGENT, théâtre du 31 janvier au 7 février à la Comédie de Colmar, à Colmar www.comedie-colmar.com
focus
Al’Tarba © Clément Ducourty
20
© Jean-Louis Fernandez

environ 300 mm
Grand luxe
En écho à « l’année du verre » instaurée par les Nations unies, l’Abbaye des Prémontrés consacre une double exposition à ce matériau recyclable à l’infini, symbole d’excellence et de savoir-faire, devenu depuis longtemps un incontournable dans tous les domaines ou presque. Ce qui est d’autant plus vrai que le Grand Est a un lien historique très fort avec l’art de la verrerie ! Intitulée « Passé, Présent, Futurs : Le verre dans tous ses éclats », l’expo donne à voir deux regards parallèles pour une double immersion dans un univers à la fois furieusement fort et délicatement fragile. Le premier volet, « Le cristal dans tous ses états », propose la reconstitution d’un atelier de maîtres verriers d’époque, avec mise en scène de la beauté du geste et des techniques ancestrales qui ont fait les grandeurs du luxe à la française, à travers les arts de la table, la parfumerie et les arts décoratifs. Dans le second, « Une histoire du verre dans le Grand Est – Dialogue entre matière et savoir-faire », il est question des présentes et futures utilisations de cet élément. Une histoire en perpétuelle écriture, illustrée par diverses créations spécialement conçues par des artistes verriers régionaux. À noter qu’à la fin de l’événement de Pont-à-Mousson, cette partie de l’exposition sera ensuite montrée dans tout le Grand Est.

Par Aurélie Vautrin
— PASSÉ, PRÉSENT, FUTURS : LE VERRE DANS TOUS SES ÉCLATS, exposition jusqu’au 29 janvier à l’Abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson www.abbaye-premontres.com
focus
22
Jouons © NH – Verrier : Les Infondus, verre soufflé à la canne, assemblé à chaud, hauteur de chaque lettre,


Danse avec elles
La danse ne fait pas exception : ici comme partout, les femmes sont sous-représentées. Et c’est visiblement là aussi une affaire de mauvaise volonté, puisque, pour L’année commence avec Elles, Pole-Sud a réussi à réunir pas moins de 11 chorégraphes femmes. Le nombre, la qualité et la diversité des pièces présentées rendent leur absence ailleurs d’autant moins compréhensible… Tour à tour introspectives ou explosives, joyeuses ou sombres, abstraites ou plus narratives, elles explorent des voies multiples, pas toujours d’un féminisme frontal. On pourrait lire deux axes dans la programmation. D’abord un hommage aux femmes puissantes, quand même, avec notamment Submission Submission de Bryana Fritz autour de Hildegarde de Bingen, Christine l’Admirable, Catherine de Sienne ou Christine de Bolsena ; Mascarades de Betty Tchomanga qui revisite le mythe de Mami Wata, divinité africaine puissante et redoutée, et IDA don’t cry me love, témoignage de la fascination de Lara Barsacq pour la figure d’Ida Rubinstein, interprète des Ballets russes. Ensuite, une exploration de la danse comme langage, et toutes les possibilités (et fantaisies) formelles qu’elle permet. Akiko Hasegawa chorégraphie ainsi Haré Dance à partir de l’idée de joie et de fête ; avec sa conférence dansée Nulle part est un endroit, Nach fait découvrir la culture krump dans laquelle elle s’inscrit depuis une dizaine d’années… Il y a aussi des propositions plus intimistes, d’autres plus politiques. Il y a surtout 11 pièces qui affirment une écriture forte et singulière. Qu’elle soit féminine ne sera, on l’espère, bientôt plus la question.
Par Sylvia Dubost
— L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES, danse du 12 au 28 janvier à Pole-Sud, à Strasbourg www.pole-sud.fr

Le vent du diable
Pas de personnage, pas d’histoire, pas de drame. Ainsi s’avance, comme un personnage à l’élégance taciturne qui entrerait en scène sans dire un mot, Par autan, création du Théâtre du Radeau et de François Tanguy, présentée en cette période hivernale au TNS. Comme un personnage ou comme un vent, qui souffle une langue qui nous touche sans qu’on la comprenne, puisque l’autan est le nom d’un vent fort du sud-ouest, surnommé « vent du diable », pouvant détruire les récoltes, et, dit-on, rendre fou qui écoute trop longtemps ses murmures et ses sifflements indéchiffrables. Le Théâtre du Radeau, né au Mans en 1978, est animé par le metteur en scène François Tanguy depuis 1992 ; on a pu assister dernièrement à certaines autres de leurs mises en scène au TNS, Passim en 2015, Soubresaut en 2018 ou Item en 2020. La troupe, composée de Frode Bjørnstad, Samuel Boré, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly et Anaïs Muller, revient pour nous plonger dans une atmosphère de pures sensations, nous emporter dans un espace mouvant et venteux, traversé de mélodies au piano (Éric Goudard), de résonances lumineuses (François Fauvel et Typhaine Steiner), et de fulgurances verbales, empruntées à Robert Walser, William Shakespeare, Heinrich von Kleist ou Franz Kafka, constellation rebelle et romantique.

Par Clément Willer
— PAR AUTAN, théâtre du 6 janvier au 14 janvier au TNS, à Strasbourg www.tns.fr
focus
Mascarades de Betty Tchomanga © Queila Fernandez
24
Par autan © Jean-Pierre Estournet
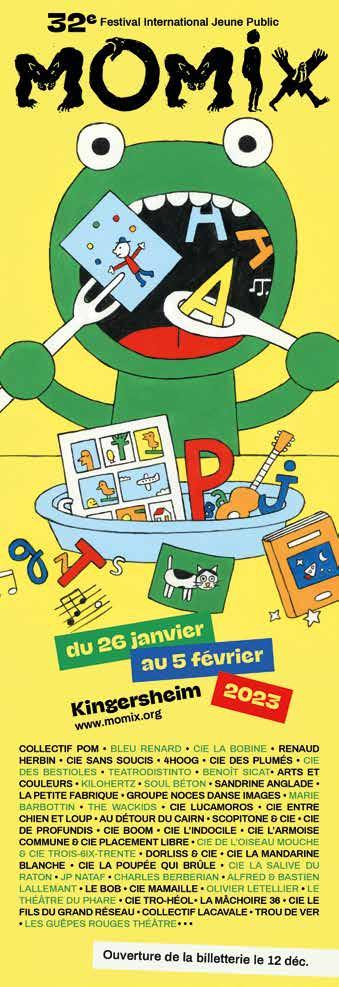

Entrez dans la transe
Tous ceux qui ont eu la chance de les voir au dernier Hellfest ou ailleurs vous le diront : pour faire simple, un concert d’Heilung, ça ne se raconte pas : ça se vit. Une peau de bête sur les épaules et l’esprit immergé dans un monde audelà de tout, de l’espace, des frontières, de la vie, de la mort. D’ailleurs, on ne sait pas vraiment si l’on assiste à un live de metal ou un rituel sacré ancestral, une cérémonie du fond des âges, un culte sacrificiel – en tout cas, à une expérience mystique et sensorielle, ça, c’est certain, pure ment subjective, profondément unique, portée par une scénographie assez dingue, des cos tumes extrêmement travaillés, des instruments de musique à base d’os, de cornes et autres antiquités nordiques… Car, petit rappel pour ceux qui seraient restés au fond de la caverne, Heilung est un groupe venu du Danemark, de Norvège et d’Allemagne, spécialisé dans la « folk expérimentale », et qui, à travers des chansons comme des incantations, nous offre un étrange voyage dans le temps, époque guerriers vikings et âge de fer. Après un quatrième album sorti cet été sous le label franco-américain bien connu des metalleux, Season of Mist, le groupe fera donc une halte à la BAM de Metz au cours de sa tournée internationale pour une cérémo nie dont vous vous souviendrez longtemps. On tient le pari !
Par Aurélie Vautrin
— HEILUNG, concert le 10 janvier à la BAM, à Metz www.citemusicale-metz.fr

Forces de la Nature
Après avoir mis le feu (sacré) à la scène de l’Autre Canal en mars 2018, les jumelles franco-cubaines de Ibeyi reviennent avec une énergie encore plus folle pour présenter leur nouvel album, Spell 31, à la fin du mois de janvier – une de leurs dernières dates françaises avant un Olympia et une grande tournée aux USA. Et autant dire tout de suite que le troisième opus des demoiselles – Naomi et Lisa-Kaindé Díaz de leurs vrais noms – est une petite merveille. À leurs thèmes de prédilection (racisme, féminisme, sororité…), les chanteuses ajoutent désormais une forte spiritualité, sous forme d’hommage aux chemins de leurs ancêtres, partis d’Afrique pour subir le sort tragique des esclaves à Cuba. Un passé qu’elles célèbrent la tête haute et le poing levé, mêlant les styles, les langues, les rythmes – soul-pop, hip-hop, jazz moderne, musiques électroniques, chants traditionnels yoruba ‒ samplant même la voix de leur père (Anga Díaz, célèbre percussionniste du Buena Vista Social Club) sur leurs titres. Et si Spell 31 tire son nom du Livre des morts de l’Égypte ancienne (véridique), Ibeyi nous offre ici un album résolument solaire, foisonnant, porté par une énergie décuplée, puissante et quasi hypnotisante, qu’il nous tarde de découvrir sur scène, où tout cela doit sans aucun doute prendre encore une autre dimension. Attention pépite !
Par Aurélie Vautrin
— IBEYI, concert le 27 janvier à l’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

focus
Ibeyi © Raphael Pavarotti
26
Heilung © Ruben Terlouw
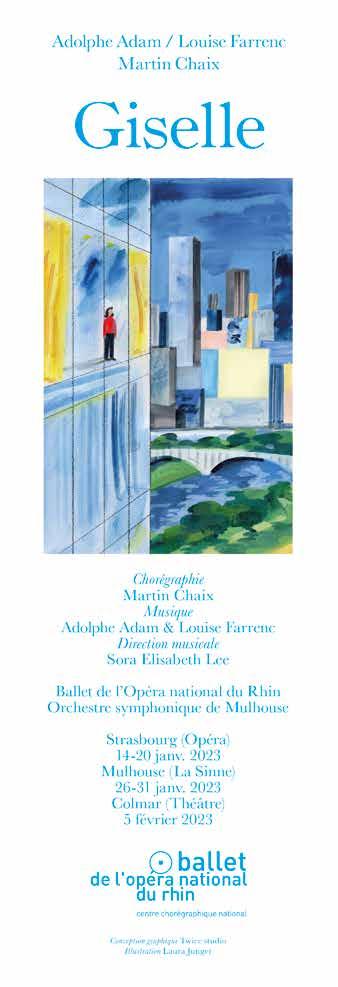

Jeux de cartes
Dépliées tant bien que mal dans l’habitacle de la voiture familiale, aujourd’hui intégrées dans nos téléphones portables, les cartes sont devenues si banales qu’on ne s’interroge plus forcément sur ce qu’elles contiennent. Pour les explorer, la metteuse en scène Bérangère Vantusso a collaboré avec la compagnie de l’Oiseau-mouche, constituée de comédiens en situation de handicap mental. Dans Bouger les lignes, il s’agit de questionner les notions de frontières, de limites, de se demander qui les dessine et surtout comment l'on se place par rapport à elles. Une véritable aventure pour quatre personnes qui sont « ici », ne se connaissent pas encore et se découvrent un intérêt commun à « savoir où on est ». Au sein de la scénographie de cartes géantes imaginée par Paul Cox, le théâtre devient leur espace de jeu et de découverte ; c’est là qu’ils font la rencontre de l’Autre, celui qui est de l’autre côté de la ligne, de toutes les lignes. Jouissive, débridée, cette expérience d’un monde qui se déploie invite à suivre les flèches, les légendes, à prendre un peu de hauteur en multipliant les points de vue... Au fil de ce cheminement entre le réel et l’imaginaire, c’est aussi à une histoire d’émancipation qu’assiste le spectateur, au même rythme que les comédiens.
Par Benjamin Bottemer
Recoller les morceaux
Le temps, l’espace et la musique forment un tableau en déconstruction permanente dans Sans tambour. Strates du passé et traces du présent y cohabitent : de l’effondrement progressif d’une maison suivra la reconstruction, faite des vies de ceux qui y ont vécu de l’âge de pierre à nos jours. Le tout autour d’une musique ellemême en « work in progress » d’après les lieder de Robert Schumann, ces fragments d’absolu qui s’écroulent et constituent les bases de nouveaux départs. « Ici, l’écriture musicale est intrinsèquement liée à l’action théâtrale, précise le metteur en scène Samuel Achache. Il s’agit d’extraire des éléments cachés de la partition pour en faire le point de départ d’une nouvelle création. Le fait de réunir sur scène acteurs, chanteurs et instrumentistes y contribue beaucoup. »
Pour ce spectacle en partenariat avec l’Opéra national de Lorraine, Samuel Achache revient à une forme très musicale qui part du lied comme forme intime pour travailler sur l’ensemble, en le faisant porter par plusieurs voix. Florent Hubert, à la direction musicale, est lui aussi familier des spectacles musicaux explorant le jeu et la composition. Réflexion sur la mémoire comme sur nos effondrements intimes, Sans tambour pose la question de ce que nous recomposons à partir du souvenir des choses, la musique rétablissant un lien direct entre notre conscience et une image, vécue ou imaginaire.

 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
— SANS TAMBOUR, théâtre du 10 au 12 janvier au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr
focus
— BOUGER LES LIGNES, théâtre le 7 février au Carreau de Forbach www.carreau-forbach.com
Bouger les lignes – Histoires de cartes © Christophe Raynaud de Lage
28
© Jean-Louis Fernandez

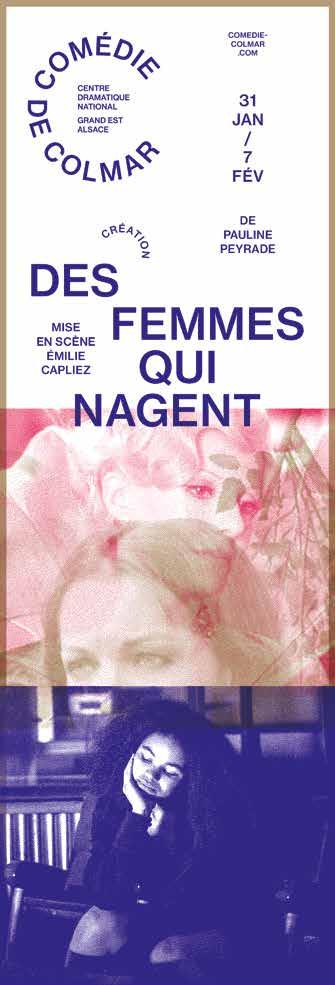
L’Est en instantanés
Après plus d’un an de chasse aux images en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne, cinq photographes présentent leur approche d’un territoire tout neuf : le Grand Est. Une résidence dans le cadre d’une commande de la Région, souhaitant s’inscrire dans la tradition des missions proposant une représentation d’un territoire à un moment donné. Chaque artiste a choisi et traité son approche en symbiose avec son expérience sur le terrain, ses rencontres, ses imprévus ; complémentarités, correspondances et contrastes se dégagent de cette confrontation d’images. Lionel Bayol-Thémines associe des images de Google Earth à des photos prises par drone, des modélisations 3D et des images de surveillance et d’analyse, tandis que les portraits d’Olivia Gay envisagent leurs sujets dans leur rapport à leur environnement professionnel, social, naturel... Éric Tabuchi met en évidence les différences entre les régions en termes architecturaux, mais surtout leurs similitudes de formes, de couleurs et de styles. Beatrix von Conta s’est attachée au thème de l’eau, primordiale à toute présence humaine, aussi bien en termes d’agrément que d’activité industrielle. Enfin, Bertrand Stofleth illustre les évolutions des paysages dues à l’activité humaine, y induisant des paradoxes tantôt frappants, tantôt insidieux, saisissant les singularités d’un territoire en pleine transition.
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
— GRAND EST, UNE MISSION PHOTOGRAPHIQUE, exposition du 7 décembre au 19 février à l’Arsenal, à Metz missionphotographique-grandest.com www.citemusicale-metz.fr
L’infini et l’au-delà
Simple, cette musique n’a rien à voir avec la réalité, et n’a rien à voir avec l’avenir. Mais tout avec la vie qui se joue dans l’instant où Torben Snekkestad, Agustí Fernández et Barry Guy en inventent les sons et les textures. Poncif sur l’impro ? Sans doute, mais toujours bon à rappeler tant un tel trio est important à voir. Voir la musique en train de se faire, de se jouer quelque part entre l’improvisation libre, le free jazz et la musique classique contemporaine, ramène tout spectateur à affronter sa vanité. Il faut le voir, pas pour le croire mais pour le vivre. Et la rapidité avec laquelle fusent les idées de ce trio international laisse à peine le temps de réfléchir. Soit débrancher la cervelle pour laisser libre cours au plaisir du son. Snekkestad, Guy et Fernández, maîtres dans l’art de la freemusic, esprits libres ne reconnaissant aucun des héritages musicaux, aucune contrainte de genres ou de styles. Tous trois ont travaillé ensemble dans différentes configurations au cours des dix dernières années. Depuis, le soufflant scandinave, le pianiste catalan et le contrebassiste britannique n’ont de cesse d’avancer entre free jazz brûlant et poésie magnifique de naïveté. Leur dernier disque, The Swiftest Traveler (Trost, 2020), en bon hommage au Walden de Thoreau, arpente tous les sentiers de création possibles, dans un souffle commun impressionnant. Ce concert, calé dans le cadre des Jazz Currents, devrait laisser quelques envies de grands larges ou de forêts, à son issue.

Par Guillaume Malvoisin
— TRIO SNEKKESTAD / GUY / FERNÁNDEZ, concert le 2 février à la Philharmonie Luxembourg www.philharmonie.lu
focus
Mission, Beatrix von Conta, Martigny-les-Bains, Vosges, 2019
30
© Torben Snekkestad
Question de mémoire
Inscrire dans le temps une voix, percer l’abcès de l’agonie, retenir ce qui s’échappe, déconstruire pour se réécrire... la trame du sensible est posée, elle s’accorde sur la nécessité d’écrire le Moi au regard du Nous.

LE DISCOURS ET LA MÉTHODE
Par Nicolas Querci ~ Photo : Claire Fasulo
EN 15 ANS, LES ÉDITIONS LA CONTRE ALLÉE, SITUÉES À LILLE, ONT DÉVELOPPÉ UN CATALOGUE DE LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE À L’IDENTITÉ TRÈS AFFIRMÉE. RENCONTRE AVEC BENOÎT VERHILLE, COFONDATEUR ET DIRECTEUR ÉDITORIAL DE LA MAISON, POUR LE HUITIÈME ÉPISODE DE LA SÉRIE CONSACRÉE AUX ÉDITEURS.
Comment inscrire dans la durée un discours, une pensée, un regard, une voix ? Pour Benoît Verhille, qui a longtemps évolué dans la musique et le spectacle vivant, où le rythme des représentations et l’importance accordée à l’instant lui ont parfois donné le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout des choses, cela passera par le texte, et plus précisément par son édition.
En 2008, il fonde La Contre Allée avec sa compagne Marielle Leroy, en gardant de son expérience le goût de la rencontre, de l’échange, du débat, du collectif et de l’indépendance. Le nom de la maison est emprunté à une chanson d’Alain Bashung, un artiste qu’ils aiment tous les deux. Ce nom correspond aussi à l’esprit des textes qu’ils souhaitent éditer, des textes qui s’écartent des chemins tout tracés.
Les deux premiers titres sont des ouvrages collectifs qui donnent le ton et permettent d’afficher les intentions de la maison. On trouve dans À chacun sa place, consacré au quartier Fives, à Lille, où se situe la maison, et dans En attendant l’Europe, qui interroge l’identité européenne, des préoccupations qui sont toujours au cœur de la littérature qu’elle
publie. Avec une ligne éditoriale clairement définie, centrée sur l’articulation entre littérature et société, La Contre Allée porte une attention particulière à la condition de l’individu dans la société contemporaine. Elle ne publie presque que des auteurs contemporains, français et étrangers, dont les textes porteurs de valeurs émancipatrices visent autant à surprendre, à émouvoir et à captiver qu’à ouvrir un espace de réflexion.
Cela se matérialise dans le catalogue par une diversité de voix, de tons, de styles, et une grande variété de formes. La façon de raconter une histoire et le point de vue comptent autant que l’histoire elle-même. C’est pourquoi l’on retrouve des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie, etc., sans que le genre, forcément réducteur, ne soit mentionné sur la couverture.
L’impression d’unité qui se dégage du catalogue est renforcée par une charte graphique qui rend chaque titre immédiatement reconnaissable, quelle que soit la collection à laquelle il appartient : des couvertures qui sautent eux yeux, des beaux papiers que l’on a envie de toucher, des marges qui laissent respirer le texte, et d’autres « fantaisies » comme
33
À
les codes-barres imagés et les colophons en forme d’illustration… Le soin apporté à la fabrication transforme le livre d’un auteur inconnu en objet que l’on a envie de manipuler, de parcourir, et finalement d’emporter.
Publier des textes, c’est aussi les défendre, les promouvoir et les vendre. Ainsi Benoît Verhille mène un travail de fond auprès des libraires pour faire connaître le catalogue de la maison, et il consacre une bonne partie de son temps à trouver tous les débouchés possibles pour ses auteurs : lectures, rencontres, résidences, prix, adaptations, traductions, etc. En parallèle, il contribue dans un souci collectif aux efforts visant à structurer la filière du livre dans les Hauts-de-France. Enfin, pour mettre en lumière la traduction littéraire, La Contre Allée organise depuis 2015 un festival consacré à cette activité et à celles et ceux qui l’exercent.

Aujourd’hui, Benoît Verhille insiste sur la dimension collective de cette histoire et tient à souligner l’apport de toutes les personnes qui la font avancer au quotidien. En janvier 2023, pour marquer ses 15 ans d’existence, La Contre Allée



publiera les nouveaux livres de Lou Darsan et d’Amandine Dhée, deux autrices emblématiques du catalogue, qui comptera alors 115 titres.



En créant La Contre Allée, est-ce qu’il y avait des auteurs que vous rêviez de publier ?
Il s’est passé quelque chose dans ma vie en lisant Fuir la spirale, de l’autrice cubaine Nivaria Tejera, puis en la rencontrant et en travaillant sur des adaptations de ses textes, avant que la maison existe. Il m’était venu le désir de rééditer toute son œuvre, ainsi qu’un inédit qu’elle a pu voir publié de son vivant, Trouver un autre nom à l’amour, son dernier texte. Pour Marielle, ma compagne, c’était Alfons Cervera. Quand on a monté la maison, elle me traduisait à la volée des passages d’un de ses textes, Maquis, en me disant qu’il fallait qu’on le traduise quand on serait assez solides. On a contacté sa maison d’édition en Espagne, qui nous a appris que les droits avaient été cédés à une maison qu’on adore, La fosse aux ours. Finalement, on a eu l’opportunité de dialoguer avec Georges Tyras, qui était en train de traduire Alfons Cervera que l’on

34
chacun sa place (2008) et En attendant l’Europe (2009) sont les deux premiers titres de La Contre Allée. La charte de la collection d’essais, d’entretiens et de documents « Un singulier pluriel », dans laquelle a paru Le Dernier des juges (2012) de Roberto Scarpinato, évoluera en 2019 (Désherbage de Sophie G. Lucas) pour se rapprocher de celles des autres collections. Dès 2010, la ligne élaborée avec Olivier Durteste est en place (Dʼazur et dʼacier, de Lucien Suel) En janvier 2023, pour les 15 ans, paraîtront Sortir au jour d’Amandine Dhée (dont La femme brouillon, paru en 2017, est l’un des titres emblématiques du catalogue) et Les Heures abolies de Lou Darsan.
est allés voir chez lui. Puis en discutant avec La fosse aux ours, quelque chose s’est organisé, que je trouve assez beau : le versant de l’œuvre consacré à la mémoire collective serait publié chez eux, et le versant plus contemporain, plus intime, chez nous.
Si les questions de société sont très présentes dans vos livres, on trouve aussi dans votre catalogue une grande diversité de genres, de formes et d’écritures. Est-ce que l’écriture et la forme sont aussi importantes que le sujet et le fond ? C’est indissociable. Je ne suis pas critique littéraire et j’aurais du mal à dire précisément ce qui fait qu’un texte s’inscrit dans le champ des littératures ou pas. C’est quelque chose que je ressens plus que je ne saurais le définir. Mon travail d’éditeur, c’est d’essayer de voir comment les choses se trament, se dessinent et s’écrivent. Il y a une littérature qui raconte le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si cette littérature y joue un rôle, mais en tout cas c’est celle qui me parle. C’est une forme de pensée, une façon de voir les choses qui vient perturber la mienne. Quelque chose me prend aux tripes, accapare mon esprit. Quand un texte me fait cet effet-là, je suis obligé d’y revenir. C’est déterminant dans mon choix. Ma raison d’être éditeur, c’est d’accompagner cette voix.
Quitte à brouiller les genres ou la frontière entre fiction et non-fiction ?
C’est difficile, aujourd’hui, de donner une définition du roman. C’est pour ça qu’on a gommé des couvertures les mentions roman, récit, poésie… Quand on a fait ça, on a vu des choses amusantes. Par exemple, on a fait de très beaux scores avec La Nuit des terrasses, un recueil de poèmes de Makenzy Orcel. Il n’y avait pas écrit « poésie » dessus. Le livre était placé en littérature, pas dans le rayon poésie, ce qui change tout. Sophie G. Lucas, c’est une poésie saisissante, mais aussi une littérature de l’intime, une incroyable capacité à générer une sorte de poésie documentaire… Ça fait plusieurs fois que l’on entend parler dans la presse, à propos du Pion de Paco Cerdà, publié à la rentrée, de « roman sans fiction ». C’est intéressant : un roman sans fiction d’un auteur qui refuse lui-même l’idée d’avoir écrit un roman, mais qui en parle comme d’un roman… Quand on publie en 2016 Des lions comme des danseuses, d’Arno Bertina, qui traite de la restitution des œuvres d’art spoliées pendant la colonisation, c’est une fiction, un conte plein d’humour. En 2018, c’est une question d’actualité, la fiction est devenue réalité. Et Bénédicte Savoy, qui a traduit ce texte en allemand, a codirigé le rapport remis au président de la République sur ce sujet. On a réédité ce texte en 2019 avec la postface de Bénédicte Savoy et une
note de l’auteur. Voilà, en fait, une « histoire » de la littérature, une projection qui trouve une forme de réalisation. Ce n’est pas de l’anticipation, c’est juste imaginer un autre possible.
Vous publiez beaucoup de littérature étrangère. Vous avez également créé une collection qui donne la parole aux traducteurs, « Contrebande », et un festival consacré à la traduction, D’un pays l’autre. Il était nécessaire de mettre les traducteurs en avant ?
La traduction est déterminante dans notre parcours de lecteur ou de lectrice. Retirez la littérature étrangère de votre bibliothèque, et dites-moi ce qu’il reste… Pour moi, les traducteurs incarnent l’ouverture et le rapport à l’autre. Si je veux accéder à une pensée différente de la mienne, il n’y a pas d’autre solution que de lire une traduction. Il n’y a pas de question à se poser sur le statut du traducteur, qui a le même contrat, le même statut que celui d’auteur. Heureusement, il est beaucoup plus courant aujourd’hui de voir le nom du traducteur ou de la traductrice sur la couverture. Cette reconnaissance est vraiment à l’œuvre. C’est plus qu’une victoire, c’est rendre à ces gens ce qui leur revient naturellement.
Ce sont eux qui vous proposent des projets ? Il y a des traducteurs qui arrivent avec un projet en nous disant qu’ils ont le sentiment que notre maison peut l’accueillir. On peut, dans l’autre sens, solliciter un traducteur pour un texte. On a aussi proposé à certains leur première traduction, comme ce fut le cas avec Michelle Ortuno, qui a traduit La Véritable Histoire de Matías Bran puis Baby Spot d’Isabel Alba, deux traductions saluées, et dernièrement Tea Rooms , de Luisa Carnés, qui a reçu le prix Mémorable. Au-delà de ça, on réfléchit aussi aux traductions qui nous ont été proposées jusqu’à aujourd’hui, et qu’il serait peutêtre important de revoir. C’est en tout cas ce qui nous vient en tête quand on lit Noémie Grunenwald dans son essai Sur les bouts de la langue. Traduire en féministe/s, paru dans la collection « Contrebande ».
Pourtant, je suppose qu’entre les droits et la traduction, publier de la littérature étrangère revient cher. Est-ce que ce n’est pas risqué économiquement ?
Je ne sais pas faire autre chose. D’ailleurs, on ne se pose jamais la question de savoir si un texte que l’on publie a eu du succès dans son pays. C’est juste qu’il correspond à une histoire qu’on a envie d’accompagner, et qu’on se dit qu’on a la capacité de le faire. On arrive, même sur des réceptions très tendues, à maintenir une sorte de « pacte ». Comme
35
pour Alfons Cervera : on a décidé de traduire tout un cycle qui se finira avec le prochain livre, le cinquième que l’on publiera. Mais c’est parfois un vrai casse-tête. Il y a des années où l’on traduit moins. Il y a des gens que l’on aimerait traduire davantage. Des gens qu’on aurait aimé traduire.
Pourquoi ne pas publier des œuvres ou des auteurs du passé ? Encore une fois, on fait avec ce qu’on est… Quand ça arrive, c’est parce que ces textes répondent à ce que l’on est en train de développer au sein du catalogue. Luisa Carnés, une écrivaine espagnole du XXe siècle, fait un peu figure de grande sœur pour des auteurs et autrices du catalogue. Quand on est allés en Espagne pour discuter avec la maison qui a publié la traduction de La femme brouillon d’Amandine Dhée, on nous a parlé de Luisa Carnés, une voix qui était en train de réapparaître là-bas.
Pour nous, c’était comme une sorte de perspective historique des œuvres de Sophie G. Lucas, Amandine Dhée, Irma Pelatan, Lou Darsan, Nathalie Yot. C’est un plaisir de se déplacer, d’aller voir des maisons d’édition et des librairies à l’étranger, ça met les catalogues en perspective. C’est un peu notre façon de travailler les sessions et acquisitions de droits.
Vous avez aussi découvert des auteurs français, comme Amandine Dhée, Thomas Giraud, Lou Darsan, dont vous avez publié les premiers livres. Est-ce que c’est différent que de faire connaître des auteurs étrangers ?
Pour nous, c’est la même chose que de découvrir un auteur ou une autrice étrangère. Ça matérialise le sens de cette maison. Si on s’inscrit dans le champ de la littérature contemporaine, ça sous-entend que l’on peut contribuer à cette histoire-là, en essayant d’identifier des textes et des auteurs et autrices qui font sens dans notre catalogue. Pour ma part, j’aime bien me déplacer pour écouter des lectures. C’est comme ça que je travaille le mieux. J’essaye d’aller au contact autant que possible pour m’exposer à des propositions. Amandine Dhée, je l’ai rencontrée en assistant à une de ses lectures. À l’époque, elle participait souvent à des séances de slam, de spoken word… Quelqu’un m’avait conseillé d’aller la voir… Effectivement, j’ai pris une claque ! Ensuite, on a organisé une manifestation où plusieurs auteurs et autrices étaient invités à lire. Ça m’a plu de voir Amandine sur scène et le public se faire happer par ses histoires. Puis on a avancé sur un livre, Du bulgom et des hommes, une sorte de roman de la ville, pour voir comment ces textes « tenaient » le papier. Depuis, on a développé une relation que je trouve géniale. On a travaillé sur des résidences
ensemble, on a répondu à des appels d’offres… Elle participe à beaucoup de lectures, à des ateliers. En janvier 2023, pour nos 15 ans, nous publierons son huitième texte. C’est une autrice qui a largement contribué à faire évoluer mon regard sur les choses. Elle a aussi joué un rôle attractif pour beaucoup d’autrices et d’auteurs.
Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits ? J’ai une boîte mail dédiée à ça. Je lis beaucoup en me déplaçant, sur ma tablette. En moyenne, on reçoit cinq textes par jour. J’arrive très vite à écarter certains d’entre eux. Parfois, on se demande pourquoi on nous les envoie… Ensuite, il y a ceux qui m’interpellent et que je range pour les lire plus tard. Et puis il y a ceux qui me happent immédiatement, comme c’est arrivé avec celui de Thomas Giraud. Pour le coup, son texte est arrivé via la boîte postale. J’ai commencé à le lire en revenant de la Poste. C’est toujours pareil… Il y a des journées où on ne sait pas comment on va s’en sortir, tellement il y a de choses à faire, et puis arrive ce truc qui va tout chambouler. Je me souviens d’être arrivé au bureau, d’avoir essayé de travailler puis d’être retourné sur ce manuscrit, d’avoir écrit tout de suite à Thomas, pour lui demander de m’accorder un peu de temps pour lire le texte. Et finalement, je suis allé le voir à Nantes. Il y a ce trouble d’un texte qui nous parvient, que l’on va publier et qui donnera un sens dingue à notre existence. Cette surprise, tout d’un coup, d’un auteur, d’un texte. J’ai envie de vieillir d’un an tout de suite pour le voir paraître !
Comment est-ce que vous établissez votre programme de parutions ?
Ce qui est précieux, pour comprendre comment je vais avancer sur une période donnée, c’est de voir la façon dont les titres se « portent » les uns les autres. Comment ils se donnent la main. C’est comme si chaque texte profitait du précédent. Il doit y avoir un sentiment commun, porteur d’un souffle. Je suis convaincu qu’il existe le bon moment pour un texte. Un moment pour nous, dans le temps de l’appréhender. Et un bon moment pour l’auteur ou l’autrice. Tout cela doit pouvoir s’articuler. C’est à mon sens souvent la clef d’un bon programme. Je repense à Lou Darsan. Deux mois avant la parution, en août 2020, de L’Arrachée belle, son premier texte, il a déjà fallu le réimprimer… Tout était réuni pour ce texte : la temporalité pour le lire et l’appréhender, le climat, l’attente… On avait repensé tout le calendrier à ce moment-là, en dessinant une ligne de force entre Amandine Dhée, Perrine Le Querrec, Clara Dupuis-Morency, jusqu’à Lou Darsan, comme s’il y avait un passage de relais.
36
a reçu le prix Mémorable en 2021. L’intérêt pour la traduction se manifeste aussi à travers la collection « Contrebande », qui donne la parole aux traducteurs et traductrices, comme Noémie Grunenwald. Son essai Sur les bouts de la langue. Traduire en féministe/s (2021) est lui-même en cours de traduction au Danemark.
Comment est-ce que vous travaillez sur les textes ? Vous échangez beaucoup ? Ça varie. Que je fasse trois annotations ou plus, c’est toujours la même histoire : c’est un jeu de miroirs. Avant de choisir et de travailler un texte, je me demande si je l’ai bien compris, bien cerné, sans quoi on ne pourra pas dialoguer avec l’auteur ou l’autrice, et je risque de vouloir emmener l’histoire ailleurs que là où elle est censée être. Or c’est à moi de me déplacer vers l’histoire. Vers ce qu’a proposé l’auteur ou l’autrice. Si on trouve cet axe, on va pouvoir discuter du texte, et mes remarques seront bien orientées. Et puis c’est une histoire de confiance. Dès qu’on a cette confiance, on peut parler librement. Il faut aussi qu’on ait du temps pour travailler. Il peut y avoir des incompréhensions, des points de crispation à un moment donné, qui se dissipent un ou deux mois après. Pas seulement parce que du temps a passé, mais parce qu’on a pu régler d’autres problèmes entre-temps. Plus on est au contact du texte, plus on s’en imprègne. J’aime faire plusieurs lectures, mais aussi voir les premières relectures extérieures, pour profiter d’autres regards sur le texte. En fonction du texte et des problèmes rencontrés, d’ailleurs, on peut choisir de le présenter à telle ou telle relectrice, en première ou en deuxième relecture, après nous. Quand on a fait tout ça, ce n’est pas fini. Il ne suffit pas d’imprimer le texte ! Arrive le moment où on le met en pages, où il commence à prendre forme, à exister. En le relisant à nouveau, d’autres choses vont nous sauter aux yeux, que l’on n’aura pas vues à l’écran. C’est pour ça que plus on accélère le rythme, en cédant parfois à une sorte de pression, moins on s’accorde de temps pour échanger. Il faut beaucoup de monde pour faire un livre. Il y a aussi beaucoup de chances de le rater. Le facteur temps, c’est un allié tant pour nous que pour l’auteur ou l’autrice.
Si la maison publie beaucoup de traductions, elle s’emploie également à vendre les droits de ses livres à l’étranger, comme Rouge pute au Japon, Des lions comme des danseuses en Allemagne, Traduire ou perdre pied en Argentine ou La femme brouillon en Espagne.




Photo : La Contre Allée.
Quels sont, en moyenne, les tirages, les mises en place ?
Avec notre diffuseur, nous travaillons sur un volume de 400 à 600 libraires environ par parution. Pour certains titres, ça va aller au-delà, pour d’autres ce sera moins. Les mises en place en librairie varient en fonction de plusieurs facteurs, comme le genre, la renommée, l’historique des ventes, etc. Le Pion , paru à la rentrée, on était à 1 400, ce qui, pour nous, est bien pour un titre en littérature étrangère. Les scénarios par titre évoluent, mais la méthode reste la même. Nous travaillons avec Aline Connabel, une chargée de relation libraires. Nous regardons de quoi il est question dans chaque ouvrage et nous établissons un panel de libraires sensibles aux thématiques
 Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,
Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,
37
abordées, en évitant de sursolliciter les mêmes libraires pour chaque titre. Comme ça, quand le représentant arrive en librairie avec son catalogue d’éditeurs, le ou la libraire a peut-être déjà reçu un service de presse et s’est intéressé au texte. Ces efforts vont nous permettre d’avoir, plus qu’une mise en place élevée, une mise en place de qualité, qui se transformera peut-être en un bon réassort. Avoir une bonne mise en place me permet d’amortir assez vite les coûts de production. Ça me facilite la vie. Mais ce qui me rassure, c’est de voir de nouvelles commandes arriver dans le mois suivant la parution. J’ai l’impression que l’on fait le commerce du livre dans le bon sens. Plutôt que de râler sur le fait que les libraires ne prêtent pas attention à nos textes, nous réfléchissons en amont à qui nous les envoyons. Quand une personne a l’habitude de recevoir certains de nos livres, elle se dit qu’il doit y avoir une bonne raison cette fois encore, que ça va l’intéresser. La visibilité en librairie, c’est important. Mais c’est surtout d’être visible là où on estime qu’il faut l’être.
Comment concilier exigence littéraire et considérations économiques ?
C’est indissociable. Il faut parvenir à résoudre cette équation entre la charge culturelle et symbolique du livre, et l’aspect économique, la « marchandise » qui circule. Mon action sur le symbolique, c’est le travail éditorial. Mon action sur le produit culturel, la marchandise, c’est la médiation et la réflexion sur la diffusion.
Ce travail d’accompagnement du texte fait partie intégrante du métier d’éditeur ?
Je ne peux pas dissocier le travail éditorial de la médiation autour d’un texte. Dès que je choisis un
texte, je réfléchis à la façon dont on va organiser le discours pour l’accompagner. Si j’attends qu’il arrive en librairie pour me poser la question, ça ne peut pas marcher. Parce que rien n’aura été pensé pour accompagner le libraire dans cette histoire un peu folle qui consiste à convaincre quelqu’un d’acheter un livre dont il n’a jamais entendu parler, par exemple L’Arbre de colère, le premier roman de Guillaume Aubin. Il faut essayer de transformer ce texte en objet de désir et de faire en sorte que les gens ressentent un besoin de le lire. Une fois qu’ils ont lu ce texte, l’auteur s’inscrit dans leur paysage. Possiblement, il élargit leur horizon. Pour avoir une chance que cette fiction devienne réalité, la réflexion sur la médiation et sur la diffusion est tout de suite à l’œuvre.
Vous organisez aussi beaucoup de rencontres, notamment des lectures musicales…

Les auteurs et autrices de la maison aiment beaucoup cette forme des lectures musicales. Certaines écritures ont évolué grâce à ces lectures, à cette confrontation immédiate au public. Et puis, il ne faut pas le négliger, c’est rémunérateur pour les auteurs et les autrices, et cela génère des droits pour la maison. Les gens que l’on publie ont en commun d’aimer le dialogue. Ils ont des convictions et les défendent. Ils ne vont pas en librairie pour faire l’apologie de leur livre, mais pour échanger, pour débattre. On finance beaucoup de déplacements d’auteurs et d’autrices, y compris de l’étranger. C’est très prescripteur. On voit vraiment que quelque chose se passe quand la rencontre opère. On a aussi vu des choses déterminantes suivre une lecture musicale pour certaines personnes du catalogue. C’est précieux, parce que ça crée une histoire sur laquelle on va s’appuyer pour la suite. Il y a toujours un moment où la lumière se fait sur un auteur ou une autrice.
Est-ce que la hausse du prix du papier et des coûts d’impression a un gros impact sur vous ?
Le premier tirage de L’Arbre de colère a été imprimé en offset en octobre 2021, avec un dos collé cousu. Ça a toujours été cher, mais jusqu’alors, les coûts restaient maîtrisables. Au moment de réimprimer, en février 2022… on devient fou ! Pour la première fois, on a imprimé le bloc intérieur en numérique. Il y avait un smic entre l’impression offset et numérique… Forcément, on s’interroge… On s’est dit qu’il y avait quelque chose qui devenait incohérent, même par rapport au prix de vente. On a toujours voulu imprimer en France. On a aussi toujours cherché à privilégier l’origine des papiers. On n’a pas encore changé de papier. Par contre, on vient d’apprendre que les pôles de production qui
38
Thomas Giraud lit des passages de La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank accompagné de Stéphane Louvain lors des Cafés littéraires de Montélimar, en 2017. Photo : Nathalie Yot.
fabriquent le vergé Conquéror de nos couvertures viennent de fermer. Je ne sais pas si on va devoir en changer. Ce serait comme changer de peau. Le coût de fabrication pose un vrai dilemme pour demain. Beaucoup de textes ont une vie entre 800 et 2 000 exemplaires. Alors que le coût le plus élevé, en fabrication, c’est le premier 1 000. Et quand on réimprime, en général, ce sont de plus petites quantités. Comment on fait pour tenir par rapport à ça ? On peut augmenter les prix de vente. Néanmoins, ça ne compensera jamais cette hausse des coûts. Je pense que ça va rendre certains choix difficiles.
À partir de quand est-ce que vous considérez qu’un livre s’est bien vendu ?
Le titre qui s’est peut-être le mieux vendu, c’est La femme brouillon d’Amandine Dhée. Grand format et poche compris, on est aux alentours de 25, 30 000 exemplaires. À mains nues, de la même autrice, pas loin des 10 000 exemplaires en grand format. L’Arbre de colère, un premier roman paru en janvier 2022, on arrive à 5 000 exemplaires, on en est à la cinquième impression, il y aura aussi un poche… De mon point de vue, on a fait quelque chose de réussi avec ce titre. En poésie, au-delà de 1 000 exemplaires, on considère que c’est réussi. Mais il nous faut un peu de temps pour y arriver. Après, c’est tout l’intérêt de la poésie. Dire que la poésie ne se vend pas, ce serait mentir. C’est juste que ça se vend différemment, c’est une autre temporalité, une autre façon d’agir aussi : il faut que les auteurs occupent le terrain, parce que c’est souvent la lecture en public qui génère l’acte d’achat. Sinon, quand on arrive autour de 2 000 exemplaires pour un texte, on considère qu’on a franchi un cap. Entre 2 000 et 3 000, on se demande ce qui l’empêche d’aller plus loin… Il y a le bouche-à-oreille qui se met en place. On voit que d’autres cercles peuvent s’ouvrir… C’est pour ça que l’on porte une telle attention à la librairie indépendante : parce que notre histoire se fait là, sur le conseil du libraire.
Est-ce que le fait d’être installé à Lille constitue un handicap ?
Il ne faut en aucun cas que nos auteurs et autrices pâtissent du fait que nous ne soyons pas à Paris. Par exemple, quand « La Grande Librairie » nous appelle un vendredi à 13 h pour nous demander de fournir dix exemplaires d’un livre pour 15 h, il faut qu’on puisse le faire. Si on ne répond pas à ce genre de demande, c’est perdu. C’est fonctionner au rabais. On s’est organisés de manière à être réactifs. Ça veut dire par exemple qu’on a un petit stock d’appoint à Paris, au cas où. Non, on n’est pas à Paris, mais ce n’est pas grave.
Être éditeur indépendant en province n’est pas un frein dans la course aux prix ?
Je me souviens avoir lu à propos d’Hubert Nyssen quand il a fondé Actes Sud qu’on lui prédisait qu’il ne se passerait rien pour lui, sur ce point-là… Je ne sais pas s’il se passera quelque chose pour nous. Et puis les temps changent, aussi. En tout cas, je ne m’interdis rien. Si je dis qu’on n’a aucune chance d’obtenir ce genre de reconnaissance, ça sous-entend que les gens que l’on accompagne n’ont aucune chance d’y prétendre. Si c’était le cas, je ferais peut-être mieux de changer de domaine éditorial… Dans tous les cas, les prix, sans en faire une fixation, on y travaille très sérieusement. On essaye de répondre aux interrogations qui pourraient être soulevées, par rapport à notre capacité à réagir, à suivre. C’est ce paysage-là que je consolide aujourd’hui. Cette année, L’Engravement d’Eva Kavian figurait sur la dernière liste du prix Wepler et du Rossel, que l’on a coutume d’appeler le Goncourt belge. Il n’y a pas de petits ou de mauvais prix. Maintenant, je ne publie pas un texte en fonction d’un prix, mais je peux penser à un prix à propos d’un texte que l’on va publier.
Vous avez publié votre 100e nouveauté en 2022 et vous vous apprêtez à fêter les 15 ans de la maison en 2023 avec la parution des nouveaux livres de Lou Darsan et d’Amandine Dhée. Que représente cette étape ? Aujourd’hui, s’il y a un intérêt à ces 15 ans, c’est le fait qu’on soit toujours là. Je suis le premier surpris. Peut-être que ça joue un peu dans l’esprit des gens… En parlant des prix : cette année, nous avons figuré dans plusieurs sélections dans lesquelles nous n’avions jamais été retenus. Est-ce que cela veut dire que l’on avance ? Qu’une forme de reconnaissance est à l’œuvre ? Je pense que nous avons aussi la confiance des libraires qui portent une vraie attention au catalogue. Quinze ans, c’est jeune dans l’histoire d’une maison. Cela étant, on reste quand même sur une tension permanente. On a lancé cette maison sans réel apport financier. J’avais un autre « capital » : mes relations dans le champ artistique, une compréhension du montage économique, etc. Ça a longtemps été fragile. L’année des 10 ans a été particulièrement difficile, avec un changement de diffuseur-distributeur. Les 15 ans sont là pour témoigner qu’on a réussi quelques petites choses. Quand même. lacontreallee.com
39
VIE MAJUSCULE
 Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien
Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien
EST LA RÉALITÉ D’UN SEUL INDIVIDU. […] UNE ÉQUATION À UN MILLIARD D’INCONNUES ET AUTANT DE VARIABLES. »
DANS LE CŒUR NE CÈDE PAS, GRÉGOIRE BOUILLIER TENTE DE PERCER LE MYSTÈRE D’UNE FEMME QUI S’EST LAISSÉE MOURIR DE FAIM ET
QUI A ÉCRIT LE JOURNAL DE SON AGONIE. L’AUTEUR DU MONUMENTAL DOSSIER M LIVRE UNE FOLLE ENQUÊTE LITTÉRAIRE QUI L’AMÈNE À SUIVRE TOUTES LES PISTES IMAGINABLES.
À quel moment, pendant que vous meniez vos recherches, avez-vous décidé d’écrire un livre sur Marcelle Pichon ?
Dès le départ. Dès que j’ai eu connaissance de l’émission de France Culture que j’avais entendue dans les années 1980 et où il était question de ce fait divers. Il m’était resté dans un coin de la tête et lorsque j’ai découvert le nom de Marcelle Pichon, l’adresse où elle s’était laissée mourir de faim, la date exacte, cela a été un déclic. Je me suis mis à consulter frénétiquement les archives et la presse afin de recueillir un maximum d’informations. L’écrivain en moi a su tout de suite que cette histoire allait fournir la matière d’un livre. Quel livre ? Ça, je ne le savais pas… Au début, je voulais retrouver le journal d’agonie de Marcelle, avec l’idée de le publier tel quel. J’aurais ajouté une préface, pour contextualiser ce document qui, selon moi, présentait un véritable intérêt littéraire. Le problème, c’était de retrouver ce journal d’agonie et, peu à peu, je me suis pris au jeu de la recherche. Pendant un an et demi, j’ai cherché tout ce que je pouvais sur Marcelle, jusqu’à ce que je retrouve ses petits-enfants et que je reçoive le mail de la petite-fille m’interdisant d’écrire sur sa grandmère. C’est en lisant ce mail que je me suis dit qu’il pouvait devenir le début du livre. Parce qu’il posait de véritables enjeux littéraires sur ce qu’il est possible ou non d’écrire. En même temps, cela faisait un an et demi que je faisais des recherches et il était temps que je me mette à écrire, parce que je pouvais continuer d’enquêter indéfiniment tellement cette histoire était inépuisable. À partir de là, j’ai raconté l’histoire en reprenant tout depuis le début, de façon chronologique. Et quand le moment de l’écriture a rejoint celui où j’en étais de mes recherches, c’est le livre qui a conduit l’enquête, m’obligeant à faire de nouvelles recherches. Tout le livre s’est donc écrit comme une espèce de work in progress
Il y a énormément de « peut-être » et de phrases interrogatives dans le premier tiers du livre… Moins ensuite.
Au départ, je ne savais rien de Marcelle. Je n’avais que des questions. Pourquoi s’était-elle tuée de cette façon ? Pourquoi écrire le journal de son agonie ?
Qui était-elle ? etc. En fait, la moindre information que je dénichais suscitait plein d’hypothèses. Par exemple, Marcelle s’est mariée en octobre 1940, mais qui se mariait en octobre 1940, alors que les Allemands occupaient Paris ? Et puis j’ai découvert qu’elle était enceinte de sept mois au moment de convoler. Pourquoi ? D’un côté, j’avais toujours plus de questions mais, de l’autre j’obtenais des réponses et, petit à petit, l’étau s’est resserré sur l’essentiel. Il y a un exergue qui dit « Comme une guitare dans une peinture cubiste ». Eh bien, Marcelle était comme cette guitare ! Sachant qu’il y a très peu de choses sur elle. Sa mort est spectaculaire, mais sa vie est complètement anonyme et, du reste, cela m’a plu de consacrer 900 pages à une « vie minuscule », au sens de Pierre Michon. Car Marcelle n’a rien laissé. Hormis son journal, quelques photos, quelques dates, je n’avais que des trous, des blancs, qu’il fallait que je parvienne à combler. La solution est venue de l’arbre de la connaissance tel que Diderot et d’Alembert l’ont défini. Plutôt que de s’en remettre à Dieu pour avoir des réponses, ils établissent que le savoir repose sur trois facultés humaines : la raison, la mémoire et… l’imagination ! Je me suis donc servi de ces trois facultés. Par exemple, que faisait Marcelle dans les années 1970 alors que, deux fois divorcée, elle allait sur ses 50 ans et se retrouvait seule ? Je me suis alors souvenu du film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, sorti en 1975. J’ai trouvé dans ce film toute la matière pour imaginer le quotidien de Marcelle à cette époque de sa vie. C’était mieux que rien. En fait, c’était génial. L’art permet d’élucider la réalité.
« INSAISISSABLE
41
Pour contourner « l’interdiction » d’écrire, vous avez créé une agence de détectives fictive chargée de mener l’enquête pour un client nommé Grégoire Bouillier. Comment avez-vous eu cette idée ? Les choses se sont passées comme je les raconte dans le livre. Après avoir reçu le mail de la petitefille de Marcelle, il fallait que je contourne l’interdit qui m’était fait d’écrire ce que je voulais – une première pour moi ! C’est devenu un enjeu du livre. Pour moi, la vérité est importante. Je veux bien croire que la vérité n’existe pas, mais c’est quelque chose que l’on peut dire seulement si on a tout fait pour la découvrir. Ce ne peut pas être un postulat de départ car, dans ce cas, c’est la porte ouverte à l’impunité du mensonge. Le problème, c’est que j’avais cet interdit. J’ai donc inventé un dispositif fictionnel, avec un détective (Bmore) et son assistante (Penny), qui sont des personnages totalement inventés. Ce sont eux qui enquêtent sur Marcelle Pichon. C’est-à-dire que, pour une fois, la liberté de créer est au service de la vérité et, inversement, la vérité se déploie à l’intérieur de la liberté de créer. C’est quelque chose que je n’avais jamais expérimenté et j’ai adoré faire ça. Finalement, cet interdit de départ s’est transformé en aubaine littéraire. Tout ce que découvrent Bmore et Penny est vrai. Ils ne falsifient rien. Il n’y a aucune triche. Alors que, eux, sont totalement imaginaires.
En vous lisant, on a l’impression que, paradoxalement, c’est la littérature qui permet de s’approcher le plus de la réalité, de la cerner dans toute sa complexité, au contraire de la presse qui a rapporté ce fait divers.
La réalité est tissée de fictions. Le capitalisme est un récit, par exemple. Dans le cas de Marcelle Pichon, la presse ne s’est pas contentée de rapporter qu’une femme de 64 ans s’était laissée mourir de faim en écrivant le journal de son agonie. Non. Il a fallu qu’elle l’enrobe d’un récit. C’est ce que font toujours les médias : ils donnent une information, mais avec son mode d’emploi, avec ce qu’il convient d’en penser. Dans le cas de Marcelle, une seule chose a intéressé la presse et la télévision : le fait qu’on ait découvert son corps dix mois plus tard. Marcelle est ainsi devenue l’emblème de l’indifférence dans les grandes villes. Ce fait divers est tout de suite devenu synonyme d’un fait de société. Ce qui n’est pas totalement faux. Le problème, c’est que tous les médias sans exception ont mis l’accent sur cet aspect et uniquement sur cet aspect. Pour eux, le fait qu’une ancienne mannequin se laisse mourir de faim et qu’elle écrive son agonie pendant 45 jours : aucun intérêt ! Pas un journal ne met l’accent sur le fait humain. Alors que c’est ce qui, moi, m’a tout de suite interrogé. Contester les récits que met en place la société, c’est aussi ça la littérature.
Le journal de Marcelle semble vous fasciner. Quel est son statut ? Est-ce qu’on peut le considérer comme une œuvre littéraire ?
Ce journal d’agonie m’a immédiatement fasciné. Pour moi, il s’agissait d’un document littéraire exceptionnel. Ce pourquoi j’ai tout fait pour le retrouver. Mais ce n’est qu’à la fin que j’ai compris son véritable statut. À savoir qu’il s’agit d’une œuvre qui a quelque chose à voir avec l’art brut. Lorsqu’elle écrit son agonie, Marcelle ne cherche pas à faire une œuvre littéraire. Elle se fiche d’être lue, elle écrit uniquement pour elle, face à sa folie autodestructrice et à son martyre. Son texte tire sa force de cette autarcie absolue. Et aussi du fait que, lorsqu’on le lit, on sait qu’il a été écrit par une femme qui s’est réellement laissée mourir de faim. Il tire donc son prestige de son hors-champ. Moi, je suis écrivain, c’est-à-dire que mon livre s’inscrit dans une histoire littéraire, il travaille l’ordre social du langage, les limites de la narration, etc. Le lecteur n’a pas besoin de savoir qui je suis car mon livre tient debout tout seul. Ce qui n’est pas le cas du journal de Marcelle. Et c’est précisément ce qui, pour moi, en fait le véritable intérêt : il se situe dans la zone négative de la littérature et, en ce sens, il interroge ma pratique d’écrivain. Il est un texte « fou » que je ne pourrais jamais écrire. D’où ma fascination !
Chaque chapitre s’ouvre sur une citation, sachant que le livre en comporte 99… Zola y côtoie Le Club des cinq. Comment faites-vous pour les choisir ? Quand je lis ou que j’entends une phrase qui m’interpelle, je la note. Ce peut être une phrase dans un livre, une réplique dans une série télé, un vers dans une chanson, peu importe… Je la note dans un carnet, avec la référence, la date. J’ai comme ça une sorte de stock. Au moment de trouver les 99 exergues, certaines phrases me sont revenues, naturellement. D’autres, je suis allé les chercher, en fonction du chapitre, mais aussi de l’exergue du chapitre précédent, afin de ménager des effets, des surprises. C’est comme un jeu avec le lecteur, une narration parallèle. Parfois, c’est la citation elle-même qui m’intéresse, parce qu’elle est profonde ; mais parfois, c’est l’auteur ; et parfois, c’est le livre d’où est tirée la phrase. Par exemple, si je cite Wittgenstein, je m’arrange pour citer au chapitre suivant Oui-Oui et le train de Miniville. C’est une façon de ne pas me prendre trop au sérieux. Et, en même temps, c’est très sérieux. Comme le sont tous les jeux. Ou les mathématiques. Ce qui compte, c’est que les citations s’enchaînent parfaitement les unes à la suite des autres et qu’elles produisent quelque chose d’intéressant, que ce soit pour faire réfléchir ou pour faire sourire. En général, les exergues des livres sont toujours hyper sérieux, hyper profonds ! Or, la culture d’un
42
individu est autant faite de grands auteurs que de séries télé ou de chansons débiles. C’est tout ça, la culture. Je tiens beaucoup à cette idée.
Qu’est-ce qui vous plaît tant dans les hasards, les coïncidences, les signes qui, en permettant des rapprochements, des analogies, des coq-à-l’âne, font souvent progresser l’enquête ?
Ce qui m’intéresse dans les hasards plus ou moins objectifs, c’est qu’ils déjouent l’ordre établi. Les coïncidences produisent des étincelles qui, d’un seul coup, jettent une nouvelle lumière, éclairent de façon insoupçonnée les êtres et les choses. Voici qu’on n’est plus sur des rails. Pour moi, les coïncidences, c’est le surgissement de la poésie dans l’ordre de la réalité.
Qu’est-ce qui vous a le plus exalté : l’enquête, l’écriture, l’histoire de Marcelle ?
Tout. Le fait divers m’a halluciné, le journal de Marcelle m’a fasciné, l’enquête m’a passionné et écrire le livre m’a mis dans un pur état de jubilation. Toute cette histoire m’a rendu dingue, en fait. Pour moi, écrire, c’est entrer dans un temps et dans un espace qui n’ont rien à voir avec le temps et l’espace social. Ma vie devient intense, tout à coup. C’est comme une effervescence, un excès de vitalité. Tandis que j’écris, la vie quotidienne, les factures EDF, le bordel ambiant, tout cela passe au second plan. Je continue de payer mes factures, mais ce n’est plus si important. J’ai mieux à faire. Proust parle des livres comme de « comprimés de vie ». C’est exactement ça ! Écrire a pour moi quelque chose d’existentiel. C’est comme tomber amoureux : tout devient intense, je deviens hyper concentré, hyper vivant. Et cela dure tant que dure le livre, jusqu’au moment où l’histoire se résout et, d’un coup, c’est fini. Il se trouve qu’il m’a fallu 900 pages pour élucider le suicide par inanition de Marcelle – car Bmore et Penny élucident ce qui s’est passé rue Championnet ! –, mais cela aurait pu être au bout de 300 ou de 1 500 pages. Ce n’est pas moi qui décide. Pas seulement moi.
Comme pour Le Dossier M, vous avez publié de nombreux documents sur un site Internet dédié au livre. Pourquoi ?
J’ai toujours ce souci de vérité. Cela m’embête que les gens se demandent si ce que je raconte est vrai ou pas. Alors que oui, tout est vrai en ce qui concerne Marcelle. Quand j’ai découvert ses actes de décès et de naissance, je me suis dit que j’allais les publier sur un site, comme des preuves. Puis j’ai mis des photos, des articles, des vidéos… Tout est là. J’aime bien ce côté bureau des greffes, le côté making of. Je crois que j’ai aussi le sentiment que l’objet livre ne suffit pas, qu’il gagne à investir d’autres supports. De toute façon, rien ne suffit jamais.
On retrouve aussi l’adresse mail de Penny et Bmore à la fin du livre. Il y a beaucoup de gens qui vous écrivent ?
Je ne sais pas ce que veut dire beaucoup mais, oui, la Bmore & Investigations reçoit pas mal de mails. La plupart pour dire des choses super gentilles, mais certains pour m’apporter des informations ou pour me poser des questions. Du côté de Bommiers, après le reportage d’une journaliste du Berry républicain, j’ai appris que des gens menaient l’enquête pour retrouver la maison où habitaient les arrièregrands-parents de Marcelle. D’autres me livrent leurs propres hypothèses sur tel ou tel aspect de sa vie. Il y a plein de trucs comme ça, qui font que le livre continue de vivre sa vie en dehors de moi et cela me ravit. À tous ces mails, ce n’est pas moi qui réponds : c’est Penny ou Bmore. Il s’agit de jouer le jeu jusqu’au bout. En fait, c’est presque toujours Penny. D’ailleurs, ça la fait râler, comme si le fait qu’elle soit une fille signifiait qu’elle devait être secrétaire… Là où les choses deviennent cocasses, c’est qu’il lui arrive d’ajouter un P.-S. qui dit : « Heu, ne trouvez-vous pas bizarre de correspondre avec un personnage de fiction ? » Que la fiction s’incarne dans la réalité, je trouve cela de bonne guerre ! D’ailleurs, les lecteurs jouent totalement le jeu : ils écrivent à Penny et à Bmore, pas à Grégoire Bouillier, ce qui me va très bien. En fait, ils écrivent surtout à Penny. Elle a beaucoup de succès.
Au début du Cœur ne cède pas , vous évoquez la période de dépression que vous avez connue après avoir écrit Le Dossier M. Comment vous sentezvous à présent, après la parution de ce livre ? Comme Le cœur ne cède pas est moitié moins gros que Le Dossier M , on va dire que je suis moitié moins en dépression post-partum (rires). En fait, le livre marche plutôt bien, il s’est retrouvé sur les listes de prix et tout ça crée une agitation qui m’occupe et qui tient à distance le moment où je me retrouverai confronté au désœuvrement sans pouvoir y échapper. Mais pour l’instant, tout va bien. Je fais des rencontres en librairie un peu partout en France, je réponds aux mails qu’on envoie à la Bmore & Investigations et comme je participe au Goncourt des détenus, je vais aussi dans des maisons d’arrêt et ça, c’est très fort, humainement parlant. Cela m’évite de me poser la question de l’après. Mais cette question va me rattraper. Je le sais. C’est comme ça.
— LE CŒUR NE CÈDE PAS, Grégoire Bouillier, Éditions Flammarion
Pour signer la pétition contre la pratique du micro-trottoir dans les journaux télévisés : www.lecoeurnecedepas.fr
43
BLUTCH, ÉLAN D’AMOUR
CHEZ L’ÉDITEUR STRASBOURGEOIS 2024, BLUTCH PUBLIE UN ALBUM SOMPTUEUX, LA MER À BOIRE : UN RÉCIT ONIRIQUE QUI ACCORDE GRANDEMENT SA PART AU DÉSIR.
Revenons au projet initial de La Mer à boire. Tu comptais publier un livre érotique si je me souviens bien.
Oui effectivement, au départ je voulais faire un livre résolument érotique, mais j’en suis incapable. Ça fait plusieurs fois que je tourne autour d’un genre que je n’arrive pas à aborder frontalement.
Qu’est-ce qui t’en empêche ?
En fait, si je fais une bande dessinée érotique comme je l’imagine, j’ai peur de devenir trop primaire et de ne pas en dire assez. Mais surtout, je n’ai jamais trouvé la bonne idée. Tu vois, un peu comme Manara avec Le Déclic. Il avait trouvé une idée toute simple. C’est enlevé, c’est drôle et excitant. De fait, j’ai des scrupules et je rencontre un problème de représentation : à quelle distance puis-je me mettre ? Cela non plus, je n’ai pas réussi à le déterminer. L’érotisme nécessite cette distance : on doit se situer plus ou moins près, s’approcher du sujet ou s’en éloigner, mais en fonction de tes choix ça devient autre chose. Pour aller vite, disons que ça peut devenir de la pornographie. Ce sont autant de paramètres sur lesquels je n’arrive pas à me décider. Après, peut-être ai-je eu peur d’être catalogué ?
Cela ne t’empêche pas de t’exposer de manière très surprenante ? Oui, j’avais un but : dessiner des choses que je ne dessine jamais ; sans doute par goût pour la transgression ou l’exploration, aller dans des endroits où d’autres ne vont pas. Ces premières planches, qui correspondent à ce moment où A rentre dans la chambre et B est à poil sur le lit, je les avais envoyées à mon ami Bertrand Mandico [cinéaste, auteur notamment des Garçons Sauvages, ndlr], il m’a tout de suite dit : « Ah, c’est de l’autoérotisme ! » Ce qui était assez marrant. Du coup, j’ai répondu : « Oui, oui ! » [Rires] En réalité, j’opère un renversement. Une inversion des personnages.
Effectivement, tu exposes le personnage masculin dans sa nudité, alors que le personnage féminin l’observe.
Si on retourne aux premiers crayonnés, c’était le contraire : la femme était observée sur le lit. Et au moment de dessiner les planches finales, j’ai décidé d’inverser. Ça m’embêtait que la femme soit le sujet de l’observation, parce que je l’ai déjà fait. Et bien sûr, parce que c’est courant. Il me semblait qu’il y avait autre chose à mettre en jeu. Curieusement, il ne faut pas y voir d’impudeur. C’est la réflexion, puis le travail littéraire, qui m’a conduit à cette forme-là. Je ne voyais pas d’autre issue que cellelà : que ce soit le type qui se retrouve crucifié, nu.
Je trouve intéressant que tu aies inversé les rôles : tu romps ainsi avec cette tradition du peintre et son modèle féminin. Ici, la jeune femme se retrouve dans une position active, alors que l’homme est passif sur son divan. Oui, nous nous situons dans de la pure fiction, ce qu’on appelait un temps de la BD d’aventure – l’antiBD du réel. On ne trouve rien d’événementiel. C’est le type de séquence qui m’est apparu et qu’il me semblait indispensable de représenter. Sans
Par Emmanuel Abela (avec l’aimable contribution de Frédéric Tousch)
44

45
C’était mon lasso à moi, il fallait que je
doute parce que je me dis que ce sont des choses intimes qu’on ne voit représentées nulle part. Dans ce cas-là, je ne sais même pas si « intime » est le bon terme pour qualifier ce type d’approche. De toute façon, c’est une démarche qui nécessite d’être approfondie…
Justement, la première chose que tu m’as dite à propos de cet album, c’est que tu ne pouvais pas t’empêcher d’y voir un nouveau départ. En quoi est-ce un départ, et vers quoi ? Oui, un départ... Je voulais décrire la vie de couple en elle-même : un homme et une femme vivent ensemble, on les suit tout du long. Pour cela, j’ai imaginé plein de séquences, dont certaines ont été crayonnées et mises en place. Pour ce volume, j’imaginais un développement plus long dans le temps – je racontais des épisodes qui s’étalaient sur une vingtaine d’années. Mais ces épisodes, pas réalistes du tout, je ne les ai pas réalisés. À force de réécritures, de nouveaux développements et de personnages qui se sont rajoutés, cette introduction initialement prévue sur une dizaine de pages atteint les 40 pages. Ce qui devait ouvrir le livre déséquilibre le tout, puisque le livre ne raconte que cela : cette rencontre à Bruxelles en 2004, au cours de laquelle le couple se forme. Toutes les séquences écrites, il me faut les réaliser à présent pour que ce projet prenne de l’ampleur et qu’il soit vraiment inédit. Il faut que je continue...
Ce qui est inédit pour toi également, c’est ta propre mise en couleurs…
Oui, de colorier ma bande dessinée, c’est effectivement nouveau. Mais il faut que je poursuive. Je me suis vraiment amusé à faire cela. Même si c’est difficile, cela me procure plein de satisfactions. J’ai travaillé avec des coloristes très talentueux, mais je n’arrivais pas toujours à leur donner les bonnes indications. Tout ce que je sens, je n’arrive pas à le formuler. Sans doute parce que ça se passe de mots et que ça fonctionne au feeling. Là, j’ai pu expérimenter.
Au-delà de la couleur, je sens une implication de ta part dans l’édition même de l’ouvrage. C’est le cas notamment de ce principe qui fait que la première planche se trouve en deuxième de couverture par exemple.
Oui, ça me rappelait ces recueils comme Spirou qui débutaient parfois par une première série de planches qui correspondaient souvent sans transition à la suite d’épisodes présents dans une édition précédente. Mais là, je voulais donner l’impression au lecteur que l’histoire avait commencé avant qu’il arrive et qu’elle continue après son départ.
Ce qui sera forcément le cas puisque tu poursuis l’aventure.
Bien sûr, mais là je n’ai pas signé, je n’ai pas écrit le mot « fin ». Rien ne dit que ça s’achève. Je veux donner le sentiment au lecteur qu’il entre à l’improviste.
Le titre La Mer à boire nous indique l’idée d’une vaste entreprise.
Ce titre se veut ironique. Il vient d’un roman que j’aime beaucoup d’Henri Calet, Monsieur Paul. Il compare la vie de couple à « la mer à boire ».
Alors que l’expression fonctionne par une négation.
Oui, « ça n’est pas la mer à boire ». Mais Henri Calet dit que c’est « la mer à boire », avec tout ce qu’elle contient. Je le cite déjà dans C’était le bonheur. [« C’est la mer à boire et tous les poissons qu’elle contient et l’écume d’en haut et la boue qui est au fond et l’écume de l’amertume », ndlr] En 2020, au moment du confinement, nous étions à Fécamp. Durant cette période, comme le monde semblait disparaître, j’ai commencé à faire des dessins pour essayer de tout retenir. Retenir ce qui s’en allait... Au départ, ce projet s’intitulait La Mer à boire, réminiscences et souvenirs. Poème d’amour. À raison d’un dessin par jour, je représentais tout ce dont je me souvenais. J’ai dû en faire une centaine comme ça : des dessins à la plume, en noir et blanc. Le premier de la série était une case de Tintin qui me trottait dans la tête et que j’ai refaite de mémoire comme je n’avais pas l’album sous la main, les librairies étant fermées : une case du Trésor de Rackham le Rouge dont je n’arrivais plus à me souvenir…
De quelle case s’agit-il ? C’est une case dans laquelle le capitaine Haddock passe la barre du chalutier à Tintin alors qu’ils croisent des pêcheurs [page 15 du Trésor, ndlr]. J’avais même écrit à Bruno [Podalydès] pour lui
—
46
le tienne. —
demander s’il s’en souvenait, mais il ne la situait pas. Je l’ai redessinée d’après le souvenir que j’en avais. J’en ai tiré la conclusion que tout mon travail et par extension tout travail littéraire –, porte sur la mémoire : la mémoire de ce qu’on a vécu, mais aussi la mémoire de ce qu’on a lu ou vu.
Mais cette case te revenait ainsi ? Oui, comme dans un demi-sommeil, quelque chose qui te traverse l’esprit. Par la suite, dans cette série de dessins, j’ai placé des nus, des portraits. C’était la première mouture de ce projet : publier ces dessins.
Avec peut-être l’évocation d’une impossibilité au cours d’une période contrainte : l’immensité inquiétante de la mer comme horizon… Oui, il y a sans doute de cela. Avec ceci qui nous sauve cependant : dans ton champ de vision de la mer, il n’y a pas d’humain. Je ne me lasse pas de cela… Nous avons parlé de ce projet de publications de dessins avec 2024, mais j’ai trouvé l’approche trop plastique et je conserve, malgré tout, ce goût pour la bande dessinée, du récit et du séquençage : une suite de cases. Je reste ce mélange entre un grand classicisme et une volonté d’expérimentation ; cela crée une tension.
Ce qui est étonnant, c’est que tu avais sous-titré ce recueil « Poème d’amour » et c’est précisément ce que l’on ressent à la lecture : quelque chose de nouveau, une forme d’impulsion vitale, désirante. Les deux personnes cheminent l’une vers l’autre et finissent par se retrouver.
Au départ, j’avais imaginé un motif simple : le garçon allant de la gauche vers la droite et la fille, de la droite vers la gauche, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent. Un dispositif ténu. Mais j’avais envie de cela : à la réception de l’hôtel, on retrouve le même réceptionniste de manière inversée. Je voulais qu’ils se rencontrent, mais je repoussais à chaque fois l’échéance et j’accumulais les obstacles…
Avec un déséquilibre : le garçon semble dans une difficulté plus grande au point de se retrouver attaché, empêché.
Oui, c’est plus difficile pour moi de me mettre à la place du personnage féminin. Je suis obligé de composer. Alors que pour le type, j’avais Hergé sous le coude…
À quel endroit ?
Mais partout ! Ma première réplique dans le train, « Enfin, nous y sommes, c’est l’essentiel » est calquée sur celle de Tintin en Amérique, puis je me retrouve
attaché au poteau de torture avec le chef indien Pour moi, c’était presque de l’ordre, pour parler vulgairement, du remake. De même pour la scène de la réception, j’y rejoue Coke en stock avec ce passage à l’Hôtel Bristol où Tintin et le capitaine Haddock esquissent le portrait du général Alcazar. C’était mon lasso à moi, il fallait que je le tienne.
À cela – et c’est central dans ton œuvre – , tu rajoutes la part de rêve. Et tu poses la question de savoir qui rêve au final… Peut-être y suis-je arrivé un peu mieux : décrire des situations déraisonnables, mais les rendre acceptables pour le lecteur. Comme dans le rêve, des choses tout à fait déstructurées peuvent te sembler admissibles. De même, j’aimerais prendre le lecteur par la main et lui faire accepter des choses, sans le perdre pour autant. C’est en cela qu’Hergé me sert, sa grande simplicité, sa rigueur du récit…
Hergé, c’est aussi la quête inassouvie – on va au bout du monde chercher quelque chose qu’on a sous les yeux, on part sur la Lune ou on tourne en rond dans le désert –, non ?
Oui, mais il ne lâche pas son lecteur Chez lui, je cherche sa manière de tenir le lecteur. C’est ce que je souhaite faire, tout en étant irréaliste.
Justement, il me semble que tu y parviens merveilleusement.
Je n’ai pas de recul, je n’ai pas relu le livre et je suis dans ma phase un peu compliquée, cette sorte de baby-blues.
Le lecteur finit par arriver quelque part, même s’il s’interroge sur sa destination initiale. Justement, je n’avais pas prévu de le conduire là [rires]. J’avais vendu à 2024 un récit de traversée du Lac Léman dont on ne voyait jamais le bout – le voyage dure des années jusqu’à ce que les barbes poussent ! Mais là, il faut vraiment que je dessine, que je le fasse. Je n’ai pas épuisé le sujet et pour cela il me faut dessiner plus simplement avec moins de traits. J’ai déjà essayé de dégraisser un peu, mais ça n’est pas assez. Pour moi, la mer n’est pas seulement à boire, elle reste à faire…
— LA MER À BOIRE, Blutch, 2024
47

Contes stratifiés
Autant piste de course et ring de boxe que chemin de traverse, la scène palpite. Cet hiver, fraternités et violences, vides et tensions, apprentissages et mises en garde sont au rendez-vous. Et si certains tirent leur révérence avec élégance, le rideau ne se baisse que pour mieux se relever.
— Les histoires d’un CDN s’écrivent par passage de relais. —

PASSER LE CAP
Par Aurélie Vautrin ~ Photo : Ishaq Ali Anis
LE CDN DE BESANÇON A 50 ANS ! L’OCCASION DE FAIRE LE POINT AVEC CÉLIE PAUTHE, LA DIRECTRICE DE
L’ÉTABLISSEMENT
Quel regard portez-vous sur ces cinquante années passées ? Quand on est nommé comme moi à la tête d’un CDN, on sait que ce n’est qu’un passage. Et que les histoires elles-mêmes s’écrivent par passage de relais. Nous sommes les héritiers d’une histoire longue et emblématique de la décentralisation théâtrale, qui s’est construite par strates, et qui fait partie des plus belles pages de l’Histoire culturelle bisontine, franccomtoise, nationale ‒ voire internationale puisque le CDN s’est ouvert à des projets internationaux d’envergure à l’occasion des deux dernières grandes mandatures. Notre CDN a une histoire très singulière dans la ville : je rappelle qu’à sa création en 1972 par André Mairal, il n’avait pas vraiment de lieu, et occupait une petite boutique-théâtre sur l’île SaintPierre… Il a fallu plusieurs années d’action avant qu’il investisse l’ancien cinéma-théâtre qu’il occupe aujourd’hui, qui lui-même se transforme au fur et à mesure des années. D’ailleurs, cet anniversaire coïncide également avec la fin d’une longue phase de six mois de travaux, qui ont permis de refaire complètement le plateau, et de pouvoir mieux accueillir les personnes à mobilité réduite avec notamment l’installation d’un ascenseur dans le hall. Cet anniversaire, c’est aussi pour le public celui d’un théâtre retrouvé, un théâtre rénové et projeté vers l’avant. Qu’est-ce qui fait selon vous l’identité du CDN de Besançon ? Est-ce que cette philosophie a changé au cours des années ? Je crois que le CDN est marqué depuis son tout départ par des notions très profondes, celle d’exigence artistique, de partage du sensible… Et je dirais même de fraternité et d’hospitalité. Ce sont des mots qui lui sont profondément attachés depuis les origines, et qui sont encore parfaitement adaptés aujourd’hui. Il y a toujours eu ici un sens très profond du rayonnement, de l’accueil. J’en ai hérité moi-même. Je crois donc pouvoir dire que la philosophie du lieu n’a pas changé, car les valeurs sont toujours les mêmes… Il y a quelques années, avant d’être nommée directrice, j’étais venue jouer ici à Besançon, et je me souviens avoir été frappée par la curiosité et par le caractère extrêmement aigu de l’écoute du public bisontin, une qualité d’échanges, de discussions… Et je pense que toutes les personnes qui ont fait l’histoire du CDN, même sans y être directement associées, comme Jacques Fornier ou Jacques Vingler par exemple, toute cette constellation d’artistes, de pédagogues, de transmetteurs, ont permis la création d’amateurs de théâtre éclairés et passionnés comme j’en ai rarement rencontré ailleurs. C’est une chose très émouvante d’hériter également de cette histoire-là.
DEPUIS NEUF ANS.
Qu’avez-vous prévu pour marquer ce passage de cap ?
Une grande journée d’animations le samedi 10 décembre, avec des visites insolites et poétiques, l’inauguration de deux fresques réalisées par des artistes locales, un quizz participatif avec les spectateurs, une soirée festive… Et du théâtre évidemment, avec la présentation du chantier Comme il vous plaira de Shakespeare, sur lequel je travaille actuellement avec quinze jeunes du DEUST théâtre de l’université de Franche-Comté ‒une formation à laquelle le CDN est historiquement attaché. C’est une pièce qu’il est formidable de redécouvrir avec des jeunes gens, car elle contient des problématiques qui sont vraiment au centre des enjeux sociétaux actuels, comme la question climatique, celle des genres… Il était très important pour nous d’inclure la jeunesse dans cet événement, pour marquer vraiment cette idée de passage de flambeau en plus de l’aspect mémoriel. Coupler le passé et l’avenir, l’avenir et le passé. Là encore, nous ne sommes que de passage entre les deux…
— 50 ANS, théâtre le 10 décembre au CDN Besançon Franche-Comté, à Besançon www.cdn-besancon.fr
51
LIGNES DE FAILLE
Par Sylvia Dubost ~ Photo : Grégory Batardon
Une nouvelle étape dans sa vie de danse, débutée à 5 ans, qui l’a menée du Japon à la France en passant par les États-Unis. Une vie que nous avons retracée avec elle, pour voir ce qu’elle avait déposé dans son œuvre et ce qui éclaire ce choix. Il y est question de vide, d’énergie, d’enfance et de réparation.
On l’a d’abord vu beaucoup danser pour d’autres, Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, James Thierrée, Sidi Larbi Cherkaoui… Frappés sans doute comme nous par les possibilités apparemment infinies de son corps. Aurélien Bory lui avait composé un solo sur mesure, Plexus (présenté au TJP), la faisant évoluer au milieu d’une forêt de fils tendus, à la fois marionnette et prodigieusement libre. Ces cordes bien visibles renvoyaient sans doute à celles, invisibles, sur lesquelles elle ne cesse
d’évoluer : pour Kaori Ito, la danse est affaire de tension, dans l’espace de la scène, entre elle et le spectateur. Dans ses pièces à elle, solos ou de groupe, elle déploie un langage sensuel et inquiétant, fait de tremblements, où son corps mécanique et élastique sert des projets plus intimes. On est un peu étonnés de la voir au TJP, scène historiquement dédiée au jeune public, que Renaud Herbin a dirigé pendant deux mandats comme un terrain d’expérimentations protéiforme. À déployer avec elle son parcours, à en tirer et renouer les fils, il se dessine comme une évidence…

Vous avez commencé par la danse classique à 5 ans : c’était comment ?
Je sautais beaucoup sur les genoux de mes parents, je leur faisais mal, ils se disaient que ce serait bien que je saute mieux ! Ce n’était pas la grâce qui m’intéressait, c’était tourner, lever les jambes. Depuis le début, je savais que c’était ce que je voulais faire toute ma vie.
À 43
KAORI
52
ANS, LA DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE
ITO PREND LA DIRECTION DU TJP, À STRASBOURG.
Que gardez-vous de ces bases ?
La conscience des extrémités, des finitions, des minuscules parties du muscle. Je peux faire papiercaillou-ciseaux avec les pieds. Dans chaque danse, on danse différemment, je danse avec les os, les articulations, comme les marionnettes, je cherche à savoir comment vider mon corps pour le contrôler. Cela permet aussi de ne pas me faire mal quand je m’abandonne, pour cela, il faut beaucoup de technique pour savoir comment lancer son corps. La liberté vient quand on est en sécurité.
Y a-t-il quelque chose de spirituel dans cette idée de faire le vide ?
Je pense à ce maître de théâtre Nō qui voit ce qu’il y a autour des comédiens et des danseurs. Il regarde le vide, c’est ce qui m’intéresse. La danse existe parce qu’on la regarde et c’est le vide entre le spectateur et le danseur qui permet le regard et l’échange, quand le cerveau s’active. Souvent, on me dit que ma danse est comme un trait d’énergie. Le but c’est, comme en calligraphie, de capter l’énergie du présent. Je travaille à la formation de jeunes artistes et je sais que je suis utile pour ça, pour créer un espace de questions sur le vide, sur les fils tendus mais qui ne se voient pas.
Après votre formation classique au Japon, vous êtes partie à New York : pourquoi ? À 17 ans, j’avais besoin de faire une autre danse, et j’ai commencé à regarder des magazines. Je voulais apprendre à bouger aux États-Unis, mais avant cela, je voulais créer un spectacle. J’avais 18 ans, j’étudiais la sociologie et l’éducation, et j’y ai mis toutes mes recherches, notamment la collecte de témoignages. Cette démarche est devenue importante.
Quelles traces cette formation a-t-elle laissées ? Quand j’avais 5 ans, j’avais un enregistreur à cassettes, j’enregistrais tous les sons, car j’avais peur de mourir sans laisser quelque chose à mes parents. Les recueils de parole, ça vient de là. Je fais le plein d’archives, et le son de la voix, les mots, c’est vraiment la première étape de mon travail sur chaque spectacle. Il y a toujours une démarche sociologique. C’est important de faire le lien avec la société actuelle.
Et New York, c’était comment ? C’était très fun ! J’étais à l’université d’art et j’avais des amis qui faisaient de la sculpture, du théâtre, dans notre milieu, il y avait Cocorosie, Anthony and the Johnsons…. J’ai rencontré beaucoup de gens très créatifs, c’était une sorte de grande fête, alors que je venais d’un pays hyper strict. J’ai participé à une battle de hip-hop, je jouais du berimbau, je testais des moyens d’expressions différents. Notre force quand on est à l’étranger, c’est qu’on peut tout effacer et construire une identité différente.
Vous êtes installée en France depuis 2003, pourquoi ce choix ? J’ai rencontré Philippe Decouflé au Japon, il m’a invité à venir travailler avec lui et j’ai eu mon premier contrat à Chaillot. J’ai bien lu toute l’histoire de la danse, j’ai souligné les chorégraphes avec qui je voulais travailler. J’ai fait des auditions pour m’entraîner, j’ai trouvé du travail facilement car je cherchais les rencontres, et j’ai enchaîné assez rapidement… Dès le départ, je voulais créer ma compagnie, et travailler avec ces chorégraphes pour un seul projet chacun, pour que cela ne s’imprime pas dans mon corps.
Je ne savais pas que d’être reconnue comme interprète serait aussi handicapant comme chorégraphe. C’est comme quand un acteur déjà connu réalise un film, les professionnels sont très sévères et la pression assez haute. Mais des gens m’ont soutenue et me soutiennent toujours. Quand j’ai besoin d’enregistrer quelque chose, Denis Podalydès le fait pour moi, Aurélien Bory vient souvent voir les filages, Alain Platel pour qui j’ai beaucoup d’admiration est souvent là pour me conseiller. C’est très précieux.
Question bête : qu’y a-t-il de japonais dans votre danse, ou dans votre manière de travailler ?
Je me suis éloignée du Japon pendant très longtemps, je ne voulais pas danser en kimono, je n’avais pas de formation de butō car je voulais exister en tant que personne et pas culture. La rencontre avec Yoshi Oida pour Le Tambour de soie m’a beaucoup rassurée, on peut revenir vers un pays tout en le méconnaissant, être toujours ouverte et continuer à apprendre. J’ai également fait un spectacle avec mon père qui m’a beaucoup remuée, c’était une porte d’entrée pour revisiter ce que je n’ai pas pu voir pendant des années. Maintenant, je suis prête à reconsidérer mon identité. En ce moment, je travaille autour du kintsugi [méthode japonaise de réparation des céramiques au moyen de laque saupoudrée d’or, ndlr]. Dans le kintsugi, plus la fêlure est grande, plus il y a d’or, plus c’est précieux. Ces concepts sont devenus plus évidents dans mon travail même s’ils ont toujours été là. Waremono, qui sera ma première création au TJP, parle ainsi des blessures de l’enfance, qui touchent tout le monde…
Pourquoi vouloir diriger un lieu ? Et pourquoi le TJP ? J’avais déjà écrit un projet de lieu autour de l’enfance et de la jeunesse, parce que ce sont eux qui nous donnent la clé de l’avenir. Ils ont tellement d’énergie et de violence en eux, l’art nous permet de la convertir en énergie vitale, comme l’aikido. Cela permet de parler d’universel : on a tous été des enfants, on peut s’adresser à l’enfant et l’enfance qui sont en chacun. J’avais rêvé d’un lieu pour fluidifier la relation entre les enfants et l’artiste, un lieu auquel je puisse m’attacher pour développer un projet sur le long terme.
Le tremblement est caractéristique de votre danse, d’où cela vient-il ? Je viens d’un pays qui tremble, qui est conscient que tout se casse, qui sait que l’architecture la plus solide est celle qui bouge avec la terre. Métaphoriquement, cela s’applique tellement aux gens… On ne construit pas sur le solide, surtout pas. On construit sur des failles et c’est cela qui est beau. Leonard Cohen disait dans une chanson : « When there’s a crack, that’s when the light comes in. » Aujourd’hui, il y a une force qui nous dépasse, profitons de ce temps précaire pour pénétrer dans les failles. C’est là que j’ai besoin des idées de la jeunesse. Peut-être qu’on va tous mourir mais on aura tenté de faire une fête.
www.tjp-strasbourg.com
53
UNE HISTOIRE DE LA VIOLENCE
 Par Sylvia Dubost ~ Photo : Pascal Bastien
Par Sylvia Dubost ~ Photo : Pascal Bastien
SES SPECTACLES SONT VIOLENTS, « LA RÉALITÉ EST
PIRE ». AVEC HÔTEL PROUST, LE METTEUR EN SCÈNE STRASBOURGEOIS
MATHIAS MORITZ SE REPLONGE EN 1995, CE QUI A CHANGÉ DEPUIS, OU PAS… LA RAGE DES DÉBUTS EST-ELLE TOUJOURS UN MOTEUR ?
Mettre au jour la barbarie de notre société, plus ou moins bien cachée sous des dehors « civilisés », Mathias Moritz s’y emploie depuis plus de 20 ans. Avec comme vecteurs le trash et l’excès, dans les corps et/ou dans les mots. On sort souvent de ses spectacles éreintés, émotionnellement usés, comme lessivés. Pas une soirée à recommander aux âmes sensibles. Ce déboulonnage est souvent passé par des textes « classiques », dont il livre une version inouïe. Shakespeare, Marlowe, Büchner, mais aussi Flaubert avec une version lecture personnelle de Madame Bovary, lui permettent de raconter notre monde en le regardant de loin. Pour ne pas que la noirceur nous submerge. Mais de fait, elle nous submerge quand même. Il y a aussi au panthéon l’Autrichien Werner Schwab, qui oppose « à la violence du monde la violence de ses propres mots », pour reprendre ceux de sa maison d’édition. Qui conviendraient aussi au combat théâtral de Mathias Moritz.
Pour sa nouvelle création, Moritz met en scène un texte contemporain, écrit pour le spectacle par un de ses acteurs fidèles, Antoine Descanvelle. Hôtel Proust croise les destins de sept personnages logés au même endroit, quelque part dans l’année 1995. Pourquoi 1995 ? Parce que ce n’est pas si loin, qu’on a tout oublié et qu’à bien des égards, cette année porte les germes de la crise qu’on affronte. C’est l’année des attentats à Saint-Michel, de l’élection de Jacques Chirac sur le thème de la fracture sociale, de Juppé et des femmes ministres (les « jupettes », WTF !), de grèves monstres, de la reprise des essais nucléaires en Polynésie, du redémarrage du réacteur Superphénix… Tout comme les figures qui traversent le spectacle et qu’on reconnaîtra plus ou moins clairement, la liste résonne de manière curieuse et cruelle.
En 1995, Mathias Moritz a 12 ans. « Je n’ai pas de souvenirs politiques profonds de cette époque, tout avait l’air d’aller bien et ça m’énervait. Je me souviens de la colère que j’avais au fond de moi. » Il passe son temps au théâtre, au Maillon à Strasbourg, où un ami de ses parents est régisseur lumière, et au TNS,
découvre Claude Régy, Matthias Langhoff, Romeo Castellucci. « Je me souviens de sa Genèse. Il n’y avait pas foule dans la salle et encore moins foule à la sortie. J’ai ressenti quelque chose que je n’ai plus ressenti au théâtre depuis : il a réussi à me faire peur. Ce géant avec un chapeau, les références à Auschwitz, Antonin Artaud, cette femme énorme, cela me transperçait à un endroit où je n’étais pas à l’aise. » Six ans plus tard, à 18 ans « et un mois », il monte son premier spectacle au Molodoï, scène autogérée dans le quartier Gare. « C’était brouillon, je n’avais jamais mis en scène, la moitié des acteurs n’avaient jamais joué. » Pendant dix ans, il y présentera six spectacles par an. Sarah Kane, qu’il découvre à Avignon et dont la première pièce, Anéantis, est jouée en 1995 (la première didascalie inspire d’ailleurs le décor de Hôtel Proust : « un hôtel si luxueux qu’il pourrait se trouver n’importe où dans le monde ») ; Rodrigo Garcia dont il met en scène trois pièces… « On était les héros. La salle était à disposition, le prix était libre, j’avais trouvé un terrain de jeu agréable. Avec mon auto-formation, je pouvais faire ce que je voulais. On a mis beaucoup d’énergie pour faire le maximum de formes, passer du classique au contemporain. »
En 2012, sa mise en scène d’ Antiklima(X) de Werner Schwab est programmée au Maillon et l’installe comme le metteur en scène strasbourgeois à suivre. « Schwab, c’est un théâtre de l’exorcisme. Il va dans le sale pour trouver le beau. Comme dans le film [de William Friedkin, ndlr] où un prêtre perd la foi et la retrouve quand il rencontre le diable. C’est pareil avec le beau. » Les spectacles qu’il monte avec les acteurs de sa compagnie Dinoponera / Howl Factory sont autant d’exorcismes, pourrait-on dire. Et ils passent nécessairement par des émotions fortes, y compris négatives. Parce que « c’est l’émotion qui te questionne. »
Aujourd’hui, Mathias Moritz dit avoir envie d’autre chose. Avec sa nouvelle compagnie, Tongue (la langue en anglais), il veut revenir à un théâtre d’acteur. « Avec la Dinoponera on parlait fort, il fallait être vif, musclé, le danger était partout. Mais lorsque l’état d’urgence est le commun, il nous fallait monter encore d’un cran. Et c’était épuisant. » On aurait cependant tort de penser que le combat est terminé. Il prend simplement une autre forme, que Mathias appelle « comédie pessimiste ». C’est en tout cas vers là qu’il veut aller. « Je ne sais pas s’il est encore question d’exorciser quoi que ce soit. C’est pire qu’avant, mais on est encore vivant. Alors peut-être qu’on peut en rire ? » Quand on vit dans un monde où, comme il nous le rappelle, Deleuze (décédé d’ailleurs en 1995) a été remplacé comme philosophe médiatique par BHL et Onfray, effectivement, ça vaut sans doute mieux.
— HÔTEL PROUST, théâtre les 12 et 13 janvier au Maillon, à Strasbourg www.maillon.eu
55
TERRASSER LE MONSTRE
Par Sylvia Dubost ~ Photo : Nicolas Joubard
AVEC LE DRAGON D’EVGUENI SCHWARTZ, THOMAS JOLLY LIVRE UNE SATIRE FINE ET CAUSTIQUE DU POUVOIR TOTALITAIRE, OÙ IL DÉPLOIE TOUT LE POTENTIEL
SPECTACULAIRE
DU THÉÂTRE.
Entre Starmania et la direction artistique des JO de 2024, il est sans conteste l’un des metteurs en scène les plus médiatisés du moment. C’est surtout l’un des plus prolifiques et passionnants. On se souvient encore de son Thyeste de Sénèque, magnifique et sidérante variation sur la monstruosité qui avait ouvert le Festival d’Avignon en 2018. Thomas Jolly, comédien et metteur en scène, s’intéresse ici à une autre forme de monstre, Le Dragon de l’auteur russe Evgueni Schwartz (1896-1958). Écrite en 1943, la pièce commence comme un conte : une petite ville est terrorisée depuis des lustres par un dragon qui, entre autres, demande chaque année le sacrifice d’une jeune fille. Schwartz y dénonce très clairement tous les totalitarismes de son temps, nazi comme stalinien. Une accusation œcuménique que la censure soviétique a assez peu goûté, puisque la pièce a été censurée dès le lendemain de sa première. Au-delà de l’aspect politique, Le Dragon est aussi, pour reprendre les mots de Thomas Jolly, « une machine à jouer très luxuriante où le rire tient une place très cynique ». Une pièce de choix pour le metteur en scène qui n’aime rien tant que mettre en œuvre les artifices du théâtre pour donner matière à penser.
Comment avez-vous rencontré cette pièce ? Entre 2003 et 2006, à l’époque où j’étais à l’école du TNB à Rennes, je me souviens avoir lu Le Dragon, Le Roi nu et L’Ombre d’Evgueni Schwartz et d’avoir rangé les pièces dans ce que j’appelle ma besace imaginaire, où je mets des textes qui me plaisent, me questionnent, m’inspirent et dans laquelle je pioche souvent. En prenant mes fonctions à la tête du Quai à Angers [Centre Dramatique National, ndlr] en janvier 2020, et avec ce virus qui a bouleversé nos vies, je me suis demandé ce que je pourrais raconter face à cette réalité qui dépasse la fiction, quel récit il était possible de porter. Je suis retourné voir ces pièces et me suis dit que Le Dragon serait un juste éclairage, une alarme, sur les délitements de ce qui peut faire humanité. C’est important d’écouter ce que Schwartz a à nous dire, qui plus est dans une année électorale où ce qui fait humanité n’est pas vraiment ce qui est porté dans les discours.
Le contexte dans lequel s’inscrit le texte et sa réception ont pesé dans votre choix ? Je tiens d’abord à dire que je ne souscris pas du tout à l’idée que nous vivons actuellement dans un régime totalitaire ! Il ne s’agit surtout pas pour moi d’alimenter la dissension et les fractures de notre société.
On ne peut pas ignorer le contexte dans lequel Schwartz écrit ce texte, car il en livre une vraie analyse, et dénonce les mécanismes du système totalitaire, quel qu’il soit. Il utilise le motif du conte pour dénoncer tout système totalitaire, qui vient corrompre ce qui fait humanité. Il n’y a pas de dénonciation contextuelle, Schwartz est beaucoup plus intelligent que ça : il déplace et dépasse le contexte temporel et géographique dans lequel il écrit. C’est plutôt une réflexion générale sur nous autres, les peuples, nous autres, les humains.
Qui est ce dragon ? Justement ! Ce que nous dit Schwartz, c’est que le dragon est une énergie. Ça vaut pour le monstre comme pour l’homme providentiel, car face à lui nous avons le bien nommé Lancelot. La monstruosité et le courage ne sont pas une incarnation, Ce sont des forces qui s’insinuent dans toutes les couches de la société. Ce que nous dit Schwartz, c’est que le monstre n’est pas le seul responsable du malheur, et attendre l’homme providentiel n’est pas une solution. On peut faire ici le parallèle avec le Discours de la servitude volontaire de La Boétie, pour qui le pouvoir totalitaire ne prospère qu’avec la coopération volontaire, involontaire, inconsciente même, de la population. Nous sommes responsables de notre devenir politique, c’est important de le dire.
56
Il y a deux parties distinctes dans le texte, et presque deux genres littéraires aussi…
Il y en a beaucoup ! Schwartz s’amuse des genres littéraires, et offre un éventail délicieux et très théâtral. Le Dragon est une pièce à machines, qui permet le déploiement d’une large distribution, d’effets scéniques et scénographiques. Le théâtre est ici porté très haut, et nous, derrière, devons assumer !
Schwartz dénonce des mécanismes politiques sous couvert de fable et, comme La Fontaine, va très précisément et pertinemment au cœur du sujet. Une fois que les personnages fantastiques ont péri dans la bataille, Schwartz se débarrasse de ces motifs pour un récit plus réaliste, nous laisse face à cette réalité, justement : une fois qu’on s’est débarrassé du tyran, s’est-on pour autant débarrassé de la tyrannie ?
Ce texte est un merveilleux terrain de jeu théâtral, comme vous le disiez : pour vous, c’est du pain béni !
Je crois très fort dans la force du théâtre, en ses capacités visuelles, performatives, scéniques. Je suis amoureux de tous les aspects du théâtre : le maquillage, les postiches, les machineries, la fumée, le son… Schwartz ne se bride absolument pas dans son écriture, et on développe cet univers magique. Par là, j’affirme un théâtre qui touche à la fois le cerveau mais aussi les yeux, les oreilles, le
cœur, l’âme. Le théâtre est un outil avec beaucoup de facettes et c’est par là qu’il est opérant : il met en circulation la pensée. On doit se remettre en réflexion des sujets, ces questions doivent être posées – et je n’apporte jamais de réponse –, et tous les outils du théâtre permettent de brasser la pensée pour que, surtout, elle ne se fige pas. Faire humanité ensemble est un travail de tous les instants, et le théâtre ne sert qu’à ça.
Quel est votre rapport au monstrueux ? Ça commence à se voir ? [Rires] Les monstres sont mes personnages préférés car ils portent le théâtre. Le mot monstre vient de monstrare en latin : c’est celui qui montre ou est montré. Pour certains comédiens on parle de monstres sacrés. Et le théâtre doit montrer les travers, les failles, comme un miroir grossissant, une loupe sur nos humanités. Il rend superlatifs les caractères : dans la vie, les monstres sont plus discrets mais plus dangereux. Richard III, Atrée [le monstre de Thyeste, ndlr] , Médée, des monstres poussés au bout de leur « difformité », sont les personnages les plus théâtraux qui soient. Le monstre, c’est celui qui sort de l’humanité, qui dépasse les lois du faire ensemble.
— LE DRAGON, théâtre les 8 et 9 février à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
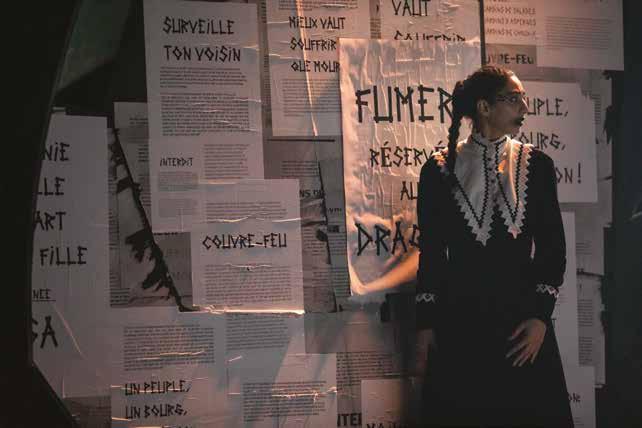
57
Par Aurélie Vautrin

LA FIN D’UNE ÉPOQUE
APRÈS PLUS DE 30 ANS D’EXISTENCE, LE FESTIVAL MOMIX SE TARGUE D’ÊTRE UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU « SPECTACLE JEUNE PUBLIC ». AUX COMMANDES DU NAVIRE DEPUIS LE DÉBUT OU PRESQUE, PHILIPPE SCHLIENGER TIRE SA RÉVÉRENCE À LA FIN DE L’ÉDITION 2023… RENCONTRE. Dominique toute seule (Programmation Momix 2023) © Margot Briand 58
Que retenez-vous de ces trente dernières années ? Beaucoup de choses ! Déjà, j’ai vu le festival se transformer et, de manière générale, l’approche du « spectacle jeune public » se modifier dans la société. D’ailleurs, j’ai souvent lutté contre cette appellation restrictive, « jeune public ». Pour moi, l’idée a toujours été de présenter des productions qui s’ouvraient à toutes les générations. Des spectacles portés par des artistes dont la volonté était de toucher l’enfance, avec une vraie exigence. Or il y a trente ans, la dimension la plus naturelle du spectacle vivant en direction de la jeunesse, c’était uniquement le théâtre – et il n’était pas valorisé dans les établissements officiels, loin de là. Alors qu’aujourd’hui, tous les CDN, les centres chorégraphiques, etc., proposent une programmation jeune public !
Momix a été un précurseur ?
Je crois qu’on peut le dire, oui, même si on a pris des chemins de traverse. Aussi dans notre approche pluridisciplinaire et cette volonté de ne pas se cantonner à une forme plutôt qu’à une autre – d’ailleurs le mouvement artistique s’est depuis ouvert à toutes les esthétiques, cirque, marionnettes etc. Je crois que toutes les dimensions qui englobent le spectacle – la scénographie, la lumière, l’adaptation d’un texte, l’énergie sur un plateau – se sont totalement développées : les équipes artistiques créent des spectacles de façon beaucoup plus impliquée qu’il y a une trentaine d’années. Des spectacles qui ne sont plus cantonnés aux établissements historiques : les artistes investissent à présent des lieux tiers, des écoles, des préaux, des médiathèques. Dans un sens, Momix a sans doute participé à tout cela. Et puis bien sûr, il y a la dimension internationale qu’a prise le festival ! On est devenu un lieu de repérage pour les autres structures culturelles du pays, autant pour les compagnies françaises que pour les troupes étrangères.
Le festival a toujours eu cette fonction de « tremplin » ?
Pas au début, non, c’est le travail de trente années qui a permis de développer cette notion de « label ». Aujourd’hui, Momix est un lieu de visibilité pour les compagnies. Cet effet de levier est primordial, car ce qui manque le plus souvent aux créations, françaises ou étrangères d’ailleurs, c’est d’être vues par un nombre conséquent de programmateurs. Momix permet ça.
—
Au vu de la conjoncture actuelle, comment s’est montée l’édition 2023 ?
Disons que l’on a dû faire preuve d’un peu de réalisme afin de pouvoir maintenir l’esprit du festival dans un contexte contraint. Cela s’est traduit par une programmation légèrement réduite mais en gardant une vingtaine de lieux partenaires autour de Kingersheim, Mulhouse, Dijon, Fessenheim. La pluralité des lieux, c’est l’essence même de Momix : présenter des projets ambitieux pour les théâtres, et des spectacles adaptés aux communes plus modestes. J’ai toujours été sensible à cela – travailler avec toutes les échelles de partenaires pour que l’idée puisse irriguer. Semer des graines.
Qu’en est-il de la suite ?
Ce qui est certain, c’est que l’empreinte de Momix dans le territoire est forte, et que les différentes institutions qui soutiennent le projet sont toutes totalement convaincues de l’intérêt de garder un événement comme celui-ci sur le territoire. On peut donc espérer un bel avenir pour le festival, même s’il faudra peut-être penser à une structure revisitée – car finalement, en période de manque de moyens, la solution, c’est sans doute de se regrouper et de collaborer encore plus.
— MOMIX, festival du 26 janvier au 5 février à Kingersheim et autres lieux www.momix.org
59
j’ai souvent lutté contre cette appellation restrictive, « jeune public ». Pour moi, l’idée a toujours été de présenter des productions qui s’ouvraient à toutes les générations. —

Incarnations
peuvent avoir en commun Joe Strummer, David Demange, Mouse DTC, Fred Poulet, Théo Ceccaldi et Nadine Khouri ? L’énergie de l’âme, la puissance de la liberté, les larmes au cœur, et la musique, bien sûr. Ultime, encore et toujours.
Que
J AS JOE

62
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Richard Dumas
DU CLASH AUX MESCALEROS, JOE STRUMMER N’A JAMAIS RIEN
VANTÉ DE MIEUX QUE LES VERTUS DE L’INACHÈVEMENT. À L’OCCASION DES 20 ANS DE SA DISPARITION, ÉBAUCHE
D’UN PORTRAIT SOUS LA FORME D’UN ABÉCÉDAIRE.
A comme Acte
Dès ses débuts, le Clash a fait du passage à l’acte l’un de ses signes de reconnaissance et d’adhésion. Passage à l’acte musical dans un premier temps, avec un propos direct et sans concession qui laisse cependant la part belle à des mélodies comme autant d’hymnes à reprendre en cœur Passage à l’acte artistique ensuite qui permet au groupe de signer chacune de ses apparitions avec des distinctions fortes : des vêtements peints avec des slogans, une esthétique rock renouant avec les codes du genre et un goût prononcé sur scène pour l’affichisme contestataire inspiré des étudiants des Beaux-Arts de Paris en mai 68. Passage à l’acte politique enfin, sous l’impulsion principale de Joe Strummer, avec l’affirmation d’un esprit libre qui, à la différence des Pistols, offre un espoir et invite la jeunesse anglaise – et par-delà celle-ci, continentale ! – à la contestation de l’ordre établi. De l’acte à l’action, il n’y a qu’un pas que le Clash a franchi maintes fois durant sa trop courte carrière.
B comme Big
Un jour, Damien Hirst l’interroge : « Quelle est la plus grande chose que tu aies eu l’occasion de tuer ? » Sans hésiter, Joe Strummer lui répond : « Ma carrière ! »
C comme Clift
En écoutant, adolescent, « The Right Profile » sur London Calling, on prend l’allusion à Montgomery Clift pour une private joke avant de se rendre compte que l’acteur en question nous a déjà ébloui dans Une place au soleil à la télévision Il nous suffit pourtant de lire attentivement les paroles : Joe Strummer y énumère les films Red River (Howard Hawks), A Place in the Sun, donc (George Stevens), les Misfits (John Huston) et From Here to Eternity (Fred Zinnemann). Mais s’il les cite dans le désordre c’est qu’il nous signifie une gradation qui conduit la
star américaine vers l’éternité – en passant toutefois par la blessure. Strummer insiste sur une étrangeté “Everybody say’ what’s he like? / Everybody say’ is he all right? Everybody say’ he sure looks funny! That’s… Montgomery Clift, Honey!” Dans cette singularité, il se reconnaît, comme un portrait de lui-même dans le miroir : l’anti-héros magnifique, ultime. Monty, l’irréductible, qui affirme ses choix au point de refuser un contrat important pour jouer La Mouette de Tchékhov dans un petit théâtre.
JOE STRUMMER PAR RICHARD DUMAS
Un jour de l’année 1985, j’étais en train de préparer un livre de portraits rock, quand soudain l’idée me vint de demander à Joe Strummer de m’écrire un petit texte sur une photo de John Lee Hooker. Comment s’y prendre ? Simplement, aller voir le Clash qui se produit dans un festival d’été breton, et apporter la photo avec soi. Après le concert, se rendre dans le backstage à ciel ouvert, bien aidé par l’organisateur de l’événement, et essayer de parler à leur manager, réputé coriace, le fameux Kosmo Vinyl. Il fait nuit noire, mais c’est le premier type sur lequel je tombe ! Je lui mets le grappin dessus et lui donne une explication complète et franche (pas d’argent) de ce que je voudrais. Il veut voir la photo, mais je lui dis : « S’il vous plait pas ici, c’est beaucoup trop sombre. » Il a l’air nerveux tout à coup, et je l’entends me hurler soudainement aux oreilles : « GOOD PICTURES DON’T NEED LIGHT ! » Je n’ai qu’une envie, c’est disparaître. Mais il attrape la boîte et jette un œil à la photo, puis doucement me dit d’attendre. Dix minutes plus tard, il était de retour avec un texte de Strummer écrit directement au BIC bleu sur la boîte ! J’étais fou ! Avant que je parte, le manager tient à rajouter le copyright Joe Strummer à la fin du texte ! Aujourd’hui, je n’aurais sans doute plus le culot de faire une chose pareille, mais je peux vous dire que je n’ai jamais oublié la leçon : une bonne photo n’a pas besoin de lumière ! Je n’avais jamais lu ça dans aucun manuel de photographie.
Richard Dumas, le 19 février 2003.
P.-S. : J’ai pris cette photo de Joe quelques années plus tard à Saint-Brieuc, alors qu’il remplaçait le chanteur des Pogues, Shane MacGowan, parti lui en cure.
63
D comme Dub
Dans The Clash, on attribue l’influence reggae à Paul Simonon, et on le fait à juste titre tant le petit gars de Brixton s’est abreuvé de ces brûlots reggae qu’il entendait sortir des fenêtres de son quartier. Mais Joe Strummer n’a jamais été en reste quand il s’agissait de participer à la joyeuse punky-reggae party, dont il est l’un des éléments pionniers, dès les 101’ers. Il se dit que Bob Marley et Lee ‘Scratch’ Perry, stupéfiés, ont fini par apprécier la reprise punk du classique « Police and Thieves » de Junior Murvin. Des photos témoignent de l’intérêt que portait Joe à ce que diffusait le tour DJ du Clash en tournée, entre 1978 et 1980 : Barry Myers, dit ‘Scratchy’. Comme Don Letts qui a initié Joe très tôt au reggae, Barry Myers, en parfait connaisseur des pépites ska et dub, a ouvert la voie à un DJ-ing dans un style refusant toute forme de technique. Son influence est grande sur Sandinista! Il a retrouvé Joe à l’époque des Mescaleros auprès desquels il est redevenu le tour DJ 20 ans après. Bouclant ainsi la boucle reggae de Joe.
F
comme Future
En 2007, The Future Is Unwritten de Julien Temple livrait le portrait ultime de Joe Strummer. Loin des frasques rock, on découvrait l’intimité d’un homme. Le film éclairait sa profonde mélancolie, ses doutes les plus ancrés. Il nous livrait quelques-unes des clés de compréhension de la vie d’un homme faite d’éclats mais aussi de renoncements. Empruntant la voie d’un lent documentaire, le cinéaste se refuse, en parfait iconoclaste, à l’hagiographie d’une supposée icône punk. Il préfère emprunter des chemins de traverse – les légendaires émissions radio de Joe viennent admirablement ponctuer l’exercice –, tout en donnant la parole à ceux que le leader du Clash a abandonnés, parfois sans ménagement, sur le bord de la route : ses amis d’enfance ou de squat, jusqu’à Don Letts, lucide sur le parcours de son ami. Il en résulte un hommage fait d’ombres et de lumières, qui révèle au final l’extraordinaire vitalité de l’homme. Et sa profonde liberté.
G comme Go on
Joe Strummer aime y « aller » ! Il y va avec conviction et détermination. Quand on l’interroge sur son positionnement politique, il se dit « socialiste ». Dans l’hebdomadaire New Musical Express, il affirme en janvier 1981 : « Je crois au socialisme parce qu’il me semble plus humain. Plus humain que tous ces gars qui ne pensent qu’à eux. […] J’évolue avec cette vision des choses. » Quelques mois plus tard, il enfonce le clou dans Sounds : « Je ne connais aucun système en capacité de sauver le monde, mais dans le socialisme j’y vois plus d’humanité. » Il poursuit dans Rolling Stone en mars 1979, « Il va sans dire que nous sommes opposés à toute forme de racisme. » À ceux qui aimeraient le lui reprocher, il se démarque fermement de toute tentation totalitaire, celle qu’il associe au régime soviétique. En cela, il se rapproche d’un idéal anarchiste, celui qui a prévalu en Espagne dans les villes administrées par les Républicains durant la guerre civile avec l’affirmation de l’autogestion dans les usines. Insistant en cela sur le fait que The Clash est « un groupe pro-actif ».
H comme Héritage
Pourquoi Joe Strummer reste-t-il si important aujourd’hui encore, 20 ans après sa disparition, près de 40 après la séparation d’avec la formation historique du Clash ? Sans doute parce que son intégrité est demeurée intacte Ainsi que sa capacité de fascination. Nous sommes quelquesuns à nous souvenir de la diffusion du film Rude Boy à la télévision française dans le cadre d’une soirée spéciale dédiée aux films rock à l’époque sur Antenne 2 en juin 1983. On se souvient d’un court entretien avec Joe Strummer dans ce film de fiction-documentaire. Il arborait un t-shirt Brigate rosse, les brigades rouges italiennes, bardé du logo de la RAF, la Rote Armee Fraktion, en hommage au groupe terroriste Baader-Meinhof et expliquait les raisons de son combat avec calme et détermination à l’un des protagonistes du film. Il le fit avec un certain goût pour un romantisme désuet – en soi discutable, certes –, mais non sans sincérité. Avec sa forte capacité d’évocation, cette scène a façonné l’engagement d’une génération tout entière.
64
J comme Joe
Son nom est John Graham Mellor, il est né à Ankara d’une mère écossaise et d’un père anglais ; il hérite de ses arrière-grands-parents du sang arménien et juif allemand. Constamment en mouvement du fait des activités de son père, haut fonctionnaire aux affaires étrangères – et MBE ! –, John Mellor ajoute à sa culture rock naissante celle des pays dans lesquels s’installent ses parents. Lorsqu’il retourne en Angleterre, il s’invente des personnages comme autant de nouvelles incarnations, loin de l’héritage familial. Il est un temps « Woody » en mémoire du folk-singer contestataire Woody Guthrie, un nom avec lequel il crée ses premiers groupes dont le pub rock band 101’ers. Il finit par devenir Joe Strummer (« le gratteur ») quand il rejoint The Clash, rompt avec ses anciens amis jugés trop hippies et se coupe les cheveux. Il ne cherche plus à changer d’identité, devenant Joe Strummer pour l’éternité. Avec l’intransigeance qui le caractérise, malgré les soubresauts d’une vie artistique tourmentée.
K comme K7 (Sandinista!)
Les années Clash étaient également les années K7 : les petits gars se faisaient un plaisir de copier leurs derniers vinyles à une poignée de leurs amis de collège. Tout le monde en profitait ! Le Clash, pourtant vigilant quant au prix de ses albums, n’échappait guère à la règle. Mais qui a tenté d’écouter Sandinista! en K7 n’en est jamais arrivé au bout – en vinyle non plus, cela dit ! – ; même les C90 de Maxell ne suffisaient pas à contenir ce triple album. Forcément, il faisait une durée de 144 min 29 sec, alors des choix douloureux s’opéraient. On devrait compiler toutes les versions tronquées de Sandinista! , sans compter qu’il arrivait souvent que le copieur laissât tourner son enregistrement jusqu’à éjection de la K7 en question, en plein milieu d’un morceau. L’écoute rajoutait du mystère à cette vaste entreprise d’un disque-monde infini, fascinant par les perspectives qu’il ouvrait. D’autres K7 circulaient également sous le manteau : des bootlegs live alimentaient un marché fait de listings fantasmés qui faisaient que l’esprit de subversion se doublait d’un sentiment d’illégalité.
L comme London Calling
Pour beaucoup d’entre nous, il y eut un temps avant. Puis, un temps après. Il a suffi qu’un ami l’achète pour que vous soyez tenté, vous aussi, de franchir le pas. Posséder London Calling, c’était passer de l’autre côté du mur, tutoyer les mauvais garçons et la contestation. C’était mesurer la rage scénique aussi bien au recto qu’au verso de la pochette ; c’était tenter de déchiffrer des paroles écrites à la main, chercher leur sens, identifier les voix qui les portaient – celle de Joe, le plus souvent, celles de Paul et Mick moins fréquemment – et les attribuer. Enfin, c’était embrasser le rock’n’roll dans sa forme la plus pure avec une poignée de chansons comme autant de coups sur la tête. Et s’opposer à tout ce qui ne s’y apparentait pas. Un gars, pas plus âgé que nous, mais plus mûr sans doute, nous prévint : « Ainsi donc, petits, on écoute London Calling. Dans six mois, ce sera les Sex Pistols. » Personnellement, je ne relevai nulle pointe d’ironie dans son propos, mais espérai avec impatience. Sa seule erreur, minime : je n’attendis pas six mois…
Mcomme Magnificence
“What have we got? Yeh-o, ma-gni-fi-cence!”
Ncomme No
Joe Strummer a dit « non ». Non à la négation. Non à l’acceptation. Non à la résignation. Non à l’évidence. Non à la société. Non à la loi. Non à l’ordre établi. Non au désordre. Non à l’information. Non à la désinformation. Non à la déformation. Non à la falsification. Non à la récupération. Non à l’obstruction. Non au mensonge. Non au préjugé. Non à la haine. Non à la guerre. Non à la paix. Non à l’amour. Non à la religion. Non au patriotisme. Non au fanatisme. Non au capitalisme. Non au fascisme. Non au totalitarisme. Non à la soumission. Non à l’asservissement. Non à l’abrutissement. Non au conditionnement. Non à l’endoctrinement. Non au détournement. Non à l’enfermement. Non à la technique. Non à l’expérience. Non à l’organisation. Non à l’obéissance. Non à l’ignorance. Non à la richesse. Non au business. Non à la publicité. Non à la télévision. Non à la complaisance. Non au succès. Non à la notoriété. “No, in a word. No chance. No way!” En revanche, il a su dire « oui » au punk, à la vie et à l’humanité.
65
O comme 101’ers
Tout amateur de Clash s’est un jour procuré l’album des 101’ers, ce groupe de pub rock à la Dr. Feelgood qui lorgnait du côté du rockabilly et du reggae. Et dont le chanteur n’était autre que Joe Strummer, encore appelé Woody. Généralement, ce fan y cherchait les prémisses d’un style ; généralement, il s’amusait à l’écoute de cette tentative prometteuse au point de la situer à part. Un Letsgetabitarockin’ conserve toute sa fraîcheur, tout comme le reste d’un album sans prétention, qu’il se surprend à placer sur sa platine presque par négligence. Avec un plaisir coupable. En leur temps, les 101’ers n’ont publié qu’un single, mais l’album en question, Elgin Avenue Breakdown, publié en 1981 avec sa pochette inspirée des bootlegs, révélait un univers premier respectable qui manifestait une forme d’insouciance et un réel éclectisme Étrangement, il nous apporte son éclairage sur Sandinista! sorti un an auparavant mais enregistré bien longtemps après, comme il nous informe sur les sources du Joe Strummer post-Clash. Pas si négligeable, donc.
P comme Punk
Quand cessera-t-on de faire du punk « une attitude » ? Le punk est une certitude : une esthétique de rupture et de contestation, ni plus ni moins que certains grands mouvements qui l’ont précédé – pêle-mêle parmi ses prédécesseurs, Dada, Cobra ou Fluxus. Sans doute, plus que d’autres, Joe Strummer a-t-il donné sa véritable dimension sociale au punk. Alors que les Sex Pistols affirmaient, non sans une bonne dose d’abstraction, une subversion de circonstance – nihiliste, faisant table rase de tout sans possibilité de retour – au point de se saborder eux-mêmes, The Clash visait la prise de conscience, avec candeur parfois, avec justesse souvent. En cela, Joe et sa petite bande ont joué un rôle de passeurs de sentiments et d’idées, à une génération passablement désœuvrée. Tout en grandissant, se nourrissant, se diversifiant et s’enrichissant, mais sans jamais perdre leur âme ni dévier des causes qu’ils défendaient ensemble avec âpreté.
R comme Radio
Gamin, John Mellor, futur Joe Strummer, écoutait la radio alors qu’il voyageait à travers le monde. Il se branchait alors sur BBC World Service sur petites ondes. Sans doute en souvenir de ces moments radiophoniques fondateurs, il a accepté de devenir un DJ radio sur la même station en 1998 avec l’émission London Calling , révélant au passage ses influences les plus anciennes : le rock’n’roll de Gene Vincent, Eddie Cochran, Ritchie Valens et Bo Diddley, le mêlant à merveille avec les nouveautés du monde, Amadou et Mariam et quelques morceaux choisis d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud ou des Caraïbes, sans oublier le reggae du toaster U Roy. C’était pour lui l’occasion de passer quelques messages politiques sur une autre forme possible de globalisation mondiale. Le bonheur qu’il trouvait dans ces diffusions explique sans doute en partie son envie de revenir au premier plan : cette période annonce la formation des Mescaleros, sa dernière formation, la plus importante depuis la séparation du Clash.
S comme Suicide
« Le passé est une chambre pleine de mélasse. Tu penses avoir la possibilité de simplement la traverser et en sortir, mais tu ne peux pas ! », répond Joe Strummer à un journaliste qui s’aventure sur ce terrain. À ce moment-là, pense-t-il à son grand frère disparu, David Mellor ? Il y a de fortes chances qu’il ait du mal à s’extraire de ce passé. Les conditions de cette disparition , un suicide en 1970 , ainsi que ce qui a précédé celle-ci, la fascination de son frère pour l’imagerie fasciste, rendent la chose forcément douloureuse pour un jeune frère appelé à reconnaître le corps du défunt, « empoisonné, selon lui, par les mensonges, les drogues et la haine ». Et pourtant, longtemps après, malgré la part d’incompréhension mêlée de déni , Joe continue de se montrer protecteur : « On ne sait comment cela affecte les gens. […] Je pense que de se suicider a été courageux de sa part. » Sans doute Joe a-t-il puisé dans ce drame cette part de combativité, y compris politique, qui l’a animé des années durant. Non sans être rattrapé par ses propres démons
66
V comme Vince Taylor
Après ses apparitions dans Rude Boy, Joe Strummer a multiplié les rôles au cinéma : il partage une scène avec Robert de Niro dans La Valse des pantins de Scorsese, puis enchaîne dans une demi-douzaine de films, dont Mystery Train de Jim Jarmush – sous le nom de Johnny alias Elvis – et J’ai engagé un tueur d’Aki Kaurismäki – son propre rôle –, avant de finir en trafiquant d’armes sous le nom de Vince Taylor dans Docteur Chance du réalisateur français F.J. Ossang. Il s’avère que le vrai Vince Taylor était pressenti pour interpréter ce rôle avant sa disparition en 1991. De ce fameux rocker, le Clash avait interprété un impressionnant Brand New Cadillac sur London Calling, fusionnant pour l’occasion les énergies du rock’n’roll et du punk dans un même mouvement. Façon maligne pour le groupe de s’inscrire dans l’histoire tout en revitalisant le genre. Sans le vouloir vraiment, Joe Strummer, au risque de fâcher quelques puristes, y obtenait une légitimité nouvelle qui le plaçait dans la droite ligne des pionniers.
W comme Warlord
Joe Strummer aimait se faire passer pour un « chef de guerre ». À jamais, il restera le « punk warlord ».
X
comme X-Ray Style
Il a fallu la rencontre avec Antony Genn, ponctuellement membre de Pulp et connu pour avoir dansé nu sur scène lors d’un concert d’Elastica au festival de Glastonbury pour que Joe Strummer se lance à nouveau dans l’aventure d’un groupe : les Mescaleros. Interpellé par le jeune insolent lors d’une soirée dans le restaurant de Damien Hirst à Notting Hill Gate, le Pharmacy « Tu es Joe Strummer, qu’est-ce que tu fous en ce moment ? » –, Joe est piqué à vif. Il jugea le gars plutôt persuasif lorsque celui-ci poursuivit : « Tu devrais être loin d’ici avec une ‘putain’ de Telecaster autour du cou. » Dès lors, de rencontre en rencontre, les conditions d’un come-back sont réunies, même si l’ombre du Clash plane encore audessus de la tête de Joe. Des premières sessions est née « Yalla Yalla », puis l’album Rock Art and the X-Ray Style qui posait l’intention du groupe : s’inscrire dans une continuité, celle de l’histoire de Joe, tout en s’accordant des possibilités nouvelles avec les sons du moment. Renouant avec sa créativité première, Joe se laissa aller à l’esprit sound system. Comme il l’a toujours fait, au final.
Y comme Yalla Yalla
Sur cette chanson extraite du premier album des Mescaleros, une boucle électronique lancinante vient dire la dimension sulfureuse de paroles obscures. Yalla Yalla, signe de reconnaissance libanais ou invocation africaine plus ou moins subversive ? Joe Strummer n’en a cure, il se joue des interprétations et s’attache aux sonorités engageantes de ces quatre syllabes. Il y a de la plainte dans cette ritournelle hors temps ; on y trouve aussi ce moment de libération absolue, comme si rien ne pouvait empêcher personne de faire ce qu’il a à faire dans l’instant. Joe Strummer a-t-il en tête la chanson électro de Rachid Taha, « Voilà Voilà » , qui constate amèrement la renaissance de l’hydre fasciste ? Rien n’est sûr, et pourtant « Yalla Yalla » semble lui répondre avec cette ferme exhortation à vivre. En effet, Joe vit sa renaissance, il se sait entier avec une maturité et une joie manifeste qui traverse ce morceau très dansant. "Yalla yalla, yalla yalla / Yalla yalla, ya-li-oo, whoa / Yalla yalla, yalla yalla / Only to shine, shine in gold, shine"
Z comme Zéro
Le punk est négation. Négation de ce qui précède et parfois même négation de ce qui advient. Le Clash n’échappe pas totalement aux codes en train de se figer autour de la personnalité dévastatrice des Sex Pistols. Leur année 0 est celle de l’avènement du mouvement, même si celui-ci est né quelques mois auparavant : 1977. Alors, Joe y va gaiement de son refrain : “No Elvis, Beatles, or The Rolling Stones / In 1977”. Il ne peut pas feindre d’oublier que John Lennon lui-même avait déjà tout nié dans sa longue énumération de « God » sur le Plastic Ono Band. Mais en intro à son brûlot punk, il précise les contours d’une envie qui renoue avec l’essence même d’une jeunesse éternelle : “In 1977, I hope I go to Heaven” (« En 1977, j’espère monter au ciel »). Il en a laissé d’autres le faire à sa place dans les années qui ont suivi On est nombreux cependant à se laisser surprendre par sa disparition si soudaine le 22 décembre 2002 à l’âge de 50 ans. Soit 25 ans après l’année 0 du punk : 1977. On ne sait pas s’il a atteint le ciel punk, mais il ne doit pas en être loin.
67
NADINE KHOURI LA MÉMOIRE ET LA MER
Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Renaud Monfourny
NÉE AU LIBAN, ÉLEVÉE EN ANGLETERRE, LA MUSICIENNE NADINE KHOURI S’EST INSTALLÉE À MARSEILLE CET AUTOMNE.
LE 18 NOVEMBRE EST PARU SON DEUXIÈME ALBUM, ANOTHER LIFE, SUR LE LABEL TALITRES. ENTRE FOLK PANORAMIQUE ET SOUL INTIME, UN GRAND DISQUE.
Le papier peint bleu qui recouvre le mur, les rideaux qui ondoient en vagues dans le vent – tout, dans la chambre, rappelle la présence si proche de la mer Méditerranée. Les bruits de Beyrouth filtrent par la fenêtre et se mêlent au murmure, imperceptible presque, de l’eau. Nadine a 15 ans. Ses parents ont quitté sa maison natale pour emménager dans un appartement dans le quartier d’Achrafieh. Là, pour la première fois, elle a une chambre à elle et, dans son intimité woolfienne, elle commence à écrire ses propres chansons. Depuis qu’elle a 8 ans, Nadine et ses parents vivent en Angleterre où ils ont immigré. Mais dès que possible, ils reviennent au Liban. C’est à Londres, pour ses onze ans, que sa mère lui a offert une guitare, exauçant alors un rêve tenace, qui s’était rivé plus encore après la découverte bouleversée – puis l’écoute obsessive –d’Elvis Presley. C’est la volonté de jouer et chanter les titres du King, ainsi que ceux des Beatles, qui lui donne l’énergie de l’apprendre en autodidacte. Il y aurait ensuite d’autres rencontres – Marvin
Gaye, Nina Simone, Patti Smith, Mazzy Star, Low ou encore Talk Talk... Il y aurait aussi de nombreux voyages, dont un séjour à New York où Nadine se pose un temps avant de revenir s’installer à Londres auprès des siens. Et il y aurait ce retour cyclique à la chambre bleue, point d’ancrage et lieu inspirant, qui verra naître la plupart des chansons qui figureront sur le premier album de Nadine Khouri, The Salted Air, publié en 2017 et réalisé par le producteur anglais John Parish.
« Il y a, dans sa manière de chanter, une simplicité et une sincérité qui sont extrêmement touchantes, témoigne ce dernier. C’est ce qui se passe avec les grands interprètes : ils savent, en chantant des mots très simples, provoquer des émotions profondes. La puissance, l’élégance et le grain de la voix de Nadine lui permettent d’apporter cette profondeur et c’est ce qui me fascine chez elle. » Aussi, à peine entend-il cette voix, par le truchement d’un disque que la jeune femme lui remet en 2010 (A Song to the City, son premier EP qui vient alors de paraître), qu’il l’appelle et l’invite à chanter sur un titre qui figurera sur son album Screenplay (2013). Puis, tous deux travaillent au premier disque long de Nadine : dans le studio dont il est coutumier, le Toybox à Bristol, le producteur assemble un groupe de musiciens qu’il connaît bien, dont le batteur Jean-Marc Butty, qui joue sur les disques de PJ Harvey que Parish réalise invariablement. « Ces musiciens ont vraiment emmené le disque très haut », sourit Parish. La douceur, la simplicité et la rigueur de John rassurent Nadine, tandis que son ouverture et son esprit d’aventure la stimulent. « Il fait confiance à son instinct et sait vite repérer l’essence de la musique et son authenticité, confie-t-elle. C’est une des choses que j’ai apprises avec lui : trouver dans les chansons leur vérité. Même si une note semble insolite ou étrange, est-ce qu’elle résonne au maximum de sa sincérité ? »
Dans la foulée de The Salted Air , qui reçoit un accueil critique enthousiaste (« une merveilleuse incantation spectrale », déclare Uncut tandis que Mojo célèbre « une voix extraordinaire »), paraît un
68

EP, A New Dawn, qu’elle réalise seule. Magnifiques, ses trois chansons réitèrent le miracle du premier album : celui de mélodies qui s’imposent avec le temps, d’une musique qui s’éploie comme se dissiperaient les dernières traînes d’un songe. Celui de ce grain de voix unique, trouble, un peu grave, qui étire les syllabes comme l’on défie les lois du temps ‒ un grain que Nadine dépose dans les rouages de ses chansons, un grain qui se joue du rythme et provoque l’inouï accident d’une inflexion, d’une intonation, d’une respiration. Il y a des silences bouleversants dans la musique de
Nadine Khouri et l’on se dit que ses chansons sont aussi ceci : un dialogue entre sa voix et le silence, entre elle et les disparus, les esprits, l’immatérielle beauté du monde, le souvenir de toutes choses. « Le silence peut faire peur car il induit une certaine confrontation avec soi-même, propose la musicienne. Il offre à la musique du relief, mais aussi un espace où l’on peut vraiment se concentrer sur elle et elle seule. »
Le silence, s’il baigne les chansons de Nadine Khouri, visite aussi sa discographie : il se passe cinq longues années entre les parutions de The Salted

70
Air et de son deuxième album, Another Life. « La réalisation de ce disque a été brusquée par la pandémie, témoigne-t-elle. C’était une période étrange car, en raison du confinement, je n’avais plus le luxe de pouvoir voir mes musiciens comme avant. Cette fois-ci, j’ai écrit les chansons et les arrangements seule. » Une écriture qui se révèle difficile. « Le confinement à Londres n’était pas propice à l’écriture, tant j’étais crispée par l’angoisse, explique-t-elle. On peut puiser, pour écrire, dans la colère, l’amour ou la tristesse, mais le stress que j’ai connu à cette période-là a bloqué toute inspiration. J’étais comme fermée au monde. » Grandis au cœur
de la gangue silencieuse du lockdown londonien, soufflés par l’explosion qui, en août 2020, ravageait Beyrouth, les nouveaux morceaux de Nadine Khouri s’épanouissent à Marseille, ville où elle s’installe définitivement à l’automne 2022. « Cette ville m’a beaucoup inspirée et, d’une certaine manière, sauvée », révèle-t-elle. Marseille, ou le retour au murmure immémorial de la mer Méditerranée. Les chansons portent les stigmates de ces deux années contrastées et accueillent des vents contraires : le chant, tout à la fois engourdi et tranchant comme une lame, se pose sur des grooves cotonneux, des mesures qui se brouillent. Elles contiennent le frisson et le chaos, la blessure et le baume ; elles pleurent l’exil comme chantent le retour. La musicienne y célèbre les soleils levants et y salue les morts, scrute les mille nuances de rais de lumière comme se perd dans l’épaisseur de la nuit.

Cette fois-ci, quand elle entre en studio avec John Parish, elle est accompagnée des musiciens avec lesquels elle a longuement répété ses chansons. « C’était un groupe soudé, se souvient John Parish. Les musiciens étaient géniaux – et l’atmosphère aussi. C’était important car la musique de Nadine requiert une harmonie entre les musiciens : c’est une musique et un chant très ouverts émotionnellement, à vif. » Ainsi naissent, dans la sérénité et après un long voyage tourmenté, les neuf chansons – d’un folk atmosphérique, une soul immatérielle – de son nouvel album. « Le confinement m’a plongée, de manière soudaine, dans mes souvenirs... Je me suis rendu compte que mes chansons me permettaient de fixer les choses, de ne pas les oublier : elles sont ma mémoire. Dans Another Life, je parle beaucoup d’exil, de débuts et de fins, de personnes disparues. Peut-être que c’est un disque hanté », songe Nadine Khouri.
Sur le fil tendu entre réel et imaginaire, passé et présent, Nadine Khouri progresse, funambule, dans l’univers de ses chansons, dont Parish a su saisir les éclats de vérité première. « Il sait capter l’intimité de la voix dans ses productions mais aussi la spontanéité du moment », assure la chanteuse. À l’été 2022, quelques mois avant la sortie du merveilleux Another Life , Nadine Khouri a enfin pu retourner à Beyrouth. C’était la première fois qu’elle avait passé autant de temps sans revenir dans sa ville natale ; elle n’y était pas retournée depuis les explosions du port. La déflagration a meurtri le havre de l’appartement familial, fissuré la coquille de la chambre bleue. « Ma belle guitare Taylor, qui m’a offert tant de mes chansons, a été complètement détruite, confie-t-elle. Mais bizarrement, une vieille photo d’Elvis est restée quant à elle intacte, punaisée au mur. » Ainsi en va-t-il des rêves : leur source est éternellement vive, leur miracle renouvelé, leur beauté intouchable. Ainsi en va-t-il, à l’avenant, de l’art irréel de Nadine Khouri.
— ANOTHER LIFE, Nadine Khouri, Talitres, 18 novembre 2022
71
DAVID DEMANGE, DIRECTION LA RODIA
Par Aurélie Vautrin ~ Photo : JC Polien
DIRECTEUR DU MOLOCO PENDANT PLUS DE DIX ANS, DAVID DEMANGE VIENT TOUT JUSTE DE
À LA RODIA, PRENANT AINSI LA SUCCESSION DE MANOU COMBY À LA TÊTE DE LA SMAC DE BESANÇON.
ON FAIT LE POINT AVEC LUI.
Qu’est-ce qui t’a poussé à te lancer dans cette nouvelle aventure ?
En arrivant au Moloco, je m’étais fait la promesse de n’y rester que dix ans. Selon moi, c’est la limite de temps à passer à la tête d’une structure culturelle, après il y a forcément un phénomène d’essoufflement, ou en tout cas un besoin de revivification. J’ai donc simplement appliqué cette promesse… Mais je n’aurais pas postulé dans n’importe quelle salle ni ville. Je suis co-président du réseau régional des musiques actuelles en Bourgogne-Franche-Comté, je suis donc très attaché à cette région qui a un tissu culturel et associatif très développé.
Tu as vraiment ressenti cette « inéluctable lassitude des dix ans » ?
Alors non pas du tout, pas de lassitude - aussi parce que la crise sanitaire avait rebattu un peu les cartes, il avait fallu se réinventer, rester actif. Par contre, je pense que j’aurai probablement fait les années de trop sans m’en rendre compte. Là, mon départ correspondait aux dix ans du Moloco, c’était la fin d’un cycle, tout concordait. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester là-bas où tout fonctionnait bien, mais j’avais besoin de me remettre en danger. Et de laisser la place.
Te voilà donc à la direction de la Rodia. Faut-il s’attendre à une révolution ? Pas une « révolution » non, car c’est une structure qui marche bien, mais à une vraie évolution, oui sans aucun doute. Car comme dans la nature, tout organisme qui n’évolue pas finit par disparaitre… L’idée n’est pas de terminer en fossile intégré à la Citadelle de Besançon ! Mon ambition centrale, c’est de faire rentrer la Rodia dans la vie de chaque habitant de la métropole. Nous sommes au cœur d’un territoire dynamique, que ce soit d’un point de vue social, sportif, culturel ; je voudrais donc multiplier les portes d’entrée, mais pas dans une logique d’accès à la culture, plutôt dans une logique de faire de la culture ensemble. Tisser du lien. La Rodia a toujours travaillé avec les assos, les producteurs privés, les centres sociaux, mais je pense que je peux approfondir tout cela avec une forme de partenariat un peu global sur le territoire et des opérations un peu fortes et structurantes. N’oublions pas que nous sommes situés dans un quartier très dynamique culturellement parlant, avec la Cité des Arts, le FRAC, le Conservatoire, le Bastion… Il y a quelque chose à faire avec toutes ces structures-là, et avec les habitants. Pour ce faire, nous allons multiplier et expérimenter les formats, notamment sur la diffusion, et proposer
POSER SES CARTONS
72
des événements un peu atypiques, insolites - des vraies expériences dont les gens se souviendront, peut-être même plus que du concert lui-même. Une rencontre au lever du jour à la Citadelle, un atelier de percussion aquatique dans une piscine, un mix musiques actuelles-musiques classiques… Sortir des formats habituels, aussi dans l’action culturelle, voilà ce que j’ai envie d’amener. Parce que sur les projets classiques d’une SMAC, la Rodia fonctionne très bien, il n’y a donc pas de raison de changer - même s’il y a sans doute plus de transversalités à avoir, des choses à inventer. L’idée est donc d’instaurer des projets qui vont dénoter, mais qui s’inscrivent dans une forme de continuité.
Tes actions passées au Moloco nous ont appris que tu es quelqu’un de passionné, avec mille idées à la seconde et l’envie de porter des projets un peu fous. Est-ce que ce sera la même chose ici ou estce que tu penses te « calmer » un peu ? (Rires) Je ne pense pas que je me calme, non ! En ce moment, j’ai l’idée d’un concert de black métal avec un orchestre symphonique et ça ne me fait pas peur du tout ! J’ai toujours envie de tenter des choses, parce que la musique est plurielle, qu’il faut casser les frontières, casser les codes. Et pour être franc avec toi, j’ai la conviction que pour faire rentrer une SMAC dans « le 21e siècle », il faut aussi qu’on aille sur les questions de transition écologique, et j’aimerai que la Rodia devienne un modèle sur ces questions-là. À présent, je crois beaucoup aux plus petites formes, au retour des relations de proximité entre les artistes et le public. Le côté grandiloquent et grandiose, les événements surdimensionnés m’intéressent aujourd’hui un tout petit peu moins que de retisser cette relation après la crise sanitaire. J’aimerais travailler sur des choses un peu low-tech, acoustique, des expériences organiques de proximité. L’envie et l’énergie sont là, maintenant les contraintes sont également plus nombreuses avec une grosse structure comme la Rodia, qui a un modèle économique à tenir : 50% de recettes propres, donc en grande partie basées sur la billetterie, le bar, le mécénat. Il faut tenir ce modèle-là, composer, jouer un rôle d’équilibriste entre la logique de la demande, la logique de l’offre, et la sphère DIY du territoire.

Ton équipe est au courant que tu ne restes que dix ans ? (Rires) Oui, oui, je leur ai dit ! Je me suis fait une promesse, il faut que je la tienne jusqu’au bout ! Et puis je ne sais même pas si dans dix ans je serai encore directeur de SMAC, peut-être que j’élèverai des chèvres à Marnay ! Mais pour le moment, l’énergie est là, j’ai toujours la même conviction que c’est possible - d’ailleurs, c’est le territoire qui me nourrit, la rencontre avec les gens, l’équipe de la Rodia… Ce sont les autres qui me donnent cette énergie.
larodia.com
73
— Comme dans la nature, tout organisme qui n’évolue pas finit par disparaitre… L’idée n’est pas de terminer en fossile intégré à la Citadelle ! —
TRALALA DADA
MOUSE DTC NOUS MET AU DÉFI AVEC SON NOUVEL ALBUM : ATTRAPEZ-NOUS SI VOUS POUVEZ ! NOUS AVONS RÉUSSI, NON SANS MAL, À METTRE
LE
GRAPPIN
SUR
HERMANCE VASODILA ET ARNAUD DIETERLEN. ENTRETIEN VERSION X EN CLAQUETTES-CHAUSSETTES.
Qu’est-ce que c’est Mouse DTC ? Arnaud Dieterlen : C’est mulhousien ! Ce projet existe depuis plus de dix ans, mais nous avons avancé doucement avec ce désir premier d’écrire des chansons qui nous faisaient marrer. Nous faisons les choses très sérieusement, mais nous nous amusons énormément en jouant beaucoup plus sur la sonorité des mots que sur leur sens. Je me suis sans doute inspiré d’artistes que j’ai longtemps accompagnés, comme Alain Bashung, qui travaillaient à partir de différents textes pour y puiser des éléments hétéroclites et les assembler.
Hermance Vasodila : Mouse DTC, c’est le mélange de nous deux, c’est notre complémentarité : le côté sautillant d’Hermance – la plasticienne – plus la rythmique et le groove d’Arnaud – le batteur.
A. D. : J’ai accès au carnet intime d’Hermance qui contient dessins, textes, pensées ou retranscriptions de blagues faites à 3 h du mat’ au comptoir d’un bar. Nous procédons par couches, par superpositions : une ligne de basse un peu idiote, quelques associations de mots et les choses se construisent petit à petit.

Que trouve-t-on Dans Ton Computer ?
A. D. : Des dizaines de pistes qui s’accumulent. Le morceau-titre « Attrapez-nous », par exemple, vient d’une boucle d’il y a une dizaine d’années.
H. V. : Nous récupérons des chutes et autres fragments pour en faire des cadavres exquis, ajoutons de la matière organique sur des rythmiques, de manière dadaïste.
Par Emmanuel Dosda ~ Photos : Teona Goreci
74
J’imagine que la démarche est différente lorsque vous faites des reprises, comme celle d’« Homosexualis Discothecus » de Jean Yanne sur l’album Dead The Cat…

A. D. : C’est la musique qu’on entend dans la scène où César (Michel Serrault) entre en boîte gay dans Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ce morceau file bien la banane quand on le joue.
Certains textes de l’album Dead The Cat ont été signés par Miossec. Là aussi, la manière d’écrire a dû être différente…
A. D. : Pas tant que ça, car nous étions ensemble en résidence sur l’île d’Ouessant, au Sémaphore du Créac’h, près de l’impressionnant phare multifacette qui nous faisait penser à une fête foraine ou une discothèque. Avec Christophe Miossec, nous écrivions et composions en abusant des huîtres et du rosé pamplemousse. À Ouessant, c’est extrême : les gens vieillissent plus vite là-bas !
Que trouverait-on Dans Ton Cerveau si on parvenait à y pénétrer ?
A. D. : En ce moment, c’est un peu le chaos. Il y a beaucoup d’objets pop rétro en formica des seventies.
H. V. : Nous sonnons un peu « seconde main » ou « marché aux puces ».
Qu’est-ce qui se cache Derrière Tes Cochonneries ? H. V. : Tu trouves que nos morceaux sont cochons ? Ok, c’est vrai que c’est un peu une obsession… Actuellement, je me questionne surtout quant
à mon statut de chanteuse « bonnasse » quadra, vieillissant doucement. Sans vouloir faire ma chienne de garde, à une époque, certains tourneurs vendaient ma sexitude avant de parler de notre musique. Le morceau qui ouvre le disque, Ton tralala, est une chanson #metoo qui parle justement de ça, de la drague lourde.
Qu’est qui vous attire Dans les Tonalités eurodance type Corona ( The Rhythm of the Night…) ?
H. V. : Je suis très heureuse de ce nouveau disque, le plus eurodance de tous [rires]. Tu parles de Corona, mais j’aime aussi Ace of Base ou la musique d’aérobic… [rires] même si je n’irais pas jusqu’à porter des leggings en lycra fluo. Ce qui m’attire dans ces musiques, c’est la danse.
Que se passe-t-il Dans Ton Corps durant tes performances ?
H. V. : Lors de notre concert pour les trente ans du Noumatrouff, j’ai eu des bouffées de chaleur, le cœur qui bat et les larmes aux yeux.
A. D. : Je suis traversé d’émotion et de bonheur. Ça bouge beaucoup, mais j’essaye de rester concentré sur mes batteries et machines.
— ATTRAPEZ-NOUS, Mouse DTC, Médiapop Records www.mediapop-records.fr
75
LES VIRAGES DE FRED POULET
Par Alma Decaix-Massiani ~ Photo : Dorian Rollin
LAURÉAT DU GRAND PRIX SPORT ET LITTÉRATURE PAR L’ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS SPORTIFS POUR SON ROMAN SUR MARCO PANTANI, FRED POULET EST DE RETOUR EN ALSACE POUR UNE SÉRIE DE CONCERTS.

Entre la musique, le cinéma, l’écriture d’un livre, beaucoup de projets émergents, arrives-tu à ne pas te perdre de vue ? C’est plutôt l’inverse, c’est grâce à cela que je reste en contact avec moi-même. Au début, je faisais que chanteur, je crois que ça m’a fait flipper. Donc quitte à se perdre… C’est pas que j’ai préféré faire comme j’ai fait, c’est que je n’avais pas le choix. En plus, je n’ai aucun contrôle sur mon existence… Je suis en panique, alors je fais des trucs.
Pourquoi ne pas avoir le choix ?
Parce que je crois que l’on ne peut pas faire réellement autre chose que ce que l’on fait, tu vois ?
On se raconte plein d’histoires, on voudrait être machin ou machin, et puis à un moment, on se rend compte qu’on fait toujours la même chose.
76
De gauche à droite : Maxime Delpierre, Fred Poulet et Günther Marisa
Les éditions Médiapop te sont familières, tu es en train d’écrire un livre sur le Football Club de Mulhouse, peux-tu nous en dire plus ? Quel est ton rapport à ce sport ?
Oui, je suis en train, je ne l’ai pas fini, mais c’est vrai. J’ai un rapport étroit avec le foot, tu vois, là on est à Brunstatt, il s’avère que j’ai joué à Brunstatt. J’ai aussi fait la rubrique sport dans la revue Vacarme pendant un moment, où je parlais beaucoup de foot, et ça m’a amené à faire un film avec un footballeur pendant la Coupe du Monde 2006 [Substitute avec Vikash Dhorasoo, ndlr]. C’est toujours présent dans ma vie. J’aime le football, je vibre pour cela, surtout si c’est la France, mais je ne suis pas réellement un supporter. En tout cas, dans ce livre je raconte quelque chose qui se passe entre fin 1981 et juillet 1982.
De manière plus générale, quel est ton rapport à Mulhouse ? A-t-il changé depuis que tu habites la ville de l’amour ?
Il a complètement changé, je suis parti depuis suffisamment longtemps pour ne plus être d’ici. Donc je reviens comme un étranger, pourtant tout m’est familier. C’est un sentiment étrange, très agréable que j’aime beaucoup, c’est un peu comme un rêve.
Côté musique, ton actu c’est La Gagne !, le disque de Monsieur Masters, avec ta voix, tes textes, ainsi que la flûte de Magic Malik, les instruments et chœurs de Cyril Aveque. Peux-tu nous décrire l’univers musical de cet album ?
En fait, j’ai fait un disque de Calypso parce que je voulais faire une musique dont j’avais rien à foutre. Pour être dégagé du fait de devoir se raccrocher à un seul style qui a donc ses limites, d’autant plus que je ne suis pas que chanteur. Alors j’ai raconté une histoire qui se passe dans les îles, avec lesquelles je n’ai aucune affinité. C’est surtout un projet avec des musiciens vraiment formidables, et qui reste accueillant pour d’autres musiciens.
On retrouve beaucoup de poésie dans tes productions. Te considères-tu comme un poète ? Est-ce que chacun l’est, à partir du moment où il crée ?
Du moment qu’il crée, je ne sais pas, mais j’entendais Virginie Despentes parler à la radio et elle fait beaucoup d’actions avec des gars en insertion, dans les quartiers populaires, et elle disait : « Je ne leur apprends pas à écrire, j’essaye de faire en sorte qu’ils prennent conscience que leur vie vaut la peine d’être racontée. » Je souscris à cette idée.
Il est question d’un spectacle sur Bashung, Rejouer Figure Imposée, auquel tu participes. Je suis en train de faire un film à partir d’archives qui introduira le spectacle. Bashung, je trouve sa musique très forte, d’ailleurs ce que j’ai joué ce soir s’en rapprochait assez. Le seul problème c’est qu’il m’a tout piqué. [Rires]
En 2005, tu confiais : « En tant qu’artiste, je vais d’espoirs en découragements, mais je ne suis pas à l’abri d’un miracle. » Dix-sept ans plus tard, le miracle est-il arrivé ? Tout le temps. En 2005, j’écris un article sur un footballeur qui s’appelle Vikash Dhorasoo dans Vacarme, une revue confidentielle qui se retrouve entre ses mains, et en 2006, je fais un film avec lui, qui sort au cinéma. Et c’était ma nouvelle vie, je suis devenu réalisateur. Ça, c’était un miracle absolu. Et toute ma vie, c’est ça.
Comment perçois-tu ton futur, artistiquement parlant ? J’en sais rien, moi, j’ai toujours été en panique que ça ne va pas s’arrêter maintenant.
Les Beatles ou les Stones ? Ah putain. [Rires] Pas celle-là, quoi… Je réponds pas musical, je réponds politique : les Beatles, parce que c’est les prolos. Mais musicalement, je ne répondrai jamais à cette question.
— 21 VIRAGES, Fred Poulet, En Exergue Éditions
— « LA GAGNE ! », Monsieur Masters, Médiapop Records
— FRED POULET, concert le 10 décembre au Noumatrouff (première partie de Rodolphe Burger), à Mulhouse www.noumatrouff.fr
—
77
On se raconte plein d’histoires, on voudrait être machin ou machin, et puis à un moment, on se rend compte qu’on fait toujours la même chose. —
NOUVEAUX TRIPS
Par Benjamin Bottemer ~ Photo : Nicolas Leblanc
TRADITIONS ET TERRITOIRES VISITÉS OU FANTASMÉS DESSINENT LA TRAJECTOIRE ACTUELLE DU VIOLONISTE THÉO CECCALDI, À L’ARSENAL DE
METZ CETTE SAISON.
Depuis la création de son trio en 2010, on tente de ne pas perdre de vue Théo Ceccaldi. C’est que l’Orléanais bouge beaucoup, sortant volontiers la jazzosphère de son axe. Avec le bouillonnant Tricollectif et son Grand Orchestre du Tricot, la liberté furieuse de Freaks, auprès du pianiste Roberto Negro, en tentet avec Joëlle Léandre… Emportant son instrument vers d’autres mondes, multipliant les rencontres, il trace un chemin qui aboutit ces dernières années sur les paysages de Constantine et de Kutu : de l’Algérie à l’Éthiopie, voix et électronique se conjuguent pour une grande dose de poésie et d’énergie brute, entre jazz, rock, musiques traditionnelles et énergie punk. Nourri à la liberté, premier enseignement du jazz, Théo Ceccaldi est l’un de ceux qui permettent à cette musique débridée de rajeunir et de se renouveler indéfiniment. Artiste associé à la Cité musicale de Metz cette saison, il accepte pour Novo de retracer ses explorations, escorté par son frère Valentin et par Haleluya Tekletsadik et Hewan Gebrewold, chanteuses de son projet « éthio-transe » KUTU.

Théo, on va parler de tes trois derniers groupes, qui cohabitent avec d’autres qui continuent à tourner. Tu as besoin de changer souvent de formation pour ne pas t’ennuyer ?
On peut aussi se renouveler au sein d’un même projet ! Avec le trio [ avec Valentin Ceccaldi à la contrebasse et Guillaume Aknine à la guitare, ndla], on a livré un album de compos, un autre d’impros et un troisième autour de Django Reinhardt. Et là, on a été invités par un domaine viticole en Gironde,
78
Château Palmer, pour composer une musique autour de l’un de leurs millésimes… autant de chapitres très différents donc.
Ton nouveau quintet, en concert en mars à l’Arsenal, est en tout cas composé de musiciens avec lesquels tu n’as jamais joué auparavant. C’est vrai que le quintet est né d’une envie de nouvelles rencontres, avec un combo assez spécial trombone-harpe-violon, où trois musiciens utilisent leurs voix. Violon et trombone marchent bien ensemble, le son du trombone très doux et celui plus « brillant » du violon. La harpe électrique de Laura Perrudin est hyperpolyvalente, pouvant jouer comme un synthé, une guitare électrique, une basse… Il y a également un jeune claviériste très ouvert, Auxane Cartigny, qui joue dans des groupes pop, electro ou jazz.
Cette volonté de transcender les clivages, c’est ta vision du jazz ?
Pour moi, ça ne correspond pas à une esthétique particulière, car ça englobe des choses extrêmement variées ; reste la notion d’impro et un état d’esprit aventureux et créatif avant tout. Auxane définit toute musique « non-formatée » comme du jazz. J’aime ne pas perdre pied avec la nouvelle génération en allant découvrir ce qui se fait de neuf, à La Gare à Paris par exemple, pour voir comment les jeunes conçoivent le jazz : ils savent tout faire !
Ton voyage en Éthiopie en 2019 a donné naissance à KUTU, un groupe « éthio-transe » qui a sorti en septembre un album, Guramayle Qu’es-tu allé chercher à Addis-Abeba ? Je ne savais pas exactement ce que je cherchais ! Je sortais tous les soirs dans les clubs et les azmari bets pour écouter la musique azmari d’aujourd’hui, rencontrer les musiciens qui se réapproprient la tradition et regardent ce qui se fait ailleurs. C’est le cas de Jano, le premier groupe d’éthio-rock, dont Hewan et Haleluya sont les chanteuses.
Comment définir la musique de KUTU, qui ne correspond à rien de ce que tu as fait jusqu’à présent ?
Une fusion de jazz, de musique éthiopienne, de rock, d’electro… je ne voulais pas d’un collage de musique azmari sur ma musique, je voulais créer quelque chose de singulier avec Hewan et Haleluya. Akemi Fujimori, aux claviers et à l’électronique, a une grosse présence, mais aussi la batterie de Cyril Atef, qui apporte un côté transe. On n’a pas conservé d’instruments traditionnels, mais ça reste une influence, par exemple lorsque je reproduis le son du masenqo, un instrument à cordes éthiopien, avec mon violon.
Hewan Gebrewold : Les paroles, entièrement en azmari, parlent de nos vies, de notre pays, d’amour… elles sont toujours à double sens : politiques et
poétiques. La musique de KUTU devait montrer la diversité d’un pays aux dix-huit nationalités ; autant de langues et de musiques différentes. Nous voulons être la voix de notre génération.
Haleluya Tekletsadik : On est fières de nos traditions, mais le fait de les mélanger à d’autres choses les rend encore plus uniques. On se sent libres de les emmener vers de nouveaux horizons ; KUTU et la rencontre avec Théo ont permis cela.
Ton avant-dernier disque Constantine est également une sorte de voyage, en hommage à ton père Serge Ceccaldi. Comment est-il né ? Notre père a essentiellement composé pour le théâtre, de manière assez confidentielle et sans rien enregistrer. Avec Valentin, on a voulu ressortir les partitions du placard pour ses 60 ans. Mais comme il le dit lui-même : « Théo et Valentin ont voulu faire quelque chose pour moi, mais ils le font aussi pour eux. » On se réapproprie largement sa musique. Il y a beaucoup de contrastes dans Constantine : des moments vraiment intenses, d’autres plus intimistes.
Un projet très personnel donc où ont été conviés les musiciens du Grand orchestre du Tricot et huit invités (Michel Portal, Thomas de Pourquery, Émile Parisien, le chanteur saoudien Abdullah Miniawy…). Il fallait cette force du collectif pour lui donner forme ? C’est un projet en famille : celle du sang mais aussi celle de cœur et de musique. De nombreux musiciens sont passés par l’école de musique que dirigeait notre père à Orléans. On a également voulu s’entourer de gens qui nous ont influencés, une démarche qui illustre bien le propos de Constantine, qui parle des chemins de vie de chacun, de l’influence de ces endroits par lesquels nous sommes passés, d’exil et de déracinement. Valentin Ceccaldi : Créer Constantine, c’était aussi remettre toutes ces musiques dans leur contexte, celui de notre histoire familiale en Algérie. Il a été pensé comme une entité, on ne voulait pas d’une succession de vignettes avec des invités qui défilent. Et le live est un spectacle à part entière.
Théo, la notion de voyage semble être une piste que tu explores actuellement : voyages véritables comme pour KUTU, mais aussi fantasmés avec ces folklores revisités dans Constantine et avec le quintet. C’est dans cette direction qu’évolue ta musique ?
Les folklores tels que je les conçois s’inspirent beaucoup de l’image que je m’en fais, des mélodies qui me viennent : c’est en quelque sorte un folklore intime. J’ai effectivement envie d’aller encore plus loin là-dedans, comme dans l’utilisation des voix, de l’électronique… et aussi aller en Afrique et en Amérique du Sud.
On a le sentiment que ton jeu est moins « devant », un changement qui semble coïncider avec ceux, esthétiques, de tes nouveaux projets. Là aussi, tu expérimentes une autre approche ? C’est vrai qu’au début j’étais plutôt dans un truc de soliste, une énergie très intense avec de gros solos. Là, je recherche plus la cohésion du groupe, la construction. Idem en termes de musiques : après un jazz influencé par les musiques contemporaines et improvisées, on est davantage dans le rythme, la danse et la transe. Il y a tant de choses qui nous intéressent, ce serait dommage de se priver !
— NUIT DU JAZZ, concert le 11 mars à l’Arsenal, à Metz
— CONSTANTINE, concert le 7 juin à l’Arsenal, à Metz www.citemusicale-metz.fr
79

Vaporeuses
Tandis que chez Camille Auburtin, l’élaboration du geste se fait par la souvenance de récits invisibilisés, chez Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky, les injonctions sociales brisent tout équilibre – individuel, familial, social.
LE TEMPS RETROUVÉ
 Par Valérie Bisson
Par Valérie Bisson
En corrélant son expérience chorégraphique à des formes diverses d’expression, objets filmiques, performances et ateliers d’éducation artistique, Camille Auburtin tente de répondre à plusieurs questions sur l’oubli et l’invisibilité. Filmer sa grand-mère ou travailler en milieu carcéral participe du même fil conducteur dans sa démarche. « J’ai toujours fait les deux, danse et cinéma, mais sans vraiment faire le lien. C’est la découverte du cinéma expérimental et de la ciné-transe des documentaires de Jean Rouch qui m’ont guidée vers ce que j’essaye de faire aujourd’hui. J’ai commencé à faire des films partout où je dansais. Finalement, c’est en vivant le mouvement à travers l’objectif, en explorant la composition chorégraphique par le montage, que mon chemin dans la danse s’est creusé. »
Cette grand-mère, Madame Auburtin « Mimi », ancienne danseuse professionnelle de formation classique ayant côtoyé chorégraphes et maîtres de ballet du début du XX e siècle, de Nijinska à Serge Lifar, son mentor, se voit atteinte de la
© Camille Auburtin CAMILLE AUBURTIN EST DANSEUSE ET CINÉASTE. DANS SON PREMIER DOCUMENTAIRE, LES ROBES PAPILLONS, ELLE CONVOQUE DIFFÉRENTES FORMES POUR ÉLABORER UN GESTE D’ÉCRITURE FAIT DE PELLICULE ET DE CORPS, SUPERPOSE LES RÉCITS, ET REDONNE DE LA LUMIÈRE À CE QUI A VOCATION À ÊTRE PEU À PEU RELÉGUÉ DANS L’OMBRE.
maladie d’Alzheimer et ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. En la filmant, Camille lui rend mémoire et dignité. « La réalité de son corps était devenue son immobilité, alors qu’elle n’avait eu de cesse de le mobiliser et de le faire vibrer. Quand je me rapprochais d’elle, la touchais, lui parlais à l’oreille, elle se détendait et finissait par m’identifier. La mémoire qui fait appel aux sens restait inscrite en elle. » La scène centrale du film remet la vie de Mimi en exergue, alors qu’elle ne se souvient plus de sa petite fille, celle-ci lui fait écouter la musique du Spectre de la rose et le geste renait, intact, précis, vivant. Un moment transgénérationnel vécu avec Marjorie, la tante de Camille, danseuse elle aussi, qui a eu une carrière internationale dans de grands ballets et au Conservatoire de Strasbourg où elle enseignait la danse classique et la danse jazz.
Images d’archives fixes ou mobiles, documents personnels, témoignages rendent hommage à la mémoire d’une vie consacrée à la danse. « Mimi s’est toujours passionnée pour l’évolution

des corps et des recherches autour du mouvement. Pendant près de quarante ans, elle a développé une approche pédagogique militante inspirée de pratiques chorégraphiques contemporaines. Très tôt, elle a mis en place, au Conservatoire régional de Metz, l’apprentissage de l’histoire de la danse et de l’anatomiephysiologie. Juste avant le début de sa maladie, elle avait encore un appartement à Metz et une vie sociale dynamique. Elle avait eu une vie artistique intense et riche, faite de rencontres, d’expériences, de voyages. »
En s’emparant de sa fragilité, invisible, la cinéaste dit aussi la réalité des corps des danseurs : en majesté sur scène, en souffrance en coulisses ; arthrose, blessures à répétition, carrière courte, corps de ballet oublié dans l’ombre ou centaines de danseurs aux carrières discrètes : « Ma grandmère est aussi devenue ma professeure de danse mais rapidement, malgré l’intensité de mes efforts, j’ai dû admettre que, pour la danse classique, mes hanches n’étaient pas assez ouvertes, mes tendons trop fragiles, mon coup de pied pas assez fort. J’ai persévéré en m’orientant vers le contemporain et je suis devenue danseuse professionnelle. » Les récits d’autres corps de danse s’ajoutent à l’histoire intime et donnent à voir ce qui est caché : « Les différents corps de danseurs présents dans le film incarnent aussi ma grand-mère, ils ont tous été ses élèves, Françoise Leick, aujourd’hui enseignante au Conservatoire de Metz, a dansé toute sa carrière avec Maguy Marin, il y a une ancienne soliste du Ballet de Bonn, une autre est professeure au Conservatoire de Saint-Avold, elles sont toutes dans les archives Super 8 et à la fois dans le film. J’ai dû imaginer différents dispositifs pour stratifier le récit : le témoignage oral d’un autre danseur, la robe rose, ample et fluide, la transmission d’une chorégraphie de ma grand-mère en vidéo-danse font partie de tous les procédés qui incarnent la personne qu’elle fut. »
Les Robes Papillons raconte notre histoire, celle de la transmission, par le geste ou le récit , celle dont on s’habille pour traverser la vie, celle qu’on continue à raconter à l’enfant que nous étions pour rêver encore… « J’ai voulu interroger cet héritage, le rassembler et le révéler afin de continuer cette passation : celle d’une force de vie lumineuse et de l’épanouissement du corps dans l’art et le mouvement. »
83
— LES ROBES PAPILLONS, Camille Auburtin, 2020
WORKING CLASS HEROES JORDAN
Le travail vecteur d’emprise et d’aliénation dans le moyen métrage étonnant de Brieuc Schieb Koban Louzoù (Grand Prix S. Labarthe). Le travail cynique instrument de contrôle du patronat sur les mouvements anarchistes du XIXe siècle dans le fascinant Unrueh de Cyril Schäublin (Prix de l’aide à la distribution). Le travail parfois dirty, difficult and dangerous, comme est là pour nous le rappeler le titre du beau long métrage de Wissam Charaf (Prix du public). La rétrospective consacrée à la trop rare Emmanuelle Cuau ( Offre d’emploi, Circuit Carole, Très bien, merci, Pris de court) a mis en lumière un regard perçant et subtil sur les mécanismes pouvant mener incidemment du « monde du travail » vers la violence et la folie.
Mais qu’est-ce qu’est censé être un travail acceptable, au fond, si ce n’est cette distance juste à trouver entre soi et ses rêves, entre soi et les autres ?
C’est une des pistes ouvertes par Hannah Ha Ha, un film de la compétition internationale signé Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky, et l’une des fictions les plus attachantes qu’il nous ait été permis de voir cette année à Belfort, toutes sections confondues.
Hannah vit chez son père dans une bourgade paisible du Massachusetts (Sharon, d’où sont originaires les deux cinéastes). Ses journées sont rythmées par son travail chez un maraîcher local, quelques cours de guitare qu’elle dispense dans son voisinage et des soirées au coin du feu avec ses amis. Mais son vingt-sixième anniversaire approche à grands pas, ce qui légalement aux ÉtatsUnis signifie la fin du rattachement à la couverture sociale de ses parents. De passage à la maison, son frère aîné Paul – le prototype du startuper aux dents longues – exhorte sa sœur à trouver un emploi plus rémunérateur et stable. Cette pression exercée par ce frère omnipotent va bouleverser l’équilibre sur lequel était fondé le quotidien de Hannah et de son père, sonnant pour eux le glas d’une période d’insouciance et de tranquillité.
Le long métrage de ce duo prometteur assume de prendre son temps pour approfondir son portrait de la classe moyenne américaine. Derrière l’apparente ligne claire de sa proposition formelle, ce film attentif et doux déploie une riche palette d’émotions. Il pointe discrètement cette tendance du marché du travail à verser dans l’illusion et les faux-semblants, sans pour autant nous dire que « c’était mieux avant ». Hannah Ha Ha s’apprécie comme un contrepoison salutaire au diktat de l’efficacité et à la recherche de réussite sociale à tout prix.
Rencontre avec son co-réalisateur Jordan Tetewsky.
LA QUESTION DU TRAVAIL S’EST SOUVENT POSÉE LORS DE LA 37e ÉDITION DU FESTIVAL ENTREVUES QUI S’ACHEVAIT À BELFORT LE 27 NOVEMBRE DERNIER.
TETEWSKY
Texte et photo par Nicolas Bézard
~ Traduction : Vincent Poli
84

Quel a été le point de départ de Hannah Ha Ha ? Joshua et moi avions déjà écrit plusieurs scénarios et réalisé des courts métrages. Mais la réalisation d’un film long exigeait un budget qui était hors de notre portée. En 2021, nous avons tout de même réussi à sortir trois courts, dont un en mars avec l’actrice qui interprète Hannah dans Hannah Ha Ha . Ce dernier film était d’ailleurs une sorte de prototype du long métrage à venir. L’été est arrivé et Josh était libre. Moi-même, je venais de terminer un boulot sur un film. Cela faisait cinq ou six ans que l’on avait cette idée du long métrage en tête et on s’est dit que c’était le moment de tenter l’aventure, même si nous n’avions que très peu d’argent.
Comment vous répartissez-vous les rôles avec Joshua Pikovsky ?
Au tournage, je m’occupe essentiellement de la caméra là où Josh s’occupe plutôt du son. Il regarde aussi beaucoup les acteurs puisque c’est lui qui supervise les essais puis les répétitions, pendant que je réfléchis davantage au travail de l’image, à la préparation des angles, des cadrages. Le manque de moyens a fait que nous n’avons utilisé que peu de lumière additionnelle, et nous ne tournions
qu’un faible nombre de scènes par jour. Au final, il y a quelques moments d’improvisation dans le film, mais l’essentiel de ce que l’on y voit a été déjà scrupuleusement écrit en amont.

Votre actrice Hannah Lee Thompson est musicienne, son frère dans le film est joué par le producteur Roger Mancusi, et leur père est incarné par votre propre père, Avram Tetewsky, absolument brillant dans son rôle. Pourquoi avezvous choisi de travailler avec des comédiens nonprofessionnels ?
Parce qu’on aime bien travailler avec les amis et la famille (rires). Et dans le film, même s’ils ne sont pas comédiens de métier, je pense qu’ils s’en sortent très bien. Mon père a déjà joué dans quatre de mes films, et en ce qui concerne Hannah Lee Thompson, j’avais envie de travailler avec elle depuis dix ans, d’où ce court métrage que j’ai réalisé en 2021. Je dois préciser qu’elle est différente dans la vie que dans ce que donne à voir d’elle Hannah Ha Ha. Certes, nos interprètes n’ont jamais reçu de formation d’acteur, mais ils ont effectué un véritable travail de composition et ont su nous proposer quelque chose d’éloigné de ce qu’ils sont au quotidien.
86
Hannah Ha Ha, Jordan Tetewsky & Joshua Pikovsky, 2022
Il y a des films d’action et il y a des films d’observation. Dans Hannah Ha Ha , beaucoup de choses se jouent dans ce qui est simplement perçu à travers le regard de votre héroïne. Et le film possède lui-même une grande qualité d’observation, en s’attachant à des détails qui associés contribuent à donner au film son authenticité et sa profondeur.

En effet, la question de l’observation et du regard est très importante dans ce film. Mais je pense qu’elle n’est pas uniquement dévolue au regard de Hannah. Les spectateurs voient aussi beaucoup de choses que Hannah ne voit pas. Le déclin de santé de son père, par exemple, lorsque ce dernier se promène en forêt et se retrouve soudain complètement désorienté au milieu d’un terrain de golf pour gens fortunés. C’est quelque chose qui échappe à Hannah. De cette manière, le regard du film est plus élargi et tend vers une certaine vision objective du réel, à partir non plus seulement du point de vue des personnages, mais de la caméra.
On apprend à connaître vos protagonistes à travers leurs actions, leurs mots, mais aussi et surtout leurs silences. L’écriture du film n’entre jamais dans une forme de psychologie. On reste à l’extérieur et chacun peut ainsi à sa manière imaginer les pensées et motivations intimes des personnages.
Le film ne penche pas vraiment vers ce côté psychologique, vous avez raison. Il nous importait de ne pas dicter au public ce qu’il doit voir ou comprendre, de ne pas le prendre par la main. Et pour le moment, j’ai l’impression qu’il nous en est plutôt reconnaissant.
Ce béhaviorisme, cette absence de psychologisation, cela me rappelle beaucoup le roman américain de la middle class américaine : Richard Ford, Richard Yates, Raymond Carver. Cette littérature a-t-elle constitué une source d’inspiration pour l’écriture de ce film ?
Oui, nous avons pensé à des écrivains, mais notre inspiration première, ce sont les problèmes économiques auxquels sont confrontés la plupart de nos proches, un sujet que l’on rencontre beaucoup dans la littérature américaine. Nous voulions montrer comment cette classe moyenne qui se débrouille en travaillant doit faire face à une instabilité de plus en plus prégnante. Le fait que notre film part d’un regard individuel pour finalement s’élargir à toute une communauté le rapproche certainement des livres des auteurs que vous citez. Du côté du cinéma, nous nous sommes référés à des grands auteurs américains indépendants des années 1970 comme Bob Rafelson
et son film Five Easy Pieces, mais également à des œuvres plus récentes, je pense à Old Joy de Kelly Reichardt, ou au cinéma d’Andrew Bujalski.
Pour revenir à la fabrication du film, ce dernier bénéficie d’une photographie singulière qui restitue avec finesse la douceur des couleurs et la lumière chaude, presque ouatée, de la NouvelleAngleterre en été. Vous avez recours à des focales longues qui réduisent la profondeur de champ et donnent une forme de rondeur à l’image. On pense parfois à Edward Hopper, qui a d’ailleurs beaucoup peint cette région des États-Unis. Je constate effectivement que cet aspect légèrement vaporeux de l’image a été remarqué par beaucoup de gens, c’est d’ailleurs quelque chose qui divise. Personnellement, j’ai un faible pour ces couleurs un peu lavées. Un long métrage qui nous a visuellement inspiré, c’est The Long Goodbye de Robert Altman. Certes, dans ce film, vous avez une caméra erratique et ce n’est pas du tout le cas dans Hannah Ha Ha, mais il s’en dégage une atmosphère de rêve éveillé assez fascinante, et c’est cela que nous voulions reproduire avec les teintes adoucies de Hannah Ha Ha . Les tableaux d’Edward Hopper n’étaient pas une référence consciente mais maintenant que vous le dites, je comprends l’analogie. En fait, ce que j’utilise et ce que j’ai déjà utilisé plusieurs fois sur d’autres films, ce sont des collants que je place devant la lentille de la caméra afin d’obtenir cet effet assez étrange où les couleurs donnent l’impression de se mélanger.
La bande originale du film, très folk, est composée et interprétée par Arden Yonkers. Quelle place vouliez-vous lui donner par rapport aux images et aux émotions des personnages ? D’une certaine façon, elle était là pour souligner le ton des scènes, pour donner un caractère presque confortable au film. Nous avions été impressionnés
87
Hannah Ha Ha, Jordan Tetewsky & Joshua Pikovsky, 2022
par la collaboration entre le groupe Yo La Tengo et Kelly Reichardt pour Old Joy, c’était un exemple à suivre. Nous avons donc demandé à Arden Yonkers de composer toutes les musiques, y compris la chanson que l’on entend dans la séquence chez le glacier. Néanmoins, les scènes n’ont pas été pensées avec de la musique dès le départ. À l’exception de la séquence du golf, nous avons écrit, tourné et même monté le film sans nous soucier des musiques additionnelles, qui ne sont arrivées qu’à la toute fin.
Le film donne le sentiment d’une approche lente et douce des personnages. Beaucoup de choses sont tues ou suggérées plutôt que montrées : la vie sentimentale de Hannah par exemple dont on ne connaît pas grand-chose, ou la santé possiblement fragile de son père.
C’est vrai qu’il y avait cette envie de ménager de l’espace entre les récits, entre les personnages, entre les spectateurs et les personnages. Mais nous avons quand même laissé quelques indices pouvant permettre au public de combler ces interstices. Par exemple, il est question à deux endroits de l’excompagne de Hannah, mais je me demande si cela est réellement perçu par tout le monde, je n’en suis pas certain.
Face à ce frère qui la somme de trouver un emploi, Hannah pourrait avoir le vertige et s’effondrer, mais il n’en est rien : elle endure, persévère, et fait preuve d’abnégation. Le seul moment du film où l’on sent une réelle perte de repère, c’est lorsque son père sort de chez lui et finit par se perdre sur un terrain de golf.
Le fait que son frère lui mette la pression pour qu’elle trouve ce qu’il appelle un vrai travail est presque périphérique par rapport à l’arrièreplan familial compliqué que le spectateur devine. Hannah est très active là où son père perd légèrement pied, mais je vois cet homme comme quelqu’un qui n’a pas capitulé, et qui continue de mener la bataille. C’est vrai que mentalement, c’est difficile pour lui, mais il a encore l’esprit vif et il est présent avec son entourage. Dans cette scène du terrain de golf, le père de Hannah sort de chez lui dans l’espoir de briser sa solitude, car il vit le même ennui que sa fille dans son nouveau travail. Leurs deux trajectoires se rejoignent. Et lorsqu’il pénètre sur le green et se retrouve insulté par un golfeur, c’est quelque chose qui nous est arrivé à Josh et moi alors qu’on se baladait dans notre ville. On s’est égarés et un golfeur nous a menacés de mort. On tenait donc à utiliser cette anecdote, car on trouvait qu’elle fonctionnait bien à cet endroit du film, même si elle ne fait pas avancer directement l’intrigue. Elle montre aussi comment
la ville se transforme, avec des rues supprimées et de nombreux arbres coupés pour construire ce genre d’endroits pour populations nanties.
Votre film réfléchit sur le sens de ce que signifie réussir.
C’est la question centrale du film, et elle est directement connectée à celle du travail. Si vous prenez Hannah au début de l’intrigue, c’est quelqu’un qui mène une vie simple mais très utile, car orientée vers la communauté, avec les cours de guitare qu’elle donne, son travail chez le maraîcher. Cela contraste avec son frère dont on ignore à quel point ses activités contribuent à la société. Il exerce un métier qui semble en réalité entretenir beaucoup d’artifices et de faussetés. Avec Josh, nous avons remarqué que de plus en plus de boulots isolent et séparent les gens. Avant que son frère intervienne, Hannah ne gagnait pas beaucoup d’argent, mais elle travaillait, elle s’en sortait. La mélancolie du film vient en partie du fait qu’un grand nombre de vies sont aujourd’hui gâchées par des emplois tel celui que Paul veut imposer à sa sœur.
Face à cela, la vérité ne vient-elle pas de la bouche de l’oncle de Hannah, animateur dans une radio locale, lorsqu’il dit : « What do you need a real job for ? »
C’est sans doute un peu plus compliqué que ça. À mon avis, la question serait plutôt : pourquoi Hannah ne peut pas continuer à vivre sa vie telle qu’elle a existé pendant des années ? Une vie où elle travaillait beaucoup – et cette précision est importante pour moi. Quels sont les critères pour juger du sérieux d’un emploi ? On sait pertinemment que pour tout un chacun, la vie est une lutte, une bataille de tous les jours, donc pourquoi décréter que certains emplois sont valables et que d’autres ne le sont pas ? Nous espérons que Hannah Ha Ha invite à réfléchir à ces questions.
— HANNAH HA HA, Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky instagram.com/hannahhahamovie
Cet entretien est disponible en podcast parmi d'autres sur le site de Flux4, la radio partenaire du Festival Entrevues : www.flux4.com/index.php/entrevues
88
Cycles
Cascade d’expositions, réalités alternatives, art asilaire, essence du geste, intimité graphique, énigmes sonores, expérimentations textiles, reflets décalés, renouvellement passé, rythmes gravés…
Cette année s’achève sur une irrésistible question : le côté du champignon qui fait grandir ou celui qui fait rapetisser ?
Pouvez-vous revenir sur ce qu’est la Regionale, en quelques mots ?
Un grand événement transfrontalier piloté par Bâle depuis vingt-trois ans, dont le but est de promouvoir l’art contemporain local, et qui regroupe aujourd’hui une vingtaine d’institutions suisses, allemandes et françaises. La règle du jeu étant de proposer, dans chaque espace, des artistes des trois nationalités. Peinture, dessin, performance, photographie, art numérique… Pas de thème imposé, mais une large sélection de productions d’artistes toutes générations confondues, confirmés ou émergents, le tout encadré par un commissariat propre à chaque lieu – musées, galeries et même un bar du côté de Bâle.
Chaque exposition est indépendante ?
Oui, complètement, chaque lieu conserve une grande liberté, ce qui permet une vraie mise en valeur de la scène artistique d’un territoire qui nous est proche et loin à la fois. Chaque lieu propose le travail d’artistes différents et multiplie ainsi la visibilité de tous. Alors, on peut choisir de ne voir qu’une seule expo, après c’est beaucoup plus enrichissant de passer d’un lieu à l’autre et d’aller découvrir aussi ce qui se passe de l’autre côté des frontières. Tout a été pensé pour profiter un maximum avec des horaires harmonisés, un bus tour, des vernissages en cascades Regionale est un événement très festif.

Parlez-nous de l’expo sur laquelle vous avez travaillé.
Elle s’intitule « Sitting in front of the mirror », c’est une double expo à découvrir à Strasbourg, à la fois à Garage COOP, notre nouveau site, et à La Chaufferie, la galerie de la Haute École des arts du Rhin. Nous avons invité une jeune commissaire lyonnaise, É milie d’Ornano, qui a sélectionné 16 artistes parmi les 700 candidatures du pot commun de la Regionale. Il y a des sculptures, des installations, des vidéos, toutes autour de l’estime et de l’image de soi, de l’absence, du manque. Les expos de cette commissaire portent en elles un aspect doux-amer : un côté girly-queer, des questions intimes et des sujets profonds. C’est un artiste tout juste sorti de l’école d’art de Strasbourg qui nous l’a présentée… On a également travaillé sur une scénographie très pointue, basée sur des matériaux jouant sur les ombres, les reflets, le tout en mutualisant nos moyens et nos savoir-faire.
— REGIONALE23, festival jusqu’au 8 janvier dans divers lieux de la région de Bâle et de la région trinationale regionale.org
— SITTING IN FRONT OF THE MIRROR, exposition du 9 décembre au 15 janvier à Garage COOP et La Chaufferie, à Strasbourg garage-coop.org / www.hear.fr
ARTISTES SANS FRONTIÈRES
CHAQUE ANNÉE, LA REGIONALE REGROUPE 200 ARTISTES ET UNE VINGTAINE DE LIEUX D’EXPOSITIONS EN SUISSE, EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE. SOPHIE KAUFFENSTEIN, DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION STRASBOURGEOISE ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES, REVIENT SUR LE VOLET FRANÇAIS DE CETTE MÉGA-EXPO.
Par Aurélie Vautrin
90
Jan Hostettler, Zusammen Scheitern © Jan Hostettler
LES AUTRES EXPOS DE LA REGIONALE, CÔTÉ FRANCE
TRANSMERGENCE
Le FRAC fait dialoguer l’art et l’artisanat comme langage universel de transmission, interrogeant les frontières établies par la société occidentale entre ces entités aux similarités indéniables. L’expo est centrée sur des travaux artistiques qui utilisent des techniques artisanales répétitives : crochet, tricot, couture, broderie, dessin, peinture… Des questionnements d’autant plus intéressants que les traditions textiles et les arts appliqués partagent une longue histoire dans la région transfrontalière.
—TRANSMERGENCE #04 ART E-S-T MÉTIER, exposition du 10 décembre au 5 mars au FRAC Alsace, à Sélestat frac-alsace.org
DANS LE DOUTE
Orchestrée par la nouvelle équipe de FABRIKculture, l’expo met en avant l’échec en tant que performance, appuyant l’idée que créer, c’est aussi parfois échouer. D’ailleurs, combien de revers a-t-il fallu traverser pour aboutir à cette même exposition ? Combien de tentatives avant d’aboutir à l’œuvre proprement dite ? Les dix-sept artistes réunis ici défont le jeu du processus de création pour assumer les failles et les erreurs de parcours, montrant ainsi la création artistique comme un acte d’espoir.
— DANS LE DOUTE, UN PAS DE CÔTÉ
- IM ZWEIFEL ZICKZACK, exposition jusqu’au 8 janvier à FABRIKculture, à Hégenheim fabrikculture.net
OUR DAY
À Mulhouse, deux expositions très différentes : à La Filature, le travail de Stephen Dock, photographe français autodidacte, témoin des traces laissées par les conflits en Irlande du Nord comme celles trouvées dans une ancienne maison d’arrêt à l’abandon… Tandis qu’à la Kunsthalle, autre ambiance : trois expos successives dans un chalet éphémère installé sur le marché de Noël, qui invitent le public à fermer les yeux, respirer, et se détacher quelques instants d’un monde matériel lourd d’inquiétudes.
— STEPHEN DOCK, OUR DAY WILL COME + CONSTRICTION, exposition jusqu’au 8 janvier à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
— FERME LES YEUX ET RESPIRE, exposition jusqu’au 27 décembre à La Kunsthalle, marché de Noël, à Mulhouse kunsthallemulhouse.com
 Saba Niknam, Nommo le dieu poisson © Saba Niknam
Saba Niknam, Nommo le dieu poisson © Saba Niknam
91
PRÉSENCES DU FUTUR
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
En 1977, lors du Festival international de sciencefiction de Metz, Philip K. Dick déclarait dans une conférence restée célèbre : « Si ce monde vous déplaît, vous devriez en voir quelques autres. » Le Centre Pompidou-Metz prend au mot le maître des réalités alternatives en évoquant, à travers deux galeries et quelque 200 œuvres, une littérature SF politique et critique née à la fin des années 1950. L'exposition « Les Portes du possible » s’articule autour des lignes de force (univers fascisants, cyberpunk, biopunk, afro-futurisme...) d’une « new wave » revendicatrice et volontiers expérimentale du point de vue esthétique.
LA CARTE ET LE RÉSEAU
Cinq thématiques sont abordées dans autant d’espaces nommés en référence à de grands classiques : Soleil vert, Neuromancien, Le Meilleur des mondes... l’œuvre phare d’Aldous Huxley prête son titre à une première partie mettant en scène les architectures de sociétés futures : régimes totalitaires ( Soleil double de Laurent Grasso et son évocation de l’architecture fasciste, la Slave city de l’Atelier Van Lieshout...), caricatures des mégalopoles d’aujourd’hui, champs de ruines rappelant le Stalker adapté par Tarkovski, déserts... Un monde qui semble craquer sous son propre poids mais qui se réinvente aussi au gré des hybridations : Is More Than This More Than This de John Isaacs, homme obèse grignoté d’immeubles et de végétation, en est le symbole.
LE CENTRE POMPIDOU-METZ MET EN VOLUMES
EN IMAGES UNE SCIENCE-FICTION INSURGÉE, DÉBRIDÉE ET PLURIELLE EN ÉTAT DE MÉTAMORPHOSE PERMANENT.
ET
92
Le cyberpunk prend le relais : la technologie intégrée aux corps pour mieux manipuler les esprits devient monstrueuse (l’amas cronenbergien Hardware de Diego Bianchi) et déshumanisante (la Chine robotisée d’Asia One de Cao Fei). Le cloud computing où les drones apparaissent comme les prolongements des interrogations d’un genre ayant émergé dans les années 1980. Nulle trace du hacker, sa figure emblématique, qui se réapproprie les technologies pour mener la lutte... à moins que ces as du détournement ne soient les artistes eux-mêmes.
ORGANISMES ILLIMITÉS
Puis rêvent les androïdes, dont le corps est l’étendard. Cyber-féminisme et créatures queer croisent une Wonder Woman passée au cutup, des enchevêtrements de cuir, des armures
biomécaniques androgynes. Les mutations effacent les frontières entre hommes et femmes, humains et machines, virtualité et réalité. Même les murs de la maison semblent se fissurer sous l’invasion : la paroi sanglante d’Adriana Varejão, métaphore du cannibalisme culturel au Brésil, côtoie la troublante (et velue) Pince à câlins d’Anna Uddenberg. Dans les élégantes sculptures de Lee Bul, le corps féminin semble éclore vers un nouvel état.
La SF n’a pas attendu le dernier rapport du GIEC pour anticiper le changement climatique : la climatefiction et le biopunk de la partie « Soleil vert » ont un temps d’avance. Ici le cyborg est fait de chair, de circuits et de racines. Corps et architectures se reconnectent avec la nature, parfois avec violence : les floraisons cadavériques des Chrysalides de Patrick Bernatchez, la « nouvelle écologie » mutante de Tetsumi Kudo, les insectes-robots végétaux de Max Hooper Schneider et Rina Banerjee...

Le continent oublié de la science-fiction a ses apocalypses : esclavage, colonisation, racisme.
La dernière partie des Portes du possible est consacrée à l’afro-futurisme, outil d’émancipation où les mythes et les cultures non-occidentales sont réinventés. Voyages, exil et mort dans les navires colorés de Hew Locke RA, lutte anti-apartheid (A Reversed Retrogress de Mary Sibande), « écosystème de révoltes et de soulèvements » dans la fresque The Deep & Memories de Josèfa Ntjam... lever le voile sur ce courant artistique méconnu constitue sûrement la meilleure idée de l’exposition.
POINTS DE VUE SUR L’AVENIR
Faisant la part belle à des créations récentes et aux jeunes artistes, Les Portes du possible propose un regard actuel du monde de l’art sur des thèmes emblématiques de la SF, et remet en évidence l’intérêt du genre pour penser hier, aujourd’hui et demain. De plus, les nombreux grands formats, les sculptures mutantes, les noirceurs et les couleurs de la pop culture offrent une expérience visuelle souvent forte. Les œuvres composant ce cycle de métamorphoses (de nos corps, de notre environnement, de nos sociétés) esquissent un avenir justement hybride, entre idéal et tragédie, même si pour l’auteur Kim Stanley Robinson, « l’utopie ou la catastrophe sont probables mais plus l’entre-deux » ; on peut aussi lui préférer le point de vue du romancier Philippe Curval : « L’être humain est une utopie qui cherche à se réaliser. »
— LES PORTES DU POSSIBLE, exposition jusqu’au 10 avril au Centre Pompidou-Metz www.centrepompidou-metz.fr
93
Larissa Sansour, Nation Estate, 2012
CLAIRVOYANCE DE
FOLIE
Par Luc Maechel
C’est en 1945 que Jean Dubuffet pose le périmètre de l’art brut : « des œuvres créées hors de tout conditionnement culturel et de tout conformisme social », un art asilaire…
Au commencement, début XIX e siècle, il y a l’asile d’aliénés : un dispositif de mise à l’écart des fous pour protéger la société. Un cadre rude : traitements brutaux (camisole, pratique récurrente des bains glacés…) et malnutrition. Dans cet espace réservé, hors du temps, certains internés se consacrent à des pratiques artistiques (parfois en cachette). Progressivement, des médecins s’y intéressent, préservent les travaux et commencent à les exposer vers 1914. Ils sont réalisés avec

LA
CONSACRER UNE EXPOSITION À L’ART BRUT EST UNE ENVIE ANCIENNE DE MARIE-FRANCE BERTRAND, DIRECTRICE DU MUSÉE WÜRTH. ELLE S’EST CONCRÉTISÉE GRÂCE À L’EXPERTISE ET AU RÉSEAU DE JEAN-PIERRE RITSCH-FISCH, GALERISTE STRASBOURGEOIS EXPERT EN MATIÈRE D’ART BRUT ET CO-COMMISSAIRE AVEC CLAIRE HIRNER DE CE DIALOGUE SINGULIER. GRÂCE À LUI, L’EXPOSITION BÉNÉFICIE DE NOMBREUX PRÊTS : LES TROIS QUARTS DES PIÈCES PRÉSENTÉES N’ONT JAMAIS ÉTÉ EXPOSÉS.
Ira, 1986, Huile sur toile, 162 x 130 cm, Collection Würth
94
© Georg Baselitz 2022. Photo : Jochen Littkemann, Berlin
peu de moyens et la plupart des auteurs restent anonymes. Des tendances se dégagent : tout le support est couvert, très souvent au recto et au verso, des récurrences obsessionnelles s’invitent, des annotations aussi, et fréquemment une grande prolixité (emblématique : l’autobiographie fantasmée d’Adolf Wölfli). Des caractéristiques qui demeureront quand l’art brut s’élargira au-delà du cadre psychiatrique avec la reconnaissance et l’attribution progressive des œuvres.
En dépit de cet isolement, il est troublant de découvrir des analogies : Chakinoff Nazaretnidoff (1932) évoque les jardins de Sennefer (XVIIIe dynastie, une représentation de l’espace avant la perspective), plus loin Léonie (1914), un dessin de profil, rappelle Klimt… Parenté ou constantes ataviques ? « Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux » (Christian Bobin, Le plâtrier siffleur, 2018). Et la main pour les transcrire…
La publication d’Expressions de la folie de Hans Prinzhorn en 1922 change le regard sur ces œuvres, mais bientôt la propagande s’en empare. Les nazis organisent l’amalgame pour jeter le discrédit sur l’Entartete Kunst (l’Art dégénéré) avec l’exposition inaugurée en juillet 1937 à Munich. Gratuite et itinérante, elle circule durant quatre ans dans les grandes villes du Reich, suscitant une curiosité tant pour les artistes estampillés fous que ceux réprouvés par le régime : elle sera vue par près de trois millions de visiteurs. Grâce à son fond, le musée Würth renoue ici ce dialogue entre Paul Goesch et Emil Nolde.
L’ENGAGEMENT DE DUBUFFET
Dès l’après-guerre, Dubuffet, lui-même autodidacte, collectionne et défend ces artistes. « L’œil existe à l’état sauvage », comme l’écrit André Breton qui le soutient un temps. Au bout de trois décennies de pérégrination, Lausanne ouvre un musée à sa collection en 1976. Ce regain d’intérêt rappelle que l’art brut a inspiré les artistes établis tout autant que les arts dits premiers. Certains le revendiquent : Dalí, Tinguely, Baselitz dont l’Ira (1986) accueille le visiteur.
Dès lors, l’art brut sort du champ asilaire et s’élargit à des artistes œuvrant en marge des « instances de légitimation » et des logiques qui fabriquent l’art officiel. Ils exercent parfois un métier modeste, ont presque toujours des itinéraires de vie atypiques fréquemment marqués par le traumatisme. La quantité demeure avec les nombreux recto-verso d’Aloïse Corbaz qui systématise les bouches en forme de cœur, les quinze mille feuillets d’Henry Darger dont le graphisme rappelle Little Nemo, la tension monothématique avec les créatures de Josep Baqué ou les impressionnantes sculptures inspirées des danses de mort du boulanger strasbourgeois Hervé Bohnert. La récupération – épluchures (Philippe Dereux), coquillages (Paul Amar), matériel électronique (A.C.M.) – stimule l’inventivité et une exubérance kitsch chez certains.
Anonyme (Léonie), Dans les cols désastreux la folie en montre à la raison, 18.01.1914 Pastel, crayons de couleurs et fusain sur papier, 63 x 49 cm. Collection privée, courtoisie galerie J.-P. Ritsch-Fisch, Strasbourg, Photo : Thierry Ollivier

S’y agrège aussi un nouveau champ : les productions médiumniques créées sous influence (voix intérieure, etc.). L’hommage de Julian Schnabel à Victor Hugo (1990) – adepte du spiritisme – suggère son ancienneté.
NOUVEAU REGARD
Dans les années cinquante, la commercialisation des premiers neuroleptiques permet de calmer les agités et de nouvelles pratiques naissent, dont l’art-thérapie qui clôture le parcours. Au fil des cimaises s’impose un art intime, discret et essentiel : le regard sur le monde de ceux qui sont en dehors, mais aussi leur monde – proche ou lointain – qui nous regarde avec, surgissant de leurs images, ces yeux béants qui invitent à « fermer les yeux en les gardant ouverts » (Jean-Philippe Toussaint, L’Urgence et la patience, 2012, éditions de Minuit).
— ART BRUT, UN DIALOGUE SINGULIER AVEC LA COLLECTION WÜRTH, exposition jusqu’au 21 mai au Musée Würth, à Erstein un cycle de cinq cours sur l’art brut (du 26 novembre au 18 mars) animé par Anne-Virginie Diez accompagne l’exposition www.musee-wurth.fr
95

POUR CETTE EXPOSITION CONSACRÉE À FABIENNE VERDIER, LA COMMISSAIRE FRÉDÉRIQUE GOERIG-HERGOTT A IMAGINÉ UN PARCOURS INITIATIQUE À TRAVERS LE MUSÉE UNTERLINDEN. MENANT VERS L’ACKERHOF REPENSÉE EN CHAPELLE ARDENTE, CET ÉCHO COSMIQUE À LA NEF ABRITANT LE RETABLE D’ISSENHEIM A POUR AMBITION DE METTRE EN RÉSONANCE LE TRAVAIL DE L’ARTISTE AVEC LES COLLECTIONS. CHORÉGRAPHIE COSMIQUE Par Luc Maechel Cetus, 2018, Acrylique et technique mixte sur toile, 183 × 407 cm © Inès Dieleman 96
Les principales étapes de son chemin sont présentes : l’influence de la Chine, les maîtres anciens, la musique, sa fascination pour l’énergie universelle avec les Rainbows réalisés en lien avec ce sidéral embrasement qui transfigure le Christ de Grünewald et tentent de représenter la lumière.
GESTE ESSENTIEL
«
Saisir l’instant en un trait, voilà ce qui me fascinait. » (La Passagère du silence, 2003, éd. Albin Michel)
Le trait essentiel – « l’unique Trait de Pinceau » de Shitao – pourrait caractériser la quête de l’artiste. Mais accéder à l’essence par un seul geste est complexe. Aussi, elle lit beaucoup, échange, écoute afin d’élaborer en amont cette économie et cette concentration. Cependant, pas de geste sans support : le glacis du fond – dense, subtil, vibrant, mais fin et brillant – capte et renvoie la lumière alors que la trace du « motif » épais, coagulé, retient les ombres.
Si l’artiste utilise l’acrylique, elle s’est longuement penchée sur l’alchimie des glacis de la peinture flamande du XVe siècle. « Depuis vingt ans, je cherche, j’invente des fonds de tableaux susceptibles d’accueillir avec grâce la pensée poétique des coups de pinceau du walking painting » : de gros pinceaux suspendus manœuvrés par un guidon ou une poche à douille déposant par gravitation une matière généreuse sur la toile posée au sol. Ainsi l’énergie chorégraphique du corps-outil agrandit le geste du calligraphe à la dimension de ses grands formats.
Cette diffraction entre le rayonnement du glacis et l’ample matière du trait qui se permet parfois une « entrée ou sortie de champ » (Cetus, 2018) est pour beaucoup dans la magnétique vitalité des peintures de Fabienne Verdier.
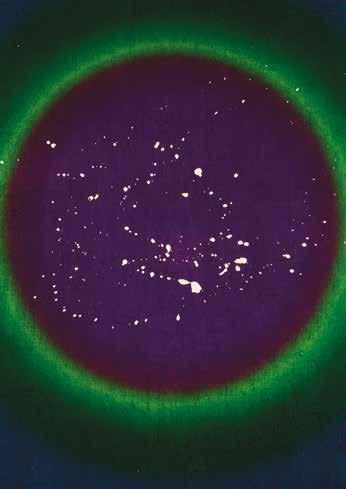
CERCLES ET CONFINS
« Le cercle est le point central : vide nourricier, plénitude première, lieu de naissance de tout ce qui est. » (La Passagère du silence)
Avec Rainbows, le fond de chaque pièce décline une interprétation du halo d’or en fusion (Huysmans) de La Résurrection de Grünewald, ce cercle aux frontières impalpables vibrant des couleurs de l’arc-en-ciel. De ces bleus nuit, de cette matière noire, de ces aurores incandescentes jaillit le geste de l’artiste : tourbillons, pouponnières d’étoiles, lave en fusion, éclaboussures éthérées…
Chaque arc-en-ciel se veut à la fois le portrait d’une étoile et, à travers un prénom choisi, une nouvelle naissance pour une victime de la pandémie, car les étoiles meurent pour renaître.
Tsala, 2021, Rayonnement, aurore boréale, Géorgien, acrylique et technique mixte sur toile, 183 x 135 cm, photographie : Inès Delieman © Fabienne Verdier, ADAGP, Paris, 2022
Les deux registres des Rainbows convergent vers le Grand Vortex d’Unterlinden (2022) : un portrait de cette « maison-mère » qu’est le néant?
Avec cet enveloppant mandala de la nef, Fabienne Verdier se mue en passeuse d’éternité et nous invite à « retrouver l’unité primordiale qui nous mène à l’éveil ».
—
FABIENNE VERDIER
LE CHANT DES ÉTOILES, exposition jusqu’au 27 mars au Musée Unterlinden, à Colmar www.musee-unterlinden.com
— DANS L’ŒIL DU COSMOS, DESSINS DE FABIENNE VERDIER exposition jusqu’au 5 février au Saarlandmuseum – Moderne Galerie à Saarbrücken www.modernegalerie.org
97
DÉFENSE DE L’AFFICHER
Par Lucas Le Texier
RÉFÉRENCES DANS LE GRAPHISME DE CRÉATION, LES DEUX MONSTRES DE LA
1997, an 0 pour ter Bekke & Behage, soit 25 ans déjà que l’atelier des graphistes néerlandais fait de l’affiche et du flyer, un art. À la suite de leur rencontre à Paris, les deux Hollandais, Evelyn et Dirk de leurs prénoms, fondent leur atelier éponyme. Ce qui leur plaît en France ? L’implication que l’on exige de ceux qui confectionnent les supports de communication. L’importance des enjeux sociaux, politiques et culturels, aussi. Les liens entre arts graphiques et idéologies en URSS, et les utopies portées par l’école du Bauhaus dans l’Allemagne des années trente, condamnées par les nazis, les précèdent dans la question du rôle et des utilisations de la discipline. La première question est donc celle-ci : qu’est-ce le graphisme français ? Au Signe, de la sélection faite par les deux graphistes dans « Ça s’en va et ça revient », il ressort que le pendant français né à la fin du XIXe se nourrit de l’œuvre des peintres et de la culture visuelle des Beaux-Arts. On voit de suite le Chat noir d’Henri de Toulouse-Lautrec qui, réalisé à la peinture comme la plupart des affiches typographiques de l’époque, prolonge les codes des tableaux. Ce graphisme peint persévère et signe, réitéré par la création graphique d’aprèsguerre des publicités de Raymond Savignac ou les couleurs de Michel Quarez pour les com’ des quartiers populaires. La sélection en trois périodes, 1880-1940, 1945-1990 et 1990-jusqu’à nos jours, laisse voir l’analogie française entre graphiste et artiste. Dans ce parcours « patrimonial et matrimonial », les œuvres ont été sélectionnées dans un souci d’équilibrer le rapport Femme/ Homme dans le giron du graphisme, difficilement paritaire jusque dans les années quatre-vingt-dix. Le Signe a proposé au duo de constituer dans le même temps une exposition monographique, sobrement intitulée « Works/Travaux ». Réputés

SIGNE
MONSTRATION EVELYN TER BEKKE ET DIRK BEHAGE REVIENNENT AU
SUR LEUR PROCESSUS DE FABRICATION ET SUR LEUR VISION D’UN GRAPHISME FRANÇAIS ET PARITAIRE.
98
© Atelier ter Bekke & Behage
pour leurs collaborations auprès de grands établissements culturels, celles du théâtre parisien de La Colline ou du Musée national Adrien Dubouché de Limoges, les deux graphistes jettent un regard dans le rétroviseur de leur atelier au cours du quart de siècle. Ça se passe en trois parties. Dans « Réflexions », le duo expose les esquisses et idées à la base de ses commandes ; un segment intime qui permet aux spectateurs d’analyser les différentes étapes du processus de création. La deuxième partie, « Applications », se concentre sur les petits formats offset proposés par ter Bekke & Behage. Elle retrace les différents langages et identités visuels des institutions commanditaires. Enfin, dans « Immersion », le Signe a privilégié un accrochage sauvage et pléthorique de plus de 150 affiches grands formats, façon monstration urbaine. Si l’on y retrouve les communications les plus connues comme celle de La Colline déjà citée ou de l’Odéon, cette troisième partie met en exergue les contraintes liées au projet de l’atelier. Les deux graphistes jouent sur un petit nombre de couleurs et une impression en sérigraphie pour produire moins mais « mieux » ‒ et surtout, diminuer les coûts. Ce sont aussi les associations

avec les designers industriels, les architectes, les photographes, les rédacteurs ou encore les développeurs qui sont mises à nu dans la réalisation de ces supports. Une manière de répéter que le graphisme est avant tout un art de la combinaison.
— ÇA S’EN VA ET ÇA REVIENT, TRAVAUX
/ WORKS, exposition jusqu’au 19 février au Signe, Centre national du graphisme, à Chaumont www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe
99
© Marc Domage
LE SON EN POINTILLÉ
Par Aurélie Vautrin
ORIGINAIRE DE NANCY, DOMINIQUE PETITGAND JOUE AVEC LE SON, DIFFUSANT SES PAYSAGES SONORES ET AUTRES MICRO-UNIVERS AUSSI BIEN EN FRANCE QU’À L’ÉTRANGER, DANS DES CENTRES D’ART,
DISTANCE ABOLIE. RENCONTRE.
Qu’est-ce qui vous fascine dans le son ? Je ne suis pas « fasciné » : le son est un outil. D’ailleurs davantage que le son, tout mon travail commence par l’écoute. Le texte final est le résultat de plusieurs étapes ‒ écouter, enregistrer, monter, faire une composition, diffuser. Rien n’est pré-écrit. Ce sont avant tout des paroles que j’enregistre, des conversations. Et à partir de ces enregistrements, tout démarre, notamment ce que j’appelle « les installations sonores » qui sont une partie de mon travail : la mise en espace de ces sons dans des lieux d’arts.
L’idée est-elle toujours de raconter une histoire ? Quand j’enregistre une conversation, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je déconnecte vraiment l’enregistrement et le montage. Par la suite, je vais prélever des extraits, des mots, des phrases pour former un tout, en y ajoutant parfois quelques autres sons, des bruits, des éléments musicaux. Ce que je fais est narratif, maintenant la façon dont je raconte l’histoire est particulière. La plupart du temps, je travaille plus sur ce qui manque que sur ce qu’il y a à écouter. Les blancs, le vide. Ainsi ce sont des formes d’énigmes, de mystères, des récits très courts qui mettent en route la pensée de celui qui écoute et qui commence à imaginer sa propre histoire.
Peut-on appeler votre art de la « sculpture sonore » ?
Oui et non. On me parle aussi de cinéma sans images, de poésie sans écriture ‒ même si le montage est aussi une forme d’écriture… Il y a certains de ces aspects bien sûr, mais la relation à l’espace de mes installations n’est pas du tout proche de celle de la sculpture par exemple. Ici, tout l’environnement est pris en compte et participe à l’œuvre, le lieu même, l’architecture, la salle, la façon dont les haut-parleurs sont positionnés… Une sculpture est posée sur un socle autour duquel on tourne, alors que l’installation sonore telle que je la fais, ce n’est pas un objet, c’est un espace.
Quel est votre processus de création pour une exposition comme celle de Nancy ? Je n’ai pas fait de nouveaux enregistrements ‒la vérité est que j’aime avoir un matériau assez limité. Des enregistrements d’il y a une vingtaine d’années me servent encore aujourd’hui ! Ce qui a été spécialement conçu pour le musée, c’est le dispositif. La mise en espace. Dès le début, il était clair que je n’allais pas simplement m’installer dans la salle des expositions temporaires, mais m’éparpiller partout. Ainsi, je suis présent dans neuf endroits, et chaque espace, un escalier, une
DES GALERIES, DES THÉÂTRES, DES RADIOS ET MÊME DES FESTIVALS. LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY LUI CONSACRE UNE EXPOSITION, LA
100
salle vide, une salle pleine, une salle avec des grands tableaux ou une autre avec des petits tableaux, chaque endroit a ses propres caractéristiques avec lesquelles j’ai dû composer pour présenter quelque chose de juste. Ce qu’on entend, les montages, les voix existent par ailleurs dans d’autres œuvres que j’ai faites. Mais tout a été recomposé, recombiné et réadapté pour le musée.
Qu’entendez-vous par « quelque chose de juste » ? Comme l’idée c’est d’être éparpillé, les œuvres que je propose cohabitent avec celles du musée, et l’écoute de ces installations se fait en harmonie avec d’autres actions, regarder un tableau, s’arrêter, se promener, réfléchir… Trouver la justesse de l’œuvre, c’est trouver comment elle peut exister par elle-même, tout en laissant exister le reste ‒ les autres œuvres, le lieu lui-même. Comment être présente mais aussi absente d’une certaine façon, être audible, visible, mais aussi pouvoir s’effacer.

C’est pour cela que vous parlez de votre exposition comme d’un « long pointillé sonore » ? Oui, cette notion de « pointillé » se retrouve partout. Déjà parce que la visite de l’exposition se fait par étapes, dans des espaces différents ‒comme un point entrecoupé de silence. Ensuite, dans la première partie, plusieurs haut-parleurs sont accrochés à différentes hauteurs du mur et forment comme une ligne en pointillé. Aussi parce que les séries de voix, de mots, parfois même des syllabes, sont détachées, comme pour faire des courbes et des trajectoires de phrases et de son. On retrouve également cette notion de pointillé dans l’idée que le son n’est pas continu, et les silences à l’intérieur ou entre les phrases sont ce qui permet à l’œuvre d’exister dans l’espace, au contraire d’un son permanent qui prendrait tout. Comme une ponctuation ‒ une respiration.
— LA DISTANCE ABOLIE, exposition jusqu’au 26 mars au musée des Beaux-Arts, à Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr
© Ville de Nancy 101
Par Valérie Bisson
Égarée dans un monde jamais à sa taille, Alice va vivre une série d’épreuves plus incongrues les unes que les autres et en tirer une sagesse aussi universelle qu’autodéterminante.
L’entrée dans ces univers fantastiques, la gueule monumentale du chat du Cheshire conçue par l’artiste anglaise Monster Chetwynd, amène à s’immerger dans une scénographie qui se décline en jardin psychédélique et en décor
de théâtre baroque inspiré des Jardins italiens de Bomarzo et de L’Enfer, cabaret parisien dont l’étage servait d’atelier à André Breton et de lieu de réunion aux surréalistes. Ce seuil physique et symbolique franchi, le visiteur est propulsé dans des changements de points de vue, de rapports aux temps et à l’espace propices à l’introspection. Sans repère auquel se rattacher, un chat dont le sourire s’efface irrémédiablement, un lapin blanc

PENSÉE EN DIPTYQUE, COMME LES MONDES SÉPARÉS PAR LA TRAVERSÉE DU MIROIR, L’EXPOSITION « SURRÉALICE » S’AFFICHE AU MAMCS AVEC « LEWIS CARROLL ET LES SURRÉALISTES » SOUS LES COULEURS DES LIENS ENTRE ARTS ET LITTÉRATURE, ET AU MUSÉE TOMI UNGERER AVEC « ILLUSTR’ALICE », QUI EXPLORE L’ILLUSTRATION DES RÉCITS DE CARROLL. QUELQUE CHOSE D’ALICE
102
Jan Švankmajer, Jabberwocky, 1971, Film d’animation © Athanor Lld
qui s’échappe sans cesse dans sa course après le temps, Alice nous confronte à des vérités fuyantes et se délecte avec gourmandise de mets qui ne lui permettent jamais de s’ajuster au réel…
Né sous la plume de Lewis Caroll entre 1865 et 1871 (la traduction française arrive à peine quelques années plus tard) et tombé à tort en désuétude, ce récit d’éducation destiné à Alice Liddel, la jeune nièce de l’auteur, fait son entrée dans la culture française comme classique de la littérature jeunesse puis comme référence auprès des avant-gardes artistiques du milieu des années vingt. Pour André Breton et les surréalistes, le pays des merveilles est celui des songes, de l’écriture automatique, de l’irrationnel. C’est le début d’une histoire qui va mettre en symbiose la psychanalyse naissante, la découverte de l’inconscient et une toile de fond d’un Paris coloré de jazz, d’arts premiers et de valeurs revisitées par le chaos des conflits. Tout le milieu artistique parisien s’empare du texte. Germaine Dulac en 1928 dans son film La Coquille et le Clergyman d’après un scénario d’Antonin Artaud, Max Ernst, René Magritte ou Jean Arp qui mélangent les univers oniriques étrangement familiers, Louis Aragon en 1929 qui traduit The Hunting of the Snark et consacre à Lewis Carroll un article dans « Le Surréalisme au Service de la Révolution ».
Chez Carroll, les écarts entre le réel et ses représentations se doublent d’un langage décalé mettant en exergue les choses et leur nom. La langue est le point d’orgue de la puissance créative et rebelle de l’auteur, il la triture jusqu’à l’absurde et le nonsense redistribue les cartes d’un pouvoir remis en question. Ne fait-il pas dire à Humpty Dumpty : « Quand j’utilise un mot, il signifie ce que je choisis qu’il signifie, ni plus ni moins. La question est... qui est le maître ? » Le seul non-sens devient celui qui consisterait à ne pas questionner constamment le sens, à le ridiculiser, le mettre en doute pour le renforcer et le célébrer, le nonsense autorise l’excès face au manque, se meut dans la brèche de la contradiction constante, se met au service de la nuance, ravive le désir. Un exercice de style, dont il est de bon ton de s’emparer en visitant l’accrochage pensé selon l’ordre du dictionnaire surréaliste, d’Absurde à Zibou, afin de relire les œuvres en regard de définitions inattendues et d’une promenade dans leurs univers décalés.
Non loin de là, « Illustr’Alice » explore le registre de l’illustration humoristique et satirique ainsi que l’univers du livre pour enfants. L’omniprésent nonsense sert de guide à une diversité de traitements selon les sensibilités géoculturelles des artistes. Support idéal pour le dessin de presse dans un but de critique sociale et politique,
Anne Dufourmantelle, Intelligence du rêve, Payot et Rivages, 2012
Max Ernst, La libellule, vers 1934, assemblage de métal et plume d'oiseau dans une boîte en carton vitrée, 26 x 38,6 x 5,5 cm, Strasbourg, MAMCS.
Photo : M. Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg © ADAGP Paris 2022
cette tradition graphique s’est développée dès la parution en 1902 de Clara in Blunderland, illustré par J. Stafford Ransome. C’est cette diversité formelle, tout autant que l’universalité du thème, que le parcours a pour ambition de montrer à travers l’accrochage de 150 œuvres et de livres issus d’institutions muséales, de bibliothèques et de collections privées, de France et d’Europe, de noms célèbres ou moins connus de l’illustration de la fin du XIX e siècle jusqu’à aujourd’hui, tels qu’Icinori, Dagmar Berková, Peter Blake, F’Murrr, Jean-Michel Folon, Tove Jansson, Ralph Steadman, Roland Topor ou Alice B. Woodward, pour n’en citer qu’une pincée.
— SURRÉALICE, exposition jusqu’au 26 février au MAMCS et au Musée Tomi Ungerer, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu

—
On ne se remet pas de l’enfance, on se déplace au bord, on y revient en pensées, en rêves, en souvenirs… —
103
ADRIEN VESCOVI DANS DE BEAUX DRAPS !
Par Mylène Mistre-Schaal

104
Vue de l’exposition Adrien Vescovi, Jours de lenteur au Casino Luxembourg, Forum d’art contemporain (01.10.22–29.01.23). Photo : Marc Domage
ADRIEN VESCOVI CONTINUE À EXPLORER
LES POTENTIALITÉS DU TEXTILE, SON MATÉRIAU DE PRÉDILECTION, POUR
MIEUX
CAPTER LES COULEURS DU TEMPS QUI PASSE.
On l’a vu au Palais de Tokyo exposer ses drapés « Futur, ancien, fugitif », retenir le temps à Marseille « Slow Down Abstractions » ou dompter les nuances de la rouille à Milly-la-Forêt. Cet hiver, l’artiste marseillais a mis les voiles pour le Luxembourg.
On les voit de loin. Offertes au souffle des éléments, elles ondulent légèrement dans la brise du matin. Un peu comme les draps suspendus aux balcons des villes du Sud, cinq installations monumentales cascadent le long de la façade du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain. Empiècements de lin, morceaux de coton et bouts de tissus composent ces étonnants tableaux textiles, imaginés comme un préambule au reste de l’exposition. « Je tenais à ce qu’Adrien intervienne aussi à l’extérieur, que ses œuvres viennent se confronter à la rugosité de l’espace public. Dès le départ, j’ai aimé la tension entre la monumentalité de l’installation et la légèreté, la douceur du médium utilisé », nous confie Stilbé Schroeder, curatrice de l’exposition.
Au Luxembourg, Adrien Vescovi poursuit un travail entamé il y a une dizaine d’années sur la manière dont les fibres textiles enregistrent les mille variations de leur environnement. Avec un goût certain pour l’expérimentation, il les laisse se délaver en pleine lumière, se piqueter de taches ou d’auréoles au contact du soleil, de la pluie ou de la pollution. « Le tissu enregistre non seulement le temps qu’il fait, mais également le temps qui passe, puisque l’intensité de sa couleur évolue jour après jour en fonction des conditions atmosphériques », précise la curatrice. Des draps anciens, une approche très personnelle de la couleur et les méandres du temps, voilà les trois ingrédients principaux de « Jours de Lenteur ».
Plusieurs pièces composées à la machine à coudre habillent également les espaces intérieurs. Au creux de leurs plis, on lit des paysages, des sédimentations comme des collines, de suaves abstractions où les formes et les couleurs se répondent. Dans la salle principale, Soleil Blanc s’étale à même le sol, comme une longue nappe ourlée de strates. Sur plus de 10 mètres de long,

elle accompagne l’horizontalité de l’architecture. « Cette pièce est dans la continuité d’un travail qui occupe l’artiste depuis plusieurs années. Elle correspond à un moment suspendu, alors qu’il travaillait, solitaire, dans l’atelier de son grand-père, au cœur des Alpes.
Soleil Blanc dit sa fascination pour la réverbération de la lumière sur la neige. » Il y a là quelque chose du minimalisme, du slow art et de l’arte povera. Une simplicité formelle qui appelle au temps long de la contemplation. Çà et là, des bancs invitent d’ailleurs à la pause, à s’immerger en douceur dans la fluidité de l’instant.
Enchanteur du temps, Vescovi se dévoile également alchimiste de la couleur. Peintre, il l’est par la maîtrise des teintures naturelles dont il imprègne chaque tissu. À l’appui, de nombreux bocaux de concoctions faites maison ponctuent l’accrochage, donnant au musée de faux airs d’atelier. Ils vadrouillent du vert tendre à l’ocre, du jaune pâle au rouille et racontent à leur manière la petite géographie personnelle de l’artiste. « Quand Adrien vivait en Haute-Savoie, les tons verts des teintures végétales prédominaient. Depuis qu’il s’est installé dans le sud de la France, il s’oriente plus volontiers vers le jaune et le terracotta propres aux teintures minérales de la région . » Une palette évolutive qui dit le besoin de se frotter au jus de la terre et de retenir la quintessence des paysages qui l’accueillent.
Le paysage s’écrit aussi dans la manière dont l’intérieur communique avec l’extérieur, problématique embrassée dès le début par l’artiste et la curatrice. « Adrien est un peintre qui cherche sans cesse à aller plus loin que la surface. Le procédé de la teinture, en infusant le textile, lui permet d’aller au cœur de la matière. En plus de présenter l’avant et l’arrière des œuvres, il était très important pour nous de donner à voir au travers de la peinture. » Vus du dedans, les voiles monumentaux posés en façade prennent une tout autre dimension. Recadrés par les ouvertures des fenêtres et éclairés par la lumière directe, ils deviennent paysages dans le paysage. Et l’horizon s’habille d’une profondeur nouvelle.
— JOURS DE LENTEUR, exposition jusqu’au 29 janvier au Casino Luxembourg, Forum d’art contemporain, à Luxembourg ville www.casino-luxembourg.lu
AVEC « JOURS DE LENTEUR »,
105
LE BEAU SIÈCLE
Par Louis Ucciani

Envisagée comme un écosystème, la vie artistique bisontine au XVIIIe siècle est le point de départ de cette exposition conçue en cinq sections : la prise de Besançon, vieille ville conquise par Louis XIV en 1674 ; le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ; le goût et la culture visuelle ; la formation des artistes ; et le renouvellement architectural et la pensée urbanistique. La scénographie, due à Yves Morel Workshop (qui avait déjà opéré dans La Chine rêvée de François Boucher en 2019), parvient à maîtriser l’espace, par ailleurs assez complexe du musée, et à l’habiter en en tirant toutes les subtilités novatrices. C’est sur ce mode de l’habitation que se construit ce déroulé d’extérieurs et d’intérieurs, livrant l’espace à une floraison de plus de 380 œuvres (peintures, sculptures, dessins, estampes, arts décoratifs). L’aspect didactique s’y déploie avec légèreté tout en livrant une réelle profondeur.
En extérieur, première vision : l’espace est occupé autour de deux grandes toiles. Tout d’abord, Le Siège de Besançon peint par Van der Meulen entre 1684 et 1687 où, au premier plan, le stratège distribue son armée et apparaît maître du destin. La seconde, un portrait équestre au combat de Louis XIV attribué à René Antoine Houasse et peint vers 1688, est non seulement une découverte pour le musée et son public, mais pour qui a eu la chance de fréquenter la Faculté des Lettres de Besançon on y retrouvera un de ses florilèges : le décor de son Grand Salon. Si les œuvres prennent leur essor au musée, elles peuvent également vivre ailleurs, là, au-dessus des têtes apprenantes et pensantes.
À l’intérieur de l’exposition : portraits de notables, un détour en couloir, une moquette couleur sable, une cellule, et le parcours dit « Prier », après le « Triompher » et le « Célébrer ». Dans cette cellule, Prier, se trouve un mur de Suaires d’art sacré et populaire où sont accumulées des représentations en miniatures du fameux SaintSuaire de la cathédrale de Besançon, envolé à la Révolution. En position centrale, gravée sur cuivre et estampée sur tissu, la représentation du suaire est entourée de personnages du clergé, peints et brodés par les petites mains des religieuses des couvents alentour. Ce cabinet isolé apparaît comme un lieu de curiosités. La salle elle-même montre
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE DE BESANÇON SE DÉVOILE DE MANIÈRE INÉDITE LA PÉRIODE EXCEPTIONNELLE DE 1674 À 1792 AYANT FAVORISÉ L’ESSOR DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE DE LA VILLE, ALORS CAPITALE DE LA FRANCHE-COMTÉ.
106
Gaspard Gresly, Nature morte au compotier, cerises et œillets, Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, inv. 853.100.
divers plans et représentations de la reconstruction des églises qui laissent apparaître la ville de Besançon comme un immense chantier, cadre dans lequel elle se meut encore aujourd’hui.
Et puis, il y a les peintures de Wyrsch, notamment Le Christ mort de 1779 prêté par le Kunstmuseum de Bâle. Plus loin, le maître du trompe-l’œil, Gaspard Bresly et ses étonnants tableaux. Les cris et bruits de Besançon où s’accumulent les portraits des simples gens réalisés par Gresly, mais aussi Wyrsch et, comme en final, cette plaisante peinture tardive de 1856 par Moréal de Brévans, Une fête dans le parc de Chamars, vision festive de ce qu’a pu être notre ville. Le parcours s’achève sur Claude Nicolas Ledoux et la Révolution. On y entrevoit ce qui se profile et qui prendra d’un côté le nom de Fourier, mais aussi, en arrière-fond de Wyrsch et de son Christ mort, Courbet…
Foisonnante et subtile, l’exposition nous invite à comprendre un moment charnière de notre histoire, mais plus que cela, elle insiste sur l’idéal d’apprentissage. Je repense au tableau de l’entrée et à la Faculté des Lettres en me plongeant dans la salle consacrée à l’école de peinture et de sculpture de Besançon.
— LE BEAU SIÈCLE. LA VIE ARTISTIQUE À BESANÇON DE LA CONQUÊTE À LA RÉVOLUTION (1674-1792) exposition jusqu’au 19 mars au musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon www.mbaa.besancon.fr

107
Jean de Loisy, Représentation brodée du Saint-Suaire, Besançon, ADD, 21 Fi 4
LE TEMPS LONG
Par Coralie Donas
À LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER, UNE DOUBLE EXPOSITION INTERROGE NOTAMMENT L’ÉCOULEMENT DE L’EAU ET LE PASSAGE DU TEMPS.
2.0
«
Les artistes exposés s’inscrivent dans le temps long, à contre-courant du monde dans lequel nous vivons », souligne Marie Terrieux, directrice de la Fondation.
Le Centre d’art de Wattwiller propose deux expositions, dans lesquelles chaque œuvre présentée est le résultat d’un travail au long cours, de la répétition d’un geste, voire d’une obsession sans cesse revisitée.
« Réceptacle » expose les lauréats de la dixième édition du concours Talents contemporains, qui distingue chaque année des créations sur le thème de l’eau. Pour InventaRios, l’installation qui ouvre l’exposition, le collectif EthnoGraphic, formé des Français Émilie Renault et Ghislain Botto et de la Brésilienne Letícia Panisset, a travaillé pendant trois ans dans le Sertao, une région reculée du Brésil, riche en fer, où un projet de route menaçait de bouleverser le quotidien des habitants. Auprès des artistes venus recueillir leur témoignage, ces derniers ont exprimé leur inquiétude concernant la disparition de l’eau sur leur territoire. L’année suivante, le collectif est revenu muni d’une grande carte, pour retrouver les affluents de la rivière Capivari, longue d’une vingtaine de kilomètres, qui n’apparaissent pas sur le document. Les témoignages des riverains ont permis de nommer 56 cours d’eau et leurs nombreuses appellations, souvent poétiques. Il en résulte une grande installation où la ligne de la rivière, dessinée sur un mur, trouve un écho

108
Elvia Teotski, Spleen mircrobien
, Fondation François Schneider © Steeve Constanty
dans les 56 pots en céramique installés au sol et les 56 carnets illustrant la rivière. Un film complète le dispositif. « Nous utilisons les outils de l’ethnographie pour passer du temps avec les gens, recueillir leur parole. Au lieu d’en proposer une analyse textuelle, nous réalisons une exposition et nous cherchons à créer du lien par le dialogue qu’elle enclenche », explique Ghislain Botto. L’œuvre a aussi été montrée dans le village brésilien où le travail a été effectué.
La performance photographique du collectif moldave Dutca-Sidorenko part aussi d’une rencontre, avec une biologiste retraitée, férue de légendes. Elena Nikolaevna leur raconte le mythe d’une créature amphibie qui va devenir le personnage de l’histoire racontée en photos à la Fondation François Schneider. « Nous voulions travailler sur la pollution du fleuve Dniestr, à côté duquel nous vivons. Mais nous ne sommes pas dans une démarche activiste. Nous avons choisi le conte de fées pour la raconter », explique Carolina Dutca. Avec Valentin Sidorenko, dans un travail qui aura duré environ six mois, ils ont créé différents personnages fantasmagoriques qu’ils ont mis en scène et photographiés sur un rivage tourmenté par la pollution.
Avec Spleen microbien 2.0, l’artiste Elvia Teotski présente une œuvre qui a mis plusieurs années à se former. Un alignement de 200 sculptures, dont les formes de champignons, d’os, de souches de coraux sont le résultat de la déshydratation d’un travail antérieur. « Cette série est la version stabilisée d’une exposition que j’avais réalisée à la Belle de mai à Marseille en 2015. C’était alors une installation de colonnes gélatineuses, un mélange d’eau et d’agar-agar, moulées dans des cylindres puis démoulées », explique Elvia Teotski. Les œuvres gélatineuses se sont en partie effondrées sur elles-mêmes, ont moisi, sont entrées en décomposition, des champignons ont poussé dessus, certaines ont germé. L’eau, qui constituait 90 % des œuvres au départ, n’est plus visible aujourd’hui que dans les bulles et les pellicules qui s’observent à la surface des sculptures exposées à la Fondation et qui les font ressembler à des fossiles.
C’est aussi un travail très organique qui clôt cette édition des Talents contemporains avec le Wishing Well II de Bianca Bondi, artiste originaire d’Afrique du Sud qui travaille à Paris. Bianca Bondi plonge des objets et des végétaux dans de l’eau salée, puis les laisse cristalliser pendant plusieurs mois. Les éléments ainsi revêtus d’une couche de cristaux étincelants sont recomposés en installations et natures mortes. Wishing Well II , constitué d’un tabouret, de coquillages, de végétation et de petites pièces cristallisés, est un hommage à la tradition des fontaines où l’on jette une pièce pour voir son vœu se réaliser.
En parallèle, la Fondation ouvre à nouveau ses espaces à un lauréat de la huitième édition de Talents cIontemporains, Olivier Crouzel, pour son exposition personnelle, Horizon. L’artiste, dont les alignements de plans fixes forment des images mouvantes, revient régulièrement sur les mêmes lieux, filmés selon les mêmes procédés, pour voir ce qui change au fil du temps. L’occasion de revoir l’œuvre qui avait été primée en 2020, 18 rideaux, une installation vidéo qui met en scène l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer en Gironde. Cette barre d’immeubles, construite à 200 mètres de l’océan sur une dune sableuse qui sera détruite en janvier 2023 en raison du déplacement du trait de côte, est devenue un symbole de l’érosion côtière. « Je trouve fantastique que cet immeuble sur le point de disparaître soit préservé à la Fondation, dans une région très éloignée du problème de la montée des eaux », relève l’artiste. Avec « Réceptacle » et « Horizon », la Fondation François Schneider offre un refuge aux œuvres qui veulent transcrire l’écoulement du temps.
— TALENTS CONTEMPORAINS 10e ÉDITION, RÉCEPTACLE ET HORIZON, exposition jusqu’au 26 mars à la Fondation François Schneider, à Wattwiller www.fondationfrancoisschneider.org

109
Collectif EthnoGraphic, InventaRios, Fondation François Schneider © Steeve Constanty
VOIR LA MUSIQUE, ÉCOUTER LA COULEUR
Par Mylène Mistre-Schaal
MULHOUSE, LA BIBLIOTHÈQUE GRAND’RUE
HEYN.
À 80 ans passés, Erwin Heyn a plus d’une expérimentation sous son burin. De l’aquatinte à la gravure sur bois, de la figuration à l’abstraction et du noir et blanc aux variations colorées, l’Alsacien a fait vagabonder son imagination au gré des potentialités de l’estampe. L’exposition « Variations sur un thème » présente un panel récent de ses gravures sur bois, largement inspirées par la musique classique. « Nous avions envie d’explorer le rapport intime qu’entretient son travail avec la musique. Pour moi, ces gravures et collages à la construction extrêmement rythmée, cadencée, sont conçus comme des compositions musicales », précise Michaël Guggenbühl, conservateur et commissaire de l’exposition. Hommage à Henri Purcell, à Camille Saint-Saëns, Suite de Ravéliennes, Sacré Poulenc … rien qu’en parcourant les titres de ces abstractions musicales, on découvre la discothèque graphique d’un artiste qui créé invariablement en musique.

Un peu comme des partitions, les œuvres d’Erwin Heyn sont séquencées par des trames qui aspirent l’œil dans une verticalité assumée. L’artiste y tisse des motifs répétitifs, presque obsessionnels, où les formes se combinent et s’animent de mille hachures. Peu importe la couleur, le papier palpite. Ici, ses compositions évoquent la mosaïque aléatoire des paysages aériens (Klangfarben), là, elles semblent puiser l’inspiration dans les motifs kaléidoscopiques de l’Art déco (Les Années folles) ou dans le répertoire ancestral de l’art primitif (Le Couac du soliste).
Parmi les séries qui accrochent le regard, notons la superbe suite des Ravéliennes , composée de neuf variations colorées autour du même thème. Récemment entrée dans le fonds des collections mulhousiennes, elle est exposée pour la première fois dans son intégralité. « Il faut y voir bien plus qu’une simple variation chromatique : les volumes, les reliefs et la profondeur varient énormément d’une planche à l’autre. » Avec toute la solennité des grands formats, Le Silence d’Alspach, réalisé pour la chapelle alsacienne du même nom, s’étend sur près de cinq mètres de large. « Il me paraissait intéressant de clôturer cette exposition par l’évocation du silence, qui est un peu la musique suprême finalement ! » Présentant un dégradé du bleu vers le blanc, ce collage construit comme un diptyque nous aspire dans la profondeur mystique d’un ailleurs…
— VARIATIONS SUR UN THÈME. GRAVURES
ET COLLAGES
D’ERWIN HEYN, exposition jusqu’au 21 janvier à la Bibliothèque Grand’rue, à Mulhouse Bibliothèques.mulhouse.fr
AUX PAYSAGES
D’ÂME,
À
CONSACRE UNE EXPOSITION
ÉTATS
COLLAGES KALÉIDOSCOPIQUES ET MOTIFS
SYMPHONIQUES DU GRAVEUR ALSACIEN ERWIN
110
Erwin Heyn, Les Ravéliennes V © Pierre Christoph
n
s - i t u
i
-
Jean Ricardon (1924-2018), Le sens profond du blanc

Klein avait son bleu signature, Soulages la profondeur veloutée du noir, Rothko les variations de rouge et Jean Ricardon s’est affirmé comme un dompteur de blanc. Originaire du Jura, l’artiste peintre a su élire cette teinte comme la « couleurmère ou totale » de son œuvre. Des paysages enneigés jusqu’à la fascination pour l’architecture des visages et l’aboutissement de son art dans les vitraux abstraits de l’Abbaye d’Acey, le musée Courbet revient sur la carrière de cet artiste discret qui a su tracer sa propre voie dans le dédale des avant-gardes. (M.M.S.)
Du 17 décembre au 26 mars Au musée Courbet, à Ornans www.musee-courbet.fr
in situ
Jean Ricardon, Autoportrait © Département du Doubs - Photo Lionel Georges
112
Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe
Les œuvres de la portugaise Maria Helena Vieira da Silva portent en elles un mystère flagrant. L’espace s’y fragmente pour mieux se dissoudre et toucher aux frontières de l’abstraction. Villes aux accents cubistes, profondeur d’une chambre carrelée de bleu, paysages évanescents… les incertitudes font partie de la poésie de ses huiles sur toile. En consacrant une rétrospective inédite à une artiste phare de ses collections, le Musée des Beaux-Arts de Dijon retrace un parcours singulier qui frôle sans cesse les grands mouvements de l’histoire de l’art du XXe siècle sans jamais s’y cantonner. (M.M.S.)

Du 16 décembre au 3 avril
Au Musée des Beaux-Arts de Dijon, à Dijon musees.dijon.fr
in situ
113
Maria Helena Vieira da Silva, Composition anneau brisé © musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © ADAGP, Paris 2022
Exposition anniversaire Special Guest Duane Hanson
Imaginer la beauté naïve du Douanier Rousseau, les délinéations courbes de Matisse, la touche mouillée de Monet ou les rouges vibrants de Rothko se fréquenter de près relève pour beaucoup du fantasme ! Pour ses 25 ans, la Fondation Beyeler conjugue ces talents et propose l’exposition la plus importante à ce jour d’œuvres de sa collection. Un condensé d’art moderne et contemporain rehaussé par l’intervention du sculpteur hyperréaliste Duane Hanson, à l’ironie toujours aussi revigorante. (M.M.S.)
Jusqu’au 8 janvier À la Fondation Beyeler, à Bâle www.fondationbeyeler.ch

in situ
114
Henri Rousseau, Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope © Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection Beyeler. Photo : Robert Bayer, Bâle.
Cinq histoires de famille

Ah les portraits de famille ! Moments douloureux pour les uns, souvenirs impérissables pour les autres, ils portent en eux les joies et les non-dits de la généalogie. Secrets de famille, histoires d’exils, passés recomposés et mémoires par monts et vallons…à travers le récit visuel de cinq artistes, Stimultania explore le mythe originel et chemine de l’intime à l’universel, ou inversement ! (M.M.S.)
Jusqu’au 7 janvier À Stimultania, à Strasbourg www.stimultania.org
in situ
Laure Vasconi, Léonard at Home © Laure Vasconi
115
Stephen Dock,
Our day will come +
Constriction
Reste en chien. Trois mots gravés dans la pierre, implacables. Trois mots pour dire l’attente, l’ennui, l’abandon. Cette photo, Stephen Dock l’a prise lors d’un reportage dans l’ancienne maison d’arrêt de Mulhouse, désormais fermée. À la Filature, cette série mulhousienne est présentée avec Our day will come, un travail photographique qui s’empare du conflit nord-irlandais avec autant de puissance. En noir et blanc, Stephen Dock y saisit toutes les nuances d’une hostilité larvée dont les stigmates s’écrivent dans les murs, hantent les paysages et marquent les visages. Parallèlement, la Filature et Médiapop coéditent 36 une série de 36 images, prise entre les quatre murs d’une seule et même cellule à Mulhouse. (M.M.S.)

Jusqu’au 8 janvier
À la Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
Stephen Dock, 36, éditions Médiapop mediapop-editions.fr
in situ
Stephen Dock, Constriction © Stephen Dock
116
Anthony Vest, Tentatives d’archéologie industrielle

C’est une ville à la ligne singulière dont les tours et contours relèvent de l’accumulation. Pour bâtir cette cité fantasmée, Anthony Vest a combiné des moules de fonderie en bois provenant de l’usine Manurhin de Bourtzwiller. Comme l’ensemble de ses œuvres présentées au Musée des Beaux-Arts, The Lost City of M puise dans le passé industriel de la région mulhousienne. Pièces détachées, objets manufacturés, matériaux industriels ou typologie des jardins ouvriers : Vest s’empare de la photo, de la peinture ou de l’installation pour sublimer les traces de l’activité humaine. (M.M.S.)
Jusqu’au 29 janvier
Au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, à Mulhouse www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr
in situ
Anthony Vest, Lost City of M © Anthony Vest
117
Les quatre points cardinaux sont trois : le sud et le nord
Voici une exposition qui déboussole ! « Les quatre points cardinaux sont trois : le sud et le nord » s’imagine comme un essai et assume sa dimension expérimentale. Composant un véritable collage visuel, elle rassemble une quinzaine d’artistes d’horizons créatifs très variés, mais ayant tous un lien avec l’Amérique du Sud. Météorites et exploration des traditions rupestres, cartographies politico-poétiques et reliquats post-colonialistes, tous disent en cœur les complexités d’un territoire convoité. (M.M.S.)
Jusqu’au 15 janvier Au CRAC Alsace, à Altkirch www.cracalsace.com

in situ
118
Ana Mogli Saura, Encruzilhada das realizações © Photographie d’Aurélien Mole
Ferme les yeux et respire
Prendre le temps pour aller faire un tour du côté de l’imaginaire, c’est la proposition en trois chapitres faite par la Kunsthalle dans son espace d’exposition éphémère sur le marché de Noël de Mulhouse. On se replie dans le creux de nos rêves avec Johanna Mangold et ses œuvres tuftées alors que le poème visuel du collectif féminin Somebody*ies dégage une sensualité subversive. Mathilde Rohr clôturera cette programmation tripartite avec sa vidéo-performance eMERGEncy mOTHER. Sur l’écran, l’humain, le végétal et le minéral s’entrecroisent et se protègent mutuellement dans une apaisante chorégraphie du care. (M.M.S.)
Dans le cadre de la Regionale 23 Jusqu’au 27 décembre À la Kunsthalle éphémère au marché de Noël, à Mulhouse kunsthallemulhouse.com

in situ
119
Mathilde Rohr, eMERGEncy mOTHER, 2022 © Mathilde Rohr
Post Growth : imaginaires pour une société post-croissance
Avec un nom plus que parlant, le collectif Disnovation.org met la notion de croissance à l’épreuve. Amateurs de provocations artistiques, ses membres mi-artistes mi-hackers, testent les limites de nos technologies, de nos politiques et in fine de nos imaginaires. Baigné dans une intrigante lumière violette, l’Espace multimédia Gantner se transforme en lieu d’expérimentations où écrans et installations dignes d’un labo se prêtent à l’activation. La série de prototypes présentés, résolument éclectiques et hautement interactifs, mêlent matériaux organiques, équipements technologiques et artistiques. (M.M.S.)
Jusqu’au 21 janvier À l’Espace multimédia Gantner, à Bourogne www.espacemultimediagantner.cg90.net

in situ
Vue d’exposition Post Growth © Disnovation.org
120
La perte du bonheur – Patrick Pion
Un imagier de papier a pris ses quartiers sous les voûtes de la synagogue de Delme. Plasticien touche-à-tout, Patrick Pion a jeté son dévolu sur les objets du quotidien. Presse-agrumes, brosse à dents, pince à dessin et fer à repasser, tous ont été reproduits dans la rugosité du papier journal vierge. Véritables sculptures, ces objets bricolés à l’imperfection assumée étalent leur blancheur au fil d’une scénographie qui questionne notre rapport au consumérisme et plus généralement, au bonheur. (M.M.S.)
Jusqu’au 12 février
À la synagogue de Delme, à Delme www.cac-synagoguedelme.org

in situ
121
Vue de l’exposition « La perte du bonheur » de Patrick Pion, centre d’art contemporain - la synagogue de Delme, 2022. Photo : OH Dancy
La modernité déchirée, Les acquisitions bâloises d’art « dégénéré »

Les collections des grands musées sont toujours façonnées par une histoire singulière qui relève des donations, des politiques publiques, des aléas des acquisitions et des tours que joue parfois le hasard. En 1939, le Kunstmuseum de Bâle enrichit sa collection de 21 œuvres taxées d’art « dégénéré » par le régime nazi. En embrassant toutes les questions que suscite cette acquisition hors normes, le musée revient sur cet épisode complexe de son histoire tout en présentant certains des plus grands peintres du XXe siècle, dont Paul Klee, Franz Marc, Otto Dix ou Paula Modersohn-Becker. (M.M.S.)
Jusqu’au 19 février
Au Kunstmuseum, à Bâle www.kunstmuseumbasel.ch
in situ
Paula Modersohn-Becker, Selbstbildnis als Halbakt mit Bernsteinkette II © Bilddaten gemeinfrei - Kunstmuseum Basel - Kunstmuseum Basel, mit einem Sonderkredit der Basler Regierung erworben. Photo: Martin P. Bühler
122
Les idoles, la puissance des origines
Michel Bedez, artiste autodidacte, émergeant sur le tard, passe son enfance dans le Val d’Argent. Un petit pays peuplé d’arbres géants, de mines abandonnées et de sombres mystères. Dès le plus jeune âge, il est fasciné par les statues polychromes de la petite église, les légendes des forêts habitées, les tarots sur les tables des bistrots. C’est ainsi que sont nées les idoles, mélange du saint et du païen, du céleste et du tellurique. Les idoles sont des petits dieux, qui ont le pouvoir de soigner les maux des hommes et de la société. Elles prennent vie dans des carnets, sur des toiles ou sous forme de statues taillées dans du tilleul de la forêt proche, fruit d’une collaboration avec le sculpteur Loïc Bosshardt. (B. C.)
Du 4 janvier au 11 février en lisière de l’exposition « Art brut » au Musée Wurth à Erstein www.musee-wurth.fr

in situ 123
Série Les idoles Michel Bedez/ Loïc Bosshardt © Christophe Urbain

DANS LES CERVEAUX D’ANTOINE COUDER
Par Gilles Weinzaepflen ~ Photos : Florence Manlik
Tu publies une biographie de 300 pages sur Jacques Higelin. Pourquoi ce livre ? Mon projet, c’est d’écrire sur la musique. Pas au sens de commenter, mais comment on peut écrire la musique . J’ai essayé de le décliner dans trois livres. Fantômes de la renommée (Médiapop, 2017) est un récit d’apprentissage autour de la musique enregistrée, comment je me suis construit autour d’elle. La musique occupe l’esprit et le nourrit, mais en même temps elle empêche d’autres observations, elle coupe du monde. C’est le pharmakon, poison et remède d’Adorno. Il fallait creuser ça, à quoi sert la musique dans ce système d’occupation psychique. Pour le deuxième livre, j’ai choisi le genre biographique. Higelin, c’est une occasion de traiter de cette question de la musique à travers l’histoire de quelqu’un qui est relié à mon adolescence, sur qui j’avais déjà fait un documentaire radio. J’avais déjà beaucoup d’éléments, j’étais proche de ses proches. Le troisième livre appartient au genre de la fiction. J’ai essayé d’exprimer à quoi pourrait ressembler un texte musical. J’ai voulu résoudre la question de l’expressivité qu’interroge le philosophe Francis Wolf : exprimer quelque chose en ne disant rien, trouver une musicalité dans le langage.
Où te places-tu : journaliste, enquêteur, admirateur, juge, historien, poète ? Sur Higelin, j’ai été confronté à une bibliographie pas du tout objective ; ce ne sont que des témoignages d’amour. C’est l’homme parfait, qui plus est populaire, le poète, l’amoureux, la force, la virilité. C’est quelqu’un pour qui j’ai de la tendresse, j’aime les gens qui l’aiment. Je me place tout à la fin, le dernier arrivé, pour finir l’histoire. L’idée, c’est de faire un portrait. C’est aussi l’histoire d’un homme du XXe siècle, un homme de l’après-guerre, qui a fait la guerre d’Algérie, qui vient d’un milieu très populaire, avec ce logiciel alsacien, son père et ses grands-parents paternels qui vivaient avec lui enfant. Globalement, j’ai été touché par sa trajectoire. Il n’est pas devenu un bourgeois, il y avait chez lui une honte de classe.
Comme Annie Ernaux. J’avais pensé à elle pour la préface, mais on était dans des délais à respecter. Parents et grandsparents cafetiers, ils sont de la même génération. Je voulais l’interroger dans son rapport à ces hommes issus de la domination masculine, qui profitent à fond de la libération des mœurs.
JOURNALISTE MUSICAL, PRODUCTEUR SUR FRANCE CULTURE ET RFI, ANTOINE COUDER NOUS LIVRE EN SIMULTANÉ LES DEUX DERNIERS VOLETS DE SA TRILOGIE SUR LA MUSIQUE : UNE BIOGRAPHIE D’HIGELIN PLUS UN ROAD-MOVIE LOUFOQUE AVEC DE GRANDS ANIMAUX DU ROCK
DES FRONTIÈRES : SINGE, POULET, TIGRE ET CHIEN.
125
Tu mets en sous-titre : « Devenir autre. » Qu’est-ce que tu entends par là ? Jacques, c’est quelqu’un qui n’existe pas vraiment. Ce n’est pas un être social, il ne se considère pas comme quelqu’un qui est là. Il a toujours pensé que les autres n’aimaient pas ce qu’il faisait. Il a choisi d’être un homme public, pas au sens de Johnny Hallyday, d’un chanteur qui prend la parole. C’est un être qui a choisi de n’exister que sur scène, dans son art. Mais dans un art vivant, en faisant des concerts, en prenant la parole à la télévision, en se donnant en spectacle, etc. C’est un pacte faustien. Pour le reste, c’est difficile. Avoir des relations humaines, c’est très compliqué pour lui. Il a décidé de ne pas avoir une existence propre, mais plein de petites existences. Sandrine Bonnaire, qui a fait un film sur lui (Ce que le temps a donné à l’homme, 2014), lui a fait prendre conscience de ça. Je voulais montrer cet homme nu, dépassé, emporté, fragmenté, désintégré.
palpite avec le public. On est dans ce qui est en train d’arriver, le présent retient le temps qui passe. C’est une expérience qu’il fait très tôt, d’abord en famille puis sur scène.
Sur les 212 notes à la fin du livre, bon nombre renvoient à des conversations avec des proches du chanteur.
Je voulais signaler au lecteur que ce n’est pas mon imagination qui construit le texte. Il repose beaucoup sur des témoignages. C’est une joie de ce type d’écriture de s’appuyer sur des sources. J’ai essayé à chaque fois d’en avoir plusieurs. Je me suis aussi inséré dans des groupes de fans, des gens qui connaissent très très bien Jacques. Avec eux, il y a un débat permanent sur des points de détail. D’ailleurs, je continue à recevoir des mails, même si les lecteurs sont enthousiastes. Sinon, il y a toute une histoire de contentieux familial qui est en train d’arriver sur la place publique. J’ai pas mal de choses à dire là-dessus, quand le temps sera venu.
Comment faire mémoire d’Higelin en 2022 ? Higelin, c’est vraiment l’histoire des classes populaires en France, de l’ascenseur social, la manière dont on a inventé une culture du divertissement, un divertissement cultivé. Comment on s’est dit dans les années 1980 que la chanson était un art, qu’il y avait une télé de goût, comme si on pouvait éduquer le peuple avec des médias modernes. Jacques est vraiment très important là-dedans, à ce moment-là, c’est vraiment lui avec quelques autres comme Yves Simon, Brigitte Fontaine, même si elle est plus marginale. Higelin raconte aussi très bien la déroute d’un système de représentation esthétique, où croire qu’il suffit de dire ce qu’on pense pour être un artiste ne fonctionne plus, dans une époque où il y a inflation d’ego. C’est aussi quelqu’un qui nous parle de la place des hommes et de la masculinité dans la société. L’histoire de Jacques est bonne en ce sens. Même s’il s’efface un peu du paysage parce que son écriture ne correspond plus à notre époque, il reviendra, même si ce n’est pas sur TikTok.

Tu parles d’hyper-présence à propos d’Higelin. Peux-tu expliquer ce mot ? Comme c’est quelqu’un qui n’existe pas en dehors de la scène, il n’est que dans le moment, un moment qui lui-même ne va pas devenir mémoire. Ce qu’il vit intensément est extérieur à lui-même, c’est une extériorité. Il n’en reste rien après. C’est trop, il y en a trop, ça ne le construit pas. Être dans l’hyperprésence, c’est oublier qu’on est une personne faite de choses qui se sont déjà passées et qui nous constituent. Et c’est évidemment une sensation qu’on ressent quand on est sur scène, quand on
Tu peux citer des chansons de lui que tu aimes particulièrement ?
Si on s’intéresse à la dimension de la world music dont il est un des précurseurs, il y a Nascimo, Tête en l’air , Le Naïf haïtien . Dans sa période rock, je citerais L’Ange et le salaud, un très beau morceau. Je suis très attaché à la face A de ses inédits de 1970, quatre chansons publiées en 1979, très belles et très simples, qu’il a composées au Maroc notamment : Buster K. , Sa dernière cigarette , Seul dans notre chambre. Je ne m’en lasse pas.
126
Cette biographie sort en même temps que Rock’n’roll Animal, une épopée qui met en scène sous forme animale une tournée de musiciens rock issus du Grand Est. D’un côté, un travail biographique classique, solide, soigné, de l’autre un récit débridé, une poétique du dérèglement. Rock’n’roll Animal est un livre qui a pour sous-titre « Un revers de satire ». C’est Molière qui prévient ses contemporains que c’est bien de faire des satires, mais attention, ça peut se retourner contre toi. C’est toute l’histoire du rock’n’roll selon moi, des gens qui considèrent avoir inventé une manière de saboter la culture du divertissement, de la sortir de la machine capitaliste, mais qui ont été intégrés à elle, sans même être au centre. Le revers de satire est là. Il est aussi dans le fait qu’il est impossible de parler de musique. Dire ce qu’on entend, c’est quand même très compliqué. C’est pour ça que j’ai souhaité écrire une trilogie, pour saisir la chose par des facettes différentes. Mon livre met en avant la musicalité et l’expressivité, avant la narration et la cohérence du récit.

C’est quoi ce balancement de ton écriture, une hésitation ?
Pendant que se déroule l’autoroute Higelin, il se passe aussi des choses plus chaotiques sur cette même autoroute. Je suis aussi dans ce chaos, j’ai essayé de capter ce moment-là. Comme si on ouvrait la fenêtre et que le vent éparpillait les feuilles. Je crois au côté magique de la littérature. J’aime mettre en scène une vérité documentaire, raconter comment ça marche à travers une histoire simple et des gens ordinaires, ça me touche. Il y a une sentimentalité, une émotion qui transparaît. Écrire est un moyen d’entrer en contact avec des gens que j’aime bien, ou de dire des choses qui sont importantes pour moi à ces gens. J’ai aussi envie d’être aimé, sans doute, surtout des gens que j’aime bien. C’est une contagion de l’amour. Dans Rock’n’roll Animal, j’ai essayé de raconter ce qu’était le rock dans les années 1980 dans une petite ville, Mulhouse, en revoyant les gens aujourd’hui et en faisant d’eux des animaux. Cette sentimentalité finit par dérégler le texte.
D’où vient ton tropisme vers les frontières de l’Est ?
Je suis ancré dans la région par le premier livre de ma trilogie, publié à Mulhouse. J’ai aussi entretenu une relation avec Rodolphe Burger, Fred Poulet, Denis Schöbel (du groupe Singe Chromés). Par ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à l’histoire allemande, à la philosophie. J’ai vu aussi cette connexion avec la Suisse alémanique. Je suis au fait qu’il y a des éclats de toute cette culture qui vient jusque-là et
qui rejoint les sources du rock’n’roll, via l’émigration alsacienne et germanique aux États-Unis. Alain Croubalian, journaliste et musicien suisse, a beaucoup travaillé sur le fait qu’il y a une agitation entre l’activité économique du Rhin, les villes qui s’y créent et le divertissement. Ce qui fait qu’il y a des centres où des gens sont passés, qui vont de Goethe à Bashung. Au-delà d’une cartographie standard qui marque les frontières, il y a un enchevêtrement d’influences entre les deux côtés du Rhin. D’autre part, mon intérêt pour l’animisme, des livres comme Ce que pense la forêt, la fréquentation de Bruno Latour et de ses amis, m’ont remis dans cette dimension anthropologique, un écosystème plus vaste où l’homme ne domine pas, où il est en interaction avec la matière vivante dont il fait partie. Gaïa. D’autres créatures que lui peuvent prendre la parole.
Revenons à tes personnages-animaux. Comment as-tu affecté tel animal à tel musicien ?
Pour Singe Chromés, alter ego de Denis Schöbel, c’était facile : intelligence caustique, faculté de l’imitation. Le singe balance entre imitation et vérité, il imite les gestes de l’humanité, il rend intelligible le grand spectacle du monde. Singe Chromés est une icone au sens grec, non pas une image, mais l’idée même. Le singe est le vrai iconos. En singeant, il crée quelque chose. C’est un dieu animal. Pour Fred Poulet, je dirais que le poulet n’est pas un coq. C’est une créature fragile et gracieuse. Sous ses airs de vulnérabilité, c’est quelqu’un qui a une haute résistance. C’est le plus incarné de mes personnages. Chez Denis (Singe) et Fred (Poulet),
127
— Le présent retient le temps qui passe. —
chien, il y a celle un peu abâtardie de l’artiste. D’où cette ironie permanente sur le fait que ce sont des créatures un peu pique-assiettes, opportunistes, qui essaient de ramasser trois sous. Il y a un côté cour des Miracles. La tournée qu’ils effectuent ensemble permet de transcender les frontières. La logique de la végétation est transfrontalière, les espèces animales la traversent. C’est pour ça que je me suis dit que les animaux pouvaient évoquer cette cohérence francoallemande, qui reste encore compliquée pour les hommes. La forêt ne s’arrête pas à la frontière.
Tu cites des extraits de refrains connus tout au long du texte, que tu places entre des croches. Tu veux faire chanter le lecteur ? Je voulais faire rentrer la musique dans le texte d’une façon littérale, faire surgir dans l’imaginaire un passé qu’on a dans la tête. Des chansons parfois un peu honteuses, des mots et des sensations : c’est la petite musique
Rock’n’roll Animal commence où la biographie se termine : au cimetière. Sauf que l’enterrement d’Higelin devenu Ours a lieu au cimetière des chiens d’Asnières au lieu du Père-Lachaise ! C’est une autre version de la cérémonie, avec une ouverture vers la fiction. Une autre manière de raconter. Le livre commence par un enterrement et se termine par un assassinat : tout ça est sous le sceau de l’anéantissement.

on retrouve ce mélange de candeur et de philosophie, ils se brûlent les pattes aux lumières du succès. Chaque fois qu’il arrive, il y a une manière de se désengager, quoique la notion de survie soit plus importante chez Fred. Rodolphe Burger est Tigre, c’est un aristocrate de la jungle, la place de lion du rock français étant déjà prise par Johnny. Rodolphe est du côté de Bashung, de Jacques Higelin. Higelin a une chanson qui s’appelle « L’ours », c’est comme ça que j’en ai fait une grosse bête, un animal important dans la faune. Rodolphe n’a pas fui le succès, mais il a choisi un territoire particulier, à la périphérie du grand Barnum. Il y a moins de sabotage chez lui. Il est le roi de ce triangle Singe-Poulet-Chien.
Toi, tu es Chien. Mon personnage est un chien-journaliste. C’est quelqu’un qui crée une proximité avec les artistes. Il y a une tradition du journaliste-rock dans les années 1970, où ils étaient embarqués dans la même aventure sur les routes. C’est une distinction, mais en même temps, c’est juste un job. Dans cette figure du
Le rock est mort ? Le rock est une ligue des gentlemen qui prend fin. Heureusement, beaucoup d’éléments du rock sont intégrés aujourd’hui dans d’autres musiques. Mon fils musicien (Roman Kouder) a commencé la musique à l’époque des Strokes, il a voulu entrer dans la profession par le biais du rock. Il s’est heurté à une espèce d’intelligentsia, des propriétaires de la culture. C’est un système de castes très hiérarchisé. Il est allé voir ailleurs, dans l’electro où c’était beaucoup plus libre. Je pense que le rock aujourd’hui, c’est un truc conservateur, une musique de gens qui ont du mal à se situer dans le monde contemporain. Et c’est quand même une musique commerciale : c’est le revers de satire. L’attitude rock elle-même ne veut plus rien dire. C’est pourquoi Tigre (Rodolphe Burger) remet son pouvoir d’immortalité à Poisson-Dub (Lee Perry), pour assurer la métamorphose de Singe.
— JACQUES HIGELIN - DEVENIR AUTRE, Antoine Couder, Le Castor Astral
— ROCK’N’ROLL ANIMAL, Antoine Couder, L’Harmattan




PAS DE VIBRATION, FARINE 55
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~
MILA ET DANIEL HAFFNER

Mila et Daniel vont fêter leurs 51 ans de mariage, des noces de camélia. Ils habitent Annecy depuis leur retraite, mais ils se sont rencontrés à l’Ancienne Douane, un restaurant bien connu à Strasbourg. Nous évoquons la rue des Orfèvres, le quai Finkwiller, la rue de la Première-Armée et l’orgue de barbarie, sorte de jukebox des anciens. Le protestantisme les a réunis. Là où le catholique préfère le voir , le protestant préfère le lire. La religion a ici quelque chose à voir avec la raison pure, la cohésion mystérieuse du vivre
— Main dans la main ils vont tant mal que mal d’un pas égal. Dans les mains libres – non. Vides les mains libres. Tous deux dos courbés vus de dos ils vont tant mal que mal d’un pas égal. Levée la main de l’enfant pour atteindre la main qui étreint. — Beckett, Cap au pire
130
Photos : Benoît Linder
ensemble : étroitement lié à leur convivialité et leur sens de l’accueil. Le mariage civil a lieu à Metz et le religieux à Riedisheim, banlieue de Mulhouse. Mila a des allures de Jean Seberg mélangée à Iris Apfel, nouvelle vague couplée à l’excentrique américain. Elle aurait préféré être Jean-Paul Gaultier. Mila aime la mode, collectionne les boucles d’oreilles clips et parle aussi beaucoup à sa machine à coudre – « Je faisais les costumes de Daniel », dit-elle.
Daniel, lui, était architecte à Nancy. Le col haut, habillé en noir, avec des lunettes structurantes qui créent des ponts entre les yeux. Il a grandi à la colline de Sion, haut lieu mystique, avec sa lanterne des morts pour Barrès, et cette colline définitivement inspirée. Ses grands-parents étaient les mécènes des Prouvé. Jean Prouvé, rock star de l’habitat industriel. Dans la salle à manger, un dessin du fils Claude, une sorte de coup de griffe de Hans Hartung.
Leur intérieur est lumineux, épuré, blanc, avec des touches de bleu. La Réforme protestante, qui est iconoclaste, mais aussi « chromoclaste » assure la promotion du noir vestimentaire. Le bleu en profite et devient une couleur « honnête », dit Michel Pastoureau. C’est une sorte de monastère zen où flottent quelques formes rondes, des dessins d’élèves de Klee ou des Suisses nerveux, qui rayent des montagnes, Walter Krebs. La Suisse comme Annecy vit sous le patronage de la montagne. La montagne est une sorte de divin matérialisé par l’espace. L’éternel fantasme de l’élévation. Gravir une montagne – ou pouvoir la regarder depuis le balcon-terrasse, serait accéder à la transcendance.
Sur cette terrasse plane encore le souvenir d’un pin d’Autriche. Des petits animaux surréalistes sont restés, le lapin d’Alice (leur petite fille) ouvre le bal pour finir par la tortue.
Les corbeaux y tiennent salon le matin.
« J’aime les pommes de pin, les plumes et les cailloux », dit Mila, comme une comptine. Avant de nous servir un kouglof, recette qu’elle a longtemps étudiée : pas de vibration, farine 55, s’y atteler quand le temps n’est pas humide, attendre un jour qu’il soit (un peu) rassis.

Les choses sont souvent mieux rassies, c’est peutêtre la grande leçon de vie.
Mila et Daniel sont de ce temps où l’on ne négligeait rien, où recevoir était important. L’argot n’existait pas et les hommes servaient le vin. On ne faisait pas la vaisselle, on la lavait.
Nous nous recueillons pour la cérémonie de la dégustation autour de la table conçue par Daniel. Une table en sapin à trois pieds, car du déséquilibre naît l’équilibre. Elle est protégée par un film plastique. « Vivez salement et sans protection », je finis par clamer.
Mila a préféré faire table rase des meubles lourds et austères de ses ancêtres.
« L’âme des gens ne se trouve pas dans les objets. » Elle dit penser à sa mère tous les jours, et loue le talent de photographe de son père, ancien ingénieur chez EDF.
La structure est leur point commun ainsi que le sens de la famille. Julie et Antoine, leurs deux enfants, sont très présents malgré l’éloignement.
De la petite architecture, la mode, aux grands plans, l’ancienne maison contemporaine lorraine qu’ils ont dû quitter, il est important de parler le même langage et de marcher du même pas.
Le traumatisme de la guerre est encore vivace. « On parlait alsacien sous l’occupation », dit Mila. « Mon père s’est caché chez les voisins pour échapper aux Allemands », « J’ai encore le souvenir des bruits de bottes. Ils venaient par cinq. » On pense aux vieux échos de Parsifal. L’Allemagne a créé la musique.
« J’ai vu flamber la gare de Mulhouse. » Un temps passé dans les caves et les champs pour se protéger.
Daniel, lui, a fini à Toulouse. Son père ayant fait une fausse carte d’identité pour échapper au Reich. Mais lui a subi la guerre d’Algérie en comptant les morts dans les grands bureaux.
Le temps passe, et les portes du sensible s’ouvrent toujours un peu.
Créer, toujours, mais « j’ai pas envie de faire des paniers en rotin », assène Mila.
131

REGARD N° 17
Par Nathalie Bach ~ Photos : Mar Castañedo
Ici la terre tremble un peu chaque jour Le matin surtout Le corps prend ça pour de l’amour, Le corps devient fou
Il attend, il appelle Et la terre répond Il est celui ou celle Et le monde répond
Les sirènes incessantes marquent de leurs cris L’impossible frontière entre les jours et les nuits Des femmes vendent en hurlant Leurs viandes aux mille piments

Les dalles des trottoirs s’entrechoquent Tirées vers le ciel et la mort outside Le vent froid apaise les braises de Cuauhtémoc Mais tes roses sur ma rose m’assaillent
Tu m’attends, je t’appelle Et les aigles fondent Tu es celui ou celle En nous le feu inonde
Ici la terre s’effondre un peu chaque heure Dans l’hémicycle les enfants tout habillés Jouent à se noyer dans les fontaines à bonheur La nuit chante ce que jamais je ne dirai
133
UNE HISTOIRE ESSENTIELLE
Par Myriam Mechita
Myriam Mechita, Les coïncidences de paix, crayon et encre sur papier, 42 x 60 cm, 2018
Tout a commencé quand j’ai rencontré cet ami Facebook à un vernissage.
Ces amis qu’on connaît depuis des années et qu’on n’a jamais rencontrés, on sait beaucoup de choses sur leur vie sans rien connaitre vraiment, ils sont totalement ce qu’ils ou elles sont, sans l’être tout à fait... (Vous me suivez ?)
— Ça te dirait d’écrire une chronique dans Novo ?
— Moi ?
— Oui, toi... J’adore lire tes textes, ils me font rire et puis ils me touchent aussi…
Après une minute de réflexion, j’ai répondu « Ok » en me disant que ca allait etre compliqué...
Et depuis ça m’obsède, ça me perturbe, ça m’accompagne et ça me stresse surtout. D’habitude, j’écris dans le bus, le train, sur mon téléphone en laissant mon correcteur décider s’il fait son job ou pas. J’écris sur tout, le sandwich de mon voisin de train, un speed dating qui tourne mal, mes états d’âme de femme presque quinqua en mal d’amour. Je n’écris pas bien moi, ma prof de français en 5e aurait eu un large sourire sur ses

lèvres à entendre cette phrase, qu’elle me répétait à chaque rendu de devoir : « Vous ne ferez jamais rien Mechita… pour ça, il faut parler français… ce que vous ne saurez jamais faire… c’est comme ça », et pourtant j’écris, c’est assez simple justement. Pas de litote ou d’allitération, pas de syntaxe particulière ou de figure de style. Mon vrai travail, ma vraie vie, c’est d’être artiste plasticienne, et pas esthéticienne comme le pensent toutes ces dates pourries de sites de rencontre… Au début, je lisais : « Et tu travailles dans un salon ? », pensant sûrement que j’étais experte ès épilations définitives ou juste brésiliennes. Je répondais en ne saisissant pas vraiment : « Oui, ça m’arrive de travailler dans mon salon. »
Je peux déployer sans problème mon bordel dans mon salon, ma chambre, ma cuisine et dessiner et mettre du pigment partout, laissant traîner les feuilles qui sèchent autour de mon lit, ou sur la table de la cuisine pendant des jours et des jours. Alors que j’ai un atelier où je pourrais largement tout faire sans rien déranger.
134
Plasticienne, c’est ça, c’est comme un fardeau qu’on porte à produire des œuvres, à dédier sa vie à la création sans rien attendre en retour, et s’entendre dire à la première crise qui paralyse le monde qu’on est non essentiel. Utile à rien…
Voilà. C’est ça que ça veut dire… pas important… Utile à rien.
Mais il suffit de quelques mots pour renverser le monde, pour toucher un point sensible, et se rendre compte qu’on a les mêmes peurs et les mêmes désirs que tous ces gens qu’on croise en vrai ou dans le monde infini des amis invisibles…
Alors quoi vous dire pour la première fois... C’est comme une rencontre qu’on prépare… être silencieuse pour paraître mystérieuse… rire à chaque fois qu’il va tenter de faire un bon mot… et puis ne pas trop parler de mon travail qui va juste le faire fuir… Pas envie de vous faire fuir… pas tout de suite.
Alors je vais juste vous dire que c’est pas vrai qu’on est non essentiels. C’est pas vrai. Et je vous donne un exemple de suite : il y a quelques années, lors d’une exposition personnelle dans un centre d’art, on m’a demandé de faire un atelier annexe avec cinq adolescentes en échec scolaire. Cette intervention qui semble être comme un dû, une prolongation de l’exposition, est souvent un calvaire pour tout le monde, l’artiste qui veut juste retourner dans son atelier et ces élèves qui n’ont qu’une envie, c’est de se replonger dans les méandres artificiels des vidéos de trois secondes. Des chats qui ont peur de concombres malveillants ou des pranks en tous genres. Cet atelier commençait mal, les étudiantes étaient voilées entièrement, impossible de voir leur visage, âgées de 15 ans et aucune envie de fabriquer quoi que ce soit. La première intervention se passe difficilement et je leur propose de faire une broderie de paillettes de ce qui les fait rêver… et à la troisième intervention, je constate que personne n’a rien fait et ne fera jamais rien… et là, je sors de mes gonds. Je crois n’avoir jamais autant été en colère, j’ai parlé de la vie qui les attend, leur échec scolaire qui allait se transformer en un échec tout court. Et j’ai parlé du sens de la vie, du sens de l’amour de soi, de l’autre et de l’art qui nous permet de tout déplacer, de tout traverser, parce que sans art, on est rien. Nous traiter de non essentiels, c’est nous traîner à terre, mais c’est aussi imaginer un monde sans livre, sans musique, sans film, sans vêtement dessiné par un designer, c’est rêver à un monde où tout se ressemble, les voitures, les bâtiments…
imaginons un monde sans tout ce que ces artistes inutiles ont pu rêver… un monde mort avant même d’avoir existé.
Ma colère se transformait en tristesse… et je suis partie incapable de finir le cours. Et puis j’ai décidé de ne pas donner suite aux autres interventions non plus. Plantant des élèves pour la première fois.
Et puis il y a deux ans environ, je suis allée au Monoprix, et dans la file qui mène à la caisse, l’homme devant moi se retourne et me dit :
— Je crois que l’hôtesse de caisse vous connaît.
Je regarde attentivement.
— Non, je ne crois pas.
Je me retourne plusieurs fois pour vérifier si son sourire m’est adressé…
Il était bien pour moi.
En arrivant près d’elle, je pousse mes articles et une discussion qui me donne encore des frissons s’engage :
— Vous ne me reconnaissez pas ? C’est normal...
— Non, désolée, nous nous sommes rencontrées quelque part ? À une exposition ?
— Non, pas à une exposition, mais à un atelier que vous avez abandonné. Ça vous dit quelque chose ?
— … Oui…
Je regarde attentivement son sourire que je découvre pour la première fois, et je sais immédiatement de quoi il s’agit.
— J’étais voilée, vous ne pouvez pas me reconnaître…
— … Effectivement.
— Je pense à vous souvent… très souvent…
Elle me tend son téléphone et me montre une photo d’un salon, je reconnais un canapé, une table basse et je vois au-dessus du canapé une broderie de paillettes, je vois un paysage délicat, avec une montagne et une sorte de rivière.
— Je l’ai fini, vous aviez raison, tout ce que vous nous avez dit sur la vie, l’amour et l’art… J’ai quitté ma famille, j’ai repris des études, j’ai un petit ami, et puis je vais voir des expositions dans les musées. Et c’est grâce à vous. Vous avez sauvé ma vie.
J’ai les yeux à ce moment-là qui se remplissent d’émotion, le monsieur qui range ses courses dit en pleurant :
— C’est pas rien, dites donc, ce que vous avez fait pour cette femme.
Tout le monde pleure en souriant.
Je lui ai répondu :
— Si j’ai sauvé votre vie et bien vous, ce matin, vous donnez du sens à la mienne.
Et à cette minute-là, précisément, elle a rendu à tous et toutes les artistes de ce monde le sens premier de notre existence. Nous rendre essentiel les à la vie.
Je me présente, je m’appelle Myriam Mechita, et je suis heureuse d’être ici.
135
CHRISTOPHE FIAT
LE JEU AUTOBIOGRAPHIQUE… OU L’AUTOFICTION COMME REPRÉSENTATION
Par Louis Ucciani
Développement du sensible de Christophe Fiat est un livre piège qui peut se lire comme un roman au premier degré et voir se dérouler une sorte d’éducation sentimentale, à la sensualité, à la lecture et à l’écriture. Il peut se lire comme une autobiographie, celle d’un jeune provincial qui livre ses premiers émois où se forge une âme de poète et d’écrivain. Mais Christophe Fiat est aussi philosophe. Et c’est dans ce creuset des influences croisées que se livre une autobiographie critique du mode autobiographique.
Dans un langage philosophique devenu vulgate, nous avons affaire à une déconstruction de ce type de récit si prisé aujourd’hui. Il faut voir ce livre comme une ironie du dévoilement, ironie de cette idée qu’il y aurait du vrai dans la mise à nu.
Imaginons un écrivain qui se prénommerait Christophe, comme il y a un chanteur qui se nomme Christophe. Imaginons que cet écrivain se prénomme Christophe parce que sa maman écoutait Aline quand elle était enceinte de son fils écrivain. Cette maman elle-même pourrait-elle
ALORS QUE L’AUTEUR ET POÈTE CHRISTOPHE FIAT ACHÈVE UNE RÉSIDENCE AU FRAC FRANCHE-COMTÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION D’UNE ÉDITION À PARAÎTRE EN 2023, LOUIS UCCIANI NOUS PROPOSE SA LECTURE DE DÉVELOPPEMENT DU SENSIBLE, UN ROMAN D’APPRENTISSAGE ET UNE ÉPOPÉE FANTASTIQUE DONT L’HISTOIRE DÉBUTE À BESANÇON. 136
se prénommer Roberte en hommage à la Roberte de Pierre Klossowski ? Imaginons-le. En tout cas, Roberte décadente se prénomme Bobette. Morceaux de bravoure sur l’enfant futur écrivain et sa maman, une relation chaotique sans doute irrésolue que l’écriture traque. Le thème est, on le sait, classique, la recherche proustienne débute quand le monde accapare la maman et prive le petit Marcel du baiser du soir. Ici aussi, il y a comme un rapt par l’extérieur, ça a à voir avec la chanson, celle de Christophe qui revient ponctuellement dans le texte de Christophe l’écrivain. Et il y a la progression du texte où l’écriture adolescente, sûrement la seule à dire cette période de vie, se mue en écriture maîtrisée et là, c’est, me semblet-il, un autre problème narratif qui est abordé. On voit par exemple que dans les autobiographies comme celle de Sollers qui dans Femmes intercale un développement magistral sur Shakespeare, ou celle de Houellebecq qui pose une trame, disons savante pour ne pas dire scientifique, autour de laquelle se déroule la narration, la fonction autonarrative s’écrit dans un référentiel savant. Ici, avec Christophe Fiat, c’est autre chose qui se noue ; la philosophie, la poésie et la littérature sont parties intégrantes de l’autobiographie, elles coexistent à l’évolution même du sujet écrivant. Si l’individu naît homme dans l’élaboration de sa sensibilité, ce qui la fait se développer, c’est précisément l’évolution de sa capacité représentative or celle-ci se forge dans ses lectures et écritures…
Le livre se donne alors comme un laboratoire d’écriture où le mode d’approche suit les paliers de l’évolution de la capacité représentative, de celui qui apprendra les mots de la narration simple de l’adolescent découvrant la sensualité dans le brut du geste, jusqu’à sa conceptualisation et son énonciation littéraire. Il n’y a pas d’alibi savant, mais une progression qui n’est pas sans me faire penser ‒ puisque vous le verrez, la science-fiction y a aussi sa place ‒ aux Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Cette progression de la narration qui va en se complexifiant et qui livre une expérimentale archéologie de la représentation où celui qui la porte, le sujet-objet de la narration, livre son évolution, s’articule autour de ce que sont les deux inconnues, ces deux x qui scandent son être dans le monde : Aline et la Dame blanche. La première, là où semble se répéter la trame d’un cri primal, l’énigme de ce qui est le premier mot qui me porte, la seconde trace vers le but, message du temps inversé, du temps s’inversant entre ce qui fut et ce qui sera… Tout ça pour vous dire l’intérêt qu’a suscité en moi ce livre.
— DÉVELOPPEMENT
DU
SENSIBLE, Christophe Fiat, éditions du Seuil

137
BERTRAND BELIN
J’ai rencontré Bertrand Belin en mai 2019 à l’occasion de son concert donné à La Rodia à Besançon. Avant une rapide séance photo en fin d’après-midi, j’ai eu le privilège de passer un peu de temps avec l’artiste. Volubile, le natif de Quiberon m’a parlé de son adolescence, de tout ce à quoi on peut s’adonner quand on a treize, quatorze ans, mais chez lui cela avait commencé vers dixhuit ans. L’apprentissage de la guitare, la musique rock, plutôt américaine. Son grand frère et l’initiation à la musique des années cinquante, soixante. Hank Williams, Johnny Cash, Elvis Presley, Eddie Cochran. Plus tard, il écoutera Thiéfaine au walkman, « qui m’emmenait dans des territoires vierges, avec des vocabulaires insensés que je ne comprenais pas. Tout ça me faisait une destination. Je me disais que peut-être un jour je fréquenterais les mondes qu’il y a là-dedans, c’était très inspirant ».

Puis nous avons parlé des cauchemars récurrents, des rêves chroniques. Les siens. Des rêves de pêches, des pêches miraculeuses souvent… Le chalut, la marée, amarrer. Le manque de rigueur dans l’écriture. Du mot « clavicule » (son mot préféré), des lectures de Bernanos, de Fat White Family, de la petite messe solennelle de Rossini, de la chanteuse syrienne Waed Bouhassoun.
HORS CHAMPS
Par JC Polien
Concernant Thiéfaine, cette petite anecdote amusante. Avant notre rendez-vous, j’étais passé au catering d’où j’avais emporté quelques mandarines, me disant qu’elles pourraient toujours me servir pour la séance. Le moment venu, je lui ai suggéré de poser avec ce vieux casque audio de marque BST chiné sur une brocante, et de plugger ce dernier à un fruit. Il a accepté bien volontiers, me disant que cela lui rappelait la pochette de l’album Autorisation de délirer sorti à la fin des années soixantedix, référence à laquelle je n’avais pas pensé en déballant mes petites oranges. Finalement, j’ai préféré garder cette série réalisée sur la terrasse du quatrième étage, le regard scrutant l’horizon, cigarette à la main. Le soir même, dans une salle comble, le concert nous a laissés « sur le cul ».
138

CHELSEA GIRLS D’Eileen Myles — Éditions du sous-sol
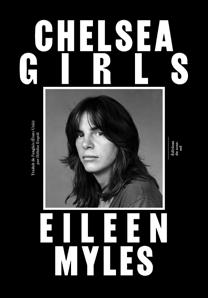
Le portrait d’Eileen qui tient lieu de couverture est signé Robert Mapplethorpe, on lit dans ce regard toute la défiance de l’autodétermination nécessaire à l’exploitation d’une brèche ardente et sensible : « Tout va bien. Je suis pleine de poèmes. » Années 1970, Eileen Myles a fui l’Amérique catholique et ouvrière pour croquer à pleines dents la vie new-yorkaise : galère, défonce, désir et art font le quotidien de la poétesse qui va devenir parmi les plus célèbres des États-Unis. Addictif et magistral, ce texte fondateur pour nombre d’artistes contemporains, dont Maggie Nelson, trace le récit inoubliable d’une romancière, universitaire et candidate à l’élection américaine de 1992. Il est son premier roman traduit en France. (V.B.)
LES PRESQUE SŒURS De Cloé Korman — Seuil

Entre 1942 et 1944, le gouvernement de Vichy a avec zèle orchestré la séquestration, le déplacement et la déportation de milliers d’enfants juifs (dont les parents étaient quelquefois en fuite, le plus souvent déportés). C’est par l’histoire de six petites filles que Cloé Korman nous plonge dans ce pan méconnu de la collaboration française : trois sont les cousines de son père – et mourront à Auschwitz –, les trois autres sont leurs amies – et survivront en s’évadant. S’appuyant sur un solide et rigoureux travail de recherche et d’enquête ; se fondant, aussi, sur des échanges avec certaines des concernées, Les Presque Sœurs offre un geste d’une puissance rare. Avec pudeur et délicatesse, Cloé Korman puise dans le réel pour témoigner depuis la fiction, et (re)donner une enfance, des corps et des émotions, une histoire, en somme, à ces six fillettes. (C.C.)
LE PRODIGE De Juan Pablo Meneses — Éditions Marchialy
Pour le deuxième volet de sa trilogie du « journalisme cash » (dans le premier, il achète une vache, dans le troisième un dieu), Juan Pablo Meneses part à la recherche d’un jeune talent du ballon rond dans le but de l’acheter et le revendre à un club européen. Il parcourt l’Amérique du Sud, consulte divers intermédiaires et rencontre un tas de personnages qui gravitent autour des terrains avec le même objectif que lui. Le plus choquant n’est pas qu’un gamin rêve de devenir footballeur et que les parents espèrent en profiter, c’est que les gens auxquels il s’adresse ne s’indignent jamais et qu’ils soient prêts à l’aider. En devenant lui-même « acteur » de ce business, avec les dilemmes que cela engendre (« Qu’on refuse de te vendre un enfant te désespère. Qu’on veuille bien te le vendre te désespère également. »), il illustre par l’absurde l’une des nombreuses dérives de l’industrie du foot. (N. Q.)

FIN D’AUTOMNE D’Olivier Kervern — Soft Copy
Après La mort en été – livre antonioniesque mais dont le titre (partagé avec Yukio Mishima) nous mettait déjà sur la voie du Japon, le photographe Olivier Kervern reconstitue en un récit bref et laconique les fragments de son rapport amoureux au Pays du Soleil-Levant. Sur une photographie, la blancheur graphique d’un habit de funérailles – un kimono banc – semble éclabousser le fond noir d’encre. Le regard attentif découvrira qu’un enfant s’y cache, visiblement interloqué par la présence de la jeune veuve, à moins que ce ne soit par celle du photographe qui capte la scène. Comme dans un film d’Ozu, il est question de temps faibles, de gosses de Tokyo, de lignes et de courbes dessinant une métaphysique sensorielle et urbaine. Comme dans un film de Mizoguchi, il est question d’une femme aimée, regardée, désirée – à la fin de l’automne. (N.B.)

lectures
140




WEYES BLOOD

And in the Darkness, Hearts Aglow / Sub Pop
Avec ses airs diaphanes et mélancoliques, la Californienne Natalie Mering dévoile une odyssée orchestrale à l’atmosphère complexe. La composition de ce diamant pur trouve son origine dans les débuts confidentiels de cette jeune artiste investie brièvement dans la scène noise expérimentale de Portland, Oregon : elle part d’un mélange folk bruitiste et intransigeant pour progressivement laisser briller de son éclat une pop riche et déroutante. Agrémenté de violoncelles, violons, flûtes et harpes, un piano scintillant laisse s’envoler la voix ample et puissante de la chanteuse, dans le cadre d’une œuvre qui constitue un merveilleux écrin pour cette multi-instrumentiste au parcours unique. (V.B.)
ARCTIC MONKEYS
The Car / Domino
Personne n’aurait parié sur l’évolution du célèbre groupe de Sheffield. Ni imaginé cette orientation si glamour. Son leader fascinant, Alex Turner, se prendrait pour Marvin Gaye que personne n’oserait le lui reprocher, tant il se prête au jeu d’une forme soul aventureuse. Le propos est grave avec des récits de trahison, de mensonge et d’espionnage domestique, dans un cadre inquiétant dont on ne sort indemne que grâce à son orchestration riche et ample. Ne feignons cependant pas la surprise, les Arctic Monkeys ont toujours su dérouter leur public. Ils le font cette fois-ci avec une maturité déconcertante, qui les situe au firmament de la pop. (E.A.)
BROKEN BELLS

Into the Blue / Awal
À raison on a tendance à se méfier des comeback, surtout quand le dernier disque en date n’avait pas convaincu les foules. Cela étant dit, 12 ans après leur premier album dont la pochette constitue une madeleine de Proust pour quiconque écoutait de la musique dans les années 2010, Broken Bells signe un retour sans tache. Brian Burton (Danger Mouse) et James Mercer (The Shins), délivrent un fantastique Into the Blue tantôt psychédélique, soulful ou pop, ne lésinant pas sur les envolées prog et atmosphériques. Un mélange savamment orchestré qui vient contredire nos inquiétudes sur les come-back. (C.J.)
OKAY KAYA, SAP / Jagjaguwar

Cela fait déjà quelques années que le talent d’Okay Kaya n’est plus à prouver. La magnifique artiste norvégienne, aussi à l’aise dans un studio que dans les musées, a profité des confinements pour produire un concept album sur la conscience. Se considérant elle-même plus proche de la sève d’arbre que de l’être humain, le bien nommé SAP serpente dans les chemins tortueux de l’esprit décalé de Kaya. Si elle a composé et produit seule SAP, elle conserve de la place à des amis comme Adam Green (Moldy Peaches). Chanter les points de vue d’autres personnages, c’est ce qui fait son originalité. On y retrouve Jolene, l’ennemie de Dolly Parton, qui répond enfin aux accusations de la blonde, mais aussi une déesse de la mythologie non contente de son sort dans Origin Story. (C.J.)

sons
142




ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer
Pour finir en beauté, on évitera de remuer le couteau dans la plaie en parlant de l’augmentation du prix du gaz et des coupes budgétaires qui font très mal à tout l’écosystème culturel. On évitera également de parler des morts (ça commence à faire beaucoup). Citons simplement deux amis artistes partis brutalement beaucoup trop tôt : André Maïo et Olivier Metzger. On évitera de parler de la guerre en Ukraine et de tout ce qui rend notre monde insupportable. Par contre, on continuera de fêter les anniversaires. Il y a trente ans, une bande de jeunes rockers manifestaient en organisant un concert sauvage sous les fenêtres de la mairie de Mulhouse pour réclamer « Une salle avant d’être vieux ». Sur les banderoles, on pouvait lire « De la thune pour notre
projet » ou « Assez de culturel au rabais ». Trente ans plus tard, les jeunes rockers sont devenus vieux, mais ils bougent toujours. Beaucoup d’entre eux savent ce qu’ils doivent à Joe Strummer, le chanteur de The Clash disparu il y a déjà… vingt ans. Avec un abécédaire concocté par Emmanuel Abela et un portrait de Richard Dumas, Novo lui rend un magnifique hommage. Sur « All the Young Punks », un des morceaux de l’album « Give ‘Em Enough Rope », Strummer chantait : « Droit devant nous avons l’avenir / Brillant comme une pièce d’or. Mais je jurerais, quand on s’approche / Qu’il ressemble plus à un morceau de charbon. » Quatre décennies plus tard, on se demande s’il est encore possible d’agir pour que l’avenir se remette un jour à briller.

144
© Photo de Francis Hillmeyer parue dans le journal L’Alsace du 3 janvier 1992 à retrouver dans le livre Les 30 ans du Noumatrouff coédité par Médiapop.






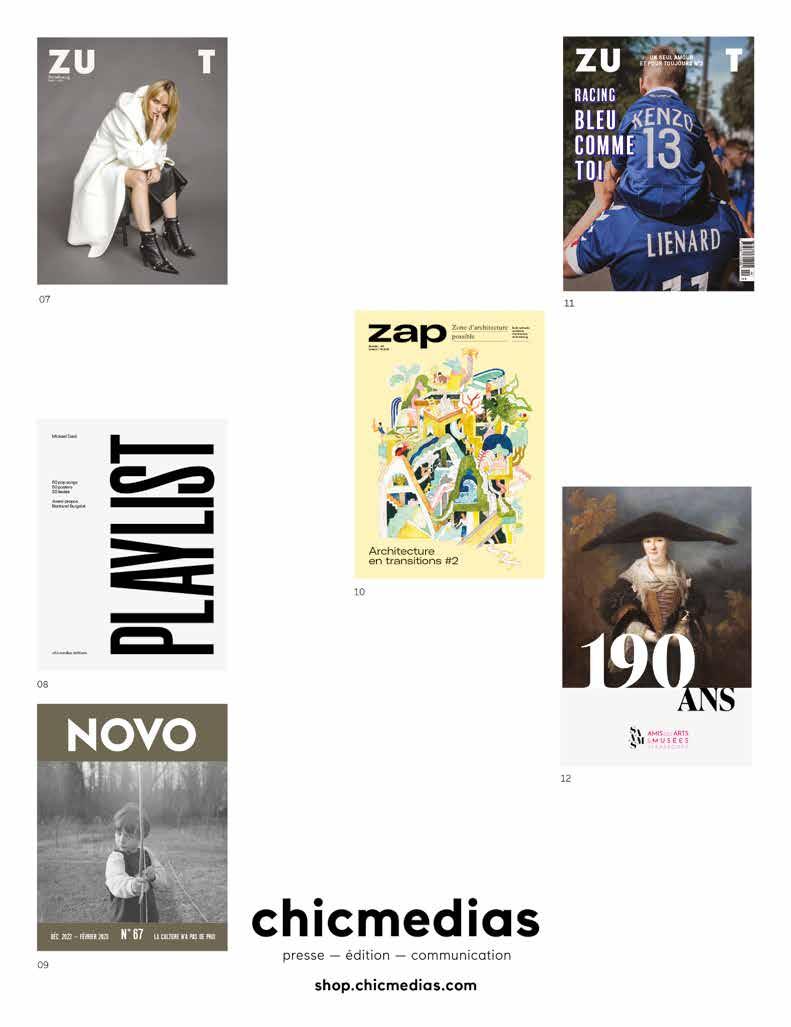



 Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny









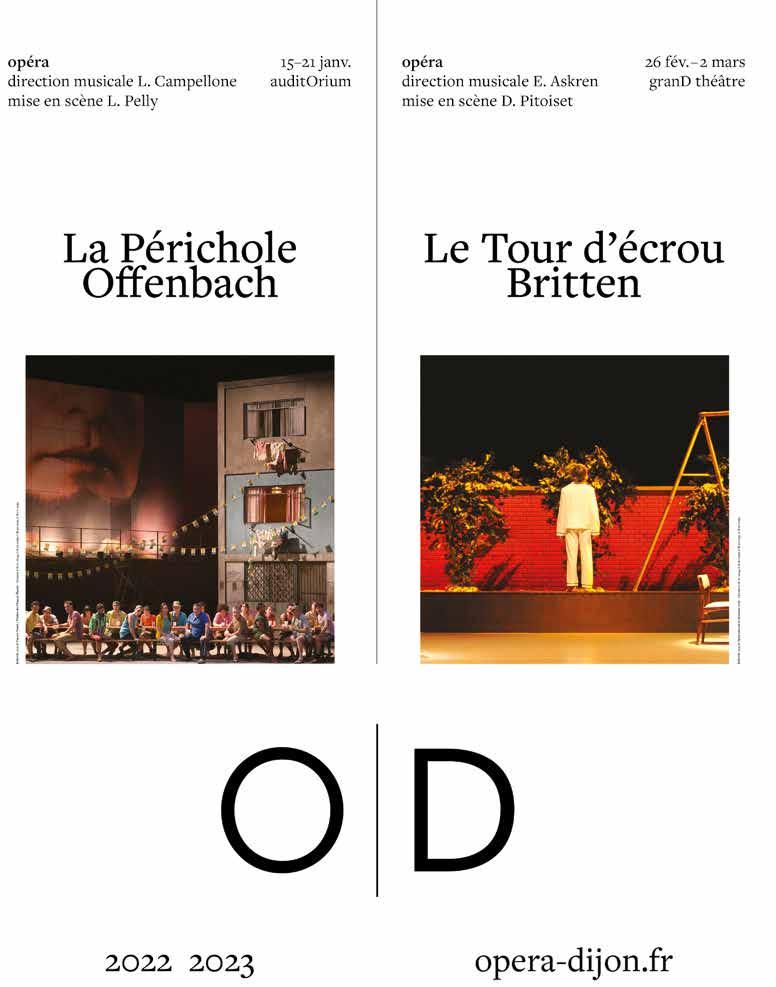

 Par Clément Willer
Par Clément Willer
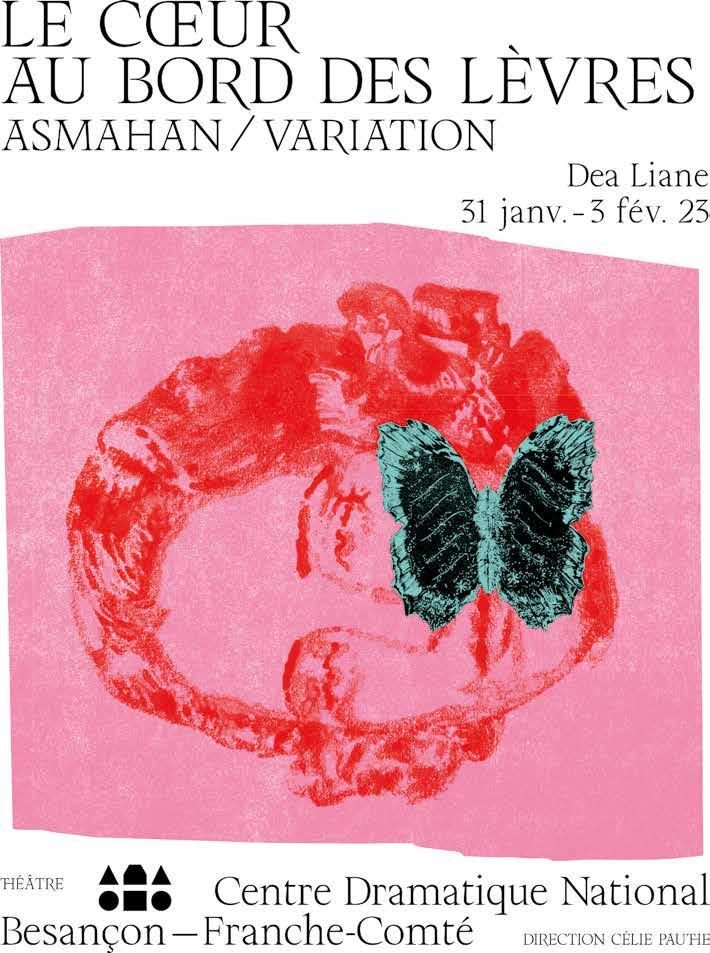

 Par Sylvia Dubost
Par Sylvia Dubost






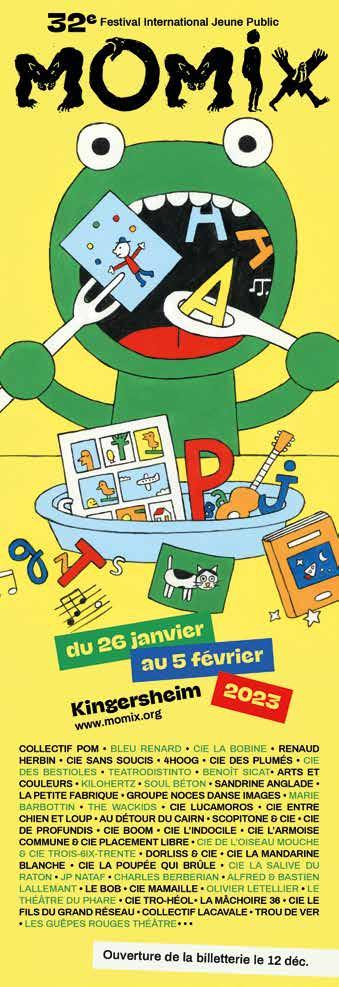



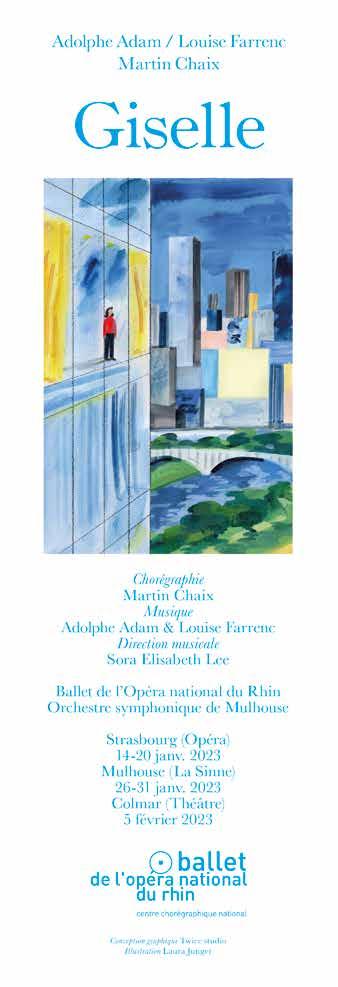


 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer

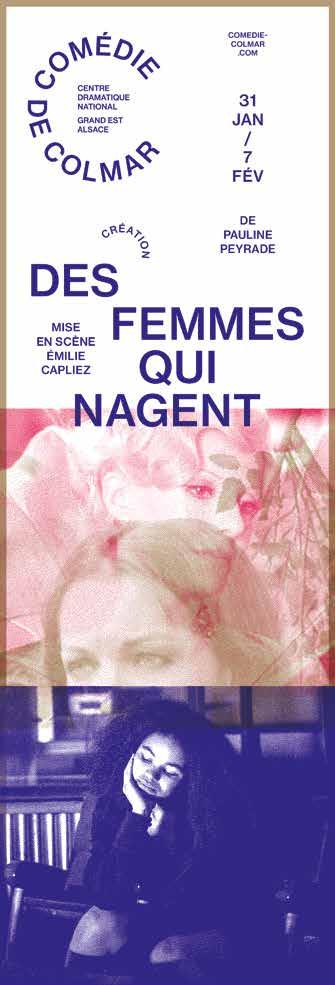
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer














 Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,
Ces vies-là (2011, trad. de Georges Tyras), d’Alfons Cervera, est la première traduction publiée par La Contre Allée. Trouver un autre nom à l’amour (2015, trad. de François Vallée), est le dernier livre publié du vivant de Nivaria Tejera. Tea Rooms (2021, trad. de Michelle Ortuno) de Luisa Carnés,

 Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien
Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien




 Par Sylvia Dubost ~ Photo : Pascal Bastien
Par Sylvia Dubost ~ Photo : Pascal Bastien
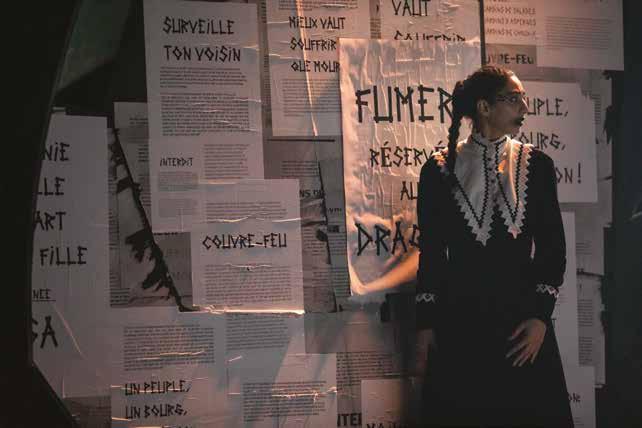












 Par Valérie Bisson
Par Valérie Bisson





 Saba Niknam, Nommo le dieu poisson © Saba Niknam
Saba Niknam, Nommo le dieu poisson © Saba Niknam
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer