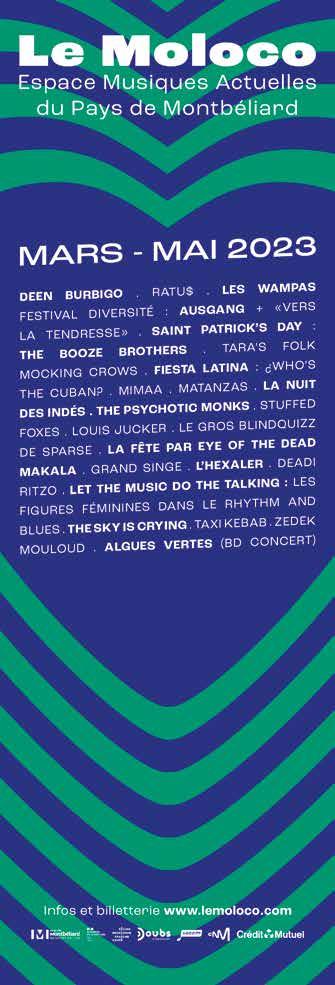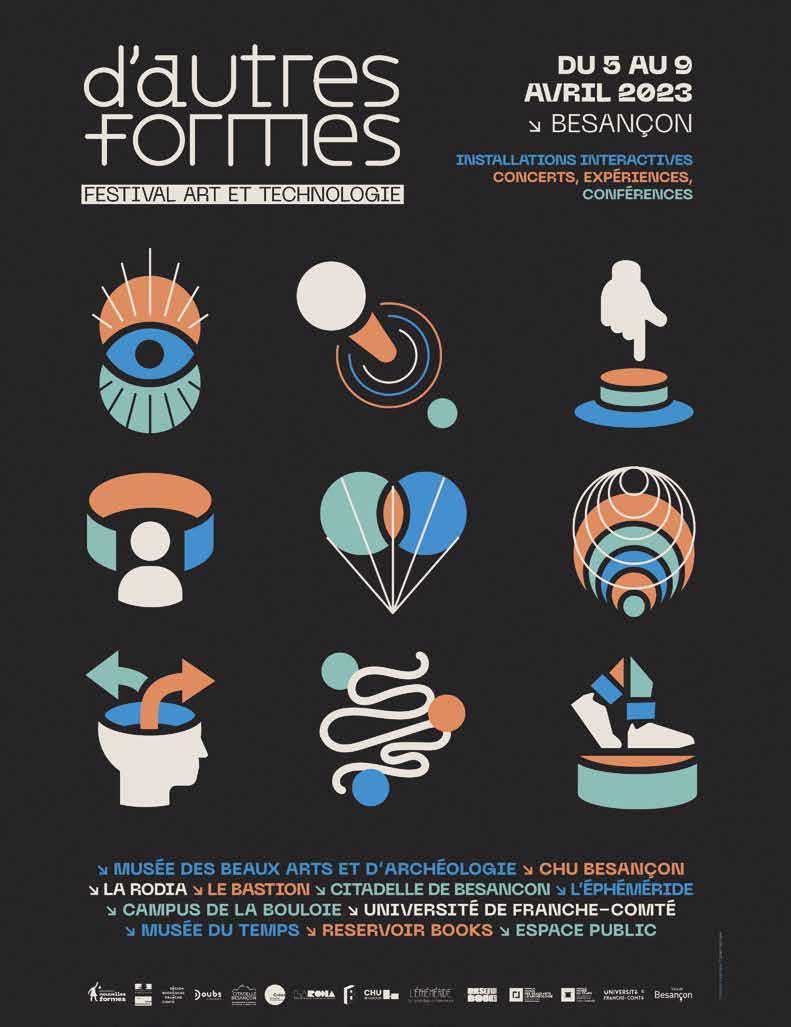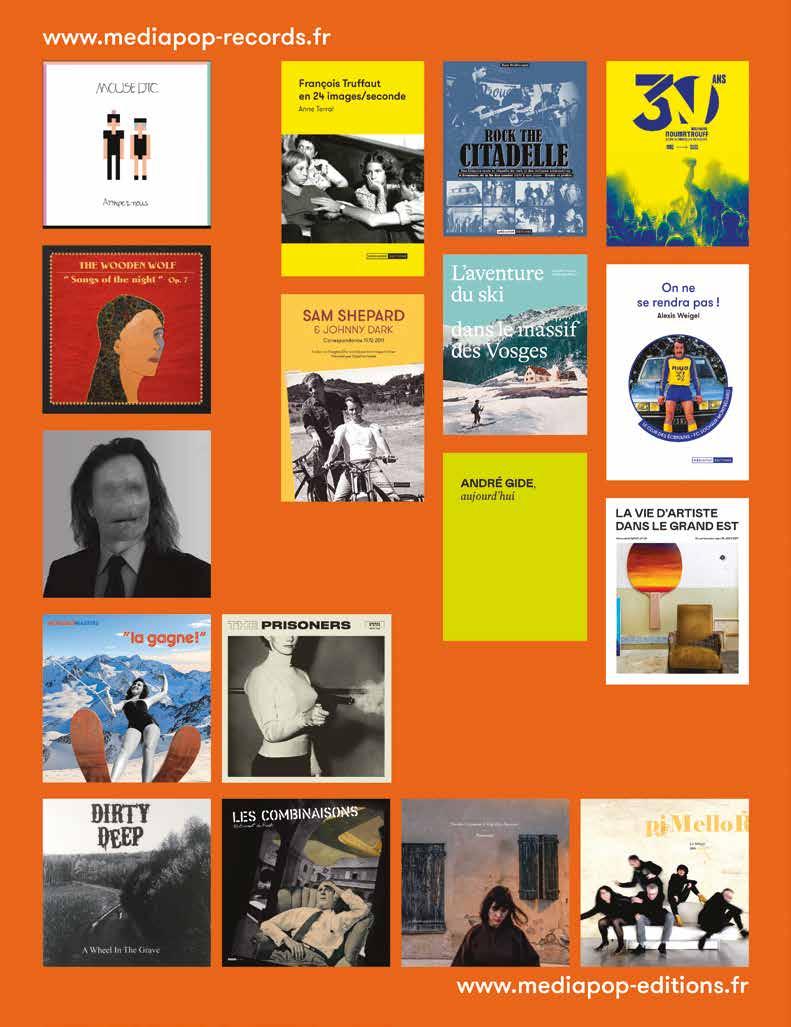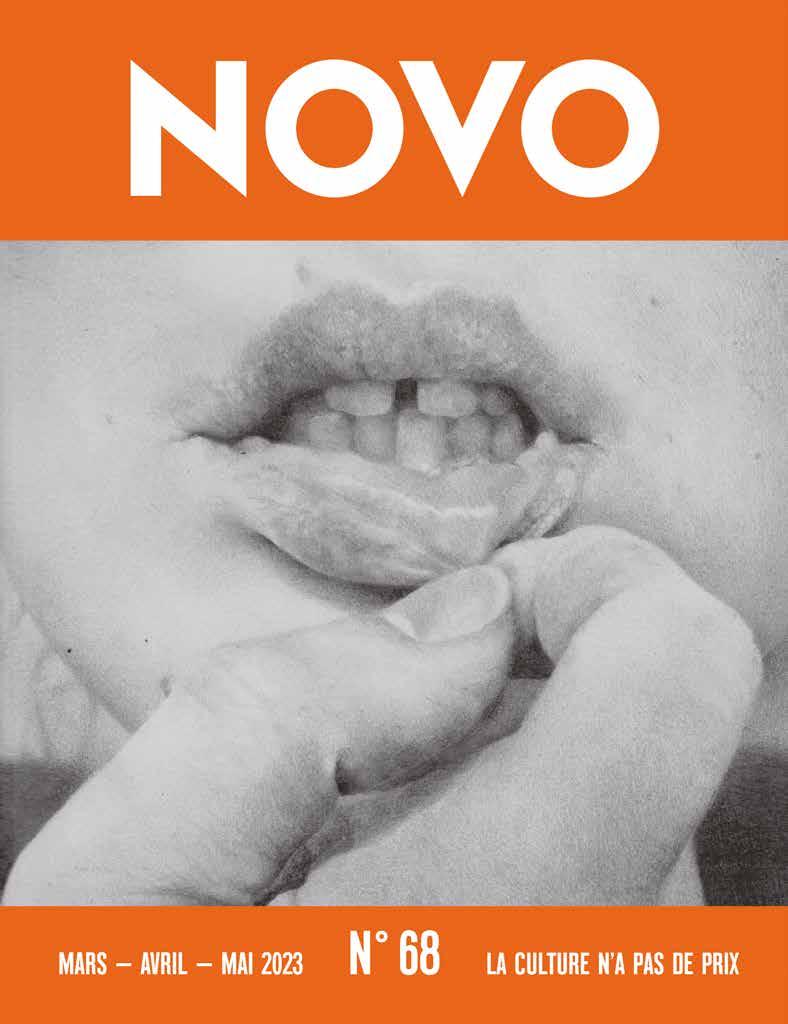



Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer
ps@mediapop.fr
06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Bruno Lagabbe, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Maïta Stébé, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Florence Manlik, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
Célia Muller. Anguish-Book, 2019. Dessin, graphite sur papier, carnet ouvert de 14x14 cm sur guéridon. celiamuller.com
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : mars 2023
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2023
Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 5 numéros — 30 €
Hors France : 5 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
PROLOGUE 7
STEPHAN CRASNEANSCKI
FOCUS 15-34
9-14
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
SCÈNES 35-48
Pascal Rambert 36-39, Vagamondes 40-41 , Dominique Pitoiset 42-44, Sandrine Abello 45-47, Maillon 48
SONS 49-60
Sam Guillerand 50-53, The Murder Capital 54-57 , Gwendoline 58-60
ÉCRITURES 61-70
Catherine Meurisse 62-64, Clément Vuillier 65-67 , Martin Panchaud 68-70
ARTS 71-78
La Répétition 72-73, Wayne Thiebaud 74-75 , Anne Marie Maes 76-77, Marina De Caro 78
IN SITU 79-91
Les expositions de l’hiver
CHRONIQUES 92-106
Nicolas Comment 92-97, Stéphanie-Lucie Mathern 98-99 , Myriam Mechita 100-101, Nathalie Bach 102 , Bruno Lagabbe 104, JC Polien 106
SELECTA
Livres 108
Disques 110
ÉPILOGUE 112
SOMMAIRE OURS
5

VERS L’APOCALYPSE
Il faisait bien trop beau pour enterrer un ami. Nous n’étions pas très nombreux autour de sa tombe, mais ceux qui s’étaient déplacés jusqu’au cimetière n’auraient raté ça pour rien au monde. Quand les quatre employés des pompes funèbres, qui me faisaient penser aux frères Dalton, se sont mis au travail pour descendre le cercueil, Manu s’est approché d’eux afin de ne rien rater du spectacle. On aurait pu craindre qu’il aille se jeter dans la fosse, mais il s’est contenté d’attendre patiemment que le cercueil soit bien en place, avant de tirer un vieux bouquin d’Allen Ginsberg de son cartable et de se mettre à lire d’une voix habitée : « Centre-ville Manhattan, midi d’hiver clair, ne me suis pas couché de la nuit, ai parlé, ai parlé, ai lu le Kaddish à haute voix, ai écouté Ray Charles gueulant son blues à tuetête comme un sourd sur le pick-up / rythme rythme – et ton image trois ans après dans ma mémoire – Ai lu tout haut les dernières strophes triomphantes d’Adonaïs – ai pleuré me disant comme nous souffrons / Que la mort est remède dont rêvent les chanteurs, qu’ils chantent, qu’ils rappellent, qu’ils prophétisent comme l’Hymne Hébreu ou le Livre Réponse des Bouddhistes – ma vision à moi, une feuille fanée – au petit jour – / Rêvant à l’envers du courant de la vie, ton Temps – le mien, en accélération vers l’Apocalypse… »
Alors que je commençais à perdre le fil et que mon esprit vagabondait comme un cabri, mon téléphone s’est mis à vibrer avec insistance. J’aurais pu l’ignorer, on ne téléphone pas dans un cimetière, mais je me suis empressé de répondre tout en faisant quelques pas en arrière.
— Allô ?
— Monsieur Chouière ?
— Je suis occupé.
— Monsieur Chouière, vous avez toujours votre imprimante Samsung ML-2165W ?
— C’est pas le bon moment.
— Monsieur Chouière, si si, c’est tout à fait le bon moment d’acheter une nouvelle cartouche pour votre imprimante Samsung ML-2165W.
Mon ami était au fond du trou. Ses amis s’approchaient à tour de rôle pour lui lancer une poignée de terre fraîche. Je n’avais pas été très présent auprès de lui pour ses derniers moments. Je savais juste qu’il avait terriblement souffert. Il était temps de raccrocher si je voulais me rattraper.
— Monsieur Chouière, c’est toujours vous qui vous occupez de l’achat des cartouches d’encre pour l’imprimante Samsung ML-2165W ?
— Je n’ai pas la tête à ça.
— Moi non plus je n’ai pas la tête à ça, mais je travaille. Il me reste deux ans de plus que prévu à m’occuper de votre imprimante.
— Bon courage.
— Monsieur Chouière, c’est pas avec la retraite que je vais toucher que je pourrai faire des folies.
Une femme s’est approchée du trou pour y jeter une rose. Elle pleurait discrètement.
— Monsieur Chouière, écoutez-moi. Si je ne vends pas de cartouche, je n’ai pas de salaire et si je n’ai pas de salaire, je n’ai pas de retraite.
— Je n’ai pas le cœur à penser à la retraite.
La femme en pleurs est passée à côté de moi. Elle m’a tapoté l’épaule sans s’attarder. Je lui ai répondu par un petit signe de tête en faisant mine de la reconnaître. Je commençais à perdre la mémoire des visages.
— Monsieur Chouière, j’ai travaillé dur toute ma vie. Je ne m’en fiche pas du tout de ma retraite. Si vous commandez tout de suite, ça ira plus vite.
J’étais en train d’enterrer un vieil ami qui n’avait pas eu la chance d’atteindre l’âge de la retraite. Je n’arrivais pas à remettre un nom sur le visage de la femme en pleurs. J’ai essayé de me l’imaginer dans la fleur de l’âge. Je ne l’avais vu parler à personne.
— Monsieur Chouière, vous êtes toujours là ? Vous voulez que je vous dise combien je vais toucher quand je serai à la retraite, moi qui ai travaillé dur toute ma vie ?
La femme s’est retournée une dernière fois en quittant le cimetière. J’ai eu l’impression qu’elle me faisait un dernier petit signe avant de disparaître.
— Il faut que je raccroche.
Monsieur Chouière, qu’est-ce que vous avez contre moi ? Elle n’était pas bonne la cartouche d’encre que vous m’avez commandée la dernière fois ?
Les amis de mon ami commençaient à se disperser. Tout s’était passé très vite. Personne ne semblait avoir envie de prolonger la cérémonie par un dernier verre. Manu a rangé son livre dans son cartable. Il ne buvait pas une goutte d’alcool. La poésie lui suffisait. Je n’avais rien à faire d’autre que de rentrer chez moi pour m’absorber dans la lecture des journaux, à la recherche d’une bonne nouvelle.
Par Philippe Schweyer
7

LA MUSIQUE DU HASARD
Stephan Crasneanscki, l’âme du Soundwalk Collective, parcourt le monde pour y questionner la mémoire des lieux, y prélève les sons comme il en prendrait le pouls. Aux matières puisées se mêlent les voix ou les notes d’artistes associés. Les amples pièces sonores qui naissent de sa quête offrent une vision inédite, un sens inouï au cours chaotique de nos vies.
 Par Pierre Lemarchand
Par Pierre Lemarchand
9
Stephan Crasneanscki et Patti Smith. Photo : Satya Crasneanscki.
Du 20 octobre au 6 mars s’est tenue au Centre Pompidou l’exposition « Evidence » que tu cosignes avec Patti Smith. Peux-tu revenir sur votre rencontre, il y a dix ans, en 2013 ?
À l’époque, je venais de traverser l’Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, étais remonté dans les Balkans et en Bulgarie pour enregistrer de la musique tsigane. C’est en Macédoine que j’ai terminé mes enregistrements, tous réalisés dans les ghettos tsiganes. Je devais retourner à New York pour monter toutes ces bandes en vue de la réalisation d’un album qui serait Sons of the Wind. C’est à Paris, où je prenais ma correspondance pour les États-Unis, que je l’ai rencontrée. Patti rentrait de Tanger. Elle avait apporté sur la tombe de Jean Genet de la terre qu’elle avait collectée en Guyane quinze ans auparavant. Nous revenions tous deux de voyages intenses. Nous nous sommes retrouvés assis l’un à côté de l’autre dans l’avion – un pur hasard. Nous nous sommes salués poliment. C’est au moment où j’ai sorti de mon sac un livre de poèmes de Nico que Patti m’a parlé. Elle avait été proche de Nico dans les années 1970, jusqu’à lui racheter un harmonium quand on le lui avait volé. Je lui ai raconté que j’avais été en juillet, le mois de sa mort, à Ibiza sur les lieux de son accident de vélo et y avais enregistré le son des grillons. Ceux-ci sortent de terre, montent dans les arbres et stridulent tout l’été. Ils sont à ce point dévolus à leur appel à l’amour qu’ils en oublient de se nourrir. Et de leurs corps vides monte en puissance leur chant. Jusqu’à en mourir d’épuisement, brûlés le temps d’un été, intoxiqués par l’amour. Je trouvais que c’était une belle métaphore pour Nico. Les chants des grillons sont les derniers sons qu’elle a entendus avant de glisser dans la mort. Cette histoire a touché Patti, nous avons parlé tout le long du vol et, quand l’avion a atterri à New York, nous n’avions pas terminé notre conversation. Le lendemain, nous nous retrouvions et nous attelions à la réalisation de « Killer Road », notre hommage à Nico. Cette conversation, nous la poursuivons encore aujourd’hui, dix ans après.
Votre rencontre est marquée par le mouvement et le voyage, qui caractérisent ton collectif, le Soundwalk. Peux-tu revenir sur son point de départ ?
Tout a commencé à New York. Je faisais des études d’art, j’étais féru de vidéo et d’installations, mais je ne savais pas définir où je désirais aller. Je l’ai su le jour où le son m’a pris par surprise. Il m’est apparu que le son, seul, m’offrait la possibilité de raconter une histoire avec beaucoup plus de liberté et d’espace que l’image filmée. J’ai délaissé les images et me suis mis à créer des installations autour des sons de New York. Ma première pièce, « Kill the Ego », est un collage de sons que j’ai captés tandis que je marchais. Ainsi est né le nom Soundwalk. Mes micros étaient invisibles, je les customisais moi-même et ils enregistraient à 360 degrés. J’ai ainsi enregistré un peu partout, de jour comme de nuit, avec en tête cette réflexion de John Cage, selon laquelle l’accumulation de sons à New York fait qu’ils s’annulent et deviennent une sorte de silence. J’ai longtemps enregistré sans but précis –des clubs SM du fin fond de Meatpacking à du rap dans le Bronx, des block parties d’Afrika Bambaataa au quartier ukrainien de Little Odessa. J’ai laissé, des années durant, le son dicter l’histoire qui devait se raconter. J’étais, quant à moi, un flâneur. Je me laissais porter, sans volonté, sans ego, par la couleur des sons, acceptant qu’ils m’emmènent dans un bâtiment, une rue, un quartier.
Quel est ce jour où le son t’a pris par surprise et a enclenché ce mouvement de la marche et de la quête sonore ?
Le 11 septembre 2001. Quand la première tour s’est effondrée, je me suis aussitôt rendu sur les lieux de ce que l’on croyait encore être un accident. Quand la deuxième tour est tombée, tout le monde autour de moi filmait. Moi, j’ai enregistré et n’ai cessé de le faire toute la journée. L’effondrement de la tour, les sirènes, les hurlements, les corps qui chutaient de centaines d’étages, la torpeur : j’ai capté ces sons, comme étouffés par l’immense nuage de cendres. J’en étais totalement recouvert. 9/11 a opéré un double déclic : j’ai arrêté mes études d’art et j’ai compris qu’il y avait dans le son un chemin à suivre.
Ce point de bascule mondial a opéré chez toi un bouleversement plus intime, a scellé ton destin ? Oui, et comme le destin est souvent fait de loops, un an plus tard, j’ai été approché par la radio NPR. Elle avait collecté les messages laissés sur les répondeurs de leurs bien-aimé(e)s ou ami(e)s par les personnes qui étaient dans les tours ou les avions. NPR avait eu connaissance de la pièce sonore que j’avais réalisée sur la naissance du
—
10
Je me laissais porter, sans volonté, sans ego, par la couleur des sons. —
hip-hop et c’est ainsi qu’ils m’ont demandé de réaliser un montage sonore avec ces messages, en collaboration avec l’écrivain Paul Auster. Ce montage m’a pris des mois, des nuits peuplées d’insomnies et de cauchemars. Des mois passés en compagnie de ces centaines de voix, souvent très calmes, qui disaient au revoir. Je repensais à cette légende indienne selon laquelle les âmes des morts disparus brutalement traînent un temps avant de s’incorporer à nouveau. Elles tournoient, errent sur les « lieux du crime ». Cela me troublait d’autant plus que les buildings ont été en grande partie construits par les Indiens eux-mêmes, car ils ne connaissent pas le vertige. La pièce sonore que j’ai créée, intitulée « 9/11 », mêle mes enregistrements de l’effondrement des tours, les messages des disparus et la voix de Paul. J’enregistrais déjà beaucoup avant cela, mais le 11 septembre, j’ai compris que dans l’espace du son, il y avait une vie possible pour moi. Une vie non entravée ou formatée par le circuit des galeries d’art, une vie libre où il me serait possible de voyager, de flâner. Cela coïncidait aussi avec une certaine philosophie de vie : ne pas forcer, être dans une situation de présence sans objectif précis, être disponible, accueillir ce qui se présente.
Quels souvenirs gardes-tu de cette collaboration avec Paul Auster ?

Son obsession du mot juste. Sa volonté d’arriver à l’essentiel en coupant au maximum. De créer une ponctuation, un rythme et des espaces qui permettent au lecteur, et à l’auditeur en l’occurrence, de trouver sa place, de dialoguer avec les mots que l’on livre. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à écouter mes bandes et les messages des disparus. C’était une expérience intense ; nous vivions dans une période également intense, post-traumatique. Dans ce monde qui avait changé pour toujours, la présence de Paul à mes côtés a beaucoup compté.
Tu accueilles les sons comme tu accueilles les rencontres ?
Je ne me l’explique pas, mais ma vie est tissée de rencontres déterminantes. J’ai pu vivre, à travers ces personnes rencontrées, de multiples vies. J’ai passé des mois dans le Bronx avec Afrika Bambaataa à travailler sur la naissance du hip-hop et à rencontrer en profondeur cet univers musical. J’ai vécu dans la ville sainte de Varanasi en Inde avec Robert Svoboda à parcourir différents lieux liés au mysticisme hindouiste. J’ai passé deux années happé par l’exploration des archives sonores que m’a confiées Jean-Luc Godard. Tous trois m’ont ouvert la porte de leur univers et j’y ai vécu en
—
Si les âmes continuent d’habiter les lieux, alors le médium le plus sensible pour entrer en contact avec elles, c’est le son. —
11
Soundwalk Collective, Stephan Crasneanscki et Simone Merli. Photo : Vanina Sorrenti
témoin silencieux. Tous ces gens – Philip Glass, Jean-Luc Godard, Charlotte Gainsbourg ou Nan Goldin, je les rencontre et les côtoie en nomade. Je vis un temps auprès d’eux, puis je pars vers d’autres rencontres, quitte à les retrouver plus tard. Et c’est le son qui m’ouvre à ces rendez-vous, ce sont mes projets sonores qui donnent ses directions à ma vie – pour ma part, je n’ai pas d’intention particulière.
La rencontre avec Patti Smith s’inscrit dans cette logique ?
Oui. Patti Smith a offert à mon travail une dimension inédite : une dimension vocale. Avant elle, la voix ne figurait dans mes pièces sonores que de façon fragmentée. Patti, en y délivrant ses mots, a agi en chamane. Nous nous comprenons profondément. Elle observe une grande discipline de travail ; elle parle souvent de ses « fellow workers », ses collègues de travail. J’ai le même rapport au travail – utilisons ce mot à défaut d’un autre. Ma vie est exclusivement liée à ma pratique et je ne connais aucune autre activité qui m’intéresse. Je n’ai ni week-ends ni vacances ; je demeure constamment dans la pratique de l’écoute. Ma relation avec Patti s’est installée dans le temps et chacun de nos projets nourrit le suivant ; plus nous avançons sur notre chemin, plus nous gagnons en précision, touchons au but de notre collaboration.
« Evidence », l’installation visuelle et sonore de Beaubourg, fait écho à la trilogie The Perfect Vision qui recueille trois albums célébrant les quêtes des poètes Rimbaud, Artaud et Daumal. Comment est née Perfect Vision ?
Après que Patti et moi avons réalisé Killer Road , je suis parti en Éthiopie. J’étais passionné par le soufisme et ai découvert que le lieu saint du soufisme en Afrique est Harar, la ville où vécut Arthur Rimbaud plus d’une décennie. Je m’y suis donc rendu – là encore sans idée préconçue, juste attiré par le tropisme du soufisme. Il a migré du Moyen-Orient au Yémen, a traversé la mer Rouge pour arriver en Somalie puis à Harar dans ce qui s’appelait alors l’Abyssinie. Sa pratique y a été très peu persécutée et est restée très fidèle à ses origines. À Harar, j’ai découvert que les maîtres soufis plantaient dans leur estomac des graines de banians, ces immenses arbres africains qui, après des centaines d’années, croissent et recouvrent leurs tombeaux. Des milliers d’oiseaux s’y posent pour chanter. C’est un chant métaphorique : ils chantent pour l’éternité. Ces chants sont les premiers enregistrements que j’ai réalisés à Harar et c’est d’ailleurs le premier son que l’on entend quand on pénètre dans l’exposition « Evidence » Puis m’est apparu le lien qu’entretient la transe
soufie à la transe poétique de Rimbaud – il y est question de transcendance, d’illumination. Quand je suis rentré à New York, j’ai parlé à Patti de ce pont entre Rimbaud et les soufis. Elle a adoré l’idée ! J’ai fait d’autres voyages à Harar, ai continué d’enregistrer des sons, dont les chants soufis. Ceuxci fonctionnent comme le blues, sur un système de call and response. J’ai enregistré les appels, sachant que ce serait Patti qui chanterait, a posteriori et à distance, les réponses avec les mots poétiques de Rimbaud. Dès les premiers essais dans un studio à New York, j’ai compris qu’une alchimie s’était mise en place. C’est ensuite que j’ai pensé à associer Philip Glass, dont le fils est converti au soufisme et dont je savais qu’il aimerait le projet. Le percussionniste éthiopien Mulatu Astatke s’est imposé lui aussi. Le premier album, Mummer Love, mêlant l’univers sonore de Harar, les chants soufis, Patti, Philip et Mulatu, est né comme ça. Je le dois aux oiseaux de Harar : j’ai suivi leur piste et ils m’ont mené jusque-là.
C’est de cet album sur Rimbaud que naît le second, The Peyote Dance, sur Antonin Artaud ? Absolument. Cinquante ans plus tard, Artaud a lui aussi, au Mexique, fait un voyage non élucidé. Il était au départ invité par le consulat de France pour des lectures du Théâtre et son double à Mexico. Mais sans prévenir, Artaud disparaît. Il monte à Chihuahua puis, à dos de cheval, descend dans les canyons ou vivent les Tarahumaras. Il y a participé à des cérémonies de peyotl pour se désintoxiquer de l’héroïne qui le ravageait. À l’instar des lettres de Rimbaud postées de Harar, les écrits d’Artaud sont les seuls indices que l’on ait de ce voyage. Ce qui prévaut, c’est le mystère, une absence. Je me suis rendu dans le village de Norogachi où il avait séjourné et j’ai eu la chance de rencontrer le petit-fils du chaman avec qui il avait pratiqué le peyotl. J’ai pu visiter la cave où il dormait. J’ai enregistré les Tarahumaras qui avaient en mémoire la présence d’Artaud grâce à des chansons qui s’étaient transmises de génération en génération. Ils s’étaient sentis compris par le poète et avaient compris qu’il n’était pas fou. J’ai aussi enregistré les cailloux, le bois, le vent dans les canyons, les chants et instruments des Indiens. Puis j’ai recherché des fragments dans les lettres et textes d’Artaud, jusqu’aux périodes d’Ivry et Rodez, car il n’a cessé de conter cette expérience mexicaine, la considérant comme le dernier moment heureux de sa vie. Patti s’est plongée dans les pièces sonores que j’avais créées et a lu les fragments qui l’inspiraient, créant un dialogue avec les paroles de transe des Tarahumaras. Et elle a créé « Ivry », sa chanson hommage à la dernière nuit d’Artaud,
12
avant qu’il ne soit retrouvé mort au petit matin avec une cigarette encore coincée entre les doigts, à la fenêtre de sa chambre.
Cette trilogie Perfect Vision n’était pas prévue ; c’est le son qui dicte le chemin ?
L’empreinte sonore de la pierre, dans laquelle le vent s’est engouffré durant des millénaires, porte une histoire ; un caillou est le témoin silencieux du passage d’une personne il y a des centaines d’années. Le chant des oiseaux que j’ai entendu à Harar est le même que celui qu’entendait Rimbaud ; la pluie diluvienne qui s’est abattue sur le banian géant, Arthur l’a entendue à l’identique. Nous avons éprouvé la même expérience sonore. Le son est ce pont qui permet de joindre deux époques, il annule le temps, il permet la communion, le partage avec les disparus. Si les âmes continuent d’habiter les lieux, alors le médium le plus sensible pour entrer en contact avec elles, c’est le son. Il possède, comme les odeurs, une dimension proustienne : il ramène à des mémoires enfouies, permet leur réveil.
Le troisième album, Peradam, est consacré à René Daumal, avec Charlotte Gainsbourg. Sa voix ne sonne jamais aussi intensément que lorsque tu la captes. Quel lien entretiens-tu avec elle ?
J’ai rencontré Charlotte à New York où elle s’était installée. Sa voix se situe au-delà du talent ; elle évolue dans les parages de la grâce. Elle raconte la fragilité, l’intimité ; à la frontière du visible et de l’invisible. C’est sa voix qui m’a inspiré pour la pièce sonore « The Time of the Night », que j’ai créée pour la Fondation Carmignac et qui signe notre première collaboration. Elle évoque la nuit, le rêve et la frontière ténue entre le réel et l’irréel. Avec la voix de Charlotte, tout peut basculer d’un univers à l’autre. Entre ses mots surgit la magie, entre ses respirations s’invite la pure lumière, la brillance d’un diamant. Dans cette pièce, je lui fais rencontrer la voix plus physique de Patti. Celle-ci est l’âme de la nuit, le rêve ; Charlotte est la marcheuse perdue dans les bois, sur la ligne de crête du rêve, aux limites de l’aube. Ces deux voix m’inspirent beaucoup : je recherche leur compagnie, car elles provoquent l’inspiration et, ensuite, le plaisir de travailler, de chercher ensemble. Dans la foulée de « The Time of the Night », j’ai emmené Charlotte dans le troisième voyage de la trilogie, celui de Daumal. Cet album part de l’amour que Patti nourrit pour Le Mont Analogue, son livre inachevé. Comme avec Rimbaud et Artaud, il est question de voyage non élucidé, d’absence et de mystère. Tout part d’une conversation avec Patti à l’issue du mixage de The Peyote Dance . Nous parlons du voyage de Daumal dans les Alpes à
la recherche de l’invisible, mais aussi du voyage qu’il n’a jamais pu faire en Himalaya. Fasciné par le sanskrit, passionné de mysticisme indien, il rêvait d’y aller. J’ai donc enregistré des sons dans les Alpes, là où il avait grimpé, puis me suis rendu en Inde, à la source himalayenne du Gange, rivière sacrée de l’hindouisme. J’ai descendu le Gange jusqu’aux villes saintes de Rishikesh et Varanasi, où les corps brûlent sur les rives du fleuve. Nous avons convié Anoushka Shankar, fille du musicien Ravi Shankar et nièce du danseur Uday Shankar, un ami et collaborateur très proche de Daumal. Anoushka interprète une très belle pièce au sitar, Vera, et Patti y récite un poème que Daumal avait écrit pour sa femme Véra. Sur « The Four Cardinal Times », je mêle les voix de Patti et Charlotte, pour la deuxième fois après « The Time of the Night »

13
Time of the Night © Stephan Crasneanscki
Avec Charlotte, vous avez créé une pièce sonore pour la Maison Gainsbourg, ce musée sis dans l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, à Paris. Charlotte se demandait comment raconter cette maison, dormante durant trente ans, où elle n’avait rien bougé. Nous y avons passé des jours et des nuits. Charlotte me faisait visiter, me confiait ses fragments de mémoire que faisaient ressurgir les lieux. Ainsi est née l’idée de la pièce sonore « Maison Gainsbourg » : on suit Charlotte dans la maison, on écoute ses souvenirs. Ce n’est pas une histoire qui est contée, juste des moments d’enfance, d’adolescence, d’un rapport entre un père et sa fille. J’ai souhaité être fidèle au silence des lieux – les volets et fenêtres sont fermés, les tissus qui recouvrent les murs étouffent le son. Aux sons de la maison se mêle le piano dont joue Charlotte. Elle interprète des morceaux que jouait son père et qui ont habité son enfance – Ravel, Chopin, Satie. J’ai aussi incorporé des extraits des petites cassettes sténo sur lesquelles Gainsbourg
enregistrait les mélodies qui lui passaient par la tête. Cette pièce sera en écoute au casque lors des visites de la Maison Gainsbourg. J’ai repris l’idée qui m’a guidé pour l’exposition « Evidence » : le visiteur fait surgir différents sons au gré de ses déplacements. Ces sons peuvent se superposer les uns aux autres, créant ainsi d’infinies possibilités. Tous ces fragments collectés pour la pièce sonore sont « stockés » dans la Maison et peuvent être, à tout moment, convoqués par le visiteur. C’est la marche, encore et toujours, qui déclenche les pistes sonores.
Maison Gainsbourg sera publiée en disque vinyle cette année. Tout comme Correspondances , ta dernière collaboration en date avec Patti Smith. En quoi consiste-t-elle ?
Patti y interprète ses propres textes. Nous avons passé cinq ans à travailler sur Correspondances et je pense que Patti y livre ses plus beaux textes – des textes majeurs, proses, poèmes et chansons. Je pense aux derniers Rembrandt, quand il peignait des noirs d’une profondeur incroyable. Nous n’explorons plus le format chanson comme sur la trilogie ; ce sont des travellings sonores qui excèdent 15 minutes. Je suis revenu pour Correspondances à l’origine du Soundwalk Collective : on marche dans un film sonore et Patti y évolue comme une « voice over » cinématographique – une voix qui passe du chant au cri au chuchotement. La matière de ces pièces est puisée dans mes voyages. Je suis parti sur les traces d’Andreï Roublev et de son monastère près de Moscou, de Pasolini et des lieux où il mourut, de Médée en Géorgie et autour de la Mer Noire. Je suis allé à Tchernobyl et y ai enregistré le son déglingué des pianos abandonnés – il y avait dans cette ville opulente la meilleure école de musique du pays. J’ai saisi le craquement des lacs gelés de Sibérie et des feuilles des chemins de la Forêt-Noire où marchèrent Martin Heidegger et Paul Celan. Ce sont sur les pièces que j’ai composées à partir des traces sonores collectées lors de ces voyages, dont certains ont été accomplis avant notre rencontre, que Patti a posé ses textes. Je les considère comme l’aboutissement de toutes ses années de travail avec les mots et de son compagnonnage avec les morts.
— EVIDENCE, exposition jusqu’au 6 mars au Centre Pompidou, à Paris www.centrepompidou.fr

soundwalkcollective.com
 The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki
The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki
14
The Perfect Vision Trilogy, Peyote Dance, Sierra Tarahumara © Stephan Crasneanscki
f oc - u s
L’empire contre-attaque
Elle vient de là, elle vient du blues, la musique engagée, chantée et (f)rappée de Mojo Sapiens, trio alsacien transgénique composé de Mr. E (Goldencut, ex-Freez), Leopard DaVinci (The Fat Badgers) et Victor Sbrovazzo (Dirty Deep). Trois personnalités, trois bagages, un but commun : donner sa lecture de l’American Dream (qui se transforme en cauchemar lorsque le conservatisme se réaffirme, décomplexé) via Empire of Dust (Tipping Point). Une musique que Mr. E résume ainsi pour nous : « Celle qu’on écoute dans une bagnole qui roule à pleine régime en direction de l’apocalypse. » À écouter, now ! En concert au Frigo à Metz le 23 juin (E.D.)

www.tippingpointproduction.com
Ne quittez pas l’écoute !
Pour une seconde saison, La Comédie de Colmar continue à dispenser de bonnes ondes avec ses podcasts Com’ à la Radio qui s’arrêtent sur des thématiques qui traversent la programmation, afin d’en offrir une lecture enrichie. Les sujets traités par l’illustratrice Lili Terrana (et ses images visuelles et… sonores !), la jeune troupe et ses hilarants micros-trottoirs, les talents de L’Opéra Studio et leurs créations musicales opératiques, mais aussi par Pierre Maillet, le groupe Fergessen, AnneLise Heimburger, Léopoldine HH, Jeanne Candel ou Penda Diouf ? Les épisodes 22-23 questionnent le fantôme de Molière qui ne finit pas de hanter les salles, la place des femmes dans la culture, la jeunesse (et le jeunisme), nos 30 millions d’amis dans la création ou l’amour et son flot de cœurs brisés. (E.D.)

comedie-colmar.com/rubrique/ cc-live-podcasts-tv-fictions.60/com-a-la-radio.61
Échec & Matt
La voix à la fois douce et profonde du Nancéien d’origine bristolienne ne cesse de déchirer nos âmes en traversant l’immensité des tragédies d’aujourd’hui. The End of Days n’est pas un aveu de défaite, mais une série de morceaux bravant l’époque avec ses complaintes à la mélancolie balkanique, son saxophone sonnant comme nulle part ailleurs, ses chants de consolation, de réconciliation. Autant de précieux pansements pour réparer nos cœurs, un mélodieux album à paraître le 31 mars chez Ici d’ailleurs, son fidèle label de Nancy. À découvrir (gratuitement) en live dans le cadre de La Laiterie Indie Club Festival, les 12 et 13 mai avec toute une ribambelle d’artistes régionaux ou internationaux : Sons, Bad Pelicans, Sinaïve (le 12) ou Matt Elliott, Julie Doiron et JJH Potter (le 13). (E.D.)
icidailleurs.fr www.artefact.org

focus
Lili Terrana (Les Fourberies de J.B.)
Mojo Sapiens © Bartosch Salmanski
16
Visuel disque : Matt Elliott – The End of Days
Retiens la nuit


Tempérament rouge sang et cœur ardent, l’artiste alsacien Matthieu Hubrecht, alias MHUD, peint, en des coloris bleu pétrole, les merveilles du soir, instants fragiles et lumières aveugles. Les lanternes semblent éteintes tout au long de son album autoproduit Post Parade (Les 7 Lagunes) : insomniaque goûtant les ambiances dark, MHUD poursuit sa course dans l’obscurité, parcourant la nuit à en perdre haleine. (E.D.)

official.shop/mhud
Les lumières de la ville
Léon Gimpel (1873-1948) a quitté Strasbourg pour échapper au joug allemand, mais y reviendra… Il pratique l’autochrome, avec son lot de clichés colorés inhérents au genre – jardins fleuris, scènes éroticohamiltoniennes avant l’heure – et fixe son objectif sur d’autres sujets : les illuminations spectaculaires de la Ville Lumière dans les années 1920, les beautés naturelles à destination scientifique, les sommets alpins développés sur place dans le froid glacial des hauteurs, la capitale alsacienne quelques jours après la Libération, avec citoyens en liesse et drapeaux français au vent, ou jeux d’enfants façon Guerre des boutons pendant que leurs papas sont (vraiment) au combat. Guerre & Paix, à La Chambre jusqu’au 26 mars : et les frères Lumière furent, et la couleur fut ! (E.D.)
www.la-chambre.org
Pays sage
Les Éditions du livre poursuivent la réinvention des ouvrages jeunesse, avec un imprimé à la couverture bleutée tachetée de motifs dorés. Sur chaque page, un chaleureux chalet, une petite mare où croassent les rainettes, un jardinet propret et, regardant par la vaste fenêtre, un imperturbable minet profitant du paysage verdoyant. Au mur, une horloge dont les aiguilles tournent, indique le temps qui passe. Le Panorama de Fanette Mellier – diplômée de l’École des arts décoratifs de Strasbourg – est 24 fois identique… ou presque : les couleurs et la lumière changent en fonction des heures, des moments. Une invitation à la contemplation des subtiles variations… (E.D.)
www.editionsdulivre.com
focus
MHUD © Bryce Davesne
17
Léon Gimpel, Fééries lumineuses, 1921 (avec l'aimable autorisation de la galerie Lumière des Roses)
L’Extra, un week end de mai extra à Dijon

Les 12, 13 et 14 mai arrivera la deuxième édition de l’Extra Festival, événement sobre et joyeux de la SMAC La Vapeur. Déplacements durables, découvertes musicales dans des petits coins de nature (Le Maquis), en ville (La Vapeur), dans l’espace public, seul ou en famille, tels sont les mots d’ordre de l’Extra Festival. Loin du gigantisme, au programme : une vélo-parade, des conférences, des soirées roller disco en gymnase, des créations avec les artistes locaux FLAUR, des concerts psychés avec Forever Pavot ou avec la brûlure electro rap Uzi Freya. (M.R.)
www.lavapeur.com
L’œil du scaphandrier
Fabien Ribery est une plume spécialiste de la photographie contemporaine. Son blog L’Intervalle, espace d’intelligence comme il en existe peu sur la toile, fait figure d’autorité auprès des auteurs, artistes, spécialistes ou amoureux de belles lettres et d’images sensibles. Alain Willaume est ce grand photographe des confins dont l’art, tout en mouvement et transformation, offre de précieuses clés de compréhension du réel qui nous entoure, et souvent nous égare. Un réalisme hanté est leur dialogue passionnant où il apparaît que le photographe strasbourgeois est en vérité un scaphandrier, et que ses images sont les fragments rapportés d’un monde entraperçu à l’approche du sommeil, visions encapsulées dans leur gangue de rêve ou de cauchemars, annonciatrices des réels de demain. (N.B.)

Un réalisme hanté – Se parler, Alain Willaume et Fabien Ribery, Arnaud Bizalion Éditeur
Mélankhelique
Où puiser son inspiration ? Renaud Walter, alias Renz, n’a eu qu’à traverser le Rhin, un soir, prendre le pont menant de Strasbourg à l’hôtel Astoria de Kehl, l’autoradio crachant la voix de Laure Adler sur France Inter pour changer d’Horizon, voir la vie en bleu… couleur de la planète, des Pépito ou des crêpes. Pour le label/fanzine Langue Pendue, il délaisse la rudesse du roc vosgien et les cornes de chèvre de Guisberg. Renz Allume son sampler plein à craquer et sa boîte à rythmes tenant une éternité. Il branche sa guitare et chante, dans la langue de Bashung, des hymnes à la procrastination et aux âges farouches. (E.D.)

//languependue.com (version K7)
www.hrzfld.com (édition CD)
focus 18
Relire l’Orient
La seconde édition du salon Livres d’Ailleurs, porté par l’association Diwan en Lorraine, sera cette année dédiée « aux littératures et aux idées de l’Orient au sens large du terme ». Présidé par l’écrivaine franco-libanaise Hyam Yared, il accueillera une trentaine d’auteurs de littérature, de BD et d’ouvrages pour la jeunesse issus d’une douzaine de pays. Tables rondes, récitals de poésie, expositions et séances de dédicace rythmeront l’événement. (B.B)

Livres dʼAilleurs – salon littéraire du 7 au 9 avril au palais du Gouvernement, à Nancy www.livresdailleurs.fr
Come on everybody
Depuis sa création il y a plus de trente ans, l’ADN de Rencontres & Racines a toujours été la tolérance et la solidarité – de la bonne musique et de bonnes vibes ! Un festival pour tous – âges, cultures, goûts, couleurs, associations et consorts, trois jours de fête en mode ultra cosmopolite et super familial, avec à l’affiche cette année Deluxe, Suzane, Wax Tailor, Faada Freddy, Lujipeka, Aldebert… On y va ! (A.V).

Rencontres & Racines festival du 23 au 25 juin, à Audincourt www.rencontresetracines.audincourt.fr
Oui mon fils, tu iras danser
« Suivez votre désir, émerveillez-vous, aimez, vivez… DANSEZ ! » Tels sont les mots que nous glisse Marin Delavaud, danseur au Ballet de l’Opéra national du Rhin. Depuis ses 6 ans et ses rêves de Billy Elliot, Béatrice Tourancheau, sa maman, emplit des calepins d’anecdotes et de petites formes poétiques. Avec Marin danse… et les notes dans mes carnets, sa mère raconte l’apprentissage et l’envol de son « petit rat » placé sous les projecteurs ! Rencontre avec Marin Delavaud, le 7 mars (17 h) à la librairie Kléber, à Strasbourg. (E.D.)
//edicop.fr

Deluxe
Echange entre public, auteurs et libraires
focus
19
Le pari de Mai
Point de suspension, plus que point final, minisaison dans la saison. Théâtre en Mai est depuis quelque temps désormais un rituel pour les habitués du CDN dijonnais. On y plonge avec curiosité et l’envie d’en sortir, un peu, changé. Sortir des théâtres, bien entendu, mais aussi des espaces empruntés à la Cité, des jardins.
Théâtre en mai 2023, c’est le premier festival de Maëlle Poésy, arrivée à la tête du Théâtre Dijon-Bourgogne au début de cette saison. TEM, c’est souvent une couleur et celle de cette édition s’affiche multiple et organique. Du vital, du paritaire, de l’ouvert, du hors-norme, pour résumer la chose. Impossible ici de détailler les diagonales calées par l’équipe du festival. Le subjectif donne le change. Grands textes, toujours profitables, et Molière d’abord avec la Saga que lui consacre Johana Giacardi avec les comédiennes des Estivants au jardin de l’Arquebuse. Que les fans des Larousse fassent l’impasse, ici on est dans la marge insolente tracée par JB en son théâtre. C’est une histoire, au sens premier du terme, immense, érudite et furieusement joueuse. Plus loin, c’est un focus sur le sensitif avec Dans ta peau, composé par Julie Ménard, autrice associée au TDB et meneuse d’Inoxydables ou L’Âge de nos pères. Important, la sensation au théâtre. Marque radicale de la pensée en train de s’élaborer. Ici, au Théâtre Mansart, élaboration d’un corps de mutant au son du glam rock et des arrangeurs magistraux des années 1970, naissance d’un avatar calé sur les mélanges de chansons et d’électronique. Suspension idéale, avant l’été, puis la saison qui recommence.
Par Guillaume Malvoisin
— THÉÂTRE EN MAI, festival du 18 au 28 mai au Théâtre Dijon-Bourgogne et autres lieux, à Dijon tdb-cdn.com
10 ans plus tard, toujours debout

Du bruit qui danse, du son qui pense. Et aller-retour. Retour aussi pour le festival MV dont les deux premières phrases de ce texte pourraient être gravées au fronton de leur futur Arena. En attendant cette consécration plus que fictive, MV fête ses 10 ans. La belle année, puisque Sabotage, asso dijonnaise porteuse du festival vient d’éteindre ses 20 premières bougies d’un poumon d’acier. Métal réglementaire pour des concerts assemblés sous une bannière sombre et réjouissante, démentielle et nuancée. Énergie, plaisir et avant-garde, soit. Éclectique, exigeante et accessible, dont acte. La 10e édition du prochain MV devrait garder la cadence du 2 au 7 mai. Émergence tous azimuts, lieux constellés, partenaires multiples. MV est de son temps. Donc, fragilisé et légèrement paupérisé. Moins de formes artistiques en place, mais aucune raison pour rogner sur la qualité du produit, cependant. « La musique, la musique », braillait Nicoletta. Oui, mais ici on sera sur d’autres gammes. Posées plus haut sur l’étagère. Citons, entre autres, Monsterwatch au Singe, le 2 mai, DJ plaisir qui prend une carte blanche à la Péniche Cancale le 5 mai ou encore Andrea Belfi, le 7 mai avec LeBloc dont la finesse de balais vous brise un cœur de pierre. Autre monument : Joke Lanz et son Sudden Infant (et Johnny Mafia, Getdown Service…) au Consortium Museum, avec Ici l’Onde. En 2014, dans ce même magazine (Novo 31), Joke confiait : « J’ai eu un fils très jeune, j’étais un jeune punk qui ne voulait pas grandir. D’un coup, j’étais papa avec plein de bruits et de pensées bizarres autour de moi. C’est mon inspiration pour balancer le public dans mon kindergarten. » À vos pelles, à vos râteaux.
 Par Guillaume Malvoisin
Par Guillaume Malvoisin
— FESTIVAL MV, festival du 5 au 7 mai à Dijon www.sabotage-dijon.com
Joke Lanz par Sébastien Bozon
focus 20
Dans ta peau © DR

Le mythe d’Eurydice
On connaît le mythe d’Orphée, poète descendu aux Enfers pour sauver sa bienaimée Eurydice, la perdant néanmoins à tout jamais, l’abandonnant à l’obscurité éternelle des entrailles de la Terre, pour s’être retourné et avoir posé son regard sur elle avant d’avoir quitté les territoires infernaux, trop impatient… On connaît le mythe, mais surtout du point de vue du poète beau parleur, à la gueule d’ange, comme Jean Marais dans le film Orphée de Jean Cocteau. On commence cependant à entrevoir la part d’ombre de l’histoire, à l’entendre raconter du point de vue d’Eurydice, comme en témoigne la pièce Ombre (Eurydice parle), de l’écrivaine viennoise Elfriede Jelinek, adaptée, mise en scène, mais aussi en musique, par Marie Fortuit. Après être passée par Les Plateaux Sauvages à Paris ou le Cabaret de curiosités du Phénix à Valenciennes, la pièce sera présentée au CDN Besançon Franche-Comté ce printemps. Le sens de l’histoire antique se renverse, l’abandon devient possibilité d’émancipation, et l’ombre, le lieu d’une liberté nouvelle. Marie Fortuit et sa compagnie Les Louves à minuit nous font découvrir une Eurydice rebelle, punk, indomptée. Autrement dit, émancipée de toute tutelle patriarcale, renouant avec une enfance électrique. Comme a pu le confier un jour Elfriede Jelinek à Christine Lecerf, une artiste comme elle est née d’abord « d’un interdit, celui de devenir adulte ».
Par Clément Willer
— OMBRE (EURYDICE PARLE), théâtre du 4 au 6 avril au CDN Besançon Franche-Comté, à Besançon www.cdn-besancon.fr

Punk & folk
Venu tout droit de sa Suisse natale, Louis Jucker est un artiste comme on en fait peu – ou plus, peut-être. Un artiste multi-casquettes, multiinstrumentiste, multi-un-peu-tout, adepte du Do-It-Yourself, fan de VHS et bricoleur du lundi et des autres jours de la semaine. De ceux qui façonnent leur musique de la première à la dernière note, avec ce qui leur tombe sous la main ou ce qu’ils construisent eux-mêmes et font sauter les barrières à grands coups d’activisme parfaitement assumé. De ceux qui écrivent, composent, produisent, jouent, diffusent, partagent, mélangent les genres, les manières et les savoirfaire. De la jaquette de leur disque à la guitare qu’ils ont sur scène, du sol au plafond et de la cave au grenier. Et parce que le bonhomme n’est pas du genre à se limiter, il jongle en prime – et avec talent –entre composition de musiques de films et techniques de riffs acérés, punk hardcore et folk intimiste. Car en parallèle de son activité de hurleur sauvage chez les metalleux furieux de Coilguns, Louis Jucker tourne également en solo, en mode poète rockeur lo-fi et créateur prolifique hyperactif… Et c’est justement dans ce format qu’il va enchanter le public du Moloco le 25 mars, dans le cadre de La nuit des indés, aux côtés des Stuffed Foxes et des Psychotic Monks. Préparezvous à entrer dans un autre espace-temps : le voyage s’annonce des plus ensorcelants.
Par Aurélie Vautrin
— LOUIS JUCKER, concert le 25 mars au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com
 Louis Jucker © Augustin Rebetez
Louis Jucker © Augustin Rebetez
focus 22
Ombre (Eurydice parle)

Expériences augmentées
Le numérique est aussi beau quand il nous rassemble. Dans le quadriptyque de la septième édition de sa Saison numérique, le Département du Doubs nous confronte à une altérité 2.0. Après des représentations multimédias croisant théâtres et contes philosophiques, voici venu pour mars et avril l’ère du Do It Yourself au travers du laboratoire de 3615 Señor. Ses Brutlabs sont l’occasion pour le collectif de hackers & cie de faire s’entrechoquer la création sonore brute et les publics en situation de handicap à l’aide de modules favorisant l’expérimentation collective. 3615 Señor s’est invité au Bastion de Besançon et ouvre grand la porte pour profiter de l’objet qui y naîtra : un savant mélange entre performances musicales, liesse populaire et foire numérique low-tech. L’expérience augmentée, c’est aussi revisiter ce que l’on pensait connaître. La Saison numérique inaugure à ce propos le « Centre de lumières » de la Saline royale d’Arc-et-Senans, un espace immersif de réalité augmentée de près de 1 500 m² pour nous plonger en vidéomapping dans les merveilles du patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre l’excursion d’Instant Architect du collectif Ex Lumina pour Nouvelles Formes, le chorégraphe Alexander Whitley revisite The Rite of Spring, le désormais classique ballet de Nijinski et Stravinsky, au travers du gaming, de l’animation 3D et de la réalité virtuelle. Et c’est peut-être de cet entre-deux entre matérialisme de l’installation et imaginaires numériques que naît ce Beau digital.
Par Lucas Le Texier
— LA SAISON NUMÉRIQUE, festival jusqu’au 7 avril sur l’ensemble du département du Doubs saisonscap25.cd25.fr

(Dé)jouer le numérique

Plutôt que de se piéger avec le sempiternel « Pour ou contre » quant à l’usage des nouvelles technologies, l’association Nouvelles Formes a misé sur le jeu. Seconde édition pour son festival D’Autres Formes qui sort cette foisci de La Rodia et s’invite dans divers lieux à Besançon pour mettre la technologie au service de l’art et des publics. Au programme, onze installations qui interrogent par le biais d’un dispositif à manipuler notre rapport au numérique, voire le subvertit : dans 3615 Brazil du collectif 3615 Señor, le public doit prendre en main des minitels et microfilms pour déjouer les dépêches générées par des machines futuristes et autonomes. Autre création, Instant Architect d’Ex Lumina autour du vidéomapping, qui permet aux spectateurs de transformer l’architecture d’un bâtiment à l’aide de leur smartphone. Nouvelles Formes s’attèle aussi à présenter le numérique dans ses dimensions poétiques et créatives à l’image de Sol Vif par Guillaume Mit et Small Studio : une fresque géante près de l’hôpital Minjoz, au pied de l’unité pédiatrique, qui se meut en jeu vidéo lorsqu’on y rentre le code sur sa tablette ou son téléphone… Destiné à tous les publics, D’Autres Formes croise ici installations ludiques et réflexions en espérant toucher (aussi) les ados et le public de demain dans un monde où la technologie a dorénavant pris ses quartiers. Vivre avec son temps, c’est autant savoir s’amuser de cet écosystème que le déconcerter. Quand il le faut.
Par Lucas Le Texier
D’AUTRES
FORMES,
festival du 5 au 9 avril à Besançon larodia.com
Hikikomori © Nicolas Boudier
—
focus 24
3615 Brazil, 3615 Señor

Légèreté minérale
« L’Œuvre qui va suivre » est une suggestion, sa concrétisation une rencontre pour en susciter de nouvelles avec le public et élaborer une culture à partager, à inventer : la danse, le musée au xxie siècle. Une passerelle voulue autant par Thierry Cahn et l’équipe du Musée que par Bruno Bouché, directeur artistique et chorégraphe du CCN, Ballet de l’Opéra national du Rhin. Elle prolonge un geste créé l’an passé pour l’inauguration du retable restauré : Bless – ainsi soit-IL Le projet est aussi la deuxième collaboration du Ballet avec le peintre scénographe Silvère Jarrosson après Dansez Schubert (saison 2021-22). Il reprendra à la Piscine du Musée le même dispositif de panneaux mobiles de très grands formats. L’expressionnisme abstrait de ses toiles monumentales déploie les strates vibrantes d’un ordre liquide où domine le mouvement, qui évoque les drapés de la Transfiguration du retable, même si la gamme chromatique froide est plus proche des tons que révèle la lumière dans les Outrenoir de Soulages. Les danseurs chorégraphes du Ballet évolueront sur Bach, Schubert, mais aussi des textes de Rilke et Michaux. Une dizaine d’événements (conférences, ateliers), de nombreux invités (Hervieu Léger de La Comédie Française le 10, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste le 18) et une volonté transdisciplinaire : la culture, lieu de tous les possibles. En clôture, une soirée lyrique avec l’Opéra Studio (le 24).
Par Luc Maechel
— L’ŒUVRE QUI VA SUIVRE, exposition du 5 au 24 mars au Musée Unterlinden, à Colmar ; création performative en présence de l’artiste les 17 et 18 mars www.musee-unterlinden.com www.operanationaldurhin.eu

Treize femmes en colère
Elle avait marqué les esprits en 2018 avec Les Enfants, mi-comédie de mœurs féroce mi-satire écologique… La scénariste britannique Lucy Kirkwood raconte aujourd’hui Le Firmament, récit brillant comme la lame d’un scalpel sur une jeune domestique reconnue coupable du meurtre d’une fillette dans l’Angleterre du xViiie . Dans un tribunal en huis clos, douze femmes du peuple sont alors chargées de déterminer si la meurtrière est enceinte comme elle prétend l’être – ce que lui ferait éviter la peine de mort si les faits étaient avérés. Mais comment le prouver ? Et que faire de ce pouvoir de décision inconnu, confié à des matrones habituellement cantonnées à leurs tâches ménagères dans un monde dicté par les hommes ? D’une écriture résolument contemporaine magnifiée par des dialogues ciselés à la feuille de boucher, Lucy Kirkwood dissèque le débat entre querelles de village et conflits de classe, avec en toile de fond des sujets diaboliquement actuels : patriarcat, tabous sur la maternité, déterminisme, passé colonial, place des femmes et de leurs corps… Connue aussi pour son travail sur la série Skins, la scénariste emprunte au genre certains de ses codes pour mieux les faire exploser sur les planches, le tout puissamment mis en scène par Chloé Dabert, actuelle directrice de la Comédie - Centre dramatique national de Reims. Une pièce totalement inédite à découvrir sans tarder.
Par Aurélie Vautrin
— LE FIRMAMENT
théâtre les 22 et 23 mars à la Comédie de Colmar www.comedie-colmar.com

focus
Surface mince, sans force (détail) © Silvère Jarrosson
26
Le Firmament © Victor Tonelli

Blancheur feutrée des dimanches

On est tout de suite envoûté par le titre, précis et nébuleux, d’Éloge du blanc. Mais aussi par une bribe de phrase qui, dans le programme enthousiasmant du Théâtre Jeune Public de Strasbourg, présente la pièce comme une « contemplation feutrée d’un dimanche après-midi »…
On se dit, c’est ça. C’est étrange, dans ces mots quelque chose m’appelle, je vais aller au théâtre pour une atmosphère, blanche, pour me replonger dans cette sorte de contemplation feutrée, faite d’ennui et de douceur, qu’on a éprouvée enfant, et qu’on retrouve parfois les dimanches après-midi, les dimanches après-midi d’hiver surtout. C’est comme ça que j’ai pris une place sous le coup d’un envoûtement soudain. On imagine, déjà, à quoi pourront ressembler les murmures des draps blancs, des étoffes anciennes, et la fascination de la petite fille, Blanche, interprétée par Nina Gohier, qui revient au monde après un étrange accident, et que l’on retrouve dans plusieurs des créations de Christelle Hunot, dont on a déjà pu voir au TJP Sous les yeux de mon père, Petite mélodie pour corps cassé, Sous un ciel bleu sans nuage et Seule. Réveillant notre sensibilité aux matières textiles, Christelle Hunot, qui anime La Bobine, pratique ensemble la broderie, la couture, la sculpture. Dans ce premier volet d’une série nommée Panoramique, le blanc cassé des draps semble ambivalent, présage de rêverie, d’égarement, comme de résilience, de renaissance.
Par Clément Willer
Le propre de l’homme
Un travail sérieux n’empêche pas la contraction subite du diaphragme et le déploiement sonore tonitruant de l’air à travers nos cordes vocales. Le rire a cette vertu de remettre en mouvement le corps et la pensée. C’est un peu ce qu’essaye de nous montrer l’artiste d’origine suisse-iranienne, Kiyan Khoshoie, dans son solo Grand Écart. Né à Genève en 1988, Kiyan Khoshoie pratique la gymnastique et le plongeon à haut niveau avant de prendre son premier cours de danse classique à dix-sept ans. Deux ans plus tard, il entre à la Rotterdam Dance Academy aux Pays-Bas et poursuit ensuite sa formation à Barcelone. Sous la direction de Catherine Allard, il dansera des pièces d’Ohad Naharin, Jiří Kylián, Sidi Larbi Cherkaoui, Stijn Celis, Alexander Ekman… Kiyan choisit ensuite de se tourner vers un travail plus théâtral et performatif. Il crée Grand Écart en 2018, sous la direction de la comédienne Charlotte Dumartheray et la pièce fait partie de l’édition 2022 de la Sélection suisse à Avignon. Parallèlement, il développe son travail chorégraphique avec sa compagnie KardiaK. Grand Écart s’inspire des codes du one-manshow, du stand-up et de la performance, ce solo hybride et rafraîchissant oscille entre passion et désamour et questionne les limites de la pratique chorégraphique ; celles du corps, de la dévotion et du pouvoir. Le temps d’un long plan-séquence virtuose et désopilant, le danseur décortique son lien à la profession jusqu’au nonsense. La plongée intime et étourdissante dans la vie d’un praticien de la scène rappelle qu’un danseur est un travailleur comme un autre, confronté lui aussi aux difficultés du monde du travail parfois absurde, souvent égocentré et plus que jamais en perte de sens.
Par Valérie Bisson
— PANORAMIQUE N°1
ÉLOGE DU BLANC, théâtre du 5 au 16 avril à la Petite Scène du TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com
— GRAND ÉCART, danse les 11 et 12 avril à POLE-SUD, à Strasbourg www.pole-sud.fr

focus
–
Éloge du blanc, La Bobine © Fanny Trichet
28
© Julien James Auzan

À la rue complet
Longtemps considéré comme le bâtard méprisé de l’Art avec un grand

A, l’urban art s’est peu à peu imposé comme un incontournable de nos vies contemporaines. Tant en danse qu’en musique, en dessin, en art, en sport ou même en cuisine, l’inspiration prend désormais corps dans la rue, la tête haute et le poing levé. Un état de fait fêté chaque année dans les rues de Nancy avec RUN, anagramme de Rencontres Urbaines de Nancy, grand rendez-vous à dimension internationale qui réunit acteurs locaux et mondiaux pour un festival pluriel et éclectique. Une nouvelle édition placée cette année sous l’égide de la musique, en clin d’œil au festival NJP et au hip-hop, qui fêtent tous les deux leur demi-siècle en 2023 ! On va donc pouvoir profiter de moult concerts, DJ sets, rencontres, conférences, débats et autres expositions, des rues de la ville à la scène de l’Autre Canal, en passant par le muséum-aquarium ou la galerie Poirel… Sans oublier du skate, de la sérigraphie, des battles de danse ou encore l’Urban Flea Market, un marché aux puces destiné à tous les fanatiques de sneakers ! Parmi les autres temps forts de ce RUN 23 : la création de la nouvelle œuvre monumentale d’Alex Chinneck, le sculpteur britannique défiant l’apesanteur, ou encore une grande expo monographique au musée des Beaux-Arts consacrée à Faith XLVII, figure majeure de l’art urbain contemporain (voir In Situ).
Par Aurélie Vautrin
— RUN 23 - RENCONTRES URBAINES DE NANCY, festival du 1er au 9 avril à Nancy www.run.nancy.fr
Restons groupés
Célébrer la notion même de danse en groupe, tel est le point de départ du second programme de la saison 2022-2023 du CCN – Ballet de Lorraine. Aborder à la fois l’énergie, la force et la complexité du collectif, mais également explorer ce que l’idée de groupe nous dit de l’intime et de la liberté… Le tout agrémenté d’une dimension internationale puisque les commandes de ces deux nouvelles créations sont laissées à l’Australien Adam Linder et à la Franco-Américaine Michèle Murray. Le premier présentera en effet Acid Gems, directement inspiré des Joyaux de George Balanchine, un célèbre ballet en trois actes créé dans les années 1960 dont l’idée était d’établir un parallèle entre le langage chorégraphique et la formation des pierres précieuses. Ou comment les expressions propres aux différentes écoles de danse (française, russe, américaine) se transforment et se reflètent avec le temps, comme les différentes facettes d’un diamant. Aujourd’hui, l’Australien continue cette réflexion autour du vocabulaire chorégraphique en explorant l’évolution voire l’hybridation des danses, des styles et des influences, mêlant dans sa création ballet, théâtre, techniques somatiques et danses urbaines. De son côté, la chorégraphe Michèle Murray proposera DANCEFLOOR, dans lequel elle invitera les vingt-cinq danseurs du CCN de Nancy à prendre possession de la piste de danse, à la fois en tant que groupe et en tant qu’individualité propre. À découvrir début avril à l’Opéra national de Lorraine !
 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin
— ACID GEMS / DANCEFLOOR, danse du 1er au 7 avril à l’Opéra national de Lorraine, à Nancy www.ballet-de-lorraine.eu
focus
DANCEFLOOR (répétitions) © CCN-BL
30
Baby Volcano - en concert le 1er avril à l’Autre Canal © LAC

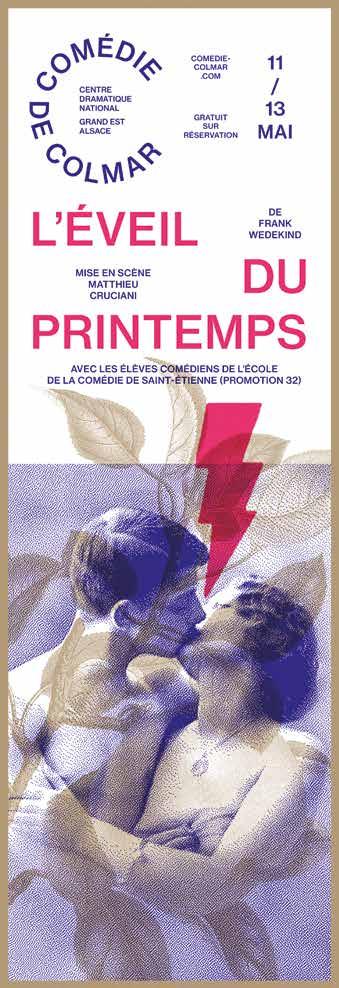
Jeux sans frontières
Perspectives, festival franco-allemand des arts de la scène, fête sa 45e édition en mettant à l’honneur une vingtaine de productions venues de France, d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Intergénérationnelle et destinée aussi bien aux curieux qu’à un public averti, sa programmation, comprenant de nombreux spectacles sans paroles ou surtitrés, croise les esthétiques et les disciplines : théâtre, nouveau cirque, danse, performances se déploieront dans une quinzaine de lieux entre Moselle et Sarre. Le chorégraphe Fouad Boussouf y présentera OÜM, qui célèbre la rencontre, à mille ans d’écart, entre la diva égyptienne Oum Kalthoum et le poète persan Omar Khayyam. Dialaw Project de Mikaël Serre évoquera la construction du port géant de Ndayane au Sénégal, nouvelle émanation d’un capitalisme menaçant une terre meurtrie et ses habitants. Dans le solo Pour sortir au jour, le danseur et chorégraphe Olivier Dubois se prête avec humour à un jeu qui pourrait tour à tour prendre la forme d’un tribunal ou d’un peep-show, voire d’une dissection… Arrêt d’urgence, « pièce de cirque tout-terrain pour semi-remorque et piano à queue » de la compagnie Akoreacro investira quatre lieux de l’espace public, sur entrée libre. Et pour prolonger l’expérience jusqu’au bout de la nuit, rendez-vous au centre culturel Sektor Heimat à Sarrebruck, qui abritera cinq soirées concerts et quatre soirées club pendant les weekends. La programmation complète du festival sera dévoilée en ligne le 20 avril.
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
— PERSPECTIVES, festival du 25 mai au 3 juin en Moselle et en Sarre www.festival-perspectives.de
À la pêche aux accidents
Cela fait un sacré bout de temps que l’on n’avait pas eu l’occasion de le voir en concert – sept ans, pour être précis : le chef de file de la scène electro, « master ès trip-hop french touch » s’il en est, Wax Tailor fera bien son grand retour en 2023 ! Avec évidemment dans sa musette un nouvel album à consommer sans aucune modération, un certain Fishing For Accidents sorti début février - facilement repérable dans les bacs grâce à une magnifique jaquette des plus stylisées signée par l’artiste japonaise Hanako Saito. Un nouvel album aux petits oignons, fait d’assemblages sonores parfaitement maîtrisés, de paysages cinématographiques, de featurings en cascade et de compos lumineuses où se mêlent rap et electro, hip-hop et trip hop, sampler et clins d’œil au 7e art. Le titre lui-même en est un d’ailleurs, puisque le Normand d’origine s’est inspiré d’une phrase d’Orson Welles à propos des « accidents » dans le processus créatif. « J’ai toujours pensé que l’accident faisait partie intégrante de la création et que le travail d’un réalisateur de films ou de disques, c’est aussi de savoir les capturer pour faire de l’accident une intention artistique, explique-t-il. J’ai décidé de ne pas suivre un concept bien établi mais cette ligne directrice plus instinctive et de partir à la pêche aux accidents. » Si la tournée de Wax Tailor débutera aux States le 1er mars, le compositeur-auteur-producteur-manager–génie se produira dans sa France natale une dizaine de fois les deux mois suivants - notamment le 11 mai à l’Autre Canal, seule date dans le Grand Est.

Par Aurélie Vautrin
— WAX TAILOR, concert le 11 mai à l’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr
Wax Tailor © Ronan Siri
focus 32
Pour sortir au jour © Pierre Gondard
Folie croassante
Comment faire théâtre à partir d’un des faits divers les plus marquants du siècle ? Pour évoquer l’affaire dite « du petit Grégory », Adieu mes chers cons fait d’abord le choix d’habiter l’un de ses plus fameux et terribles protagonistes : le corbeau. Au début de la pièce, cinq corbeaux convoqués au cœur de la forêt via un message anonyme ne tardent pas à se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes manipulés. Missives pleuvant du ciel, coups de fil tonitruants, ils s’invectivent, s’effraient et s’interrogent, changeant successivement de masques. Puisque « l’affaire » est devenue un mythe contemporain synonyme de folie collective, le metteur en scène Sacha Vilmar et l’autrice Anette Gillard usent de tous les codes du tragique, voire du récit d’horreur ou du thriller. Forêt oppressante, cris, rires, silences, ombres et lumières… le tout avec la démesure qui convient à un sujet dépassant l’entendement. Au fil de ce conte cauchemardesque, décalage et humour sont omniprésents, comme pour mieux trouver le ton sans verser dans le voyeurisme et l’indécence qui ont marqué les événements. Le grotesque côtoie donc le tragique, le rire survenant sans prévenir au fil des répliques : rire du malaise, de l’absurde, de la stupeur… un contraste nourrissant l’étrangeté, un traitement déraisonnable comme seule solution pour parler d’une histoire monstre.
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
— ADIEU MES CHERS CONS, théâtre les 31 mai et 1er juin au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr
Homme à composer
Qui était Patrick Dewaere ? Un enfant de la balle, un acteur surdoué, un être à la fois fragile et violent, fantasque, anticonformiste… Avec Surexpositions (Patrick Dewaere), la compagnie Le Souffleur de Verre tente de donner sa propre réponse ou plutôt de composer une hypothèse Dewaere, aux facettes multiples. Pour cela, elle effectue des incursions, comme autant de tentatives, dans les vies cinématographiques, théâtrales et personnelles de l’anti-héros des Valseuses et d’Un mauvais fils, loin de toute approche documentaire. « Nous décollons du réel pour entrer dans les peaux de Dewaere fictives, c’està-dire nourries de nos fictions, explique le metteur en scène Julien Rocha. Nous allons faire éclater la surface de projection qu’est devenu l’acteur sous les regards de la presse, du métier, sous son propre regard et le nôtre. » Sans reconstituer une époque ni les scènes de sa filmographie, Surexpositions (Patrick Dewaere) opère des « saluts » aux œuvres ; on y croise quelques figures de comédiens et cinéastes telles que Bertrand Blier, Gérard Depardieu ou Miou-Miou. Une pièce qui aborde les glissements entre l’art et la vie, le hors-champ, les regards et les paroles sur un homme blessé qui incarnait aussi, selon l’autrice Marion Aubert, le début du vacillement du patriarcat.
Par Benjamin Bottemer
— SUREXPOSITIONS (PATRICK DEWAERE), théâtre le 13 avril au Carreau, à Forbach
www.carreau-forbach.com

focus
Adieu mes chers cons © Teona Goreci
33
Surexpositions (Patrick Dewaere)
Éternel absolu
Le cœur sacrifié sur l’autel de la Raison d’État : c’est tout le propos de Bérénice de Racine, qui résonne encore quatre siècles après sa première représentation en 1670. La tragédienne Anne Delbée étudie et adapte Racine depuis près de cinquante ans ; l’œuvre du dramaturge est pour elle ce que le noir est pour Pierre Soulages : un objet à refaire, à défaire, à questionner sans cesse au fil de la vie. Rappelons tout de même les faits : Titus aime Bérénice mais ne peut l’épouser au risque de perdre son empire, Antiochus aime Bérénice qui l’ignore, Bérénice regagne désespérée sa patrie du bout du monde, laissant derrière elle des cœurs brisés et une histoire universelle et pour toujours actuelle. Pour cette nouvelle mise en scène dans le cadre d’une production de l’Opéra-Théâtre de Metz, Anne Delbée avait un principe : « ni reconstitution hasardeuse ni actualisation désastreuse ». Pour la tragédienne, « il faut jouer avec le temps passé, ce mystère que l’œuvre garde à travers les époques, et ne surtout pas la figer dans des actualisations artificielles ». Ici, tout part d’une scène vide, l’actrice seule en son centre, le monde a pour ainsi dire disparu, seuls le dépouillement et la souffrance accueillent Bérénice dans son Orient désert. À partir de là, tout peut renaître, Bérénice n’a plus d’âge, le temps et l’espace sont abolis : voici Versailles et son Roi Soleil soumis aux mêmes tourments se reflétant dans des miroirs infinis. Bienvenue dans un ailleurs intemporel, celui de la scène.
Par Benjamin Bottemer — BÉRÉNICE, théâtre du 4 au 6 avril à l’Opéra-Théâtre de Metz www.opera.eurometropolemetz.eu

Le trait et le son
La Cité musicale-Metz célèbre l’union entre bande dessinée et musique à l’occasion d’un « temps fort » baptisé Musiques à croquer. Au programme à l’Arsenal, deux concerts dessinés avec des duos de chocs : Cyril Pedrosa, auteur d’œuvres puissantes comme Les Équinoxes ou Sérum, sera aux côtés d’un quatuor mené par la batteuse Anne Paceo, avec le maître de la kora Ablaye Cissoko. Quant au saxophoniste Christophe Panzani, il s’est lancé avec le dessinateur Ludovic Debeurme dans la création de Mers/Mères, où musique et dessin s’influencent mutuellement ; une histoire en construction laissant place à l’instinct et à l’improvisation. L’Orchestre national de Metz Grand Est et le pianiste Florian Noack interpréteront la célèbre musique d’Edvard Grieg créée pour Peer Gynt d’Henrik Ibsen, avec les illustrations de Stéphane Torossian et Giorgia Marras. La Boîte à musiques résonnera des sonorités de la formation électro Zombie Zombie, accompagnée par un trio de chanteuses sur les images hallucinées de Philippe Druillet, monstre sacré de la science-fiction hexagonale. Enfin, ne ratez pas l’exposition aux Trinitaires des planches d’Underground : Grandes Prêtresses du Son et Rockeurs Maudits, le formidable album réalisé par Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog.
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
MUSIQUES À CROQUER, concerts et exposition du 2 au 13 avril à la Cité musicale-Metz www.citemusicale-metz.fr
Bérénice par Anne Delbée
—
focus 34
Zombie Zombie © Gwendal Le Flem
Troublefrontières
Retailler les facettes du langage
chorégraphique, transcender les innombrables cloisons de l’identité, défier les méandres politiques d’un amour impossible, nier ses droits à la mort pour les offrir à la langue, déployer et accompagner les talents… le tout, dans une joyeuse déambulation, par et pour la scène.
PASCAL RAMBERT DE MORT VIVE
AUTEUR ASSOCIÉ AU THÉÂTRE NATIONAL

DE STRASBOURG DEPUIS 2014, PASCAL RAMBERT
Y OFFRE CETTE FOIS MON ABSENTE, INSCRIVANT
L’INDICIBLE DANS LA POSSIBILITÉ DU DIRE.
Par Nathalie Bach ~ Photo : Renaud Monfourny
36
Vous dites que lorsque vous écrivez, le seul sujet qui vous intéresse, c’est la langue. Paradoxalement, nous sommes dans un monde où la déficience du langage, donc de la pensée, se vit de manière importante.
La déficience, c’est un beau mot. Dans une de mes pièces, Perdre son sac, le personnage (interprété par Lyna Khoudri) parle de ce qu’elle voit dans la rue, les ongleries ou bars à ongles, et dit à propos du langage qui y a trait : « Tout ça me coupe les lèvres. » Pour dire que j’ai un mauvais pressentiment sur la forme et la tenue de la langue. Et comme je m’intéresse à tous les langages, que ce soit celui de l’art contemporain, celui de la lumière, des volumes, des espaces, des corps et bien sûr de l’oralité des pièces que j’écris, le sentiment que j’ai, c’est que parler mal, c’est penser mal, avoir un vocabulaire réduit, c’est avoir un monde réduit. Je tourne constamment autour de ces questions dans mes pièces et je peux moi-même être attaqué sur ma manière d’écrire, on attend peut-être de mes pièces quelque chose de plus littéraire, même si c’est à dire. J’ai aussi ce mauvais pressentiment qui me dit qu’en passant beaucoup de temps sur des langages de loisir comme tout ce qui est proposé sur un smartphone, d’autres travaillent à réorganiser le monde comme ils le pensent. On le voit avec la tentation du repli nationaliste partout dans le monde, et toute ma pensée est en œuvre autour de cela. Je colporte cette idée d’inquiétude du rabougrissement de la parole. Ce n’est pas très étonnant que je sois auteur associé au Théâtre national de Strasbourg. Avec Stanislas (Nordey), nous avons le même rapport à la langue. Quand il travaille avec Falk Richter ou Claudine Galea, il a les mêmes préoccupations devant le fait de lâcher la langue et moi je la tiens comme je peux.
En même temps, Strasbourg est une ville où visiblement, parler est encore essentiel. Proportionnellement à New York, c’est tout de même la ville où il y a le plus de psychanalystes. Je n’ai jamais fait d’analyse, peut-être que ma souffrance n’était pas assez forte pour que cela réclame d’aller voir quelqu’un. À vrai dire, je suis assez heureux. J’écris ce que j’aime, je fais un métier merveilleux, je suis en bonne santé, je suis amoureux.
Ça fait 44 ans que j’écris et que je mets en scène mes textes. J’accumule et je vide. Il y a un effet de transvasement très clair. Mon lien avec la psychanalyse n’est ni universitaire ni clinique mais clairement très poétique. Lacan, comme Wittgenstein en philosophie m’ont aidé à percevoir les limites du langage et en même temps son infinie
richesse. Lacan a cerné à un tel niveau la psyché humaine… Mais je le lis comme je lis Rimbaud, c’est-à-dire comme une pure énigme. Et si j’écris, c’est parce que je passe mon temps à repousser les limites de la langue tout en pensant qu’il n’y a pas lieu d’arriver à dire exactement ce qu’on veut comme on veut arriver à le dire. Mais j’en connais la puissance déflagrationnelle. Ce que j’ai fait à vingt ans comme maintenant à soixante, c’est la même chose, simplement, plus le temps passe, plus je me rapproche de moi. Et je n’entends n’y en dévier, ni plaire ou déplaire à quiconque. C’est long d’arriver à être soi-même. Le terrain de cohérence, c’est rester dans une identité artistique extrêmement tenue.
« Ce que je cherche dans la parole, c’est la réponse de l’autre. » Votre extrême activité, soit à peu près dix productions par an dans le monde entier, n’est-ce pas aussi une forme d’imminence devant vous-même ?
Ah ah ! Je ne sais pas ! En réalité, je n’ai toujours fait que ça, je n’ai jamais travaillé de ma vie, au sens où je l’entends. Je n’ai même pas mon permis de conduire, je ne connais pas ma droite et ma gauche. Je n’auraisï jamais pu être baby-sitter ou serveur dans un bar, je ne sais vraiment rien faire. Je suis handicapé sur tout, je ne sais pas monter un jouet ni une étagère je ne sais qu’écrire et essayer d’y trouver des moments de grâce. De la langue, j’en connais aussi la réversibilité, son pouvoir et son inanité. Je recommence à chaque nouvelle pièce
37
— Je ne crois pas à la mort, ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas mourir d’ailleurs, je n’ai pas le temps, je veux que ça continue tout le temps, tout le temps. —
ce projet fou de croire en quelque chose qui ne va pourtant pas m’aider à formuler ce que je veux dire. C’est une entreprise presque vouée à l’échec mais quel bonheur ! Ça produit du poème et chez l’autre un imaginaire qui se déclenche.
la recomposition de la figure de cette personne, une femme puissante qui a été écrivaine, dont la reconnaissance sociale a été très longue. Dans mon imaginaire s’est mis en place un mix entre Annie Ernaux qui a énormément influencé les jeunes générations et la mère de Marguerite Duras, un personnage très complexe. Yves Godin a imaginé des noirs comme on en a rarement au théâtre. C’est comme si on était à l’intérieur d’un cerveau, de toutes ces paroles qui se murmurent et qui s’adressent à ce cercueil fermé. Mon absente, c’est le contraire de la profération. C’est une plongée en soi qui a certainement beaucoup à voir avec l’inconscient et ce que permet merveilleusement le théâtre, c’est d’avoir cette pensée intérieure verbalisée.
Un lien entre la vie et la mort, une sorte d’inframonde ?
En 2020, vous avez écrit et mise en scène Desaparecer pour le Teatro Juan Ruiz de Alarcón (Mexico City – création UNAM). Un titre qui sonnait comme les prémices de Mon absente ? En fait, c’est proche. C’est l’histoire d’un jeune cinéaste de vingt ans qui disparaît dans le désert de Sonora dans le nord du Mexique et dont toute la famille, amis, etc., se retrouvent autour de ce portrait évaporé. Pas un mort, mais une disparition comme il y en a tant dans ce pays. Et quand Stanislas m’a commandé ce qui allait devenir Mon absente , écrite pour les acteurs associés du Théâtre national de Strasbourg, je lui ai dit, il y a une personne qui manque sur cette liste d’acteurs, c’est ta mère. (Véronique Nordey, 1939-2017). Et je suis parti de cette idée-là, d’un groupe de gens qui essaieraient de refaire un visage d’une absente. Bien sûr, le projet a beaucoup évolué depuis 2019, il y a eu la pandémie, j’ai eu un petit garçon, pour beaucoup de gens le monde a été extrêmement bouleversé. J’ai souhaité écrire la pièce plus entre l’Afrique et la France parce que Stanislas et sa mère ont du sang africain dans les veines. Je ne parle jamais de la vie privée des gens mais cette énergie est entrée en moi. Il y a au centre du plateau un cercueil fermé entouré de fleurs et c’est une sorte de ballet entre ces acteurs et actrices autour de cette femme qui a eu six enfants, de six maris différents. C’est dans ce reposoir, cette chambre mortuaire que se joue une histoire de famille très serrée, une famille finalement pas très sympathique et acrimonieuse. Je n’avais pas envie de quelque chose de lisse comme l’époque voudrait que tout soit. Et lorsqu’on fait les comptes, on s’aperçoit que ce que l’on a à dire à un mort n’est pas forcément agréable et peut être très dur. Mon absente tourne autour de
C’est tout à fait ça et c’est quelque chose qui n’est pas éloigné de ce que le Japon ou l’Asie produit sur moi. On est dans un rapport à l’invisible quasi proche.
Comment se fait-il que l’Occident ait tant de mal à considérer la psyché quantique ?
Je ne sais pas, je travaille en ce moment en Roumanie, dans les Carpates et en parlant avec les acteurs, je suis frappé par un certain sens du merveilleux, mais j’ai toujours senti la coupure avec le cartésianisme de la France. Notre histoire nous singularise. Et ce merveilleux est très important, ça me sort de ce que j’ai appris ici.
« Le dialogue avec les morts n’a pas le droit de se rompre tant qu’il ne restitue pas la part d’avenir qui a été enterrée avec eux . » Heiner Müller pose la question de savoir s’il est nécessaire de rompre vraiment ce dialogue.
Je n’ai pas beaucoup eu affaire à la mort, excepté celle de mon père il y a trois ans à l’âge de 93 ans. Et il y a eu la mort d’Antoine Vitez, ma famille choisie lorsque j’ai commencé le théâtre. Quand Claude Régy est mort, je n’ai jamais cru vraiment qu’il l’était. À chaque première, il est là. Pour tout vous dire je ne crois pas à la mort, ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas mourir d’ailleurs, je n’ai pas le temps, je veux que ça continue tout le temps, tout le temps. Marguerite Duras n’est pas morte et me fait toujours tant de bien.
Elle disait que pour l’écriture, il fallait non pas forcément un sujet, mais un point de départ. Mes pièces ont l’identité des interprètes pour lesquels j’écris. Je ne lis pas les critiques et il vaut mieux parce que je me fais allumer depuis quarante
38
— De la langue, j’en connais aussi le pouvoir, sa réversibilité et son inanité. —
ans. C’est un sport de haut niveau, il faut être costaud [rires]. Par exemple pour Clôture de l’amour, l’identité c’est Stanislas Nordey et Audrey Bonnet. Mais toutes les versions données à travers le monde me démontrent que les mots peuvent battre dans d’autres corps. C’est aussi une preuve que la langue peut être flexible et s’incorporer dans d’autres cultures. Même si un corps japonais n’a rien à voir avec un corps mexicain, les corps sont culturels et c’est important de les réunir dans le choix de mes acteurs. Mes plateaux ont aussi changé grâce à ça. Mon absente réunit onze acteurs, c’est un mélange de générations et d’acteurs formidables
Pour reprendre la dernière phrase de Desaparecer :
« C’est quoi un être humain ? »
Une énigme mais un être de langage. Connaît-on vraiment ses parents, ses enfants ? Les choses ne se joignent pas toujours et pas toujours à travers le temps.
Et ce langage, vous avez la velléité de le bousculer ?
Oui. Même si on s’illusionne soi-même souvent beaucoup. Je pense que par endroits j’y suis parvenu. Ceux qui m’ont permis de le faire, c’est Thomas Bernhard, Proust.
Si Samuel Beckett arrivait avec son premier manuscrit, serait-il édité ?
Non. L’explosion langagière artistique qu’il y a eu entre 1970 et 1990 ne se retrouve pas. Il y a des formes très éclatées mais aussi une frilosité. Les choses qui sont demandées sont des injonctions qui viennent du ministère de la Culture et du milieu lui-même qui consiste à être dans un rapport, on ne va pas dire marchand, mais de rentabilité. Le métier a considérablement changé depuis quarante ans.
Quels sont les changements les plus flagrants ?
Déjà cette professionnalisation de partout et en même temps on est passé du « tout est possible » à un moment très dur que nous vivons notamment pour les jeunes générations. Monter des projets est très difficile en ce moment. C’est très canalisé. Lorsque j’étais chez Antoine Vitez au Théâtre national de Chaillot en 1982, on n’avait rien, juste Antoine qui nous faisait travailler. Nous n’avions aucune rémunération, aucune aide, ni de tickets de métro ni assurance. Je travaille beaucoup dans des écoles nationales en France et à l’étranger, la jeunesse d’aujourd’hui est très préoccupée par la validation des diplômes, des aides dont elle peut disposer. Ça peut très mal se passer et on peut se retrouver du jour au lendemain en n’étant plus
du tout en train de faire ce métier, mais j’en aime les incertitudes. On ne risque pas de s’y enrichir comme on peut le faire dans l’art contemporain ou en étant cinéaste. On peut très bien gagner sa vie mais ce n’est pas un métier d’enrichissement financier personnel. C’est un art que l’on peut faire avec rien. Ça ne m’empêche pas d’avoir une admiration folle pour Julien Gosselin qui travaille avec des décors immenses, de la vidéo, etc. Ce que j’écris est centralement autour de la langue et du corps, ce qui facilite les choses. La présence humaine. Sur un plateau vide. Avec de la parole. Et là, je suis heureux.
— MON ABSENTE, théâtre du 28 mars au 6 avril au TNS, à Strasbourg www.tns.fr
39
— Pour tout vous dire je ne crois pas à la mort, ça ne m’intéresse pas, je ne veux pas mourir d’ailleurs, je n’ai pas le temps, je veux que ça continue tout le temps, tout le temps. Marguerite Duras n’est pas morte et me fait toujours tant de bien. —
TROUBLES FÊTES
Bézard
 Par Nicolas
Transegalactique © SMITH, courtoisie de Act Up-Paris, 2022
Par Nicolas
Transegalactique © SMITH, courtoisie de Act Up-Paris, 2022
LES VAGAMONDES REVIENNENT ET SÈMENT LE TROUBLE AU CŒUR DE NOS IDENTITÉS POUR MIEUX LES TRANSCENDER.
Autrefois attachés à montrer la diversité des cultures du Sud, les Vagamondes s’affirment depuis trois saisons et la prise de fonction de Benoît André à la tête de La Filature, comme le festival du dépassement de toutes les frontières. L’édition précédente interrogeait les lignes de démarcation de plus en plus sensibles entre les individus et leur environnement, et l’avènement possible d’une forme de transhumanité. Cette année, c’est la question connexe et non moins actuelle du genre qui donne au festival sa coloration étrange et attirante – comme celle de la flamboyante affiche signée SMITH.
Actuelle, car il est indéniable que nous assistons à un décloisonnement de ces sujets ayant trait aux frontières intimes et mouvantes à l’intérieur de tout un chacun : le sentiment d’appartenance (ou non) à un genre et la dimension sexuelle de nos identités (multiples). Des frontières qui pour beaucoup –notamment la jeune génération – servent désormais de passerelles où circulent et s’échangent les points de vue, quand chez d’autres elles demeurent des obstacles violemment infranchissables. Frontières massivement investies et discutées, ces dernières années, par tous les champs artistiques, qu’il s’agisse de littérature ou de cinéma, de musique ou d’art visuel, sans oublier le spectacle vivant, preuve que la notion de genre ouvre un gigantesque espace de réflexion au sein des consciences et des imaginaires.
Avec sa singularité, La Filature et ses structures culturelles partenaires rejoignent à leur tour ce mouvement de fond touchant à tous les aspects de nos vies et se proposent d’explorer d’une manière exigeante, éclairée, mais aussi ludique et festive, cette tectonique joyeusement troublée des identités et des affects.
Foyer de ces tremblements existentiels, le corps se trouve naturellement au cœur des préoccupations des 15 spectacles au programme de cette 11e édition des Vagamondes.
Le corps pluriel, mutant, complexe, entraînant dans son vortex des mythologies nouvelles en opposition à la vision hétéronormée de l’étant, comme dans cette expérience mêlant théâtre, musique et danse à laquelle nous convie l’artiste visuelle Elli Papakonstantinou, The Bacchae, librement inspirée des Bacchantes d’Euripide.
Le corps nié parce qu’il ne correspondrait pas aux standards imposés par les pouvoirs dominants, à l’image de celui de Caster Semenya, championne olympique du 800 m, dont le parcours édifiant a inspiré la pièce Libre arbitre imaginée par Léa Girardet et Julie Bertin.
Le corps amoureux des danseur·euse·s du Roméo et Juliette Suite, relecture moderne et non binaire du mythe shakespearien proposée par Benjamin Millepied et le L.A. Dance Project, où les médiums fusionnent au rythme de la partition géniale de Sergueï Prokofiev.
Spectacle de marionnettes, performances, créations destinées au jeune public, ateliers et tables rondes seront également de la partie du 17 au 31 mars, le duo Superpartners (le photographe et metteur en scène SMITH, artiste complice de La Filature, et la commissaire d’exposition et performeuse Nadège Piton) donnant le signal de départ de ces réjouissances avec trois cartes blanches riches en surprises. La première de ces soirées d’ouverture (vendredi 17) verra l’inauguration de l’exposition « Trans(e)galactiques » à la galerie de La Filature, enquête « indisciplinaire » et voyage dans une constellation d’existences vécues ou fantasmées. Orchestré par SMITH & Nadège Piton, le vernissage sera performé et réunira dans une conversation « télépathique » la commissairechercheuse Taous Dahmani, l’écrivaine, chamane et spécialiste de la transe cognitive Corine Sombrun et l’autrice et dramaturge Marie NDiaye, goncourisée en 2009 pour son roman Trois Femmes puissantes. Prometteuse d’intensité, la suite de la soirée sera marquée par le concert événement de Jeanne Added, de retour avec son album By Your Side, et la performance sonore du binôme Vatican Soundsystem formé par Vikken et Franky Gogo, préambules d’une nuit des étoiles queer qui se prolongera dans le Hall de La Filature.
Samedi 18, la mezzanine accueillera Cosmos , création inédite et « astralo-friponne » associant le cabaret Le Secret de Monsieur K, SMITH et Marie NDiaye. Dimanche 19, Sébastien Lifshitz présentera au Cinéma Bel Air son nouveau long métrage documentaire Casa Susanna, retraçant les prémices des mouvements transidentitaires dans l’Amérique puritaine des années 1950-1960 – manière politique et fraternelle de conclure ce premier week-end des Vagamondes, un festival plus que jamais tourné vers tout ce qui transcende, transgresse, transporte.
— VAGAMONDES, festival du 17 au 31 mars à La Filature, Scène nationale, à Mulhouse www.lafilature.org
41
L’AMOUR À VUE
DANS SA MISE EN SCÈNE DE L’ARMIDE DE LA PAIRE LULLY/ QUINAULT, DOMINIQUE PITOISET S’ATTAQUE DE FRONT AU MÉTAVERS, À L’ABSOLUTISME ET À L’AMOUR IMPOSSIBLE. DENSE PROGRAMME, RENCONTRE FOURNIE.
Vous dites entrer dans l’Armide, par son livret. Pour moi, le livret de Quinault, c’est l’entrée dans le projet. J’étais a priori assez peu destiné à ce type de tragédie lyrique française, assez peu sensible à la musique de Lully. Je n’ai jamais oublié que ma première mise en scène de petit gars de province a été Le Misanthrope , que ce qui a fait humanité chez moi passe par ces grands classiques, que je qualifierais presque de chroniqueurs.
La mise en scène avec le dindon, non ? Oui. Dans un long couloir. C’était le point de vue d’un petit gars de province sur Paris et le système de Cour. Je ne connaissais pas encore Quinault. J’ai lu ensuite les grands tragiques, puis je suis passé assez vite au xViiie siècle. Ça m’a ouvert la porte des Lumières. Après il y a eu le Sturm und Drang, les romantiques allemands… Ça a été très important pour moi, c’est par ces lectures que je me suis sorti de ma condition sociale. Parfois pour sourire un peu, je lis Saint-Simon, ces Mémoires finissent par être drôles. C’était quand même une basse-cour, Versailles, avec l’exercice d’un contrôle sur la noblesse française dû au traumatisme de la Fronde, vécue par le jeune Louis XIV qui avait échappé à un attentat. Cette société du contrôle, je dirais presque de la webcam permanente et des lois de l’étiquette, ça m’a permis d’être dans la lecture de Quinault. [Un temps.] Quel auteur… Sa langue est magnifique, elle est droite, elle est simple, elle est puissante, il n’y a pas un mot de trop.
Il y a souvent chez vous, un sous-texte géopolitique, ici aussi ?
C’est au carrefour de beaucoup de raisons. Par exemple, mon manque d’empathie pour ce Grand Siècle français…
Ce qui rend cet exercice complexe. Nous sommes en République depuis quelque temps désormais, dans une période post-coloniale, bientôt postpatriarcale…
Et nous allons jouer à Versailles…
Ce qui doit imposer un certain twist intellectuel. La grande difficulté, c’est le prologue. J’ai choisi de le conceptualiser pas du tout Grand Siècle. Alors, on essaie de me convaincre que les costumes d’époque, c’est très bien à l’opéra, qu’on ne le fait plus assez. Mais nous sommes dans un temps où ce qui est explicite doit se démasquer, où nous devons entrer en relation à l’œuvre au-delà de sa représentation formelle. Déjà que Lully est très bavard, voire même un peu long, que la part de la danse et de la chorégraphie est très conséquente. Les parties chorales sont difficiles à mettre en scène sans que ce soit cucul la praline. La structure suit toujours le même principe : dialogue, entrée du chœur et de la chorégraphie. Ça se spectacularise avant de trouver une résolution momentanée en établissant un suspens pour l’acte suivant. En fait, c’est une série. Je vais donc faire un prologue et cinq épisodes d’une mini-série.
42
Par Guillaume Malvoisin ~ Photo : Mirco Magliocca
Souvent dans votre travail, la structure littéraire est d’abord recomposée dans la structure de l’espace de représentation. La scénographie n’est jamais décorative, elle est toujours le résultat de la relation analytique au texte et, à l’opéra, des contraintes induites par certaines figures obligées par la partition comme le nombre, certaines entrées, vitesse de sorties, etc. Avec Christophe, mon frère, on a dû faire une douzaine de projets différents. Le problème principal était de trouver la place du chœur qui induit une manière d’entrer en jeu de façon très ponctuelle pour renforcer la dynamique du récit avant de se retirer très vite. Il fallait créer des ouvertures un peu partout, ce qui faisait que la force de l’espace était détruite. Mais ça m’a fait comprendre que certains protagonistes devaient être assis au premier rang et pouvaient intervenir à n’importe quel moment. C’est une résurgence du post-brechtien. Je me suis dit ensuite que c’est comme dans le théâtre grec, les choristes sont à mipente. On entrait dans le choix non plus d’un décor mais d’une scénographie. Ça m’a ainsi libéré un grand espace vide à l’avant-scène, avec des entrées latérales avec des rideaux. On entre avec cela dans une sorte d’espace dystopique, renforcé par la volonté de ne pas me condamner à représenter Louis XIV. Mais alors, si ce n’est pas lui, qui estce ? Ceux qui d’une certaine manière célèbrent leur messe secrète. Et là, j’ai beaucoup pensé à la scène masquée et orgiaque d’ Eyes Wide Shut . Le phénomène sectaire est intéressant pour son secret et ses relents d’aristocratie mortifère.

Armide , c’est justement un choix de monarque absolu.
Pour célébrer une guerre de conquête, pour célébrer la victoire sur l’Espagne et la Prusse. Louis XIV vient d’annexer l’Alsace, la Lorraine et les Flandres, ce n’est pas rien. Il décide comme à chaque fois de festoyer. Le prologue qui le célèbre a la durée d’un acte entier, propose d’assister au plaisir et au jeu du roi. Le jeu, c’est d’avoir choisi de mettre en scène pour lui, et devant lui les amours d’Armide et de Renaud, tirés de la Jérusalem délivrée du Tasse.
Alors qu’on lui en propose trois. Et il choisit cette histoire de la première croisade menée par Godefroy de Bouillon. La chrétienté est « invitée » par le pape de l’époque à aller délivrer Jérusalem de l’occupation sarrasine et musulmane. Et voilà cette horde sauvage partie, en traversant les territoires de la Belgique au Moyen-Orient. Les troupes sont bloquées sous les murs de Damas par les armées du roi Hidraot. Sa nièce, la belle Armide,
se rend au camp des croisés pour se plaindre des abus dont elle serait victime de la part des siens. Son mensonge finit par séduire les chevaliers et dix volontaires acceptent de protéger Armide, avant d’être rejoints la nuit par beaucoup d’autres. Et tous tombent dans ce piège qui anéantit toute perspective de victoire. La conscience froide d’Armide, qui la place en mission pour la cause de son peuple, est contrariée par le seul élément réticent à sa séduction. C’est Renaud, devenu électron libre et lâché dans la pampa libyenne après avoir tué un chevalier. Il se retrouve en commando et va réussir à libérer les prisonniers et triompher d’Armide. D’une manière singulière, car il est d’abord subjugué par des narcotiques qu’Armide lui administre, c’est le palais enchanté.
43
Vous évoquez ce palais comme une sorte de prologue du Métavers actuel.
C’est intéressant, car Renaud se fait balancer dans une réalité virtuelle et devient l’avatar sexuel du combattant qu’il était et l’amant de l’enchanteresse qui, plutôt que de le tuer, en tombe amoureuse et fuit dans le désert avec lui. Armide fait l’expérience du sentiment pour la première fois, dans son corps. Elle se dégage de toutes ses protections, soit son armée et la Haine. Tout est soutenu par la question de savoir si Renaud, à son réveil, va garder mémoire des ébats érotiques et des sensations éprouvées avec Armide, sur le bord du lit défait. C’est ce qui la préoccupe, elle. Lui choisira le devoir et la Gloire. Il choisit donc l’autre femme, celle de l’ambition au détriment de l’amante impossible.
Il s’agit souvent de vertus, dans le baroque, comme ici la sagesse ou la Gloire, mais plus rarement d’émotions comme la Haine. Idée géniale de Quinault, cette Haine qui devient un personnage. On a alors un théâtre dans le théâtre avec Louis XIV qui célèbre une chose : même avec 99 % de triomphe du camp ennemi, 1 % peut inverser le cours de l’histoire. Et, la puissance de Louis XIV devient celle de la vérité, celle du monde chrétien et de la légitimité de l’incarnation du dieu sur terre.
Il proclame aussi la défaite du sentiment amoureux.
Il se permet, vraisemblablement, dans cette société très close de régler des comptes et de s’en amuser. Là, on sent qu’il met à genoux, qu’il abat, une femme : « Eh bien, regardez comment en regardant un peu en arrière, je triomphe. Je ne suis pas seulement le dieu sur terre, je suis aussi celui qui porte toute l’histoire de la légitimité du monde chrétien sur les musulmans et les femmes. » C’est un ouvrage qui est hyper sulfureux.
Une fable sur la défaite du corps et de la sensation.
Le pragmatisme l’emporte sur l’élan amoureux. C’est une œuvre féroce de ce point de vue. Un des paradoxes de cette tentation vient du fait que Quinault et Lully sont séduits par Armide, par la créature qu’ils mettent en scène. Toute l’empathie lui revient alors qu’elle est celle qui tend un piège au héros. La pièce pourrait s’arrêter là. Renaud est offert à elle, quasi, elle est armée et vient pour le tuer. Si elle n’éprouve pas le vertige face à ce corps, et qu’elle le perce, tout est fini. La deuxième partie s’appuie sur cette faiblesse de deux ennemis attirés par le vertige des sens.
C’est le dernier opéra de la paire Lully/Quinault. Ce dernier entre en religion.
Plutôt à la correction de son âme… Ils avaient une vie très très dissolue.
Est-ce qu’on sent une forme d’ultime ferveur ?
C’est le chef-d’œuvre, avec Atys , mais je ne suis pas certain que ce soit prémédité. La disgrâce de Lully, suite à cette vie dissolue, a dû les alerter. C’est énorme que le roi ne vienne pas et que l’œuvre ne soit pas représentée à Versailles. Disgracié, on est jeté aux hyènes. Lully ne se remettra pas d’un coup de bâton sur le pied ou la jambe, puis de la gangrène. Il y en a une autre, son temps est passé. Mais on le voit partout, ce système de cour, avec les vaniteux, avec l’excitation qu’il y a à devenir un satellite de l’astre. Nous vivons dans des systèmes où la liberté est un mot qu’il faut constamment réinterroger parce que les systèmes de dépendance sont bien en place. Notre propre société a son système centralisé. On se rend compte que malgré la Révolution, malgré le Code civil, Versailles est toujours un modèle. Ce qui fait notre République, c’est aussi un président monarque. C’est intéressant d’interroger ça parce que le ferment conservateur, de ce qui fait aujourd’hui dans notre pays l’extrême droite, est déjà là avec Godefroy de Bouillon massacrant les Sarrasins.
— ARMIDE, opéra les 25, 27 et 29 avril à l’Opéra de Dijon opera-dijon.fr
— Malgré la Révolution, malgré le Code civil, Versailles est toujours un modèle.
44
Ce qui fait notre République, c’est aussi un président monarque. —
L’OPÉRA STUDIO OPÉRA’TIONNEL
RENCONTRE AVEC SANDRINE ABELLO, L’HYPER-DYNAMIQUE DIRECTRICE DE L’OPÉRA STUDIO, « PÉPINIÈRE DE JEUNES ARTISTES » BASÉE DANS LES
LOCAUX DE LA COMÉDIE DE COLMAR, ET SES ONZE POULAINS À LA VOIX ET AUX DOIGTS D’OR.
Lorsque nous nous infiltrons en salle de répétition, dans « l’antichambre de leurs débuts professionnels », une partie des élèves de l’Opéra Studio travaille sur Cenerentolina , d’après Gioachino Rossini. Une Cenerentola pour les petits à partir de six ans, Cendrillon avec féerie magique et effets comiques, thématique de la fracture sociale comprise. Rires garantis lorsque Brenda Poupard, mezzo-soprano que l’on a notamment pu découvrir dans L’Enfant et les Sortilèges d’Émilie Capliez, sort de sous une table bien dressée : la citrouille placée en son centre devient couvre-chef et la nappe se métamorphose en élégante robe de soirée. Floriane Derthe, soprano, Iannis Gaussin, ténor, et Andrei Maksimov, baryton ici affublé d’un grotesque faux ventre, sont accompagnés et guidés par les metteurs en scène, décorateurs et costumiers Sandra Pocceschi et Giacomo Strada. Une « grosse » production présentée prochainement au Théâtre de Colmar, l’Opéra national du Rhin strasbourgeois
et La Sinne à Mulhouse. Ces répétitions dites « scéniques-piano » sont accompagnées par les pianistes chefs de chant de l’Opéra Studio Levi Gerke et Hugo Mathieu et sous la houlette de Samy Rachid, chef d’orchestre assistant complétant la promo 22-23. Même pas peur : les jeunes du Studio sont armés, portant déjà un lourd bagage avant d’intégrer cette formation, véritable tremplin vers des horizons opératiques radieux.
Changement de salle, changement d’ambiance lorsque nous débarquons malencontreusement en pleine séance d’italien en visio d’Oleg Volkov, baryton-basse auquel nous donnons rendez-vous plus tard. « Les élèves doivent savoir chanter dans de nombreuses langues », explique Sandrine Abello : allemand, anglais, russe (ça n’est pas un souci pour Oleg, originaire de Russie), mais aussi français… ce qui peut s’avérer parfois difficile pour cette promotion internationale, en cette structure fondée en 1974 par Pierre Barrat sous le nom d’Atelier lyrique du Rhin (l’Opéra Studio attendra 2008 pour être ainsi rebaptisé). Il y a peu encore, Liying Yang, mezzo-soprano formée à Guangzhou en Chine, Glen Cunningham, ténor écossais issu du Royal College of Music de Londres, ou Levi Gerke, pianiste passé par la Central Methodist University et l’Université de Floride, ne parlaient pas un mot de notre langue…
STUDIO ONE
De son propre aveu, la directrice musicale a un parcours atypique, devenant cheffe de chant à l’Opéra d’Avignon sans connaître toutes les gammes de la fonction, mais en travaillant dur le répertoire et le métier, en « apprenant sur le tas ». Après un tour de France des opéras (Dijon, AngersNantes, Tours, Toulon…), la responsable du Studio depuis 2021 confesse qu’aujourd’hui, les temps ont bien changé. Les jeunes qui « arrivent sur le
45
Par Emmanuel Dosda ~ Photos : Dorian Rollin
marché » ont déjà bénéficié d’une formation très complète. Pour faire partie des « élus » – quatre chanteuses, quatre chanteurs, deux pianistes-chefs de chant et un chef d’orchestre –, un niveau déjà très élevé est requis. « Le monde est tout petit pour cette génération d’artistes » qui viennent des quatre coins du monde, espérant intégrer cette école… non, cette solide « cellule d’insertion », préfère Sandrine. Ils sont recrutés sur concours : cette année, environ 500 candidatures pour onze jeunes « diplômés de prestigieuses institutions musicales de tous les pays » qui bénéficieront d’un passeport garanti pour la gloire après une année (parfois deux) de master class auprès d’artistes reconnus internationalement (artistes lyriques, metteurs en scène, chefs d’orchestre, chorégraphes), de séances de travail au piano avec les chefs de chant de l’OnR, de cours de langues à la manipulation de marionnettes, selon les besoins des projets en cours. Tout au long de leur « immersion professionnelle », ils sont amenés à se produire à Strasbourg, Mulhouse et Colmar, notamment lors des Heures lyriques, mais également en tournée avec l’Opéra volant, dispositif itinérant de l’OnR qui se déplace sur le territoire à la rencontre d’un nouveau public.
Cette saison, en compagnie de camarades musiciens de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR), ils patrouillent dans le Grand Est, effectuant une Petite balade aux enfers , opéra avec marionnettes d’après Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck. La tournée de 39 représentations (dont 22 réservées aux scolaires) a lieu jusqu’au 18 juin en des salles aussi diverses que Le Carreau de Forbach ou La Salle du Cercle de Bischheim. Au moment de notre visite, le Studio bûche également sur Candide de Bernstein, comédie musicale en deux actes dirigée par Samy Rachid, chef d’orchestre du Studio, avec le Chœur de l’OnR, l’Orchestre symphonique de Mulhouse et… Lambert Wilson en guest-star. Et ce n’est pas tout ! Les jeunes « au seuil de leur carrière », participent à de nombreux spectacles donnés dans le cadre de la saison lyrique de l’OnR : Le Chercheur de trésors de Franz Schreker, La Flûte enchantée de Mozart, Turandot de Giacomo Puccini et Le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi. Notons enfin qu’ils concoctent une intervention musicale dans le service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital de Hautepierre pour avril.

46
UN PAS DE CÔTÉ
Le Studio de l’Opéra, pourquoi ? Qu’attire tant les talents en herbe du globe à Colmar ? Pour connaître le destin foudroyant de Sora Elisabeth Lee, cheffe d’orchestre de la promo 21-22, révélation des Victoires de la Musique Classique 2023 ? Ceux qui ont assisté au magnétique Giselle de Martin Chaix avec le Ballet de l’OnR et l’Orchestre symphonique de Mulhouse savent où la barre est placée ! Ou pour suivre le chemin de Samy Rachid qui sera assistant chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de Boston dès la rentrée 23-24 ? Peut-être pour aller dans le sillon de Floriane Derthe, prochainement membre de l’Académie Favart de l’Opéra-Comique ou de Rosa Kim (promo 21-22), dorénavant cheffe de chant au Théâtre de Lübeck ? Selon Sandrine Abello, très peu nombreuses sont les structures du type Studio en France, proposant aux jeunes une formation avec de nécessaires « pas de côtés » pour apprendre à s’adapter à « l’évolution du métier », les faisant côtoyer des metteurs en scène ou chorégraphes reconnus afin de s’enrichir mutuellement. « En perpétuelle demande, ils sont avides d’apprendre, encore et toujours », s’enthousiasme-t-elle.

Postée « sur » un piano, entourée de ses camarades, Liying Yang témoigne : « J’ai accompli un rêve d’enfance qui semblait inaccessible lorsque j’écoutais de la musique classique chinoise avec ma mère. Aujourd’hui, je suis tellement heureuse de pouvoir m’épanouir ici : je me sens immensément libre lorsque je chante, que je raconte des histoires. »
Glen Cunningham sait qu’il y a encore des étapes à passer avant d’interpréter ses rôles fantasmés – le Roméo de Juliette ou Edgardo dans Lucia di Lammermoor –, mais se sent prêt à interpréter « les ténors mozartiens », le grand Wolfgang demeurant l’incontournable ! « Mozart, c’est le passage obligé, avec son univers où l’on peut s’exprimer en y volant comme un oiseau, même si je préfère la profondeur d’âme et la complexité des héros de Verdi, mon graal. »
Levi évoque son amour sans faille pour l’art total dans lequel il évolue, pour « le collectif, le but commun à atteindre, tous ensemble », tandis qu’Oleg, qui vient de finir son cours d’italien à distance, rejoint le groupe : « À chacun son approche : personnellement, ce sont les éléments extérieurs qui jouent sur ma manière d’aborder un rôle : un chapeau sur la tête, une veste de costume sur le dos, une mouche dessinée au-dessus de la bouche… L’essentiel est de faire groupe, voire troupe, et se mettre au service d’une œuvre, d’un compositeur. Nous donnons et recevons, comme dans une église. La dimension sacrée de l’Opéra est primordiale », conclutil de sa voix de baryton.
— L’OPÉRA STUDIO, Cenerentolina du 3 mars au 4 avril au Théâtre municipal de Colmar, à La Sinne de Mulhouse et à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg
Le Couronnement de Poppée du 24 mars au 30 avril au Théâtre municipal de Colmar, à La Sinne de Mulhouse et à l’OnR
L’Heure lyrique : Lyrico-Slaves les 13 et 14 mai au Théâtre municipal de Colmar et à l’OnR
Opéra Trinational Gala Concert le 27 mai au Théâtre de Freiburg
Turandot du 9 juin au 4 juillet à La Filature de Mulhouse et à l’OnR www.operanationaldurhin.eu
Les podcasts de la Comédie de Colmar auxquels l’Opéra Studio participe : comedie-colmar.com
47
NE TRAVAILLEZ JAMAIS !
Par Emmanuel Dosda
Les temps (intensément) forts rythment la saison du Maillon que nous saluons à nouveau pour son focus Espaces d’exil conviant des artistes « en transit » fin janvier. Tu fais quoi dans la vie ? résonne une fois de plus avec l’actualité la plus brûlante, la pandémie ayant sérieusement remis les pendules du monde du travail à l’heure. Ce nouveau moment explore l’univers impitoyable de l’activité professionnelle aliénante, du libéralisme sauvage, du harcèlement en présentiel ou par écrans interposés, de la mondialisation éco-non-responsable, des gains de levée d’options… à travers une programmation qui interroge un modèle dénué de sens que beaucoup remettent aujourd’hui en question. Spectacles, ateliers, conférences ou performances tenteront de nous aider à voir plus clair dans ce monde de brutes portant la cravate et de burnout en cascades. Suivez les guides, casque bien vissé sur la tête : Stefan Kaegi et Rimini Protokoll, épaulés par une équipe d’experts de la construction, convient le public à une déambulation nommée Société en chantier dans un Maillon sens dessus dessous. Attention, travaux ! Bérangère Jannelle jongle malicieusement avec les théories de Keynes ou Smith tout au long d’ Une histoire de l’argent racontée aux enfants et à leurs parents, tandis qu’Igor Cardellini et Tomas Gonzalez invitent les spectateurs à prendre une navette pour une visite théâtrale guidée, L’Âge d’or , direction le groupe de protection sociale AG2R dans un quartier d’affaires à proximité… Travailleuses, travailleurs, au Maillon !
— TU FAIS QUOI DANS LA VIE ?, temps fort du 18 mars au 2 avril au Maillon, à Strasbourg www.maillon.eu

48
Société en chantier © Benno Tobler
Spoken Words
Le son se fait transmission : fréquence rock émise à Besançon par Sam Guillerand, ce passeur de vies ; hymne à l’existence dans le deuil et à la poésie dans l’amour psalmodié par les Murder Capital ; et récit spiralaire de la reconnaissance abattue sur Mickaël Olivette et Pierre Barrett de Gwendoline.
BESANÇON SON AMOUR
POUR CERTAINS, BESANÇON
EST LA VILLE LA PLUS ROCK

DE FRANCE ! AVEC ROCK
THE CITADELLE, UNE SOMME
D’ENTRETIENS DE 440 PAGES, SAM GUILLERAND PROUVE
QUE C’EST VRAI.
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Renaud Monfourny
Besançon, ville rock. Formulé ainsi de but en blanc – et donc sans sommation ! –, les scepticismes peuvent s’exprimer fortement. A-ton jamais entendu parler de la ville de Victor Hugo, des frères Lumière ou Pierre-Joseph Proudhon – pour subversifs qu’ils fussent euxmêmes – dans un contexte véritablement rock ? Non, pas vraiment. Or une somme considérable de 440 pages, Rock the Citadelle , tend à prouver, si besoin était, que non seulement une activité rock existait bel et bien à Besançon mais qu’en plus elle était particulièrement florissante. Qui mieux que Sam Guillerand, alias Nasty Samy, pouvait rendre compte d’une telle réalité ? Lui, le musicien, critique musical et ancien organisateur de concerts qui a vécu cette histoire de l’intérieur

et qui doit tant à Besançon, une ville qu’il a ralliée en provenance de la petite ville de Morteau à l’est pour s’y installer en 1996 et s’en servir de base pour ses conquêtes artistiques futures. Avec humilité, il nous livre le poids de sa dette personnelle à sa ville chérie. « Besançon m’a permis de devenir qui je suis et de m’intéresser au cinéma, à la littérature et à la BD. Elle m’a permis d’y “aller” comme on dit. Où ? Je ne sais pas, mais j’y suis allé ! » dit-il avec un vrai sens de l’autodérision.
Pour relater cette dimension rock à Besançon, il a effectué un travail considérable, méthodique, presque vertigineux, et opté pour la forme orale. Cette forme il la privilégie dans ses ouvrages, comme celui qu’il a consacré au groupe punkhardcore français, Burning Heads, Hey You. « Oui, nous confirme-t-il , pour traiter ce type de sujet, musical, cinématographique ou culturel en général, c’est ma forme préférée. Pour moi, c’est une forme littéraire comme peuvent l’être les conversations par exemple. Je pars d’un postulat de base, très simple : quitte à raconter une histoire, autant la faire raconter par ceux qui l’ont vécue. Plutôt que de la relater sous la forme d’un essai aride, je me propose simplement de rapporter une somme de récits. Cela m’évite tous les filtres dispensables. Je vais chercher cette histoire et ce qui me plaît dans cette histoire, c’est qu’elle reste imparfaite. On rencontre des gens qui aiment raconter et d’autres qui aiment se la raconter. L’addition de ces profils différents rend la chose vivante. »
Effectivement, à la lecture, tout cela s’imbrique à merveille, comme si on reconstituait, pièce à pièce, les contours d’un immense puzzle. D’entretien en entretien, les éléments se confirment. Les récits personnels se répondent, se complètent avec une résonance interne que l’auteur semble cultiver à dessein. Il acquiesce : « C’est forcément subjectif. Avec toutes et tous, j’ai eu une histoire personnelle à un moment donné. J’ai établi des liens. Et pour cela j’ai convoqué des gens qui ne se fréquentaient pas forcément, qui s’appréciaient ou pas, dans un livre –une petite boîte à souvenirs – qui sera peut-être remisé sur une bibliothèque. »
Pour convoquer les souvenirs très personnels de chacune des personnes interrogées, le livre opte pour un dispositif simple : chaque intervenant se voit accorder un espace de quelques pages dans lequel il raconte l’évolution de son parcours, selon la forme qui lui semble la plus appropriée. Pour mener ces entretiens et accompagner la cohérence éditoriale du tout, Samuel qui réside actuellement à Paris, s’est beaucoup déplacé ; il a également opté pour des phoners ou des courriels, selon la bonne volonté de ses interlocuteurs. En tant que journaliste musical, il sait faire : « Oui, interroger, retranscrire, séquencer, je le fais depuis plus de 25 ans ! »
En effet, le travail de composition documentaire l’amène à un vrai séquençage thématique qui associe des groupes de personnes autour d’une période, d’un lieu, d’un média ou tout simplement
51
d’un style, ce qui permet d’embrasser la totalité du sujet. « Comme on parle de rock, de pop, de punk et de hardcore, il n’y a pas de science exacte, nous prévientil. Tout est vécu à un niveau personnel différent : chacun a son histoire. Chaque intervenant dans le livre a découvert la musique à sa manière, soit seul, soit par l’intermédiaire d’un frangin, des membres de la famille, de copains ou de copines. C’est ce qui m’intéresse dans cette histoire. Un essai un peu sec ne se montrera pas forcément plus précis au final. »
Ainsi, Sam rend hommage à toutes ces forces vives qui ont généré l’activité rock de la ville, les musiciens, organisateurs de concerts et « tous ces gens qui ont bricolé ». Il exhume les organes de presse divers et variés, dont de nombreux fanzines – certains ont parfois abouti en kiosque avec des journalistes qui ont fait leurs armes ailleurs, y compris en presse nationale. « Je me suis posé la question de savoir comment cette ville, dont le centre se résume à quelques rues, a pu voir éclore de telles scènes. » La réponse tient peut-être dans la relation intime d’un réseau qui part, comme pour bon nombre de villes de province, d’un petit groupe d’amis qui se relaient l’information dans un bar, se copient des K7 de leurs groupes préférés avant de créer un fanzine ou diffuser leurs titres choisis dans le cadre d’une émission de radio. Dans le rock, on le sait, la transmission est essentielle ; elle aboutit à une forme collective qui trouve sa pleine expression au moment de se retrouver tous réunis dans une salle de concert, que ce soit pour assister à la prestation d’un groupe venu dans la ville ou du groupe de rock du coin, autour duquel gravite un premier cercle d’amis. De là naissent des vocations entre ceux qui jouent, ceux qui en parlent et ceux qui deviennent à leur tour organisateurs de concerts. « Si on veut situer le niveau de chaleur sur le thermostat de la “rockitude” d’une ville, il faut bien s’attacher aux activistes, ainsi qu’aux lieux, les grands et les petits, les gens qui organisent, la forme de la presse qui relaie les informations – j’ai une affection particulière pour les fanzines, et chez nous on en trouve beaucoup, ce qui n’est pas le cas de toutes les villes ! –, avec des illustrateurs et des photographes. La plupart d’entre eux continuent de faire de la musique ou conservent une activité liée à cette culture-là. »
Il est vrai qu’on surprend des trajectoires intéressantes de personnes qui multiplient les connexions, y compris avec l’art contemporain, et qui passent d’une fonction à l’autre avec la même ferveur. Ne serait-ce que le témoignage de Manou Comby, musicien au sein de Formica, dans un style funk blanc proche des Talking Heads ou
Rita Mitsouko, avant de passer à la programmation du Cylindre, la salle de concert à Larnod, et à la direction de la Rodia qu’il a quittée l’an passé pour prendre sa retraite à l’âge de 65 ans, est éclairant. Inspirant même, à bien des égards.
Avant de se lancer dans cette vaste entreprise qui a occupé Sam quasiment à temps plein deux années durant, il y a forcément eu une intention, une impulsion. Un pari fou basé sur un constat : la méconnaissance de cette belle émulation rock à Besançon sur plus de quarante ans. « J’ai été musicien sur la route, un “touring musician” comme les nomment les Américains, pendant vingt ans. J’ai énormément voyagé que ce soit en France ou à l’étranger. Je me suis rendu compte en allant dans d’autres villes que ça ne se passait pas forcément comme à Besançon. Et ça, on ne le voit pas, on ne le sait pas ! Souvent, on me pose la question de savoir ce qui se passe dans cette ville. Les gens qui n’ont pas bougé me disent cela aussi, parfois. Or ceux qui ont voyagé constatent qu’il s’y passe plein de choses. Il faut rappeler qu’il s’agit d’une petite ville de 110 à 120 000 habitants, située entre Lyon et Strasbourg et qu’à certaines périodes de l’année, son offre culturelle s’aligne justement à la fois sur celles de Lyon et de Strasbourg. Ni plus ni moins. Et ça, je peux l’affirmer, en tout cas concernant ce type de culture qui me touche. »
Alors, pourquoi ne le sait-on pas ? Qu’est-ce qui fait que la ville ne figure sur aucune carte mentale du rock hexagonal et qu’elle semble oubliée, de ce point de vue ? « Oubliée des médias et de la presse spécialisée ! rectifie-t-il, loin de dissimuler l’agacement initial qui l’a amené à se lancer dans son projet. Par contre, pas du tout oubliée des tourneurs, ni des musiciens qui connaissent tous Besançon. Des années 1980 à nos jours – c’est un peu moins vrai depuis dix ans, mais comme tout part avec l’eau du bain, c’est forcément plus difficile ! –, tous les groupes pointus, que ce soit à l’époque des Bérurier Noir et de la scène alternative jusqu’aux groupes hardcore, screamo ou noise sont passés par Besançon. Tous les styles y étaient représentés. Ce qui n’est pas le cas partout, même à Mulhouse par exemple. »
Comment expliquer cependant, dans un tel contexte, qu’aucun des groupes bisontins dont on retrace le parcours dans l’ouvrage n’ait émergé à un niveau national ? Ni les Dee Dee’s, Eric Peugeot et ses Kidnappeurs, Emballage Perdu et Formica qui, chacun dans leur registre, aurait pu rivaliser avec bien d’autres groupes en France. « Quand je parlais du projet d’ouvrage, certains m’ont dit : “Tu veux faire 500 pages sur Besançon, mais il n’y a pas un groupe connu !” Et effectivement, on a croisé bon nombre de groupes plutôt de milieu de tableau. Mais qu’on se le dise : ces groupes travaillaient autant que les grands groupes ! Quand on fait 800 km, que ça soit pour jouer dans un Zénith ou dans une MJC ou même un bar, c’est le même travail, avec le label et le tourneur derrière ! Ce qui me semble important ça n’est pas tant la popularité, mais c’est bien l’activité. »
—
52
Je raconte aussi un peu mon histoire. —
On a beau rétorquer la réussite des Dogs à Rouen, de KaSProduct à Nancy ou de Kat Onoma à Strasbourg, il relativise. Pour lui, « tout était principalement centralisé sur Paris, et c’est encore le cas aujourd’hui ». Après, nous admettons avec lui que les villes provinciales représentées au plus haut niveau se résument à Bordeaux ou Rennes, et qu’elles ne sont effectivement pas si nombreuses. On le sent bien, on marche sur des œufs. Il est entier, sûr de son propos, l’ami Sam, et il ne dissimule guère une forme attachante de susceptibilité. La raison est simple, il nous l’avoue : « En racontant cette histoire, je raconte aussi un peu mon histoire. Après les livres consacrés à l’esthétique trash-metal, Enjoy the Violence, et aux Burning Heads [co-écrit avec Guillaume Gwardeath, ndlr], je m’inscris dans une continuité qui raconte mon adolescence. » D’où sans doute une sensibilité particulière, une implication d’autant plus personnelle. Cela s’entend clairement et se lit à chaque ligne de cette histoire relatée par d’autres. Après, il l’admet : « Je ne sais pas si on avait la qualité pour rivaliser avec les Bijou, Trust ou Téléphone, des groupes qui étaient accompagnés professionnellement. Chez nous, ça manquait un peu. Après, les scènes représentées ne correspondaient pas à des schémas voués au succès. Elles étaient principalement indépendantes en lien avec le mouvement noise, arty ou college rock. »
Dans le livre, on distingue des familles. « Oui, absolument et je recommande à ceux qui seraient tentés de picorer, une lecture du début à la fin parce qu’on va comprendre quelque chose. Je ne veux pas expliquer ni tirer des conclusions, mais ne serait-ce que l’iconographie elle-même ne cesse de bouger au fil des pages. » Il est vrai que dans cet ouvrage dont la sobre mise en page est inspirée des Inrockuptibles première époque, la mémoire se vit de manière aussi textuelle que visuelle. « Il en va de même pour la topographie, précise-t-il. Au début, ça se passe plutôt en périphérie de la ville avant de se recentrer intramuros, dans la “boucle” à Besançon. À ceux qui ne verront qu’une suite de profils, j’ai envie de leur dire que le livre est tout autre chose. » Les redondances qu’on peut lire d’un portrait à un autre appuient des arguments qu’il ne souhaite pas forcément avancer lui-même. D’où un propos sans hiérarchie ni jugement de valeur, ce qui est très appréciable en soi. Selon lui, « le fait qu’il n’y ait pas de gens très connus permet aussi de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. La présence de quelqu’un de la notoriété d’un Miossec, ne serait-ce que pour citer cet exemple, aurait créé des déséquilibres. Là, il est question d’anonymes, mais qui ont fait des choses tangibles, très concrètes. »
Au-delà de son histoire personnelle, ce qu’on lit aussi, c’est tout simplement une histoire du rock. Que le lecteur soit averti ou plus néophyte, il distingue clairement l’évolution de la musique sur la base des références de chacun des intervenants. Il est assez plaisant de voir mentionnés à côté du Clash ou des Pistols des groupes comme Soft Machine, Captain Beefheart ou XTC par exemple,

au cours de périodes musicales aussi riches que variées. Ça n’était pas forcément une volonté affichée au départ, mais Sam se satisfait de cet heureux bénéfice collatéral. « Oh, ça me fait plaisir ! Oui, on situe les bornes générationnelles d’une époque à l’autre, que ce soit la fin des années soixante-dix avec l’after-punk et ses déclinaisons, le milieu des années quatre-vingt avec la vague américaine puis plus loin les années quatre-vingt-dix avec le grunge puis la britpop qui s’y oppose. Peu ont parlé du hip-hop, mais moi j’en parle parce que c’est essentiel. »
Ce qui se dessine enfin, et ça n’est pas la moindre des choses, c’est le portrait d’une ville, touche après touche, de manière quasi impressionniste : Besançon son amour ! « Oui , nous dit-il avec le ravissement de celui qui découvre que sa finalité implicite a été percée à jour, le personnage principal, en filigrane et sur lequel je souhaite porter la lumière, c’est la ville de Besançon. On doit ressentir les rues, les lieux. J’ai poussé mes entretiens dans ce sens-là. Je ne voulais pas que ça ressemble à un catalogue avec des CV d’activistes ni à un catalogue de groupes avec une guitare. Après, je tiens à préciser que je ne suis pas nostalgique pour un sou : j’envisage le rock comme une culture et j’ai voulu interroger les portes d’entrée de cette culture-là, dans ma ville. » Et d’un environnement culturel, serions-nous tentés de rajouter, qui par bonheur ne s’est mu que par la seule volonté de ses acteurs mêmes.
— ROCK THE CITADELLE, Sam Guillerand, Médiapop soirée de lancement le 22 avril à La Rodia, à Besançon larodia.com
53
THE MURDER CAPITAL SOMETIMES EMOTIONS GET TOO REAL
THE MURDER CAPITAL, À LA LAITERIE. DIVIN.

54
Par Emmanuel Abela et Aude Ziegelmeyer ~ Photo : Pascal Bastien

55
We lie
To keep Alive
Samedi 11 février, 16 h 30. Un doux soleil traverse les portes vitrées de la Laiterie, nimbant les affiches des mythiques concerts passés : Motörhead, Ko n et Radiohead nous occupent, le temps que le tour man, George, rassemble le quintet dublinois.
The secret
La veille, les n°1 irlandais faisaient la couv’ de l’hebdo du Rolling Stone. Mains entremêlées, corps superposés, en symbiose – unis par ce second opus new wave fort différent de leur premier album, When I Have Fears (2019), flambeau postpunk exacerbé par la rage du deuil. La rage reste, toujours, mais faire l’expérience de Gigi’s Recovery, c’est être saisi par la nuque et plongé sous l’eau glacée, c’est se noyer, et refuser de remonter à la surface. La noirceur est acceptée, sublimée, les ténèbres familières. Les eaux du Styx amènent les morts aux Enfers, les vivants à l’invulnérabilité. À condition de s’y glisser intégralement, sans omettre le talon.
To hold The Past
In place
16 h 40. Traversée de passerelle, descente d’escaliers d’où émane un rythme puissant, un tambour battu par les murs, George nous guide jusqu’au groupe. Enfin, non. Des cinq prévus, seuls Damian Tuit et Cathal Roper, les guitaristes, se prêteront au jeu de l’interview. Manquent à l’appel le chanteur James McGovern, le bassiste Gabriel Paschal Blake et le batteur Diarmuid Brennan. L’un fait son jogging, les deux autres sont introuvables. Soit, ce sera donc deux contre deux. Fair match.
Une poignée de main échangée, Cathal nous tire poliment des chaises pour nous installer face au canapé qu’ils occupent. NOVO glisse entre nous, que Damian feuillète d’une main, l’autre serrée sur la canne finement torsadée sur laquelle il s’appuie pour marcher. On s’attend à ce qu’il l’abatte sur les pages pour exprimer son assentiment, mais non, un hochement du menton sans ambages clôture son examen et lance l’entretien.
Bazardées, nos questions sur la poésie romantique de Gigi , sur les penchants de leur chanteur et songwriter pour Paul Éluard, Albert Camus, Jim Morrison ou T.S. Eliot. Suspendues, celles sur le surréalisme invoqué jusque sur la pochette, une création de l’artiste Peter Doyle. Écartées également leurs influences musicales. Les n°1 sont las de s’entendre rappeler leur filiation à Joy Division, Radiohead ou leurs compatriotes, les Fontaines D.C. On retient de ces quelques
instants avec eux que la musique vient toujours avant les mots, qu’ils aiment notre capitale, où ils ont enregistré ces douze morceaux texturés, qu’ils ne suivent pas le rugby ni le match IrlandeFrance qui se tient en ce moment, et que ce n’est pas leur premier séjour à Strasbourg. Outre l’architecture allemande de la Neustadt, « the big rats ! », à comprendre les ragondins, les fascinent. S’ensuit un bref échange sur la ressemblance entre nos rongeurs alsaciens et les castors, sur la possibilité de les déguster (« the big rats ! », bien sûr) en ragoût ou en terrine à condition d’en attraper un, lorsque Pascal Bastien nous interrompt, séance photo oblige. Elle se tiendra à l’entrée de la salle de pause, dans un coin au mur incliné. Malgré un flash capricieux, les Irlandais se laissent capturer, les traits baignés d’une lumière bleu roi qui, nous l’ignorions alors, les auréolera sur scène.
Aussi sonores que sur les planches d’un théâtre, des pas résonnent dans les entrailles de la Laiterie. Talonnant George le tour man, notre poète absent fait son entrée. En sa qualité de chanteur, il est absolument nécessaire qu’il se repose les cordes vocales pour le concert à venir, c’est donc sans nous saluer, les mâchoires crispées, rejouant la colère d’Achille, que James McGovern rejoint ses camarades. Presque aussitôt, Gabriel Paschal Blake dévale les escaliers avec un sourire de garnement chopé à faire l’école buissonnière. Les trois autres se décrispent, se permettent des rictus en coin, avant de décamper le plus vite possible.
L’Irlande a battu la France 32 à 19. On se sent dans le même état.
We die
To keep
Our souls
21 h 30. La Laiterie Club, la petite salle, est pleine à craquer. Aussi anxiogène qu’excitant de se retrouver à nouveau dans une foule si dense, à se déplacer en collant les autres. Des autres majoritairement quadras et quinquas, des fans de Joy Division ou de New Order, sûrement. L’effervescence est palpable, l’attente insupportable, en particulier car les Irlandais n’ont pour cette tournée que deux dates en France, Strasbourg et Paris. On s’étonne derechef du choix de la salle, mais les sourires sont trop grands pour s’y attarder. Ça fait du bien d’être là. De faire corps, ensemble.
As features
On se fraye un chemin jusqu’à un recoin pour mieux voir la scène. Là, une dernière bouffée d’oxygène avant de plonger.
Guitaristes, bassiste et batteur prennent leurs marques. Surplombant les hurlements du public, les premières notes de la cadence hypnotique
56
d’Existence, titre d’ouverture de Gigi, fusent autour d’un micro vide. La voix la première, James apparaît. Les projecteurs teintent sa veste en cuir de bleu, ce même bleu roi choisi par Pascal, puis d’un rouge sanguin : la poésie sous-marine de Gigi face à la colère éclatante de Fears. Ses mouvements sont lents, presque trop. À son oreille, une petite boucle dorée capture la lumière. On lui pardonne sa froideur. Qu’il garde sa voix pour la scène et uniquement la scène, c’est là sa juste place.
The night
Will burn
Its wax
And wick
Les mains se lèvent, les siennes se baissent. Il caresse ce corps gigantesque que nous formons, et l’enfonce dans les profondeurs abyssales.
The stars will leave their stage
L’une de nos questions posées à Damian et Cathal portait sur la manière dont ils envisageaient l’assortiment en live du premier album au second. La réponse s’était faite bredouillante. « En fonction du moment », selon Cathal. « Certaines vont mieux ensemble que d’autres », avait tranché Damian, d’un tournoiement de canne. On peinait alors à l’imaginer. En les écoutant un casque sur les oreilles, ces albums appartiennent à des catégories distinctes, un écart que de nombreux fans de la première heure leur reprochent, et que bien d’autres saluent – à juste titre. Ah, fools ! La scène engloutit cette frontière comme un raz-de-marée. Existence, Green & Blue, le rageur More is Less aux poings qui se lèvent pour tabasser une injustice outrepassant le visible, ou encore le sublime Ethel naviguent dans un même courant. Emportant tout sur leur passage, hybrident la colère à la joie.
Il devient finalement évident ce choix de la Laiterie Club, la proximité exacerbée par le volume réduit de la salle, la puissance délivrée par ce jeune groupe déjà si grand. Et alors qu’on secoue la tête à s’en décrocher les cervicales, qu’on se rougit les paumes à chaque titre, instant de bascule – le divin Achille est mortel, lui aussi.
On Twisted Ground. Six minutes et neuf secondes issues de
When I Have Fears
La lumière bleue sacre James, sa voix plaintive transcendée par la basse puissante de Gabriel. « You could’ve watched it all / You could’ve watched it all / You could’ve watched it all », sur cette litanie désespérée, son souffle s’écorche, poussé sur le micro comme sur une braise mourante. C’est la respiration d’un noyé, les poumons brûlés par l’eau de mer. La Laiterie n’a jamais été aussi calme. Même de jour, même vide. Ses sanglots flottent sur la pureté du silence. On pleure à travers lui. Il
quitte la scène quelques instants, n’y revient, les joues trempées, qu’après le réconfort salutaire des bras de son bassiste. On comprend qu’On Twisted Ground annonçait Gigi, que le deuil ne se fait jamais, mais qu’ensemble, il est possible d’y nager. Just like ships in the night Promising to collide
— GIGI’S RECOVERY, The Murder Capital, Human Season Records, 2023
57
CHRONIQUES DE LA MACRONIE GWENDOLINE
EN TOURNÉE, LES MEMBRES DU GROUPE COLDWAVE

GWENDOLINE, MICKAËL OLIVETTE ET PIERRE BARRETT, NOUS PARLENT DE LA DRÔLE DE SPIRALE MÉDIATIQUE ET ARTISTIQUE DANS LAQUELLE ILS SONT EMBARQUÉS.
ENTRE RECONNAISSANCE INATTENDUE ET PRÉPARATION DU PROCHAIN ALBUM.
Gwendoline, une énergie stoppée par le Covid ?
En 2020, l’album Après c’est gobelet ! et ensuite, plus rien ?
Pierre Barrett : Ah, non, pas du tout. On a fait le disque et ensuite on est partis bosser. Faire autre chose que de la musique. Moi, j’étais cuisinier et Micka était pion.
Au départ, le projet, c’était vider votre bile ?
P.B. : Au tout début de l’histoire de Gwendoline, ça faisait un an et demi que nous ne nous étions pas revus. On était au bar, on parlait de nos vies
et on a abordé la politique. On était au début de la macronie. Ça nous a donné beaucoup de grain à moudre et on avait envie de se foutre de ça. Et puis ensuite, on a eu envie de faire des chansons d’amour sur nos vies [rires]
Mickaël Olivette : C’est venu assez naturellement. On a fait les morceaux un par un et au bout de neuf titres, on les a mis sur Bandcamp…
Et c’est devenu votre album. Musicalement, l’angle est très particulier : post-punk tendance coldwave.
58
Par Martial Ratel ~ Photo : Vincent Arbelet
P.B. : Oui, c’est parce que dans ces premiers temps du groupe, on aimait se retrouver dans des cafés qui diffusaient ce genre de musique.

M.O. : Et naturellement, on s’est mis à produire des boucles qui sonnaient coldwave.
Avec vos textes, vous auriez aussi pu faire du rap.
P.B. : C’était l’idée, mais on n’a pas réussi [rires]. J’avais un flow de merde…
M.O. : On ne se sentait pas du tout légitimes avec le rap.
À la sortie de cet album, toute la presse nationale et alternative s’est intéressée à vous. Étrange situation, vous qui vous considérez plutôt comme des outsiders.
M.O. : Au début c’était un peu gênant. Après, on a pris toutes les choses cool.
P.B. : Au début, on n’assumait pas trop. Ça a mis du temps pour qu’on monte sur scène. Il a fallu nous pousser. Le live me semblait aller à l’encontre de notre musique. Je me disais aussi que tout ce qu’on avait ressenti en se revoyant Micka et moi, ce n’était pas sincère. On se disait que ce n’était pas possible,
59
qu’on serait ridicule. On ne savait même pas si on avait envie de défendre ça… On se met à nu, quand même, on raconte pas mal de trucs sur nous. En fait, on veut juste faire de la musique de notre vie ! Et comme tout se passe bien finalement, on prend cette situation en mode « c’est cool ». Ce sont des petits bonus.
Est-ce que ça vous rend la vie plus douce ? Quand on fait attention à vos textes on sourit, mais on a l’impression que vous en bavez.
M.O. : Ça va bien, mais ça allait déjà avant. Gwendoline, c’est uniquement une partie de nous. On a d’autres projets musicaux où on peut jouer de la pop avec des colliers de fleurs et dans celuici, Pierre et moi, nous nous sommes retrouvés sur… ce ton-là. On se marrait quand même quand on préparait le disque. On ne se tailladait pas les veines [rires]
Dans le Monde diplomatique, Pascal Bouaziz de Mendelson et Bruit Noir dit de vous : « Antihéros revendiqués d’une province abattue, les deux chanteurs incroyablement doués tirent le portrait blafard d’un pays malade. » C’est bon, après ça, vous pouvez arrêter de faire des disques.
P.B. : C’est très stylé, d’autant que Bruit Noir est une de nos références.
Votre projet politique, qui est important dans Gwendoline, c’est quoi, il est où ?
M.O. : À gauche, forcément. Mais pas la gauche PS ou PCF. On ne glorifie pas le travail. Je ne sais pas… En fait, on aime bien avoir ce côté « pilier de comptoir » quand on parle de politique dans nos chansons.
P.B. : Humaniste, au bar.
Votre dernière sortie, c’est un 3 titres qui s’appelle Sans contact, tout un programme.
P.B. : C’est vrai que cet EP a une thématique particulière autour de ce monde qui marche sur la tête. Et nous, on regarde ça et on se dit : « Ouh là là, c’est quoi ce truc ? »
L’avenir pour Gwendoline, comme toute bonne faction politique, c’est une autodissolution ?
M.O. : On a fait beaucoup de dates jusqu’à midécembre. On bloque trois mois, dont un pendant lequel on louera une maison pour écrire le deuxième album. On va l’enregistrer avec les mêmes moyens que le premier. Rien que tous les deux. C’est très bien comme ça. On ne va pas intégrer d’autres musiciens à ce moment de création. C’est dictatorial. On va tout faire par
nous-mêmes : écrire et mixer. On verra comment il sonnera. Si ça se trouve, il ne nous plaira pas et on arrêtera tout [rires]. Il sortirait à l’automne 2023. On voudrait aussi essayer de jouer à l’étranger cette année.
Vous allez écrire en anglais pour tourner hors des frontières ?
P.B. et M.O. : Ah, non, non… On n’est pas bons en anglais.
P.B. : On voudrait jouer dans les pays limitrophes comme la Belgique ou la Suisse.
De grosses maisons de disques ont dû vous approcher en vue de ce deuxième album. Que leur avez-vous dit ?
P.B. : On ne leur a rien dit [rires].
M.O. : Une major, c’est très gros. On se pose des questions. À quel point on peut conserver notre indépendance, notre liberté de création ? On est en discussion. On verra, on enregistre et on sera en position de force quand on aura le disque dans les mains.
Vos clips aussi sont faits par vous-mêmes. Au téléphone portable.
M.O. : C’est exactement la même idée que le disque où on fait tout par nous, avec peu de moyens. N’importe qui peut le faire. Pour l’album, on avait une carte son, un ordi et même pas d’ampli…
P.B. : On fait juste comme tout le monde. On filme notre vie, au supermarché, dans les rues, dans les magasins.
M.O. : C’est aussi l’idée qu’on se fout des clips.
gwendoline.bandcamp.com
— En fait, on aime bien avoir ce côté
60
« pilier de comptoir » quand on parle de politique dans nos chansons. —
Illustres Traits
Catherine Meurisse, Clément
Vuillier et Martin Panchaud
mettent la bande dessinée à l’honneur ; poésie mordante, comètes organiques et langages picturaux originaux embrasent les pages, et nous avec.
 Dargaud / Rita Scaglia
Dargaud / Rita Scaglia
OISEAU RARE
Par Valérie Bisson
S’IMMERGER DANS LES RÉFÉRENCES DE CATHERINE MEURISSE, COMPRENDRE COMMENT L’ARTISTE SE CRÉE UNE VOIX PROPRE, SE FAIT UNE PLACE À ELLE, AVEC TENDRESSE, HUMOUR ET POÉSIE…
Dans le cadre des « Rencontres de l’Illustration » et en lien avec sa thématique sur la visibilité des femmes dans l’illustration, le Musée Tomi Ungerer, Centre international de l’Illustration, met à l’honneur l’illustratrice, dessinatrice de presse et bédéiste, Catherine Meurisse. Intitulée « Catherine Meurisse. Une place à soi », l’exposition revient sur la carrière de cette artiste prolifique et protéiforme.
Vous êtes à la fois dessinatrice de presse et d’albums pour la jeunesse, autrice de bandes dessinées, première illustratrice à être élue à l’Académie des beaux-arts et, qui plus est, vos livres sont truffés de références littéraires et picturales, comment parvenez-vous à cumuler une telle somme de travail ?
Tout part d’un manque, de quelque chose qui me tracasse. Dans chacun de mes livres se glissent et se mélangent des références littéraires et picturales qui me sont indispensables pour vivre et dont je profite pour continuer à apprendre, pour rester éveillée. Mes premiers albums, Mes hommes de lettres et Le pont des arts , partaient du même constat ; lors de mes initiales études de lettres, le dessin me manquait, l’histoire de l’art n’était pas au programme. Ensuite, je suis rentrée à l’école Estienne pour apprendre le dessin, et l’histoire littéraire y était absente. J’ai alors profité de mon métier pour réunir ces deux passions. Ainsi, chaque album me permet de fixer des choses qui m’émeuvent et me plaisent. J’y mets beaucoup de ce que je vis sans forcément me représenter. Des allers-retours se font entre ce que j’apprends, ce que je découvre chez les écrivains et les artistes, et ce que je ressens dans la vie.
Avec du recul, je me rends compte que j’aime constituer ou regrouper des familles, réelles ou
imaginaires, proches ou lointaines, dans tous les cas, vivantes. Elles me rassurent et me stimulent, me donnent envie d’écrire, de dessiner, de vivre, tout simplement. Dans cette somme, apparemment érudite, il y a aussi une bonne dose de flou artistique et d’approximation, car je ne tiens pas à ce que mes livres soient doctes : l’humour s’immisce et crée un décalage indispensable pour que tout cela ne devienne pas ennuyeux ou lourd.
Malgré la tragédie et la gravité du sujet, ce regard décalé est très présent dans La Légèreté, il n’enlève rien à la douleur et à une sensibilité très personnelle. Comment alliez-vous les deux ?
L’humour est le décalage indispensable pour tenir debout dans ce monde où la cruauté et l’injustice prévalent, il peut même fournir quelques armes de résistance. Allié à la poésie, il me semble être une bonne réponse à la violence, en l’occurrence celle de janvier 2015. La Légèreté est, outre un récit de ma reconstruction post-attentat, un hommage aux copains assassinés. L’humour étant dans leur ADN, il était naturel d’évoquer leur souvenir avec malice. C’est auprès de cette équipe de dessinateurs, que j’avais rejointe assez jeune, que j’ai appris l’art de la répartie, au point d’en faire un métier. Garder et préserver cet humour dans La Légèreté, album tristement particulier, c’était rester fidèle aux disparus, tenter de les prolonger un peu, de les avoir encore un peu avec nous. C’était aussi rester fidèle à moi-même. Autre avantage de l’humour : il permet de ne pas entraîner le lecteur dans le pathos, de garder une forme de politesse. Ce qui était trop lourd et trop grave, je l’ai gardé pour moi et je l’ai soigné, ça n’avait pas lieu d’être dans un livre. L’art est le lieu de la transformation, c’est tout ce que je souhaitais montrer, pas les coulisses.
La Légèreté, Les Grands Espaces, La jeune femme et la mer, trois albums qui se distinguent par leur singularité graphique et leur licence poétique très présente, par l’alliance de la fragilité et de la force, de la BD et de l’illustration. Quel lien faites-vous entre ces différents univers ?
On dit souvent qu’on se rend compte du livre que l’on a fait une fois que le livre est fait. C’est le cas avec les trois albums que vous citez, je me suis aperçue après coup qu’ils formaient un triptyque. La Légèreté pose la question de l’identité (qui suis-je après une catastrophe ?), Les Grands Espaces pose celle des origines (une enfance à la campagne), La jeune
63
femme et la mer s’interroge sur la disparition (des paysages aimés, de la nature). La conscience de la perte des êtres, des choses, de l’environnement, est prégnante. Ces trois albums proposent trois univers réels et imaginaires dans lesquels les questions se posent, plus que les réponses ne se trouvent. Pour ce qui est de la singularité graphique, c’est le récit qui me mène à l’outil. La plume et le pastel pour La Légèreté, le crayon pour Les Grands Espaces, la plume et le fusain pour La jeune femme et la mer. Je me laisse guider par l’intuition et ne cherche pas à respecter artificiellement les codes de la bande dessinée. À vrai dire, sa grammaire ne m’a jamais préoccupée. En école d’art, je rêvais de faire du livre illustré. En arrivant à Charlie Hebdo, un peu par hasard, j’ai plongé dans l’univers du dessin de presse, un tout autre métier. Les mentors, Cabu, Wolinski, Tignous, Willem, parvenaient en quelques coups de crayon à développer une idée, à faire passer un message. Auprès d’eux, j’ai appris à privilégier l’efficacité du dessin et à en ôter tout ce qui pouvait être superflu. C’est ce qui est devenu important pour moi. J’ai importé ce savoir-faire dans mes bandes dessinées.
L’exposition au Musée Tomi Ungerer est une rétrospective orientée illustration, elle s’inscrit dans le cadre des Rencontres de l’Illustration, un art récemment entré avec vous sous la coupole de l’Académie des beaux-arts. Quel est votre regard sur ce vaste univers ?
Avoir une rétrospective au Musée Tomi Ungerer est un moment très important pour moi, pour diverses raisons. J’aime beaucoup ce musée, le lieu, les collections, cet écrin « ungererien ». À chaque fois que je vois les dessins de Ungerer, cela me donne envie de dessiner, j’aime toutes ses périodes, les dessins de jeunesse, comme les Mellops, ou ceux plus violents et satiriques réalisés à New York. Le titre de mon exposition, trouvé par la commissaire Morgane Magnin, est évidemment un clin d’œil à l’ouvrage de Virginia Woolf, c’est aussi l’occasion d’aborder la place des femmes dans le domaine de l’illustration et dans le monde de l’art en général… Une place qu’il faut prendre. Par ailleurs, je suis infiniment attachée à l’illustration, c’est ce que j’ai vu et lu en premier, lorsque j’étais enfant. Le livre illustré en tant qu’objet me fascine presque autant que les dessins d’André François, de Maurice Sendak… Le rapport texte-image m’a toujours captivée, la manière dont le dessin se place, juste à côté, sans l’alourdir, c’est un univers que j’aime beaucoup, auquel je suis très attentive même si je le pratique moins aujourd’hui, j’ai cependant publié Les Fables de la Fontaine l’an dernier, dont les planches sont
exposées. En outre, cette exposition-rétrospective a la particularité de faire dialoguer mes petits dessins avec quelques magnifiques œuvres extraites des cabinets d’art graphique des musées de Strasbourg : un Delacroix, un Corot, un Doré… Je sais tout ce que je dois à ces grands artistes. Sur l’affiche que j’ai réalisée pour l’exposition, je tourne le dos au buste de Minerve, l’emblème de l’Institut de France, pour faire mon petit crobar sur un coin de toile : une manière de dire que le dessin vit sans craindre le poids des maîtres ou des institutions. Se confronter à des dessins de maîtres, c’est mettre son travail en perspective, et continuer d’apprendre en permanence. On ne crée pas à partir de rien. C’est assez troublant d’avoir une rétrospective à 40 ans. La première a eu lieu à Angoulême en 2020, puis elle s’est agrandie à Beaubourg et a tourné en Suisse et en Allemagne. Celle de Strasbourg est encore différente. Ce genre d’événement permet de revoir les dessins du début, impertinents, faits à un moment où j’avais zéro lectorat, il est bon de ne pas oublier cette insouciance et de la réinjecter dans les dessins d’aujourd’hui. C’est qu’il s’en est passé, des choses, depuis 2003… [rires]
Peinture, poésie, musique, philosophie… Il semblerait que la nature soit aussi un de vos éléments fondamentaux et constitutifs…
S’il fallait porter une figure au pinacle, il s’agirait bien sûr de la nature. Dans mes albums, elle est une protagoniste à part entière, autonome et indomptable, elle déploie ses horizons sur des pages entières ou des doubles pages, débordant des cases de BD. J’ai passé mon enfance à la campagne, une chance, un terrain de jeu et de découvertes sans fin, que j’explore dans Les Grands Espaces. La jeune femme et la mer met la relation nature/homme au cœur du récit et propose la peinture sur le motif et la constitution d’un herbier comme recours à la disparition des paysages. La Légèreté met en scène une quête de beauté salvatrice, qui va du bord de l’océan aux sentiers creux des Deux-Sèvres en passant par les cyprès de Rome. Force créatrice, la nature est une source d’inspiration infinie, un modèle de liberté, d’intelligence, de résilience. Elle a la générosité de nous offrir quelque chose de très précieux : la vie et la conscience de notre finitude.
— CATHERINE MEURISSE. UNE PLACE À SOI, exposition du 17 mars au 3 septembre au Musée Tomi Ungerer, Centre international de l’Illustration, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu
64
LA FRÉNÉSIE DES ÉLÉMENTS
Par Emmanuel Abela
AVEC DES OUVRAGES SOMPTUEUX, CLÉMENT VUILLIER S’ATTACHE
À LA NAISSANCE ET À LA DESTRUCTION DE TOUTE CHOSE.
On trouve une fulgurance chez Clément Vuillier : une évidence frappante. Dès la parution de L’Année de la comète en 2019 chez l’éditeur strasbourgeois 2024, on savait qu’on se situait ailleurs, dans quelque chose que la BD n’avait peut-être pas totalement exploré : de grandes images pleine page, muettes, avec un séquençage ample qui prend le temps d’une narration contemplative. Venue tout droit du fin fond de l’univers, une comète irradiante de mille feux déchaîne les éléments : les paysages s’embrasent, les tremblements de terre se multiplient, des volcans se déclenchent et des raz-de-marée dévastent les rivages. Tout cela le temps du passage furtif à proximité de la Terre, avant de retourner à une forme de quiétude cosmique. Comme si la plénitude naissait d’un bouleversement total.
On se croirait perdu dans certaines planches du Livre des Miracles, cet ouvrage du xVie qui recensait tous les signes divins – comète, épée de feu et croix – présages heureux ou malheureux selon la perception de chacun. « Je me suis interrogé sur ce qui se passait quand les éléments se déchaînaient ainsi sans que l’humain ne soit menacé : ça devient un pur spectacle ! Rien de plus réjouissant que de regarder un orage ou une tempête derrière sa fenêtre. En fait, le seul humain présent dans L’Année de la comète, c’est le lecteur lui-même qui peut, à l’abri derrière la page, jouir de ce spectacle », nous explique Clément
à l’occasion d’une exposition de ses œuvres sur papier à L’Oiseau rare, un charmant café-librairie sur les quais à Strasbourg. On surprend chez ce jeune auteur, par ailleurs graphiste et ancien étudiant en école d’art appliquée à Toulouse et de la prestigieuse École Estienne à Paris qui a rejoint l’école des arts décoratifs de Strasbourg en troisième année d’illustration – actuelle HEAR –, un trait vibrant, hors-temps. Son dessin méticuleux, précis, vif et décidé renvoie autant à la gravure du x V i e d’Albrecht Dürer qu’à certains traitements végétaux de Matthias Grünewald, le peintre du célèbre retable d’Issenheim dans la scène de la visite de saint Antoine à saint Paul l’Ermite. « Oui, confirme-t-il, Dürer fait partie de mon corpus d’images tout comme certaines gravures du xixe, mais je puise également chez mes pairs, Mœbius ou Druillet par exemple. Je m’inspire beaucoup des Japonais en général, que ce soit les maîtres des estampes ou des artistes plus contemporains. Pour moi, ils sont tous époustouflants ! » dit-il avec beaucoup d’admiration dans le regard. Et de nous citer l’œuvre de Yūichi Yokoyama, le merveilleux auteur du chef-d’œuvre La Terre de glace , dont, selon lui « le travail de séquences en a inspiré plus d’un ! »
Il faut beaucoup de maîtrise pour faire tenir un tel sujet en BD, même dans un grand format (28,5 x 38,5 cm). « Un format préexistant chez l’éditeur
65


Terre rare
pour l’une de ses collections », nous rappelle-t-il. Clément n’en était pourtant pas à son coup d’essai. Il nous livrait la suite d’une première belle tentative, Le Voyage céleste extatique, publié en 2015, réédité entretemps chez 2024. « J’ai repris ce livre d’Athanasius Kircher et lui ai emprunté ses deux personnages : Cosmiel et Theodidactus, que j’ai renommé Jean. »
Avec un brin de jubilation, il nous relate le parcours de Kircher, ce prêtre jésuite allemand, philosophe, théologien, d’une érudition phénoménale, qui a publié une bonne vingtaine de traités dans des domaines aussi variés que la géographie, l’astronomie, les mathématiques, la médecine ou la musique. Certains se souviennent qu’il apparaît en bonne place dans le récit choral de Jean-Marie Blas de Roblès, Là où les tigres sont chez eux, une tentative facétieuse de réhabilitation du génie baroque. Un brin taquin, Clément nous rappelle que Kircher a certes écrit une somme dans toutes les disciplines de l’époque et fait des découvertes brillantes, mais qu’« une fois sur deux, il s’est planté ! Il partait d’un axiome faux ; de fait, toute la déduction qui découlait de cet axiome était fausse elle aussi. Il pouvait ainsi consacrer 2 000 pages à déduire des choses fausses. » Mais au-delà « des aberrations scientifiques et de quelques délires cosmogoniques », il s’est laissé séduire par cette « sorte de road-trip interstellaire » et a brodé pour son adaptation libre un récit fascinant par bien des aspects, aussi bien sur le fond que la forme. On l’interroge sur le fait d’utiliser le nom de l’apôtre Jean, auteur – pressenti – à la fois de l’Évangile qui porte son nom et de L’Apocalypse, pour figurer l’un des personnages. « Oui, la présence de Jean se justifie. Je l’associe plus à la notion de “révélation” [allusion au titre Le Livre de la Révélation, ndlr] qu’à la notion d’“apocalypse” au sens où on l’entend aujourd’hui. Je trouvais intéressant de le placer au côté de Cosmiel. » On ne peut s’empêcher de penser à un autre voyage céleste, celui du Petit Prince, Saint-Exupéry étant expressément cité comme une référence : même candeur, même délicieuse poésie philosophique. La fluidité du récit est magnifiée par une certaine légèreté dans le trait d’un artiste en acquisition de son propre langage graphique. Une forme qui tranche avec la décision formelle qu’on trouve dans son dernier ouvrage en date, Terre rare , paru en 2022. Il nous l’annonce avec gravité : « Si on devait mentionner la notion d’“apocalypse”, on la trouverait plutôt dans Terre rare. Mais cette apocalypse-là on la doit à l’intervention humaine ! »
En effet, pour ce nouveau récit muet, des modules sphériques blancs sont lâchés sur une planète ; ils se nichent partout dans la roche avant de provoquer des déflagrations en cascade. De l’implosion naît la possibilité pour le module-mère de capturer le cœur de la planète. De l’instant décisif de cette capture de ce qui constitue l’essence – « sa dimension matricielle », selon les mots de Clément –de cette planète, naît un éparpillement organique inquiétant.
En s’inspirant des planches anatomiques de JeanBaptiste Marc Bourgery et Nicolas-Henri Jacob au xixe, l’auteur nous plonge dans un univers viscéral qui n’est pas sans rappeler le célèbre film de sciencefiction Le Voyage fantastique de Richard Fleischer en 1966. À cette différence que plutôt que d’évoluer dans le corps, c’est le contenu même de ce corps qui vient à se répandre dans tout l’Univers. En supposant éventuellement qu’il puisse se reconstituer quelque part. « Oui, nous dit-il, je m’attache à la destruction et à la régénérescence des choses. »
Pour ceux qui auraient vu une éventuelle intervention extraterrestre dans ce récit, Clément leur accorde part d’interprétation. « Je sais qu’il y a d’autres lectures possibles, et je laisse la porte entrouverte à ces lectures-là. Ça peut être un élément extraterrestre, quelque chose d’exogène en tout cas ! » Il insiste cependant sur « l’extractivisme outrancier d’une démarche qui vise à se saisir ailleurs comme on le fait trop souvent de ce dont on a besoin sans chercher à se soucier des conséquences sur l’écosystème. » Sujet d’actualité, s’il en est. « Oui, concède-t-il, nous sommes les prédateurs de notre propre monde. » Avec lui, nous constatons une gradation dans son approche graphique et narrative, qui le conduit à développer encore davantage la vaste étendue de paysages : Le Voyage céleste extatique mêle des séquences en noir et blanc à du texte, L’Année de la comète privilégie des séquences muettes en couleur et Terre rare, à l’exception de la couverture magnifique, réduit la couleur au minimum, à quelques planches quand il s’agit de figurer des motifs minéraux ou charnels. On assiste à la disparition de la présence humaine, puis à celle de la végétation. Il admet que « ce processus est à l’os » et rit de bon cœur quand on lui dit qu’on se fait du souci pour la suite… « Il faudra sans doute que je ré-épaississe tout cela par la suite », s’amuse-t-il. Nulle inquiétude cependant, la sobriété de son approche, adossée à la subtile mise en page de sa compagne, Lysiane Bollenbach et aux sublimes éditions toilées de 2024 font de ces albums des petites merveilles dont on se délecte, image par image. Indéfiniment, avec le sentiment de vivre en phase avec notre temps, que ce soit dans l’expression de nos inquiétudes, mais aussi de nos espoirs les plus rayonnants.
— TERRE RARE, Clément Vuillier, éd. 2024
67
— À l’abri derrière la page, le lecteur peut jouir du spectacle ! —
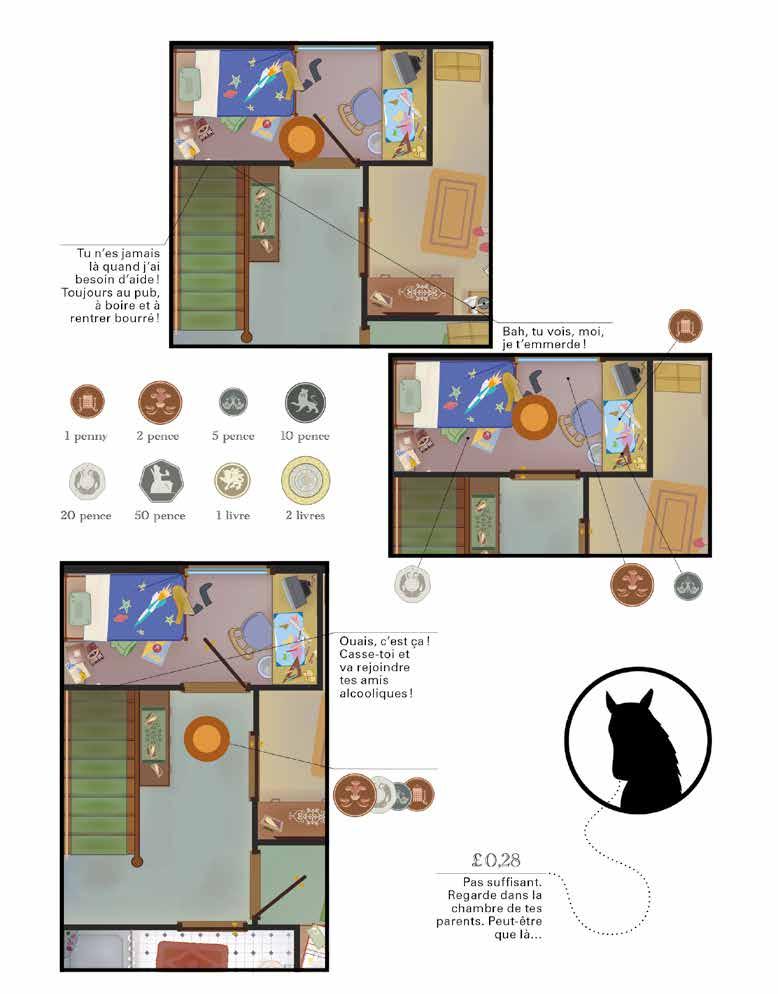
MARTIN PANCHAUD SYMBOLES VIVANTS
Par Benjamin Bottemer
POUR LA COULEUR DES CHOSES, RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX DU MEILLEUR ALBUM À ANGOULÊME, MARTIN PANCHAUD A INVENTÉ SON PROPRE LANGAGE.
L’attribution du Fauve d’or à La couleur des choses consacre cette bande dessinée tournée vers des formes nouvelles, inventives et surprenantes, combinant une audace graphique au talent de conteur de son auteur, le Genevois Martin Panchaud. Ce premier album conte les péripéties de Simon, un gamin anglais qui remporte des millions aux courses ; c’est alors que sa mère se fait agresser et tombe dans le coma tandis que son père disparaît. Simon se lance à sa recherche à travers le pays, croise une voyante, des brutes en tous genres, deux flics peu amènes et un aimable aventurier : un scénario entre récit initiatique et comédie noire loufoque rappelant certains films des frères Coen ou de Guy Ritchie. Mais la patte de l’auteur vient bousculer ces paysages familiers : les personnages sont des jetons colorés, le monde à explorer une succession de cartes et de plans. Pour Martin Panchaud, c’est le résultat d’années passées à accumuler une culture visuelle qui fut longtemps pour lui la seule source dans laquelle puiser.
Comment l’identité graphique de La couleur des choses a-t-elle pris forme ?
C’est un style que j’ai d’abord voulu expérimenter avant de l’utiliser pour un récit complexe ; par exemple avec SWANH.NET, qui adapte Star Wars, ou Royal Ascot, reconstitution d’une célèbre course
hippique [ à retrouver sur www.martinpanchaud.ch, ndlr]. Autant d’univers bien identifiés par le public qui peut ainsi se raccrocher à des références connues. Mon premier souci pour La couleur des choses était de ne pas perdre le lecteur : je voulais lui raconter une histoire qui lui plaise, de façon singulière mais sans être dans la démonstration.
Peut-on dire que ta culture originelle était surtout visuelle ?
Étant dyslexique et dysorthographique, lire a longtemps été impossible pour moi, les mots étaient des énigmes, j’ai donc pivoté vers le langage graphique. Les cartes notamment me passionnaient, j’aimais décoder ces images abstraites qui transmettent des informations mais aussi des émotions, comme dans ces vieilles cartes incomplètes où l’imaginaire voire la poésie avaient leur place.
C’est plus tard que tu as découvert la bande dessinée ?
J’ai été initié par les passionnés que je côtoyais à l’EPAC, une école d’art en Suisse. Je suis un converti, du coup, je pense avoir une approche plus radicale. J’étais convaincu que ce médium ouvrait des possibilités très vastes et voulais trouver mon propre chemin, mon propre langage.
69
Comment as-tu passé le cap entre tes premières compositions et La couleur des choses ?
J’ai fait un plan auquel j’ajoutais des choses au fur et à mesure ; c’était très organique. J’avais aussi en tête une phrase de Tom Clancy : « Écrivez dans l’idée que votre livre pourra être adapté en film. » Ça m’a inspiré ; non pas que j’ambitionnais de vendre La couleur des choses au cinéma… je me disais surtout que c’était avec ce genre de ligne directrice que mon récit allait tenir.
C’est vrai qu’il y a quelque chose de très cinématographique dans ton album, en termes de références mais aussi avec ces dialogues qui « claquent » et qui semblent plus oraux que littéraires.
J’ai toujours admiré les dialoguistes qui savent imaginer des répliques inattendues ; c’est très jouissif à faire. J’ai ingurgité beaucoup de cinéma dans ma jeunesse, ainsi que des livres audio qui m’ont permis de rattraper un peu mon retard : c’est donc à travers la parole, l’écoute et les mots « dits » que je me suis autorisé à écrire.
Tu fais cohabiter différentes formes : schémas, notices, icônes, cartes marines… pour éviter une forme de monotonie ?

Faire avancer l’histoire et surprendre passe aussi bien par les dialogues que par l’intrigue ou le graphisme. Celui-ci doit s’adapter aux situations : raconter un rêve érotique avec une carte, c’est un peu froid… Il fallait toujours inventer de nouveaux moyens de raconter l’histoire.

Au-delà du graphisme, tu as aussi créé des personnages attachants bien que représentés sous une forme abstraite, au sein d’une aventure drôle, rythmée mais aussi émouvante.
J’ai imaginé une biographie complète et une psychologie pour chaque personnage, leur place, leurs actions devenaient évidentes au moment de construire le récit. Il faut que l’on puisse y croire, il faut les aimer, sinon cela ne fonctionne pas.
70
— LA COULEUR DES CHOSES, Martin Panchaud, éd. ça et là
Alvéoles artistiques
Singulièrement bourdonnantes, les expositions de ce début d’année. Au Centre Pompidou-Metz, l’obsession s’essaime à l’envi, à la fondation Beyeler, l’œuvre de Wayne Thiebaud exhibe les couches contrefaites d’une société du paraître, à la Kunsthalle de Mulhouse, Anne Marie Maes dissèque le vivant, et au Frac FrancheComté, Marina De Caro enjoint à la désobéissance collective – féminine !
DO IT AGAIN
Par Benjamin Bottemer
VERTIGES ET OBSESSIONS DE LA RÉPÉTITION AU CENTRE POMPIDOU-METZ.
parisienne, qui alimentent la majeure partie de l’exposition. Celui-ci a souhaité nous placer dans l’état d’esprit qu’il a lui-même adopté dans les réserves du Musée national d’art moderne : explorer librement, trouver les correspondances et les échos au gré des découvertes. Pas de fil conducteur chronologique ici, juste une douzaine de brèves sections (« multiplier », « diviser », « arpenter », « persister », « accumuler », « compter »…) pouvant se parcourir de manière multidirectionnelle. Passage obligé tout de même devant le tableau qui nous accueille dès l’entrée : La Répétition de Marie Laurencin, une rareté au musée ; car déconsidérée. Elle donne néanmoins son nom et son image à l’exposition et à son affiche, un choix inattendu pour un événement qui expose Kupka, Annette Messager, Picasso, Matisse, Warhol, Hantaï... mais aussi une clé pour y pénétrer : le redoublement y est à la fois sujet (reprenant Les Demoiselles d’Avignon de Picasso) et méthode, avec ces cinq jeunes femmes aux visages identiques.
Face aux injonctions permanentes à l’originalité et à l’innovation, présentes dans le monde de l’art comme dans quasiment toutes les pratiques humaines de notre époque, préférer la tentative, l’obsession, le redoublement : c’est un peu le credo de « La Répétition », sixième exposition dite « phare » du Centre Pompidou-Metz. C’est Éric de Chassey, directeur de l’Institut national d’histoire de l’art, qui a cette fois-ci été invité à plonger dans les collections de la maison-mère
Pourquoi répéter ? Les motivations sont aussi diverses que les courants dans lesquels s’inscrivent les œuvres présentées. František Kupka veut saisir la décomposition du mouvement du corps à l’ère de la photographie (Femme coupant des fleurs) tandis que François Morellet prend plaisir à répliquer en grand format ses abstractions inspirées des tapas océaniens, un demi-siècle après leur création (Quand j’étais petit je ne faisais pas grand). Quant à Eugène Leroy, il s’immerge pendant seize ans dans la réalisation du portrait de son épouse, accumulant les couches de peinture pour faire de sa Valentine le soir une compression de matière et de couleurs. Certains font aussi le choix de l’ascèse, comme Barnett Newman, qui de 1949 à sa mort utilisa une forme unique, baptisée « zip » qu’il multiplie à l’infini avec d’infimes différences. Un parti pris mais aussi une vision qui ont quelque chose de vertigineux, comme lorsque l’on plonge dans les carrés de Josef Albers, emboîtements concentriques soumis à des variations chromatiques baptisés
 Josef Albers, Affectionate (Homage to the Square) [Affectueux (Hommage au carré)], 1954, huile sur isorel, 81 x 81 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne
Copyright : © The Josef and Anni Albers Foundation / Adagp, Paris 2022
Josef Albers, Affectionate (Homage to the Square) [Affectueux (Hommage au carré)], 1954, huile sur isorel, 81 x 81 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne
Copyright : © The Josef and Anni Albers Foundation / Adagp, Paris 2022
72
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP
Hommages au carré. De véritables célébrations de la forme géométrique déclinée également par Vera Molnár, qui décompose et réassemble un couple de carrés en des agencements inédits, ou encore par Olivier Mosset et ses six carrés d’apparence identique, mais révélant chacun les irrégularités du passage du pinceau.
Privilégié, Simon Hantaï se voit consacrer toute une partie de la galerie, où cinq de ses œuvres s’observent. Au tournant des années 1960, il adopte une peinture entièrement née de la répétition de gestes : Écriture rose comprend le recopiage ininterrompu de la liturgie du jour ; Mariale m.a.3 illustre sa technique du « pliage comme méthode » sur des toiles pliées, badigeonnées puis dépliées ; Sex Prime, exécutée « un après-midi de fascinations érotiques » rappelle que l’on parle souvent d’abstraction par commodité, en oubliant le corps. Celui-ci est ici omniprésent, soit en filigrane, soit dans le geste et/ou comme objet, depuis le tableau de Marie Laurencin. Les renflements presque organiques sur la toile de Takesada Matsutani,

les marcheurs désœuvrés de Djamel Tatah à côté desquels on piétonne, les performances vidéo de Marina Abramović et Brune Neumann encapsulant leurs mouvements compulsifs… et que dire des Poils de dessous de bras géants de Rosemarie Castoro, sans oublier les magnétiques épreuves photographiques de Mary Kelly, dénonciations des préjugés envers les femmes et d’un certain idéal féminin. L’acte de répétition traverse les époques, les pratiques et les courants artistiques qui euxmêmes s’influencent et se répondent : c’est l’un des messages d’une exposition qui nous invite à reconsidérer la notion d’avant-gardes supposément parties de zéro. Et surtout, à se construire sa propre expérience au fil des visites (l’exposition est visible jusqu’en 2025) pour mieux voir et revoir La Répétition.
— LA RÉPÉTITION, exposition jusqu’au 27 janvier 2025 au Centre Pompidou-Metz, à Metz www.centrepompidou-metz.fr
–
73
Arman, Miaudulation de fritance, 1962, accumulation de lampes de radio et polyester dans une boîte sous plexiglas, 123,3 × 163,5 × 8 cm Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne
Copyright : © Adagp, Paris, 2022 - Photo : © Service de la documentation photographique du MNAM Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP
WAYNE THIEBAUD SUCRE AMER
PEINTRE DES PLAISIRS DÉVITALISÉS ET DU SPIRITUEL ÉVAPORÉ, WAYNE THIEBAUD FAIT L’OBJET D’UNE GRANDE RÉTROSPECTIVE À LA FONDATION BEYELER. SON ŒUVRE INTERROGE AVEC MALICE CE DILEMME
PROFONDÉMENT MODERNE DE L’ÊTRE ET DU PARAÎTRE.

Pie Rows
74
Par Nicolas Bézard
, 1961
«
Les tableaux d’Edward Hopper semblent nous dire que les choses ordinaires de la vie quotidienne sont habitées par une force particulière. Il faut seulement les regarder assez longtemps pour les voir. » Ces mots de l’architecte Peter Zumthor – dont on attend impatiemment de découvrir le projet d’extension de la fondation Beyeler – pourraient s’appliquer à merveille aux œuvres de Wayne Thiebaud. Né 38 ans après l’auteur de Nighthawks, Thiebaud est beaucoup moins connu en Europe que son illustre compatriote, mais après tout, il a fallu attendre les années 1980 et les premières expositions d’envergure consacrées à Hopper pour que les images de ce dernier deviennent métaphores d’une vision rêvée de l’Amérique. On découvre donc l’art de Wayne Thiebaud avec un enthousiasme mêlé de stupéfaction, tant il paraît évident que l’on tient là un protagoniste majeur de la peinture figurative américaine du xx e siècle, au même titre que Georgia O’Keeffe et que Hopper donc, deux artistes mis à l’honneur ces dernières saisons à Riehen.
Hopper excellait à dépeindre les scènes d’intérieur, regardées sous un angle voyeuriste à travers des lucarnes, fenêtres et autres vitrines de bars ou d’échoppes. À sa façon, l’œil de Thiebaud prolonge cette cartographie de l’espace domestique américain. Dans un mouvement cinématographique de zoom avant, il traverse la vitre et resserre le cadre sur les produits disposés sur les présentoirs, les tables garnies de friandises ou sur les clients en train de consommer. Chez Thiebaud, les promesses de l’American Way of Life prennent la forme de généreux cornets de glace, de pâtisseries onctueuses et multicolores, et plus largement de tout ce qui est susceptible, dans cette société puritaine et prospère de l’après-guerre, de procurer du plaisir immédiat et bon marché : machines à sous, distributeurs de bubble-gum, accessoires de mode ou de maquillage, etc.
Portée par une scénographie intelligente et épurée, l’exposition reconstruit le cheminement d’un artiste qui va peu à peu délaisser le motif isolé, cadré en plan serré, pour élargir son champ de vision et proposer une interprétation très personnelle du paysage états-unien. Car Thiebaud ne peint pas des paysages fluviaux baignés de silence, des montagnes placides ou des mégapoles étincelantes de lumière sans y glisser quelques tensions, dissonances, vertiges, et la sensation qu’un drame – inondation, chute ou sortie de route accidentelle – pourrait s’y jouer. Avec une pointe d’humour et beaucoup d’acuité, Thiebaud gratte la surface d’un monde en apparence accueillant mais finalement inhabitable – à l’image de ces villes à la topographie délirante, hérissées de rues en pentes raides. Il en montre la vaine prodigalité, et saisit ce moment de bascule civilisationnelle où le besoin de jouissance se mue en écœurement. Là encore, la contiguïté avec l’art faussement calme de Hopper est manifeste, les deux peintres entremêlant dans
leurs univers respectifs le doux et l’inquiet, des sentiments qui affleurent notamment en présence des portraits de femmes pensives et statuesques, marquant le désintérêt de Thiebaud pour la figure humaine en action, au profit de celle qui est, ditil, « sur le point de faire quelque chose, ou qui a fait quelque chose, ou qui ne fait rien ».
Mais à la question cruciale : que peindre lorsqu’on est un artiste américain du xxe siècle ?, Thiebaud apporte une réponse plus tranchée que son aîné : la peinture elle-même. Par la peinture, entendons ici la couleur, la matière, la substance épaisse, appliquée sur la toile comme on étalerait un glaçage ou de la crème sur un gâteau. Constitués de multiples fragments colorés réalisés à l’empâtement, auréolés de contours iridescents, les objets et figures semblent littéralement sortir du champ de la toile et projeter sur nous leur physicalité puissante, impossible à reproduire sur un écran ou sur les pages d’un magazine. S’il représente ses motifs ou modèles avec réalisme et force détails, Thiebaud réduit les arrière-plans à des fonds neutres exempts de profondeur. Espace et plan, figuration et abstraction se fondent au sein d’une seule et même image, témoignant de la dissolution des machines, des denrées ou des figures sujettes au dépérissement dans le grand vide métaphysique qui travaille à les absorber.
— WAYNE THIEBAUD, exposition jusqu’au 21 mai à la fondation Beyeler, à Riehen, Bâle fondationbeyeler.ch

75
Girl with Pink Hat, 1973
ÉLIXIR DE VIE MICROSCOPIQUE
Par Maïta Stébé
AVEC « ALCHIMIA NOVA », ANNE MARIE MAES INVESTIT
LA KUNSTHALLE DE MULHOUSE EN LA TRANSFORMANT EN LABORATOIRE ARTISTIQUE DU VIVANT.
Quand la nature qui nous entoure se porte bien, elle vit en symbiose : les espèces coexistent et s’associent à d’autres pour s’aider mutuellement. Les écosystèmes forment des équilibres complexes connectés de toutes parts. Cette complémentarité se retrouve symboliquement dans les œuvres de l’artiste bruxelloise. Sa recherche sur les êtres vivants est globale, construite par des échos réciproques entre ses créations. Les formes de vie en communauté ont une place de choix dans son travail, qu’elles soient abeilles ou bactéries. Anne Marie Maes les observe, de façon contemplative ou plus méthodique, pour mieux les traduire en formes plastiques. L’exemple des peaux sensorielles, qui composent nombre des pièces visibles dans l’espace, est représentatif de cet intérêt. Cette appellation poétique désigne de fines membranes issues de la culture combinée de bactéries et de levures. Dans l’exposition, ce processus est en cours dans des aquariums remplis de thé (sucré, s’il vous plaît) où les micro-organismes perfectionnent leur construction chaque jour qui passe. Après leur séchage, ces pellicules microbiennes prennent l’aspect et la texture du cuir. On les retrouve moulées, cousues ou tissées sur le large mur qui met en scène une multitude de petits ouvrages, à la manière d’un cabinet de curiosités. Mais, c’est surtout avec l’aide de la lumière que leur matière révèle ses motifs et ses couleurs. Dans ce camaïeu, l’ocre domine. En livrant ses œuvres au public mais aussi la culture de leur matière première, Anne Marie Maes témoigne d’une transparence dans la chaîne de production.
 Pantone Alsace: Reading the Landscape, 2023
Pantone Alsace: Reading the Landscape, 2023
76
© La Kunsthalle Mulhouse. Photo : Jean-Jacques Delattre
En termes de couleurs, l’accrochage fait aussi la part belle à des teintes qui demeurent terreuses bien que plus végétales. Invitée pour une résidence de recherche, l’artiste a pu appliquer ses procédés de teinture textile en usant de matériaux locaux. Des racines, feuilles ou fleurs récoltées dans la région ont permis de teindre les carrés de tissu de Pantone Alsace. L’écho au territoire mulhousien et à son histoire industrielle textile est double dans ce cas. Comme les êtres minuscules avec lesquels elle travaille, Anne Marie Maes tisse des liens avec son environnement proche. Le rapport au sol est visuellement explicite dans ces tranches de terre humides que sont les colonnes de Winogradsky Ce protocole est emprunté aux biologistes qui l’utilisent pour cultiver la vie micro-organique contenue dans une portion prélevée de terre. Plus les semaines passent, plus l’échantillon se sépare en différentes strates et voit se développer des colonies de microbes ou d’algues. Là encore, l’œuvre évolue avec l’influence du temps sans que son issue ne soit tout à fait sûre.
L’alchimie annoncée dans le titre de l’exposition s’explique par la perpétuelle transformation des éléments que mène Anne Marie Maes. Pourtant, nul désir de sa part de découvrir la recette de l’or. L’artiste se réfère à l’imaginaire de cette discipline mystico-scientifique car, comme pour elle, l’expérimentation y est primordiale. Sa démarche est hybride, entre la rigueur de protocoles savants et la surprise issue de formes apparues par ellesmêmes. Les œuvres finies sont autant mises en valeur que les procédés à leur origine. Les principes de culture, de fermentation ou de décantation à l’origine des pièces se comprennent comme une analogie de la recherche artistique. Un travail fait d’attente, parfois de hasards mais aussi de collaborations.
— ALCHIMIA
NOVA
- ANNE MARIE MAES, exposition jusqu’au 30 avril à la Kunsthalle, à Mulhouse kunsthallemulhouse.com

77
Sensorial Skins, 2017 © La Kunsthalle Mulhouse. Photo : Jean-Jacques Delattre
RÉVOLUTION CHROMATIQUE
Par Nathanaelle Viaux
« La couleur, c’est la culture, l’expérience de chaque culture, la couleur, c’est l’expérience. » Celle-là même qui prolonge la réflexion féministe de l’artiste Marina De Caro autour de la désobéissance et de la notion du collectif. L’exposition « Chromotopie de la désobéissance - Esquisse d’un opéra épistolaire » existe grâce à la rencontre de deux femmes, Marina De Caro, plasticienne qui vit à Buenos Aires et Sylvie Zavatta, directrice du FRAC Franche-Comté. C’est grâce à l’enthousiasme de l’institution que l’artiste engagée a pu créer en toute liberté cette œuvre transdisciplinaire.

Des voix de femmes qui parlent ou qui chantent, un échange épistolaire fictif entre des féministes françaises et argentines. De la musique qui agite le corps timide du public, qui pénètre directement dans une ébauche d’opéra. Il exalte, dans cette exposition symphonique, le doux parfum d’une révolution. Le public est d’emblée conquis par ce monde chromatique et politique, cet univers où les couleurs prennent une dimension collective et affective. Marina De Caro déclare que la couleur a un comportement, elle a une identité et n’est pas figée. La couleur peut être métaphore, elle peut aussi être politique. L’artiste travaille avec et en fonction de la réalité. Il en découle une œuvre magistrale, l’esquisse d’un opéra bilingue et coloré mis en musique par le compositeur argentin Axel Krygier. Cette œuvre est un cri chromatique de femmes, l’expérience d’un art vivant.
— MARINA DE CARO, CHROMOTOPIE DE LA DÉSOBÉISSANCE, ESQUISSE D’UN OPÉRA ÉPISTOLAIRE, exposition jusqu’au 14 mai au FRAC Franche-Comté, à Besançon www.frac-franche-comte.fr
78
Vue de l’exposition Marina De Caro, Chromotopie de la désobéissance – Esquisse d’un opéra épistolaire FRAC Franche-Comté, 2022 © Marina De Caro. Photo : Nicolas Waltefaugle
i ns - i t u
Dominique Gonzalez-Foerster, Endodrome
Les couleurs se mélangent et fusionnent avec la légèreté d’une encre diluée dans l’eau. En plongeant dans la réalité virtuelle d’Endodrome, on entre dans une transe colorée, en pleine conscience. L’artiste française Dominique Gonzalez-Foerster a imaginé une œuvre en forme de voyage intérieur, aux délinéations intuitives et organiques. Un trip technologique de haut vol, accompagné d’un soundscape intrigant signé par la musicienne et compositrice Corine Sombrun. (M.M.S.)

Jusqu’au 16 avril
Au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, à Luxembourg ville www.casino-luxembourg.lu
in situ
80
Vue de l’exposition Dominique Gonzalez-Foerster – Endodrome – Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain. © Photo : Lynn Theisen
Pippa Garner, Adelhyd van Bender, Claire Pentecost
C’est beau comme la rencontre fortuite d’un escarpin doré et d’un patin à roulettes. Et en collants résille s’il vous plaît ! Avec Heels on Wheels, œuvre photographique au croisement entre sexytude et sport de glisse, Pippa Garner fait preuve de sa légendaire ironie. Comme lorsqu’elle écrit Joy sur une poubelle ou qu’elle taille un crop top dans un costume, la plasticienne prend un malin plaisir à dézinguer les faux-semblants de l’Amérique des années 1970. Au FRAC Lorraine, Pippa Garner cohabite avec le travail des artistes Adelhyd van Bender et Claire Pentecost. Un triplé qui prend l’art conceptuel à rebrousse-poil, pour mieux penser les rapports entre le corps et son environnement. (M.M.S.)

Jusqu’au 20 août
Au 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine, à Metz www.fraclorraine.org
in situ
Pippa Garner, Heels on Wheels, courtoisie de l’artiste et STARS Galler
81
Magali Reus, Le Plat Principal
Entrée ou dessert ? À la synagogue de Delme, la plasticienne néerlandaise Magali Reus a choisi d’en faire tout un plat. Adepte d’un travail sculptural inspiré du ready-made et frôlant le surréalisme, l’artiste continue à perturber les habitudes du regard avec une proposition pour le moins originale. Pour « Le Plat Principal », elle a concocté un corpus d’œuvres directement inspiré par les environs du village. Loin de l’esthétique idéalisée du cottagecore, Reus prend l’esthétique rurale à bras-le-corps et s’empare de thématiques telles que la culture intensive, l’impact de l’agro-technologie et des hybridations végétales. (M.M.S.)
Du 11 mars au 4 juin À la synagogue de Delme, à Delme www.cac-synagoguedelme.org

in situ
Magali Reus, Candlesticks. Courtoisie de l’artiste, The Approach, London ; Fons Welters, Amsterdam et Galerie Greta Meert, Bruxelles. © Photo : Michal Brzezinski
82
Clair-Obscur. FAITH XLVII
« Une recherche sur l’ombre et la lumière. À propos de la nature. À propos de notre comportement. Le conscient et le subconscient. La connexion et la dissonance. Le monde intérieur et le monde extérieur. La créativité et la réceptivité. Son et silence. » C’est avec ces mots que l’artiste sud-africaine FAITH XLVII présente « ClairObscur », expo installée au Musée des Beaux-Arts de Nancy dans le cadre de RUN 23. Une quarantaine d’œuvres – dessins, tapisseries, polaroids, vidéos –qui interrogent l’ambivalence de l’Homme et du monde. (A.V.)

Du 9 avril au 17 septembre
Au Musée des Beaux-Arts de Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr
in situ CHAOS THEORY XXI © FAITH XLVII
83
Anne Laure Sacriste, Le Monde sans les mots

Il y a quelque chose de l’Italie des primitifs, dans ces corps à l’élégance humble. Il y a aussi un petit twist du côté du Japon, avec ce titre, « Le Monde sans les mots », emprunté au poète nippon Tamura Ryūichi. C’est au carrefour de ces influences qu’Anne Laure Sacriste revient sur le mythe des origines, en quête d’un paradis perdu nourri de nombreuses références à l’histoire de l’art. Au CEAAC, toiles peintes au cadrage singulier et sculptures en cuivre se dédoublent et se répètent, entre abstraction et figuration. (M.M.S.)
Du 1er avril au 3 septembre Au CEAAC, à Strasbourg
www.ceaac.org
in situ
84
Anne Laure Sacriste, Sans titre, acrylique sur bois, 22 x 27 cm © ADAGP, Paris, 2023
Les interstices
Mince espace qui sépare deux éléments, petit intervalle d’espace et de temps, l’interstice est ce qui se faufile dans l’entre-deux des choses. C’est cet entre-deuxmondes que Frédéric Stucin a voulu approcher lorsqu’il a posé son objectif à la P’tite Cafète, accolée au pôle psychiatrique de l’hôpital de Niort. Dans cet endroit à la lisière entre l’hôpital et le monde, le photographe, immergé dans le « temps long de la psychiatrie », a laissé les patients être scénaristes de leur propre image. En résulte une émouvante galerie de portraits qui se donnent à raconter avec une intensité saisissante. (M.M.S.)

Jusqu’au 15 avril
À Stimultania, à Strasbourg www.stimultania.org
in situ
85
© Frédéric Stucin
Chères Hantises
En s’adressant à nos hantises, les élèves du master Critique-Essais de l’Université de Strasbourg font cas de nos obsessions et chatouillent nos perceptions. Devenus curateurs, ils ont réuni une sélection d’œuvres issues des collections des trois FRAC du Grand Est. Parmi les 19 artistes convoqués, on se réjouit de retrouver Capucine Vandebrouck et ses sculptures molles aux reflets holographiques ou le travail cinématographique de la Colmarienne Mali Arun. Notons aussi la présence de Clément Cogitore, d’Edith Dekyndt ou de Nicolas Boulard. Une exposition qui glisse du côté de nos images mentales, dans le fascinant tourbillon de nos projections. (M.M.S.)
Du 25 mars au 4 juin Au FRAC Alsace, à Sélestat www.frac.culture-alsace.org

in situ
Nicolas BOULARD, extrait de Diagonale, 2005, Vidéo, 7'04 © ADAGP, Paris, 2023
86
Ateliers Ouverts 2023
Qui n’a jamais rêvé de pénétrer dans l’antre d’un artiste ? D’accéder à l’antichambre de la création, et de percer les mystères de l’art en train de se faire ? Pour sa 14e édition, Ateliers Ouverts propose d’aller à la rencontre des artistes du territoire, d’Altkirch à Lauterbourg. Du labo intimiste à la grange reconvertie en chantier collectif jusqu’au méga atelier ayant fait son nid dans une friche industrielle, chaque lieu de création porte en lui un petit secret. D’un univers à l’autre, dressez votre propre cartographie des talents contemporains au fil des 138 ateliers représentés cette année. (M.M.S.)
Les 13 et 14, et 20 et 21 mai Dans toute l’Alsace www.ateliers-ouverts.net

in situ
87
Atelier Fanny Buecher Bastion 14 Strasbourg © Alex Flores - Ateliers Ouverts 2022
Biennale Mulhouse 023
La Biennale Mulhouse 2023 fait son retour dans le paysage artistique alsacien ! Elle installera ses cimaises entre les emblématiques murs de brique de Motoco et fera battre le cœur de Mulhouse au rythme de l’art contemporain à l’occasion d’un programme Off dans toute la ville. Cette édition convoque l’énergie et le talent de 45 jeunes artistes européens, dans une scénographie signée par le collectif 2920g et sous la houlette d’un jury international composé notamment de la critique d’art et curatrice Coline Davenne et du directeur artistique du Casino du Luxembourg, Kevin Muhlen ! (M.M.S.)

Du 10 au 13 juin (vernissage le 10 juin à 18 h)
À Motoco, à Mulhouse www.mulhouse.fr - www.motoco.fr
in situ
88
© Motoco
À bruit secret. L’audition dans l’art
Entendre la mer, dessiner la musique, laisser peser le silence ou écouter avec les yeux… Voici quelques-unes des propositions formulées par « À bruit secret. L’audition dans l’art ». À travers une riche sélection d’œuvres majoritairement contemporaines, elle nous prouve que les arts visuels n’ont pas l’apanage de l’œil. On se réjouit de retrouver le mystérieux Ready-made de Marcel Duchamp qui donne son nom à l’exposition, le brouhaha futuriste de Filippo Tommaso Marinetti ou l’iconique Oracle, installation sonore de Robert Rauschenberg présentée pour la première fois en Suisse. Une exposition à parcourir haut et fort. (M.M.S.)
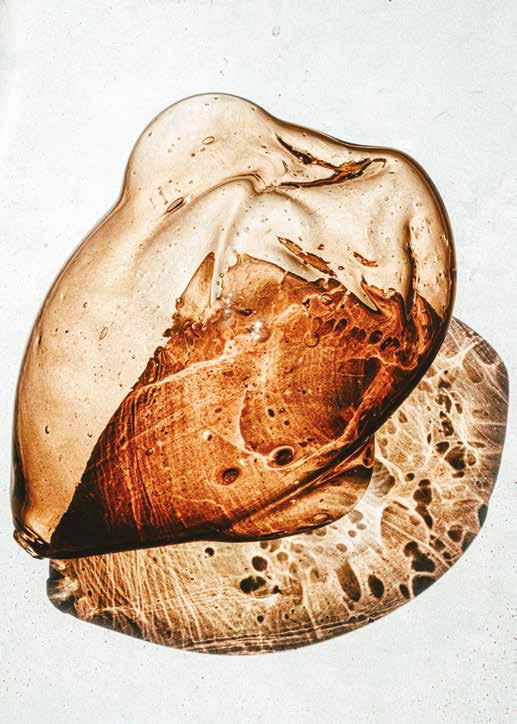
Jusqu’au 14 mai
Au musée Tinguely, à Bâle www.tinguely.ch
in situ
Dominique Koch (en collaboration avec Tobias Koch), Sound Fossil © Dominique Koch & Tobias Koch. Photo : © Jelena Luise
89
Suzanne Husky, La Parabole du Bièvre Ju Hyun Lee, Pas de cerise sans noyau
Ce printemps, Crac Le 19 propose deux expositions qui s’attachent au vivant. Du noyau de cerise au castor, l’une se penche sur le savoir-faire agricole d’un terroir et l’autre sur une espèce sauvage. Fascinée par les peuples des marécages, Suzanne Husky offre un travail hybride sur le castor, indispensable à l’écosystème de nos zones humides. En plus d’une belle série d’aquarelles, la plasticienne présente un film passionnant tourné avec la naturaliste Patti Smith, grande amie de ces mammifères. À l’étage, Ju Hyun Lee s’attache au cycle de la cerise et à l’importance de son noyau dans la production du kirsch de Fougerolles. (M.M.S.)

Jusqu’au 30 avril
Au Crac Le 19 - Centre régional d’art contemporain, à Montbéliard www.le19crac.com
in situ
90
© Suzanne Husky, Le son d’une nouvelle cascade
Sélection française : Partie II
Envie de se prendre une petite tranche d’histoire de l’art contemporain ? Avec « Sélection française : Partie II », Le Consortium se concentre sur la scène artistique de l’Hexagone depuis les sixties jusqu’aux années 1990. L’Op Art vibrant de Vasarely, les monochromes perturbés d’IFP ou les installations mémorielles de Christian Boltanski font partie des jalons de ce parcours qui fait deviser chefsd’œuvre et créations manifestes tout en remontant divers courants artistiques. Une plongée exhaustive dans les collections du Consortium Museum qui se prolonge au Musée des Beaux-arts de Dijon, avec un prêt de deux œuvres. (M.M.S.)

Jusqu’au 11 juin
Au Consortium, à Dijon www.leconsortium.fr
in situ
91
Information Fiction Publicité (IFP), Grande Surface, III, 1987. Collection Consortium Museum. Photo : Rebecca Fanuele © Consortium Museum
FEUILLE DE ROUTES
Février 1998, je me rends une première fois aux îles d’Aran, à l’extrême ouest de l’Irlande. C’est l’année de la disparition de Nicolas Bouvier, l’auteur culte de L’Usage du monde (1963). Son Journal d’Aran et d’autres lieux (1990) dont le personnage principal « est le vent » me servira de guide, spirituel. Sur ces vastes plateaux de roc « trempés dans l’océan » qui sont comme d’immenses ardoises couvertes d’inscriptions, je fais l’expérience physique d’appréhender le Paysage comme un Texte. Les îles d’Aran, en effet, sont déjà (d)écrites : John Millington Synge, Liam O’Flaherty ou James Joyce y ont laissé leurs montjoies de mots, comme autant de chevaux de frise. Les énigmatiques ringforts de l’âge de fer et ces kilomètres de murets de pierres sèches qui tatouent les îles sont comme les blocs d’immenses paragraphes... À Aranmore, ainsi que l’écrivait Jean-Claude Lemagny – à propos, je crois, d’une photographie de Bernard Plossu –, « le Caillou humilie le concept ».


 Par Nicolas Comment
Autoportrait dans le vent, Inishmore, Aran, 1998
Par Nicolas Comment
Autoportrait dans le vent, Inishmore, Aran, 1998
92
Aérodrome d’Inishmore (Inis Mór)
ÉTAPE 1 : ARAN ISLANDS

PHOTOGRAPHE-ÉCRIVAIN ET AUTEUR-COMPOSITEUR, NICOLAS COMMENT NOUS OUVRE SES ARCHIVES, PLANCHES CONTACT ET CARNETS DE VOYAGES.

93







Terre sans terre Molaire du Monde Vaste pourtant Pourtant réduite Au strict Aran Haïku, 1999
94
The White Horse / Le cheval blanc (traditionnel) d’après John Millington Synge, The Aran Islands (1907)
J’y retourne peu avant le passage à l’an 2000. Toujours en hiver. Ces « paysages de peu » qui m’apparaissent naturellement en noir et blanc sont envahis l’été par des hordes de touristes anglo-saxons vêtus de tenues sportswear fluo et de sacs à dos bigarrés… Longtemps refuge de la culture gaélique, les îles échappèrent à l’invasion romaine mais pas à la domination anglaise. Jusqu’aux années 1970, les tempêtes violentes et l’inaccessibilité des lieux permirent néanmoins aux Aranais de protéger des coutumes que Robert Flaherty fictionnalisera dans son célèbre film documentaire L’Homme d’Aran (1934). La musique traditionnelle des îles – l’Irish Gaelic –est audible dans le disque Songs of Aran (1957), mais j’écoute surtout sur place le folk moderne d’Astral Weeks (1968) et du Saint Dominic’s Preview (1972) de Van Morrison.






 Gort Na gCapall, Kilmurvy Fort Aengus
Gort Na gCapall, Kilmurvy Fort Aengus
95
Inisheer (Inis Oírr) Na Seacht dTeampaill




 Ci-dessous : Poll na bPéist – The Wormhole (Le Trou de ver), Inishmore, Aran
Ci-dessous : Poll na bPéist – The Wormhole (Le Trou de ver), Inishmore, Aran
96
à gauche : Route du Connemara, 1998
« L’Homme a pu voir que l’Irlande ne l’avait pas trahi. Dieu est tout mais tout n’est pas Dieu. Cette parole qu’un Français ne comprend plus était à l’origine d’un droit qu’avaient les anciens Rois hautains de l’Irlande de régner en dédaignant de gouverner. Cette parole, les Rois Anglais l’ont trahie. » Antonin Artaud, phrase écrite au verso d’une lettre adressée à Anne Manson, Galway, 1937.

On raconte qu’en 1937, sur les traces de John Millington Synge et dans les pas de Robert Flaherty, Antonin Artaud visita « l’île aux Saints » pour tenter d’entrer en contact avec l’outre-monde de l’antique civilisation celte. À Kilronan, l’acteur échevelé aurait promené la canne de saint Patrick, tel un miroir « le long de la grande route » (Stendhal). Cette canne qui lui venait « directement de Jésus Christ », en effet, c’est tout un roman : elle possédait treize nœuds et portait au neuvième le signe magique de la foudre ; « 200 millions de fibres, et elle est incrustée de signes magiques, représentant des forces morales et une symbolique anténatale » (A.A.). Mais qu’arriva-t-il vraiment à Artaud le Mômo et à la canne sur Inishmore ? De retour à Galway, Imperial Hotel, sur Eyre Square, il adressera le 5 septembre 1937, aux bons soins d’André Breton, une (très) méchante lettre-sort destinée à Lise Deharme. Artaud y annonçait un grand malheur… C’était en fait le sien qui l’attendait au Havre après la traversée du channel qui ramena (de force) le poète halluciné vers la réalité de l’hospice de Sotteville-lès-Rouen. Entretemps, la canne de saint Patrick fut égarée. Peut-être se trouve-t-elle quelque part encore sur les îles d’Aran ? Qui Sait ?




 Homme d’Aran, Inishmaan (Inis Meáin)
The Seven Churches (Na Seacht dTeampaill)
Kilronan
Homme d’Aran, Inishmaan (Inis Meáin)
The Seven Churches (Na Seacht dTeampaill)
Kilronan
97
Cottage
LE SOIR, ON FAIT LA CUILLÈRE

GENEVIÈVE CHARRAS ET ROBERT BECKER
Geneviève Charras et Robert Becker sont restés des enfants complices.
En arrivant devant leur immeuble de la Krutenau, je croise par hasard Robert qui rentre des courses, il sonne chez lui. « C’est le père Noël ». Le couple pousse la facétie jusqu’à vivre au-dessus – au 5e –d’un vendeur de semelles orthopédiques.
Geneviève est balafrée. Elle est tombée hier soir en allant voir le film Corsage au cinéma Star. Mais ce n’est pas très grave, car elle a pu danser un slow avec Orlan au 104 la semaine dernière.
Robert nous sert un échantillon de Noël alsacien, café, lebkuchen, et des biscuits à l’anis. Geneviève nous dit tout, malgré ses pieds plats, elle a toujours fait de la danse. En bonne historienne, elle parle du respect des règles de déplacement, du rapport à l’espace et au temps, avec un mélange de sens artistique et d’exaltation physique. Elle a commencé à Paris – « J’ai le mollet de Montmartre » –avec Jacqueline Robinson, la pionnière de la danse contemporaine. Son amour de la danse va jusqu’à comparer Bruno Chibane à Diaghilev : « Il donne des coups de pied pour sortir les potentiels. »
Elle arrive à Strasbourg à 22 ans ; s’ensuit un marivaudage avec Robert, apprenti réalisateur : « J’ai fait l’orchestre d’accueil au camp du Struthof pour Lelouch ». Robert était aussi prof de lettres dans un pensionnat pour jeunes filles où il passait son temps à faire du ski à Gstaad.
Saint Augustin
« Il est venu chez moi avec des fraises, de la crème et des pantoufles. » En 87, ils s’installent à la Krutenau. Ils se marient en 93. Il y avait 120 personnages à Dalhunden, pour une grande fête autour de l’étang de pêche. Geneviève portait du noir, un costume
— Apprends à danser, sinon les anges au ciel ne sauront quoi faire de toi. —
98
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoît Linder
de diable, pour ressembler à une carte de tarot. Ils partent en voyage de noces en Chine. Elle pensait que le mariage entraînerait l’enfant. Au lieu de ça, une belle collection de cartes postales représentant des cigognes et des bébés de toutes les époques. Elle a gardé son côté fleur bleue et enfantin même si la danse macabre la tarabuste. Geneviève a eu la chance de faire la jongleuse pour le réalisateur baroque Peter Greenaway.
Fascinée par le judaïsme : « Tu me mets dans un cimetière juif, je jubile », par les histoires, les motifs de Christian Lacroix, Geneviève garde les petits objets trouvés dans la rue et les sacs krafts de boulangers. Robert me montre la première œuvre d’art de sa collection, un escargot sous verre. « Il faut accepter la perte, tout se casse, se brise. Les assiettes de Françoise Pétrovitch se sont cassées suite aux vibrations des travaux dans la rue. »
« Si la maison brûle, je ne garde qu’un objet, c’est ce livre, le Ballet en France du quinzième siècle à nos jours », nous dit Geneviève.
Robert, lui, est plus fasciné par les alexandrins et Marguerite Duras, notamment Le Ravissement de Lol V. Stein. Il fait la lecture à Geneviève, lors de leurs voyages. Ils ont quelques rituels comme l’œuf mayonnaise, le coucher de soleil au Dabo, les hôtels ringards, s’endormir en cuillère. Dans leur chambre, 400 Barbie sont cachées et le lit n’a pas d’oreillers. Robert et Geneviève, c’est le mariage de la danse et des fleurs. Puis, la fleur s’est transformée en banane.
lafleurdudimanche.blogspot.com

99
UNE HISTOIRE DE FLEURS ET D’ARMÉE
Par Myriam Mechita

Je suis assise dans un café à Prenzlauer Berg, Berlin, et je relis mon précédent texte pour ce même magazine, et j’ai à nouveau les larmes qui me brûlent les yeux.
Je vous préviens de suite… J’ai l’âme révoltée ces derniers jours, mon humeur blagueuse reviendra avec le printemps très certainement.
Pour l’instant, je me rends compte que ce combat que je mène n’a pas vraiment de sens. Comment faire comprendre que ce qui compte dans nos vies d’artistes n’est pas de nous rendre visibles mais se trouve ailleurs. Ce n’est pas cette biennale de je sais pas où, ou une résidence de prestige dans un lieu dont tout le monde se fout, où seuls quelques élus pourront déployer pendant quelques jours,
semaines ou mois leur ego surdimensionné. Sortes de moments privilégiés pour artistes privilégiés.
Qui n’a pas rêvé en tant qu’artiste d’être dans les grands événements, d’avoir son nom en lettres de lumière et de pouvoir exhiber son travail à coups de grandes installations démesurées.
Moi la première.
Mais peut-être que le bonheur est ailleurs. Le mien, en tout cas, l’est.
En venant de nulle part, je me cale sur les détails, sur les presque-riens, l’invisible, le mini-poétique, l’infrapoétique même (si ce mot existe).
J’aimerais changer les espaces de vie de tous les jours, abandonner les lieux officiels, les white cubes qui font peur à tout le monde, et qui se réservent
lay down (reprendre son souffle). Crayon sur papier, 66 x 51 cm.
100
souvent à demeurer dans un entre-soi, investir les salles d’attente, changer les poignées de porte de la mairie, transformer le fond de la piscine municipale, égayer les EHPAD (pourquoi les cours de couleur des écoles d’art ne se font pas là)… Je suis sûre que ça répandrait des rivières d’étoiles.
Remplacer le beige et le saumon par du turquoise et des rayures jaunes, vertes…
Quand je me rends à l’hôpital, je me demande ce que nous attendons, nous les artistes, pour intervenir comme des malfrats sauveurs du monde. Nous sommes des mercenaires, et je me sens parfois en décalage, quand je sens que mon milieu est devenu si convenu et convenable.
Les salles d’attente sont les lieux les plus tristes du monde, et les hôpitaux ressemblent à des photos de pays de l’Est des années quatre-vingt dont on ne se préoccupe plus du tout.
Je me souviendrai toujours il y a huit ans quand on m’a annoncé une nouvelle terrible.
« Asseyez-vous. Il ne vous reste plus qu’entre deux à six mois. »
Je me suis dit : « Bordel ! Et en plus je vais les passer dans un lieu horrible, pourri, raccommodé à coups de scotch, les murs défraîchis, jaunâtres, écaillés. Si je meurs je veux le faire les yeux et le cœur remplis de poésie. »
Le médecin avait baissé la tête comme pour acquiescer. Effectivement, c’est la double peine…
Les artistes ne sont-ils pas la grandeur et les garants de la beauté ?
Comment se fait-il que nous ne soyons pas investis dans le quotidien de tout le monde, tous les jours. Nous devrions être d’utilité publique, et être payés à intervenir partout, partout, partout… au lieu de nous dire que nous sommes des parasites.
Comme les dentistes devraient être gratuits et nous devrions pouvoir aller nous faire masser et soigner les dents quand c’est nécessaire, sans jamais débourser quoi que ce soit… (c’est un autre combat.)
Bon, je sais pas ce qui se passe, je suis dans une période de révolte, Punk is alive!
Je cherche mon armée, je crois.
J’ai envie que ce monde qui sombre change. Et je pense qu’il peut bouger les choses petit bout par petit bout à défaut de le faire brutalement, en s’entourant de beauté.
Bordel… Dostoïevski disait que la beauté sauverait le monde, et je suis convaincue que c’est le seul programme politique valable…
Présidente Mechita du parti de la Beauté infinie (j’avoue je suis un peu mégalomane… ou juste à côté de la plaque).
Le ministère de l’avenir heureux.
Le ministère de la santé joyeuse.
Le ministère de la beauté du savoir.
Le ministère de la paix radieuse.
Le ministère de l’écologie fondamentale.
Ne rêvons pas trop. La cupidité va nous faire
sombrer. Quand je lis certains écrivains très en vogue qui fondent leurs œuvres sur leur passé de pauvres et qui finalement, à en crever d’en sortir deviennent les pires caricatures de ce qu’ils ou elles rejettent… tous ces artistes devenus des nantis, pensant qu’ils ou elles sont légitimement audessus des autres et méritent des traitements de faveur… des entreprises bien rentables.
L’image de l’artiste maudit contient quelques vérités parfois.
Je me souviens de cet échange dans le métro à 5 h 30 du matin.
Assise dans ma rame, pas maquillée, pas très fraîche et évidemment pas très réveillée.
Le wagon presque vide, une femme entre portant une doudoune et des sandales dorées.
Immédiatement mon regard se focalise sur ses sandales et je me dis : « Des sandales avec une doudoune en plein mois d’octobre, étrange… »
Je la regarde, elle me regarde.
Et comme je la vois qui se lève de son siège pour s’asseoir en face de moi, je tourne la tête, faisant mine de regarder quelque chose d’intéressant dans ce tunnel noir.
Au bout de deux-trois minutes, elle me dit :
— Vous êtes Myriam Mechita ?
Je la regarde, et me relève un peu.
— On se connaît ?
— Pourquoi vous n’écrivez plus ?
— Heu… Pourquoi je n’écris plus ? Ben, parce que j’ai pas trop le temps…
— Faut le prendre… c’est dommage…
Elle parle avec un ton un peu sec.
— Et votre fils va bien ?
— Oui, ça va…
— Ça fait longtemps que vous n’en avez pas parlé…
— Vous êtes une amie Facebook ?
— Non pas directement, ma cheffe est l’une de vos « amies » (elle fait le geste des guillemets avec les doigts).
D’un coup, elle ouvre sa doudoune, son t-shirt arbore un logo, que je reconnais immédiatement, une société de nettoyage très connue.
— Elle a nettoyé votre exposition dans un centre d’art, il y a quelques années, elle vous adore, maintenant elle dirige l’équipe, moi je suis juste femme de ménage, femme d’entretien, ça fait plus chic…
— Ah d’accord. Mais comment vous connaissez mes textes alors ?
— Elle nous les imprime pour qu’on les lise à la pause déjeuner du lundi midi… Qu’est-ce qu’on rigole…
J’ai souri au même moment où elle s’est mise à sourire.
— J’écrirai un texte sur vous alors, sur vos sandales et votre doudoune, et puis votre ton un peu vindicatif… me faire engueuler dans le métro à 5 h 30 est inhabituel. Surtout parce que vous avez envie que je vous fasse rire…
Elle rougit, moi aussi.
Elle me tend la main.
— Bérénice.
— Enchantée, Bérénice.
— Fatou va pas me croire… je vous engueule pas… mais faut penser aux petits gens… à ceux qui voyagent pas… ceux qui rêvent avec vous… faut penser à ces gens-là… qui ont besoin que vous leur fabriquiez de belles choses… même si on peut pas les acheter.
J’y pense… J’y pense… Je ne fais que ça.
Tous les jours, je ne pense qu’à vous...
Je m’appelle Myriam Mechita, et pendant que « I can buy myself flowers » hurle son envie d’indépendance dans ce café aux allures new-yorkaises, je mets ma main sur le cœur, brandis ces fleurs de la liberté et telle une guerrière sans armée, je prête allégeance à la Beauté !
Je vous le promets, nous viendrons vous sauver.
101
REGARD N° 18
Par Nathalie Bach ~ Photo : Mar Castañedo
Cet hiver-là
Rien ne me ramena à moi Aucun amour
Ni plus d’amour
Ne pouvait en vaincre le froid
Je pensais à l’océan À la caisse claire de mes rêves Loin de mes tourments
Je pensais à Mariana
Toutes ces mains sur elle
Aucune ne trouvant l’endroit Celui du cœur le seul fidèle
À son sang de chica
Je pensais à Antonio
Et son sourire d’assassin
Si beau à faire le beau
Dans l’or de chaque matin
Où je fuyais ses mots
Je pensais à Tatiana Cognant sa folie Dans la cage à marijuana Ses yeux vert-de-gris Traversés du dernier glas

Et la petite Sammy
Qui n’a pas dit son dernier mot Noyée dans l’ombre de sa famille La fierté en manteau Sur son âme en guenille
Les vins lourds de Manuel Nous avaient tous rendus à moitié fous Mariana dansait en velours et dentelles De la vie il n’y avait qu’elle À en vouloir vraiment le feu
Je pensais que je ne pensais plus
La terre était ronde et douce
Elle avait la forme d’un sein Et la saveur de l’espérance
Je ne pensais plus
Au-dessous du Pacifique Les couleurs de l’inframonde Transperçaient l’infini
Tu étais là Comme un cri devant moi Qui n’ai jamais aimé que toi
102


LE PALÉOPHONE DU COLONEL GILLIANE GILL
 Par Bruno Lagabbe
Par Bruno Lagabbe
Ce disque m’a été offert par Matthias, il vient directement de l’appartement de Gilliane Gill. Matthias habitait au début de ce siècle le 18 e arrondissement de Paris. Il m’a raconté à peu près cela : il entend sur le palier du bruit, des voix… C’est la police, les pompiers, des voisins. On discute, l’heure est grave, quelqu’un est mort ! C’est Gilliane, elle est morte depuis plusieurs jours déjà ! Son compagnon, amoureux désespéré, fou de chagrin n’a pu se résoudre à se séparer d’elle. Elle est couchée, habillée, sur le lit dans la chambre. Les voisins dérangés par l’odeur ont alerté la police… Par la suite, l’appartement a été vidé.
Dans le bric-à-brac resté sur le palier, il y avait une poignée de 45 tours…
Matthias me demande de choisir entre deux disques, je délaisse Chatte douce, le rose, et je prends le bleu avec Les morts vivants. Je suis estomaqué :
Que tu sois jaune, blanc, rouge ou noir
Ton corps pue déjà la charogne
Que tu sois belle, en robe du soir
Ton corps pue déjà la charogne
Que tu sois prince ou balayeur
Truand, procureur, honnête homme
Ton corps pue déjà la charogne
Mort aux vaches, ministre, mineur
Ton corps pue déjà la charogne.
Car on est tous des morts vivants
Logés à la même enseigne
Du plus petit jusqu’au plus grand
On crèvera tous mais oui ma chère
Asticots entrez dans la danse
Surtout aiguisez bien vos dents
Sur cette chair tiède foutue d’avance.
Crève la faim ou cousu d’or
Ton corps sera une charogne
Les chiens près des tombes le soir
Se disputeront ta charogne
La vermine viendra lentement
Manger de baisers ta chair tendre.
La dernière fois que j’ai vu bouger Gilliane Gill, elle portait une pile de draps et regardait des scènes érotiques par un trou de serrure. Elle était Madame Raymonde, lingère chez une maquerelle dans La Bonzesse, film tourné par François Jouffa en 1973.
Gilliane est une habituée des petits rôles dans les comédies olé olé, entre 1973 et 1983, on aperçoit sa silhouette replète dans La Maison des filles perdues, La Chatte sur un doigt brûlant, Je t’aime moi non plus, Si ma gueule vous plaît…
Son portrait est sur la pochette de ses deux 45 tours, la même photo en noir et blanc sur fond de papier peint à fleurs, rose pour l’un, bleu pour l’autre. Habillée à la mode 1900 : chignon, fourrure sur corsage en dentelle, on la surprend un poudrier à la main.
Te pénétrant comme un amant ah !
Il faudra bien te laisser prendre !
Car on est tous des morts vivants.
On est tous condamnés d’avance
Asticot aiguise bien tes dents
Hum… ah ! ah ! ah !
Et mes sincères condoléances !
— GILLIANE GILL : LES MORTS VIVANTS, paroles et musique : Gilliane Gill, Orchestre Michel Carley, 1974
45 tours, J.B.P. Records 29 rue Royale, Lyon, 8 tracks Scully Dolby system gravure stereo, n°444
lepaleophone.blogspot.com
104



JON SPENCER

HORS CHAMPS
Par JC Polien
Étrange moment que cette séance avec Jon Spencer. Je résume cette anecdote en trois parties. Dans les années 2000 me restait l’image d’un personnage des plus difficiles d’accès que je connaissais déjà parce que j’avais fait la tournée de Boss Hog, le groupe de sa compagne Cristina Martinez, très jolie femme il faut dire, dont il était le guitariste. Il était jaloux comme un tigre et son regard me lançait des couteaux dès que je la photographiais. Dans le taxi qui nous conduisait alors à Canal+, il m’avait même arraché des mains le Leica de l’époque pendant que je les photographiais sur la banquette arrière de la voiture. Second épisode, nous sommes à New York, Philippe Manœuvre et moi, pour Rock & Folk. Je me souviens que The Jon Spencer Blues Explosion avait joué le soir même dans un cabaret analogue
au Crazy Horse à Paris. Le décalage entre le public et son rock énervé avait été surprenant. Durant toute la séance précédent le concert je ressentais une tension permanente chez cette personne, et je sentais bien aussi que je l’agaçais et que si je pouvais disparaître, son vœu serait exaucé ! Troisième partie, nous sommes à La Rodia à Besançon le 8 novembre 2019 et une légère appréhension s’emparait de moi à l’idée de revoir Jon Spencer. À ma plus grande surprise, j’ai retrouvé un homme affable, souriant, disponible et plutôt taquin. Polaroid en main, il se prêta bien volontiers à mes directives. Depuis cette dernière rencontre avec le musicien, je me suis promis de ne plus jamais porter le moindre jugement sur les artistes que je croisais.
106


MADRE PICCOLA
D’Ubah Cristina Ali Farah — Zulma
Ce roman de l’exil donne la parole à Domenica Ahado – italo-somalienne, comme l’autrice –, à Barni, sa cousine, et à Taguere, son mari – tous deux somaliens –, qui racontent chacun leur histoire. À travers leurs témoignages, oraux ou écrits, adressés à différents interlocuteurs – ce qui donne au texte une grande diversité de voix, en même temps qu’une profonde sincérité –, ils évoquent leurs souvenirs de jeunesse à Mogadiscio, le bouleversement de la guerre civile, leur errance d’un pays à l’autre, leur rapport à la diaspora et leurs tiraillements personnels. Apparaissent, chemin faisant, la trame qui compose leur existence, et la possibilité pour ces « déracinés » d’être en paix avec eux-mêmes. Un livre essentiel pour tenter d’appréhender la réalité de « ceux qui ont fait face au choc d’une migration ». (N.Q.)

L’AVENTURE POLITIQUE DU LIVRE JEUNESSE De Christian Bruel — La Fabrique

Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages pour enfants et longtemps éditeur, Christian Bruel (qui continue d’officier aujourd’hui comme formateur) livre dans cet essai passionnant, tant par l’acuité de son regard que par les nombreuses références convoquées, un regard critique sur la littérature jeunesse. Derrière ce que l’on qualifie bien souvent de « genre » – alors qu’il s’agit plus d’un type littéraire où se déploient des regards sur le monde différents –de multiples formes, adresses, récits cohabitent. Autant de productions qui, en épousant à leur façon les évolutions des représentations de l’enfance et de la jeunesse, portent des visions politiques. En embrassant ce panorama, en débusquant les idéologies à l’œuvre, l’essai invite à penser les possibles d’une littérature jeunesse audacieuse et émancipatrice. (C.C.)
DELPHINE SEYRIG, EN CONSTRUCTIONS De Jean-Marc Lalanne — Éditions Capricci

En 14 chapitres, comme autant d’identités à fabriquer, Jean-Marc Lalanne trace le portrait d’une actrice vibrante et militante dont le jeu et les prises de position rayonnent encore aujourd’hui. Du SCUM Manifesto, co-réalisé avec Carole Roussopoulos, à Sois belle et taistoi qui donne la parole à 23 comédiennes et déconstruit le cliché de l’actrice (le film est repris en salles depuis février), la « Fée des Lilas » a eu beaucoup à dire et a usé de sa voix singulière dès les années 1970 ; à se demander comment cette parole essentielle, constructive et d’un pacifisme presque honteux a pu rester si éloignée des grands médias… Les rôles incarnés par Delphine Seyrig, d’Anne-Marie Stretter à Jeanne Dielmann en passant par la comtesse Bathory, sont à mettre d’urgence entre toutes les mains. (V.B.)
LES GRANDS EXPRESS EUROPÉENS
De
Shmuel T. Meyer — Metropolis
Non, les romans feel-good et guides de développement personnel n’ont pas tout à fait tué la littérature. Celle-ci respire encore et se réfugie parfois, comme ici, entre les lignes d’un livre bref – 130 pages – et d’une prose qui de son auteur, pense-t-on, a exigé beaucoup, sinon plus. Car n’en déplaise à l’algorithme ChatGPT ou aux tâcherons cracheurs de feuillets inoffensifs, la littérature est un travail, qui plus est humain. Découvrir le travail d’orfèvre de Shmuel T. Meyer est une expérience exaltante. On croit lire des nouvelles, il s’agit en fait d’un roman. On croit regarder, au fil de ces 12 histoires ferroviaires emboîtées façon gigogne, un travelling virtuose sur la seconde moitié du xxe siècle, on assiste à la démonstration qu’une prose est vivante, redoutablement vivante, tant qu’elle demeure inchangeable. (N.B.)

lectures
108




YO LA TENGO
This Stupid World / Matador
Ils font sans doute partie de ces artistes qu’on suit avec un amour éperdu. Depuis si longtemps… Et comme en pareil cas on finit par ne plus se poser de question de l’impulsion initiale, la publication de This Stupid World nous rappelle les raisons véritables de notre affection profonde : une pop mélancolique comme celle à laquelle plus personne ne s’attache jamais, une approche mélodique qui puise au cœur de l’avant-garde sonique et des voix enchanteresses qui, en ces temps de détresse, caressent l’esprit. Tout cela nous rappelle combien notre trio du New Jersey continue d’écrire les plus belles pages de l’aventure musicale de notre temps. (E.A.)
ANDY SHAUF Norm / ANTI Records
On peut accorder toute notre confiance à Andy Shauf. Peu de chance qu’il ponde un disque de noise et déroute ses adeptes. Chaque nouvel album est perçu comme des retrouvailles joyeuses avec un ami d’enfance qui a toujours plein de choses à raconter. C’est l’histoire d’un amoureux transi, Norm, qu’il nous conte cette fois-ci en prenant un peu de hauteur puisqu’un des protagonistes n’est autre que Dieu… Shauf a toujours eu le don de mettre en lumière des paradoxes et questions existentielles. Ainsi on va crescendo de l’amour à quelque chose de moins bienveillant. Le synthé scintille, la guitare chatouille et la voix enchante, le tout donnant à l’auditrice des papillons dans le ventre, réaction agréable qui découle en réalité de l’anxiété. Album à méditer. (C.J.)
RYŪICHI SAKAMOTO 12 / Milan Records
Async, le précédent disque de Ryūichi Sakamoto, laissait fragilement pénétrer la lumière entre les barreaux d’un cancer dont le compositeur était sorti vivant. Six années ont passé, la maladie est revenue, un nouvel album s’est donc imposé, tel un nécessaire contre-poison. Contrairement à son vespéral prédécesseur, ce sobrement intitulé 12 ne regarde pas en arrière. Point de nostalgie, mais une mélancolie distillée au fil des jours de peine, chaque morceau prenant pour titre la date à laquelle il a été conçu. Mais au-delà des synthétiseurs qui dérivent en nappes et des grelots tintinnabulants, c’est bien le piano qui donne à ce journal sonore sa couleur méditative, son battement vital, en écho duquel le grincement des pédales de l’instrument qui s’enclenchent et la respiration profonde du musicien constituent la plus bouleversante des ponctuations. (N.B.)


COSSE
It Turns Pale / A Tant Rêver Du Roi Records
Campant indéniablement sur des bases de post/ math-rock et de noise, Cosse va aussi chercher du côté du post-punk et du shoegaze pour proposer son premier long format trois ans après un premier EP qui mettait déjà en lumière les capacités du quatuor (français !). Résultat, It Turns Pale est tout simplement addictif, la fragilité contenue dans moults réverb et dissonances prend immédiatement à la gorge. « Crazy Horse », « Evening » et « Slow Divers » sont autant de titres qu’on n’est pas prêts de se lasser d’écouter. Aucun doute, Cosse fait le poi(d)s ! (C.J.)


sons
110


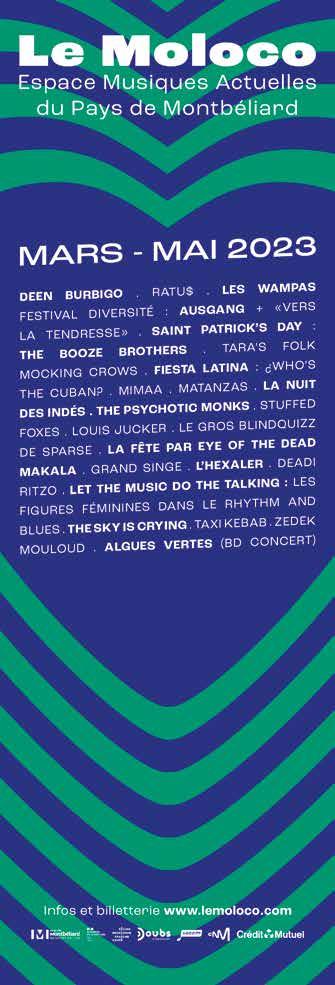
ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer
Pour finir en beauté, on évitera de se demander comment continuer à éditer le magazine que vous tenez en mains alors que tout l’écosystème tire la langue, que les frais de chauffage des lieux de spectacle explosent et que les stratèges en marketing digital remplacent brutalement les chargées de com à l’ancienne. Contentons-nous de petits plaisirs. Si notre boîte aux lettres est souvent envahie de SP (services de presse) sans rapport aucun avec notre ligne éditoriale, il nous arrive parfois d’être les heureux destinataires de livres et de disques magnifiques. C’est ainsi qu’il y a quelques jours nous avons reçu, sur les bons conseils de Bayon, une paire d’objets incroyables (des livres-disques d’art) envoyés par un label
étonnant baptisé Les Disques du Maquis. Tout d’abord, une lecture par Jean-Louis Trintignant de la Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars (Illustrations : Enki Bilal. Musique : Jean-Louis Murat. Que demande le peuple ?). Qu’importe que Cendrars ait pris ou non le Transsibérien (« Mais qu’est-ce que cela peut faire, puisque je vous l’ai fait prendre à tous ! »). Ensuite, No Direction de Jake Ziah, « groupe culte norvégien », une vraie découverte malgré les appels de phares répétés de Bayon dans Libé. Le Maquis a eu la riche idée de rassembler leurs deux albums (ici un vinyle noir, l’autre blanc) avec en cadeau bonus une version crépusculaire de « Bella Ciao » (« Bella Ciao – Waltz for Marc Ribot ») belle à en crever.

112
© Jack Ziah, Maquis 2005
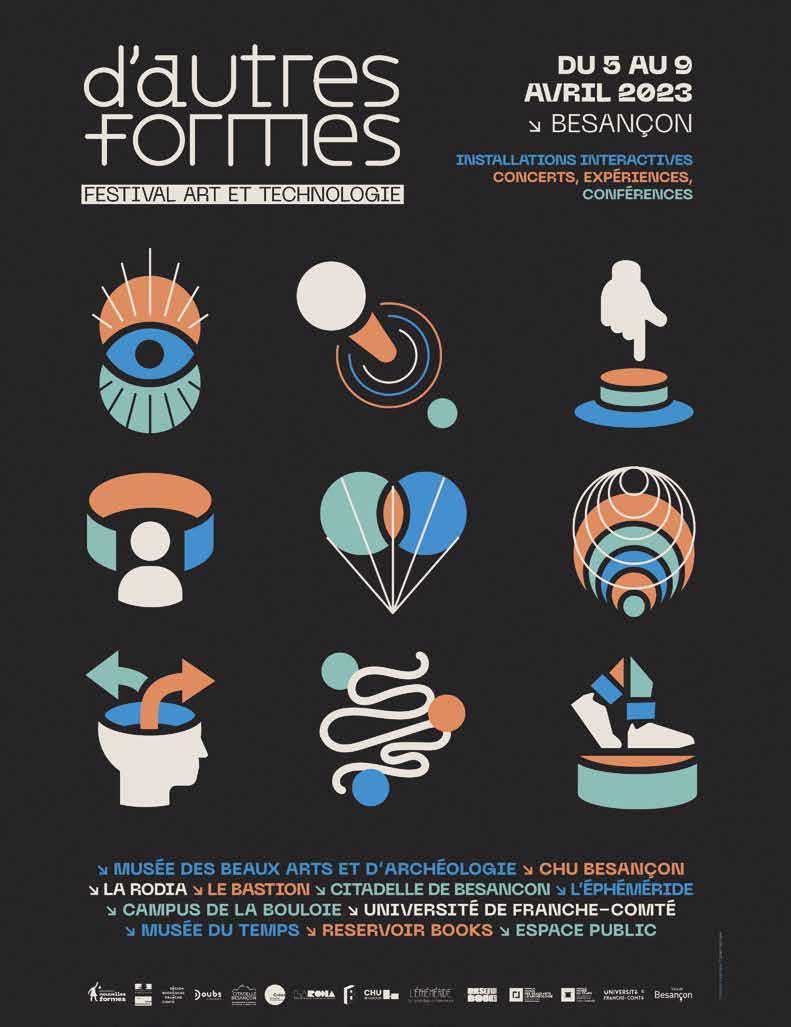
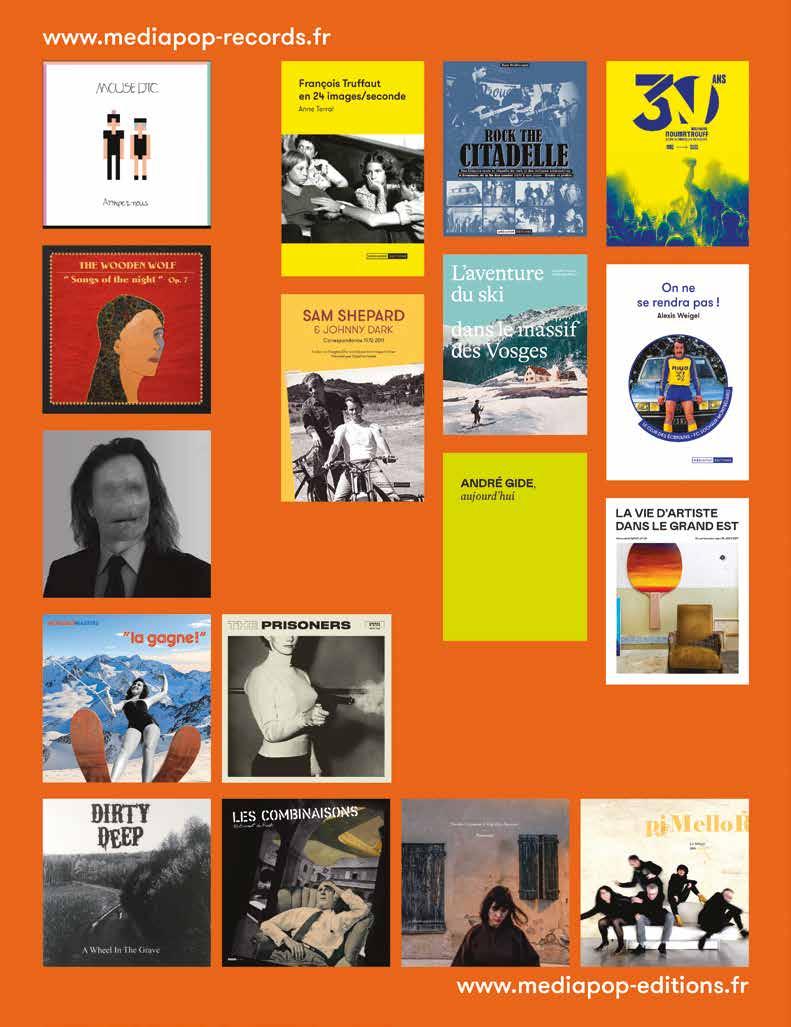


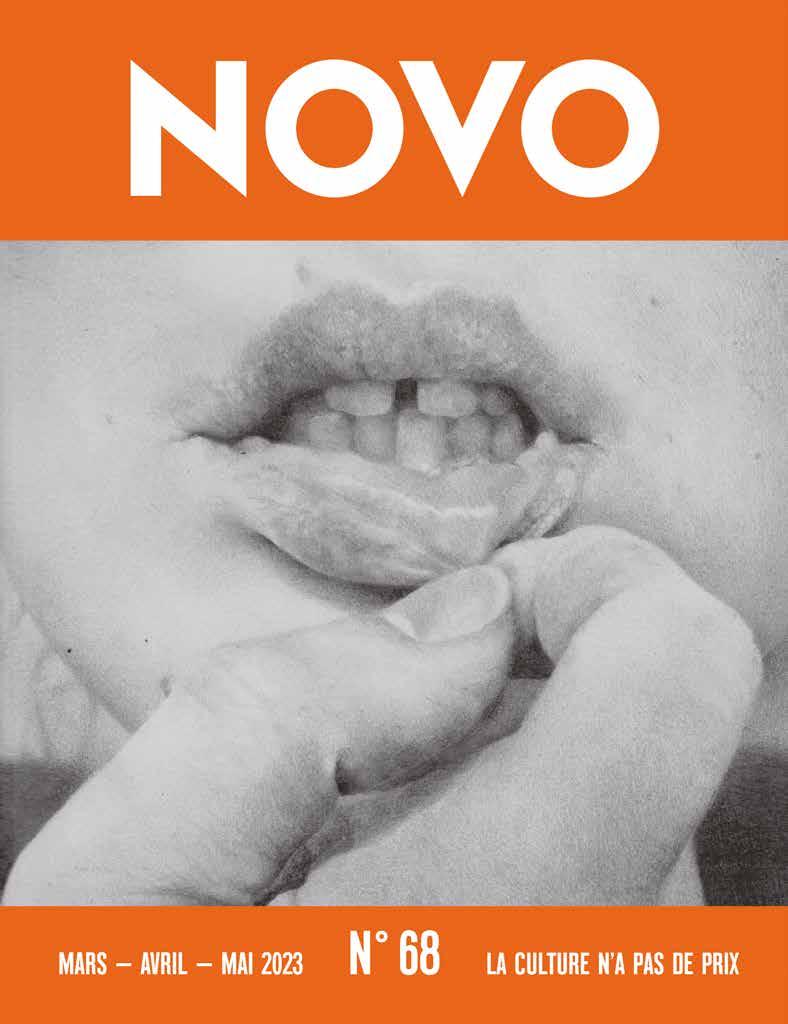






 Par Pierre Lemarchand
Par Pierre Lemarchand



 The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki
The Perfect Vision Trilogy, Peradam, Himalaya © Stephan Crasneanscki













 Par Guillaume Malvoisin
Par Guillaume Malvoisin


 Louis Jucker © Augustin Rebetez
Louis Jucker © Augustin Rebetez











 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin

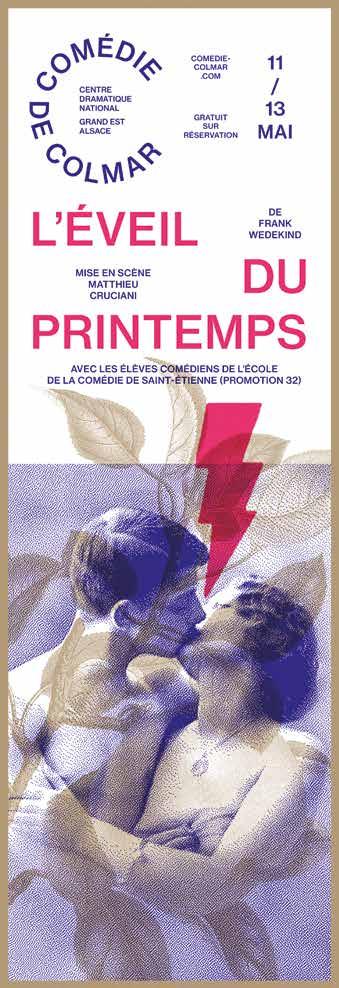
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer

 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer


 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer

 Par Nicolas
Transegalactique © SMITH, courtoisie de Act Up-Paris, 2022
Par Nicolas
Transegalactique © SMITH, courtoisie de Act Up-Paris, 2022











 Dargaud / Rita Scaglia
Dargaud / Rita Scaglia


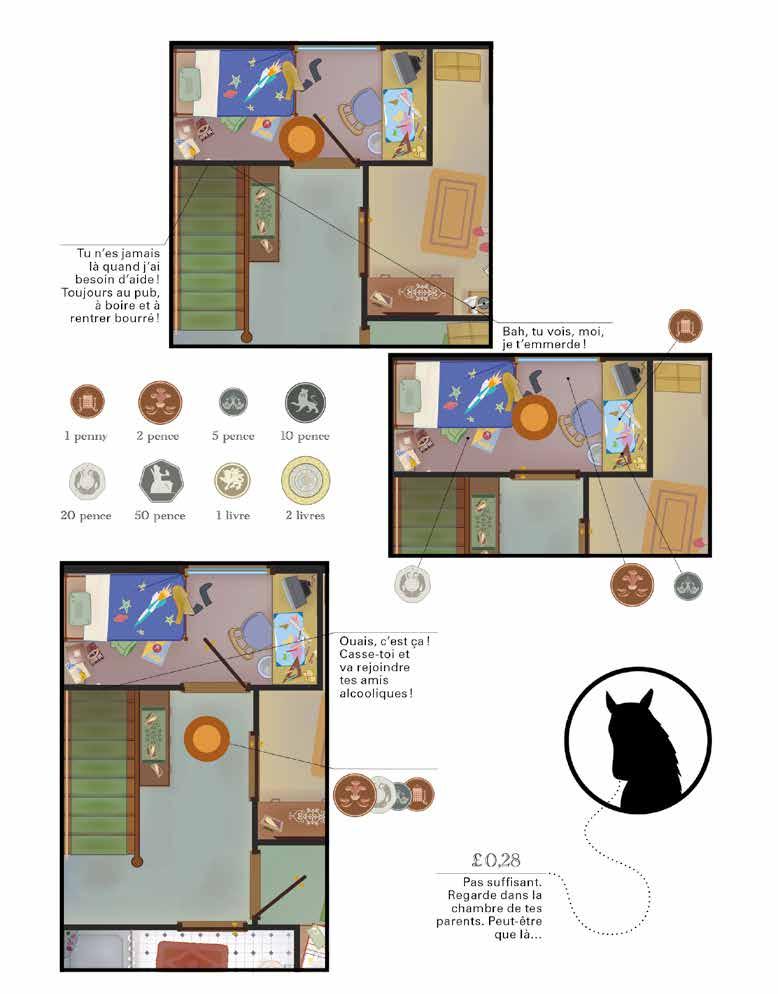


 Josef Albers, Affectionate (Homage to the Square) [Affectueux (Hommage au carré)], 1954, huile sur isorel, 81 x 81 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne
Copyright : © The Josef and Anni Albers Foundation / Adagp, Paris 2022
Josef Albers, Affectionate (Homage to the Square) [Affectueux (Hommage au carré)], 1954, huile sur isorel, 81 x 81 cm
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne
Copyright : © The Josef and Anni Albers Foundation / Adagp, Paris 2022



 Pantone Alsace: Reading the Landscape, 2023
Pantone Alsace: Reading the Landscape, 2023











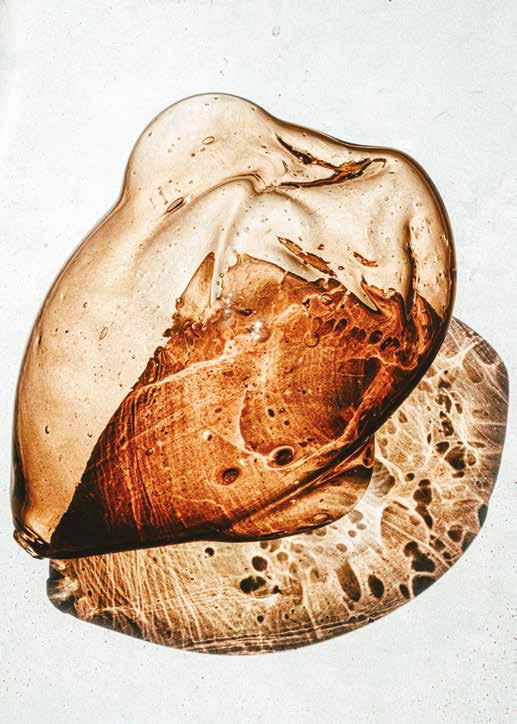




 Par Nicolas Comment
Autoportrait dans le vent, Inishmore, Aran, 1998
Par Nicolas Comment
Autoportrait dans le vent, Inishmore, Aran, 1998



















 Ci-dessous : Poll na bPéist – The Wormhole (Le Trou de ver), Inishmore, Aran
Ci-dessous : Poll na bPéist – The Wormhole (Le Trou de ver), Inishmore, Aran











 Par Bruno Lagabbe
Par Bruno Lagabbe