DJIBOUTI
LA FIN DE LA FRANCE EN AFRIQUE ?





 PAR ZYAD LIMAM
PAR ZYAD LIMAM
LA BOMBE DÉMOGRAPHIQUE
Les chiffres peuvent donner le vertige. L’Afrique vit une révolution démographique majeure. Sa population globale a été multipliée par cinq en soixante ans, entre 1960 et 2020. Aujourd’hui, elle compte plus de 1,2 milliard d’habitants, soit 15 % de la population mondiale, contre 7 % en 1960. À quelques rares exceptions près, au Maghreb, et tout particulièrement en Tunisie, la transition démographique du continent est à peine entamée. Nous continuons à croître sur une cadence trop élevée, de plus de 2,7 % par an. Une femme française a en moyenne 1,8 enfant. Une Africaine en a 4,4, et même 6,8 si elle vit au Niger. Au rythme actuel, en 2050, dans un peu moins de trente ans, la population du continent aura doublé pour atteindre 2 milliards d’êtres humains. Le Nigeria aura détrôné les États-Unis comme troisième pays le plus peuplé de la planète (derrière la Chine et l’Inde), avec près de 450 millions d’habitants. Et la République démocratique du Congo pourrait devenir le huitième, avec près de 215 millions d’habitants. Juste devant l’Éthiopie (213 millions). Les pays du Sahel sont particulièrement concernés. Le Niger pourrait compter 70 millions d’habitants (concentrés largement dans sa bande sud), et le Mali pourrait dépasser la barre des 50 millions. Même là où les situations sont relativement sous contrôle, on parle facilement de doublement de la population. 50 millions d’habitants en Côte d’Ivoire. 30 millions au Sénégal… Ces prévisions restent évidemment des prévisions. Mais la tendance de fond est là. C’est une situation d’urgence existentielle.
On connaît les arguments du relativisme démographique. Oui, effectivement, les enfants sont une richesse, mais une richesse humaine, pas une force de travail. Oui, il faut tenir compte du poids des traditions, du religieux, mais pas au point de sacrifier la nation. Oui, la densité humaine moyenne du continent reste relativement faible (disons 46 habitants au kilomètre carré), mais ce chiffre cache des disparités majeures (très forte concentration côtière, dépeuplement des hinterlands, exode rural massif…).
La réalité, incontournable, c’est que ces niveaux de croissance démographique ne sont pas

soutenables. Ils handicapent le développement et l’émergence du continent. Le président nigérien Mohamed Bazoum, en pointe sur le sujet malgré les risques politiques, l’a dit : « Aussi longtemps que nous ferons des enfants sans avoir l’intention de vraiment bien les nourrir et les éduquer, nous serons exposés à l’extrême pauvreté, et notre orgueil national sera toujours affecté par notre rang de dernier pays du monde en matière d’indice de développement humain… »
Oui, la réalité, c’est que l’Afrique doit maîtriser sa fécondité, quels que soient les tabous, les a priori, les environnements religieux. Et que la clé de cette maîtrise se trouve chez les femmes et les filles, leur éducation, leur protection, leur intégration dans le marché du travail, l’égalité des droits (nous y reviendrons).
Du nord au sud, les taux de croissance économique moyens de 5 % sont largement avalés par l’accroissement des populations. La sécurité alimentaire, la sécurité en eau, les sources d’énergie vont devenir des paramètres de survie (on pense à l’Égypte avec une population estimée à 160 millions d’habitants à mi-siècle…). La dynamique favorise l’émergence de méga-cités dont la maîtrise va devenir incroyablement complexe. La démographie impose aux États de fortes pressions, en matière d’investissements sociaux, en particulier dans l’éducation, la santé, alors que la situation actuelle est déjà dégradée. Les populations très jeunes sont « révolutionnaires » par nature, exigeantes. Elles ont besoin d’emplois, de pouvoir se dessiner un avenir. Comment créer ces centaines de millions de jobs urbains dans les décennies à venir ? Comment « turbocharger » la production agricole pour nourrir ces centaines de millions de jeunes ? Comment financer un tel effort à l’échelle d’un continent ? Comment mobiliser les opinions internationales sur l’impact planétaire de ce qui se passe aujourd’hui en Afrique ?
Ce débat est central pour nous, Africains. Parce que la réalité, c’est que notre continent va devenir le centre du monde. Par sa population, il sera au cœur des enjeux, économiques, sociétaux, climatiques. ■
N°437 FÉVRIER 2023
3 ÉDITO
La bombe démographique par Zyad Limam
6 ON EN PARLE
C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE, DE LA MODE ET DU DESIGN
Zanele Muholi, la voix engagée de la photo

28 PARCOURS
Shaïn Boumédine par Astrid Krivian
31 C’EST COMMENT ? Et nos anciens ? par Emmanuelle Pontié 50 CE QUE J’AI APPRIS Youssou Ndour par Astrid Krivian et Cédric Bouvier
78 VIVRE MIEUX
Les belles avancées de la médecine par Annick Beaucousin 90 VINGT QUESTIONS À… Khady Diallo par Astrid Krivian P.06
TEMPS FORTS
32 La fin de la France en Afrique ? par Zyad Limam et Emmanuelle Pontié
42 Moïse Katumbi se veut prophète en son pays par Cédric Gouverneur

52 Djibouti, veille d’échéances par Thibaut Cabrera
60 Tahar Ben Jelloun : « Aller vers la lumière » par Catherine Faye
66 Djamel Tatah : Conjuguer le « je » et le « nous » par Astrid Krivian
72 Yamen Manai, au bord de l’abîme par Astrid Krivian
P.32
P.42
Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps
Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

P.66
P.62
FONDÉ EN 1983 (39e ANNÉE)

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE
Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com
Assisté de Laurence Limousin llimousin@afriquemagazine.com
RÉDACTION


Emmanuelle Pontié DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com
Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com
Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com
Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
Cédric Bouvier, Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau, Catherine Faye, Cédric Gouverneur, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Élise Lejeune, Luisa Nannipieri, Sophie Rosemont.
VIVRE MIEUX
Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin.
VENTES
EXPORT Laurent Boin
TÉL. : (33) 6 87 31 88 65
FRANCE Destination Media
66, rue des Cévennes - 75015 Paris
TÉL. : (33) 1 56 82 12 00
ABONNEMENTS
TBS GROUP/Afrique Magazine
235 avenue Le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : (33) 1 40 94 22 22
Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com
AM International
31, rue Poussin - 75016 Paris
Tél. : (33) 1 53 84 41 81
P.80
Fax : (33) 1 53 84 41 93
AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris. SAS au capital de 768 200 euros.
PRÉSIDENT : Zyad Limam.
Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet.
Imprimeur : Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz. Commission paritaire : 0224 D 85602. Dépôt légal : février 2023.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2023.

ON EN PARLE
C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage
ÉVÉNEMENT
ZANELE MUHOLI La voix engagée de la photo
Après Londres et Berlin, c’est au tour de Paris d’accueillir la SUPERBE RÉTROSPECTIVE sur l’artiste d’Afrique du Sud.
LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE (MEP) présente la première rétrospective en France de l’activiste visuel·le non-binaire [personne ne se sentant ni femme ni homme, ndlr] Zanele Muholi. À travers plus de 200 photographies, vidéos et installations créées depuis le début des années 2000 et de nombreux documents d’archives, l’exposition met en lumière sa capacité à rendre visible les personnes LGBT+ et racisées ainsi que son combat contre les injustices. Dans ses portraits individuels et collectifs qui ont fait le tour du monde, l'artiste questionne les stéréotypes, montre la diversité et la singularité des membres de cette communauté, et rend hommage à leur courage et leur dignité face aux discriminations. Ses œuvres ne sont jamais neutres : elles interrogent le spectateur et le poids de l’héritage culturel colonialiste et patriarcal dans sa vision du monde. Muholi, qui réfléchit aussi à l’image des femmes noires dans l’histoire à travers ses autoportraits, collabore toujours avec ses modèles. Ce ne sont pas des sujets passifs devant l’appareil. Au contraire, ils font entendre leur voix : leur participation active à l’œuvre contribue à déterminer le lieu, les vêtements, ou la pose de chaque prise de vue. Les clichés pris dans les moments d’intimité ou les espaces publics – dont certains ont marqué l’histoire de l’Afrique du Sud – donnent à voir autant d’images fortes et positives d’une communauté souvent cachée et marginalisée, tout en promouvant le respect des individus qui la composent. ■ Luisa

 Nannipieri
Nannipieri

Rien ne semble pouvoir arrêter la jeune héroïne, interprétée par Sania Halifa.

SOUNDS
À écouter maintenant !
Batida Neon Colonialismo, Cram 316




Depuis quelques années, on suit avec attention le travail (passionnant) de Pedro Coqueñao, artiste pluridisciplinaire, maîtrisant autant la danse que l’image et le son, né en Angola et élevé à Lisbonne. Avec ce nouvel album où sont conviés ses fidèles complices, tel Ikonoklasta, il cultive un propos aussi poétique que groovy autour de la grande question du colonialisme. Bonus : un superbe duo avec Mayra Andrade, « Bom Bom ».

MICHELLE OBAMA, ADOPTEZ-MOI !
APRÈS LE SUCCÈS INTERNATIONAL de Mignonnes (2020) au cinéma, la jeune réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré frappe fort sur la plate-forme d’Amazon avec un film où la chanteuse Yseult et l’astronaute Thomas Pesquet croisent la route d’une adolescente très particulière. Hawa vit près de Paris avec Maminata, sa grand-mère et seule parente, une griotte qui va bientôt mourir, drôlement bien incarnée par Oumou Sangaré. L’adolescente de 15 ans n’a alors qu’un but : remplacer Maminata par… Michelle Obama, rien que ça ! L’ex-first lady est en France pour la promotion de son livre, et Hawa va tout faire pour la rencontrer et lui demander de l’adopter. Rien ne semble arrêter la petite héroïne, jeune fille albinos à la coupe afro et aux lunettes en cul de bouteille, taiseuse et butée. Un conte parfois bancal, mais dont l’originalité est assumée jusqu’au bout. ■ Jean-Marie Chazeau HAWA (France),de Maïmouna Doucouré. Avec Sania Halifa, Oumou Sangaré. Sur Amazon Prime Video.

Souvenez-vous : au milieu des années 1980, ce jeune rappeur fondait Assassin aux côtés de Solo, ouvrant la voie à NTM et autres IAM. Après des hauts et des bas, il reste toujours très actif, en témoigne ce troisième projet en trois ans, PP+. Les featurings sont efficaces (« Monde meilleur » avec la chanteuse soul Robin, « Retweet » avec Doc Gynéco), et le flow frappe toujours juste, entre « Pixel » et « Nouvelle dose », qui questionnent l’absurdité de nos sociétés actuelles.
Lafropop Mélange des genres, Because Music


Vegedream, Ronisia, Ya Levis, Joé Dwèt Filé, Minissia, Alibi Montana, Lartiste… Tous font partie du paysage hip-hop français, mais c’est du côté de Papa Wemba qu’il faut chercher leurs origines sonores. Quelque part entre rumba congolaise, highlife ghanéen, afrobeat nigérian, généreusement nourrie de rap américain, l’afropop est généreuse en rythmiques et en punchlines qui balancent. En témoigne cette compilation riche de 16 titres taillés spécialement pour l’occasion. ■ Sophie Rosemont

Dans ce CONTE ORIGINAL, une adolescente se met en tête de remplacer sa grand-mère mourante par l’ex-first lady
…Rockin’ Squat PP+, Livin’Astro
DRAME
LE PRIX DE L’IDENTITÉ
L’histoire vraie d’un jeune MILITAIRE FRANCO-ALGÉRIEN mort noyé lors d’un bizutage à la prestigieuse école de Saint-Cyr.
DES APPRENTIS MILITAIRES chantent à plein poumon « Commando d’Afrique », hommage aux Africains qui ont participé à la libération de la France, avant de se lancer dans une reconstitution bancale et nocturne du débarquement de Provence. Nous sommes à Saint-Cyr, près de Paris, et ce bizutage plus ou moins toléré sera fatal à l’un d’entre eux, Aïssa, seul arabe de la promotion, qui se noie dans des eaux glacées. C’est la scène d’ouverture de ce film inspiré de faits réels, puisque c’est l’histoire du frère du cinéaste. L’école va ensuite proposer une cérémonie aux Invalides, mais le reste de la hiérarchie militaire va s’y opposer, le jeune homme qui s’était pourtant préparé à mourir pour la France n’étant pas tombé au combat… La lutte de la famille pour obtenir une réparation est le moteur du récit. Et tout passe par le regard de son grand frère Ismaël (Karim Leklou), qui va d’abord se souvenir de leur enfance en Algérie : pays que sa mère (impériale Lubna Azabal) a fui avec eux en 1992 durant la guerre civile, laissant derrière elle son mari gendarme (Samir Guesmi, particulièrement émouvant). Ils vont grandir en banlieue parisienne et voir leurs chemins se séparer : pendant qu’Ismaël accumule les mauvais
plans, Aïssa (Shaïn Boumedine, voir son parcours en pp. 28-29) poursuit de brillantes études à Sciences Po, le conduisant jusqu’à Taïwan. Cette échappée n’est pas la moindre originalité de ce film qui met à mal bien des images ressassées par le cinéma français sur les familles maghrébines en banlieue. La fresque intime côtoie le message politique sans l’appuyer, chaque membre ayant ses défauts et ses qualités, de même que l’armée française n’est pas vue comme un bloc raciste et colonial. Des nuances portées par une caméra toujours à bonne distance, qui soulève bien des questions sans donner de réponses toutes faites. Dans une note d’intention, Rachid Hami (dont le double à l’écran est incarné avec une grande justesse par Karim Leclou) résume parfaitement sa démarche : « Ni lamentation victimaire et encore moins dénonciation stérile de la chose militaire, ce film propose un périple houleux dans l’intimité de deux frères que la vie a séparés, sous-tendu par une méditation plus large sur le déracinement. Faut-il payer de sa vie le rêve d’appartenir à un pays ? » ■
 J.-M.C.
J.-M.C.
« SENGHOR ET LES ARTS : RÉINVENTER L’UNIVERSEL », musée du quai Branly, Paris (France), jusqu’au 19 novembre. quaibranly.fr
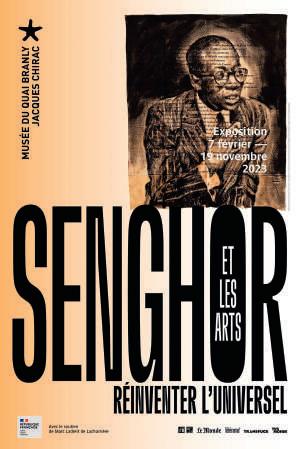

L’ART SELON SENGHOR
Illustration de Marc Chagall pour le recueil de poésie Lettres d’hivernage, de Léopold Sédar Senghor.

Portrait de l’ÉCRIVAIN, POÈTE et homme d’État sénégalais, à travers sa politique culturelle.
L’intellectuel (au centre), alors président de la République, au premier Festival mondial des arts nègres, à Dakar, en 1966.
AU PRINTEMPS 1966 s’est tenu à Dakar le Festival mondial des arts nègres, organisé par l’État sénégalais et son premier président de la République (1960-1980), Léopold Sédar Senghor. Réunissant des célébrités du monde noir des arts et de la culture, cet événement célèbre, pour la première fois en Afrique, la créativité et la diversité dans l’art et la culture du continent. En parallèle, l’homme d’État, pionnier de la négritude et premier Africain à siéger à l’Académie française, en appelle à « l’élaboration d’un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète ». L’exposition qui lui est consacrée revient sur le parcours de ce fervent défenseur de l’idée d’une civilisation de l’universel, façonnée par le « rendez-vous du donner et du recevoir ». On y découvre la politique et la diplomatie culturelles qu’il a mises en place au lendemain de l’indépendance, le 20 août 1960, ainsi que ses réalisations majeures dans le domaine des arts. Ses limites aussi. Car, au fil des relectures, la pensée de Senghor n’a pas fini d’être débattue. ■ Catherine Faye

DHAFER YOUSSEF DE L’OUD ET DE LA VOIX
L’artiste tunisien revient avec un superbe album, Street of Minarets, qui CONDENSE SES INFLUENCES.
HERBIE HANCOCK, Marcus Miller, Dave Holland, Vinnie Colaiuta… Jamais Dhafer Youssef n’aurait imaginé pouvoir un jour enregistrer avec ces grands noms de la scène jazz actuelle. Mais il a suffi de quelques messages pour que tous répondent présents, avec enthousiasme. « Être en studio avec eux, c’était comme si j’étais à table avec Jésus, Mohammed, Moïse, et même Bouddha ! Ils sont plus humains que des humains, tout en étant des prophètes du point de vue artistique. Ce qui compte, c’est uniquement ce que l’on joue ensemble. Ils étaient tous là au service de la musique. C’est un rêve éveillé que je vis encore », se réjouit-il. Un rêve (et un projet) qui aurait pu ne pas se réaliser…

En 2016, le natif de Téboulba publie Diwan of Beauty and Odd, puis en 2018, Sounds of Mirrors. Mais en pleine pandémie, il perd sa voix, subit en urgence une opération cruciale, dont il sort plus fort. « J’ai compris que ma voix était ce qui me connectait avec cette planète, mon oxygène, l’avenir que je voyais au loin, commente-t-il. Soudain, je ne pouvais plus respirer, ni recevoir cette lumière. Aujourd’hui, je déguste chaque moment où je chante, où je suis sur scène, où je parle… Ma voix est un cadeau de la nature et de tous les dieux de cette planète. » Il planche alors de nouveau sur un projet au long cours, qui va devenir Street of Minarets : sur une trame sonore d’une grande richesse et d’une intense spiritualité résonne tout son charisme.
C’est enfant, dans des réunions de famille en Tunisie, que Youssef a commencé à chanter, tout en pratiquant l’oud avec ferveur. Il y a trente ans, il est parti tenter sa chance à Vienne, dans le froid et la précarité, et a réussi, à force de persévérance, à vivre de son talent. Ce voyage dont il sort aujourd’hui plus heureux que jamais se ressent à l’écoute des 12 morceaux de l’album : « Street of Minarets représente mon enfance, mais aussi tous les sentiments qui m’ont traversé depuis durant cette expérience musicale. » ■
S.R. DHAFER YOUSSEF, Street of Minarets, Black Beat Edition.3 QUESTIONS À…
Riad Fakhri
La maison de haute couture
Chanel lui a confié la programmation de la GALERIE
DU 19M DAKAR, espace temporaire et hors les murs de son centre culturel parisien.
AM : La maison Chanel et le centre culturel 19M ont choisi Dakar pour réaliser leur premier programme culturel international. Comment est né ce projet ?

Riad Fakhri : La galerie du 19M Dakar s’inscrit naturellement dans le sillage du défilé de la collection « Métiers d’art » de Chanel de décembre dernier. Je crois que pour la maison, et pour le 19M, c’est une façon de s’intéresser et de vivre la dynamique qu’il y a à Dakar. Le projet reflète la personnalité de Camille Hutin, la directrice générale du 19M. Elle a voulu le faire le plus inclusif possible, et implanté au Sénégal, en lien étroit avec Paris. Comment avez-vous défini la programmation du lieu, qui est en accès libre et gratuit ?

Le comité éditorial, dont je fais partie, a eu une énorme liberté. Nous voulions proposer un tour d’horizon artistique le plus large possible, en soutenant la production des œuvres et en assurant le suivi artistique. Nous avons mis Dakar à l’honneur, en veillant à ce que tous les artistes, peu importe leur nationalité, aient un lien avec la ville ou soient installés au Sénégal. Ce qui a permis de créer une programmation vraiment dakaroise et ouest-africaine. Intitulée « Sur le fil », l’expo réunit artistes et artisans autour des métiers de la broderie et du tissage. Avec quel objectif ?
Faire intervenir des professionnels de ces métiers à côté d’artistes contemporains donne vie à un environnement formidable. C’est un projet très riche, qui peut impacter profondément le pays. Ce n’est pas que de l’art plastique :

À gauche, le musée Théodore-Monod d’art africain, qui accueille le projet. Ci-dessous, une tapisserie commandée aux Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès pour le projet.
il y aura des conférences, des ateliers, des workshops… On prévoit des productions évolutives et la participation du public, qui va être formé. Nous avons aussi développé un programme de médiation culturelle et pédagogique qui veut solliciter les nouvelles générations, et mis en place des navettes avec les écoles de Dakar et de sa région. Parce que notre but est de créer, d’exposer, et surtout de transmettre, pour revaloriser les métiers de la main. ■ Propos recueillis par Luisa Nannipieri
GALERIE DU 19M DAKAR, musée Théodore-Monod d’art africain, Dakar (Sénégal), jusqu’au 31 mars. le19m.fr
ADRESSE THE SOCIAL HOUSE NAIROBI, OU L’HOSPITALITÉ À LA KÉNYANE




Ce nouveau CITY HÔTEL promet un séjour douillet et surprenant.
SOUS LES FLEURSMAUVES des jacarandas, dans la banlieue résidentielle de Lavington, Juliet et Francis Njogu ont inauguré il y a deux ans la Social House Nairobi. Avec 83 chambres, quatre restaurants et sept grands salons à la déco unique, ce city hôtel est l’un des hubs culturels et sociaux de la ville. Qu’il s’agisse d’art, de musique, de mode ou de spectacle vivant, ici les mots d’ordre sont melting-pot et convivialité. Dans les chambres au style simple et moderne, tous les articles à disposition, du café aux produits de beauté, sont sourcés localement. Les visiteurs (kényans et internationaux) peuvent goûter à des cuisines inspirées des quatre coins du globe, comme au restaurant péruvien installé sur le rooftop. Ou profiter des œuvres d’art éparpillées sur la propriété, tel le Maasaï grandeur nature, en ferraille, à califourchon sur une Harley Davidson suspendue dans le hall. Parce que l’accueil kényan passe surtout par l’envie d’épater et d’amuser constamment les hôtes. ■ L.N. THE SOCIAL HOUSE, 154 James Gichuru Road, Lavington (Kenya), chambres doubles à partir de 170 $ la nuit. thesocialhouse.ke
REGARDS

VIBRATIONS À DAKAR



MALIKA SLAOUI est une éditrice de talent et qui a de la suite dans les idées. Installée à Casablanca, son entreprise, Malika Éditions, créée en 1998, s’est spécialisée dans le beau livre d’art, le patrimoine historique et artistique du Maroc. Avec près d’une centaine de titres en catalogue, dont certains en coédition avec de grandes maisons françaises, comme Actes Sud, Gallimard, ou avec l’Imprimerie nationale. Plus récemment, Malika Slaoui s’est lancée dans une collection dédiée à la scène contemporaine culturelle africaine. Celle liée aux grandes villes, à l’énergie urbaine. C’est le concept de « Nid d’artistes ». Après Casablanca en 2018, Dakar vient de sortir sous la direction et l’écriture d’Aisha Dème, militante, activiste et entrepreneure culturelle. Le livre offre un voyage dense et émotionnel dans la capitale sénégalaise, une échappée lumineuse, à la rencontre de plusieurs dizaines d’artistes et d’auteurs : Youssou Ndour, Omar Victor Diop, Baba Maal, Soly Cissé, Alain Gomis, Germaine Acogny, et bien d’autres… Entre les textes, les images, la mise en scène des œuvres, le dialogue est permanent, comme pour nous faire partager la vibration et les ambivalences de la ville. Parmi les prochaines étapes prévues de la collection « Nid d’artistes », une descente un peu plus au sud, à Abidjan, la Perle des lagunes. On s’impatiente… ■ Zyad Limam AISHA DÈME, Dakar, nid d’artistes, Malika Éditions, 368 pages, 45 €.



Un hommage aux ARTISTES de la capitale sénégalaise.
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP (Canada-France),de

Marya Zarif et André Kadi. Avec les voix de Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Raïa Haidar. En salles.

ANIMATION LA PETITE FILLE ET L’EXIL
La POÉSIECONTRE LA GUERRE : un dessin animé tout public et joyeux malgré la tragédie…
UNE FILLETTE DE 6 ANS, à la coiffure brune imposante, va bientôt devoir quitter Alep, en Syrie, où elle vit une enfance harmonieuse, malgré le décès de sa maman. Dans sa main, des graines de nigelle qui vont aider sa famille sur le chemin de l’exil… Réaliste tout en étant poétique (comme cette scène au clair de lune où s’ouvrent les pistaches dans les arbres), graphiquement superbe, ce film d’animation est à la fois délicieux et tragique. L’originalité et la simplicité du trait accompagnent un parcours semé d’embûche pour cette famille et ses voisins qui fuient les bombes. Les voix des personnages sont assurées par des comédiens exilés au Québec, dont le français mâtiné d’accent moyen-oriental alterne avec de l’arabe, pas
EXPOSITION
toujours traduit, ce qui ajoute à l’authenticité du récit mais aussi à sa magie : un arabe levantin complété par des mélodies échappées de l’oud et des flûtes de la bande-son, et aux effluves qu’on devine des épices et des gâteaux de semoule. La coréalisatrice, « née en Syrie dans une famille chrétienne cosmopolite trilingue qui voyageait beaucoup », comme elle le dit elle-même, a choisi d’appeler son héroïne Dounia, c’est-à-dire « le monde », « la vie terrestre » en arabe. Et de l’entourer de femmes au caractère bien trempé et d’hommes bienveillants, qui résistent comme ils peuvent à la guerre. Il se dégage de ce conte chaleureux, rondement mené, une musicalité et une harmonie inattendue pour un tel sujet. Un enchantement. ■ J.-M.C.


INSOLITE IMMORTALITÉ
Un parcours à la croisée du divin, de l’éthique et du scientifique. RÉSURRECTION, réincarnation, postérité… Évoquer les momies plonge dans une double fascination, celle de la mort et celle de la préservation des corps. La question de l’éternité y est centrale, à la fois métaphysique et matérielle. C’est ce rapport au temps et à la mort que propose d’explorer le muséum d’histoire naturelle de Toulouse, deuxième plus grand de France, après celui de Paris. Si l’année passée a été marquée par le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, cette exposition choisit de mettre en lumière le processus de momification, qu’il soit artificiel ou ait été naturellement induit par des actions physico-chimiques ou climatiques. Loin de concerner essentiellement les pratiques des Égyptiens de l’Antiquité, ce thème fait écho aux croyances en un au-delà, aux rituels symboliques, sociétaux ou religieux dans de nombreuses cultures et civilisations. Plus encore, il invite à se poser la question des avatars actuels ou à venir, de la cryogénisation, et autres procédés d’immortalisation. Captivant. ■ C.F.
« MOMIES : CORPS PRÉSERVÉS, CORPS ÉTERNELS », Muséum de Toulouse, Toulouse (France), jusqu’au 2 juillet. museum.toulouse.fr DR

PORTRAIT
ANNABELLE LENGRONNE ENTRE PETIT ET GRAND ÉCRAN
C’est l’une des ACTRICES FRANCOPHONES les plus enthousiasmantes. Dans le superbe Un petit frère, de Léonor Séraille, elle s’affirme dans un jeu tout en nuances.
« JE SUIS UNE INTERPRÈTE encore et toujours en train de découvrir des choses à jouer », nous confie Annabelle Lengronne, avant de préciser : « Vivre quelques mois dans la peau de quelqu’un d’autre, c’est un bel exutoire… » On la croit volontiers au vu de la multitude de rôles dans lesquels elle s’est investie depuis ses débuts sur grand écran, au début des années 2010. Élevée en Martinique, elle s’est lancée dans le théâtre pour conjurer le trauma d’un harcèlement scolaire. La suite, elle s’est (joliment) faite dans des séries et téléfilms, ainsi que chez les cinéastes Denis Thybaud, Cédric Kahn, Audrey Dana, Julien Rambaldi et, aujourd’hui, Léonor Séraille. Dans Un petit frère, qui lui a déjà valu le prix d’interprétation féminin aux Arcs Film Festival, l’actrice incarne Rose sur deux décennies. On voit cette dernière débarquer à Paris avec ses deux fils cadets et essayer de se construire une nouvelle vie, tant professionnelle que sentimentale. Mais la précarité la guette sans cesse… Pour investir ce rôle, Annabelle est allée fouiller dans son propre vécu : elle est née à Paris d’une femme sénégalaise avant d’être adoptée. « Ce qui est arrivé à Rose, c’est peut-être la vie que ma mère biologique aurait eue en restant en France, commente-t-elle. Mon personnage s’adapte et avance. Rose sait d’où elle vient, et son africanité se trouve dans son rapport au temps. » Il y a quelques saisons, la comédienne est allée pour la première fois au Sénégal, qu’elle a trouvé « d’une beauté majestueuse ». Cette élégance, elle en a sans aucun doute hérité… ■ S.R.
UN PETIT FRÈRE (France), de Léonor Séraille. Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin. En salles.


AFRO-JAZZ

JULIA SARR Wolof soul

Pour son TROISIÈME ALBUM, la Sénégalaise cultive toujours un jardin d’une grande beauté tant SÉMANTIQUE QUE MÉLODIQUE, tout en explorant des thématiques cruciales.
ON VOUS PRÉVIENT : la proposition musicale est aussi belle que la pochette à l’aquarelle… Native de Dakar, d’origines toucouleur et peule, Julia Sarr a débuté comme choriste mezzo-soprano de Fela Kuti, avant d’accompagner les plus grands (Youssou N’Dour, qui intervient d’ailleurs sur ce nouveau disque, Mano Solo, Alpha Blondy, Jean-Jacques Goldman), tout en construisant un corpus solo d’une grande élégance. Sur Njaboot, son chant en wolof ressuscite les contes griots en variant les tempos et les récits, autour de la foi, de l’enfance ou encore du mariage forcé. Le tout sur une trame sonore jazz, épurée, accompagnée du piano de Fred Soul, avec lequel la chanteuse a composé cet album, qui est sans doute le plus accompli à ce jour. ■ S.R.

JULIA SARR, Njaboot, Barkhane.
FESTIVAL DU LIVRE AFRICAIN DE MARRAKECH, Centre Les Étoiles de Jemaâ El Fna, Marrakech (Maroc), du 9 au 12 février.
CÉLÉBRER TOUTES LES ÉCRITURES
Le Festival du livre africain de Marrakechest le nouveau RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE des lettres du continent.
POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, baptisée « L’Afrique en toutes lettres », cet événement ambitieux entend vivifier les liens et les échanges entre les littératures des pays africains comme des diasporas, et démocratiser l’accès à la culture. Créé par l’écrivain et plasticien Mahi Binebine et l’association WE ART AFRICA//NS, il rassemblera autrices et auteurs, notamment Sami Tchak, Djaïli Amadou Amal, Achille Mbembe, Yasmine Chami, J.M.G. Le Clézio, Lilian Thuram, Abdourahman Waberi ou encore Ken Bugul. Pendant quatre jours, le centre culturel Les Étoiles de Jemaâ El Fna sera un vrai carrefour de rencontres, un forum d’intelligence collective et de partage d’idées, pour valoriser les différents héritages, la pluralité des écritures, débattre sur l’industrie du livre, penser l’Afrique et le monde de demain… Cafés littéraires, palabres, grands entretiens, nocturnes – rythmés par d’autres disciplines, comme la musique, la gastronomie, l’art équestre – ponctueront cette fête des imaginaires. Sans oublier les activités pédagogiques auprès de la jeunesse. ■ Astrid Krivian

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA CRÉATURES ET CRÉATEURS

SEPT JOURS. Comme la création du monde. Six pour œuvrer. Un pour se reposer. Le nouveau roman de l’auteur de La Reine Ginga : Et comment les Africains ont inventé le monde et de La Société des rêveurs involontaires se déroule tout le long d’une semaine, où chaque jour rythme une parenthèse étrange. Car sur l’île de Mozambique, à l’entrée de la baie de Mossuril, dans l’océan Indien, où des écrivains sont réunis pour un festival littéraire, rien ne se passe comme prévu. Les voilà coupés du monde, sur un bout de terre enveloppé de brouillard. Sans connexion. Ni à Internet, ni au continent. « C’est ainsi que tout commence : un énorme éclair déchire la nuit, l’île se détache du monde. Un temps s’achève, un autre commence. » Confinés sur ce récif corallien calcaire au passé glorieux, l’un des principaux comptoirs commerciaux entre l’Afrique et l’Orient, découvert en 1498 par l’explorateur portugais Vasco de Gama, les auteurs vivent alors l’impensable : les personnages de leurs œuvres
se mêlent à eux et leur demandent des comptes. La confrontation devient alors le théâtre d’échanges singuliers et palpitants sur la littérature, l’écriture, la légitimité, le processus créatif. « Je suis bien plus nue dans mes livres que lorsque je me déshabille », ou « – Vous écrivez ? – Parfois. Quand j’oublie qui je suis », ou bien encore « Je crois, moi, que j’écris pour essayer de pardonner » : chacun s’interroge sur ce qui sous-tend sa vocation. Mais la fin du monde est-elle proche sur cette île située sur la trajectoire de nombreux cyclones ? Ou bien quelque chose est-il en train d’advenir, à l’aune d’une des protagonistes de ce récit à la fois original et profond, une jeune femme sur le point d’accoucher ? José Eduardo Agualusa, qui revendique sa filiation littéraire avec des auteurs latino-américains tels que Jorge Amado, Jorge Luis Borges ou encore Gabriel Garcia Márquez, n’a pas fini de nous surprendre. Inspiré par sa propre vie, l’écrivain angolais distille excentricité, onirisme et pragmatisme dans un microcosme fortuit, encerclé par la mer. Entre ciel et terre. ■ C.F.

Un entre-deux-mondes insolite, par L’UN DES PILIERS de la littérature angolaise.
RYTHMES SEUN KUTI & BLACK THOUGHT AFROBEAT VS HIP-HOP

Le Nigérian invite l’une des valeurs sûres du rap américainà REVISITER trois de ses morceaux.
ALORS QUE L’EXPOSITION consacrée au grand Fela Kuti bat toujours son plein à la Philharmonie de Paris, son fils Seun réinvente trois morceaux de son album Black Times aux côtés du fabuleux MC des Roots, Black Thought – qui a brillé en 2022 avec une autre collaboration, Danger Mouse sur l’excellent album Cheat Codes. En résultent ces « rêves africains », du nom de l’un des titres, partagés entre rap, jazz et, bon sang ne saurait mentir, bien sûr afrobeat. Coup de cœur pour le sémillant « Bad Man Lighter », qui fait danser tout en restant conscient du chaos ambiant, et « Kuku Kee Me », sur lequel les deux artistes appellent le peuple à prendre le pouvoir. L’EP, en tout cas, est taillé pour ! ■ S.R. SEUN KUTI & BLACK THOUGHT, African Dreams, Skebo LLC.

POLICIER
Page turner
Colson Whitehead obtiendrat-il un troisième prix Pulitzer pour ce nouveau roman ?
POURQUOI PAS… En effet, celui-ci renoue avec la grande littérature afro-policière de Chester Himes, vivifiante, parfois absurde, souvent ironique, et franchement prenante. On y suit les mésaventures d’un respectable vendeur new-yorkais de meubles et d’électroménager, Ray Carney. Il n’a rien à se reprocher et veille sur sa famille… Jusqu’au jour où son cousin, Freddie, une mauvaise fréquentation toute désignée, lui propose de participer au casse de l’hôtel
HYBRIDE
Secrets de fabrication
Une plongée passionnante dans les carnets intimes de Orhan Pamuk.

L’OUVRAGE s’ouvre sur des montagnes qui dégringolent dans l’océan, sur des mots qui pleuvent du ciel. Un à un. Nous voici dans les labyrinthes de la pensée d’un créateur. À la fois écrivain et dessinateur. « Entre 7 et 22 ans, j’ai cru que je serais peintre. Puis, le peintre en moi est mort, et j’ai commencé à écrire des romans », confie l’auteur du Livre noir. Pourtant, en 2008, il ressort d’un marchand de couleurs avec crayons, gouaches et pinceaux. Dès lors, ses carnets de notes se couvrent de dessins. Son écriture, à la
COLSON WHITEHEAD, Harlem Shuffle, Albin Michel, 420 pages, 22,90 €.



Teresa, si fréquenté par les stars noires qu’on l’appelle le Waldorf. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu, et Ray va malgré lui goûter au goût doux-amer des magouilles… Avec sa galerie de personnages aux surnoms truculents et ses moult rebondissements, Harlem Shuffle prouve que Whitehead, tout en questionnant l’identité noire, est l’un des plus grands écrivains américains de sa génération. ■ S.R.
fois énigmatique et poétique, devenant, à son tour, un paysage de lettres, de courbes, de cheminements de la pensée. C’est une chance de pouvoir se promener dans les calepins d’un conteur engagé, observateur du monde qui l’entoure et cartographe de l’intime. Toujours à la croisée des mondes. De son Istanbul natal aux territoires rêvés. ■ C.F.
LE LYNCHAGE DU JEUNE EMMETT

En 1955, un adolescent noir est battu à mort dans le Sud
ségrégationniste sur la base de fausses accusations. Un épisode

FONDATEUR MAIS MÉCONNU de l’histoire des Afro-Américains.
LORSQUE LE PRÉSIDENT Joe Biden signe en mars 2022 une loi interdisant – enfin ! – tout acte de lynchage au niveau fédéral, le texte porte le nom d’Emmett Till, et beaucoup découvrent alors une histoire vieille de soixante-sept ans, aujourd’hui mise en images par la réalisatrice nigériano-américaine Chinonye Chukwu. En 1955, un jeune garçon noir de 14 ans en vacances chez ses cousins du Mississippi, regarde un peu trop longtemps une épicière blanche, qu’il voit comme une star de cinéma : se sentant « salie », elle l’accuse de l’avoir violée, et pour la venger, son mari et deux autres hommes torturent à mort l’adolescent. La mère d’Emmett, qui élevait seule son fils unique
à Chicago, loin de la ségrégation contre les Noirs, va alors sortir de sa réserve naturelle le jour des obsèques. Et demande que soit exposé le corps atrocement tuméfié de son fils à la vue du public et des photographes. Un acte fondateur, précédant Rosa Parks et Martin Luther King. Dans le film, la violence du drame et l’attitude des Blancs sont laissées volontairement à distance, pour mieux mettre en valeur le courage de cette mère de famille, dont les pressentiments sont néanmoins un peu trop appuyés. Académique, mais édifiant. ■ J.-M.C. EMMETT TILL (États-Unis),de Chinonye Chukwu. Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg. En salles.

RIAD SATTOUF, L’Arabe du futur 6 : Une jeunesse au MoyenOrient (1994-2011), Allary Éditions, 184 pages, 24,90 €.

UN MONDE EN MARCHE
Les aventures de Riad, de Gisèle et d’Aya… Trois bandes dessinées pour évoquer L’ENGAGEMENT ET LA DIVERSITÉ.



• LA SAGA AUTOBIOGRAPHIQUE de Riad Sattouf, L’Arabe du futur (plus de 3 millions d’exemplaires, traduits en 23 langues), se termine avec un 6e tome poignant. Dans ce dernier opus, l’action se déroule entre 1994 et 2011, jusqu’au Printemps arabe et au début de la guerre civile en Syrie. Après son histoire familiale douloureuse, de la rencontre entre son père, syrien, et sa mère, française, à son enfance passée entre la Libye, la Syrie et la France, l’auteur – l’un des rares à avoir remporté à deux reprises le Fauve d’or du meilleur album au festival d’Angoulême – nous invite cette fois-ci à plonger dans son intimité, de ses séances de psy à ses relations complexes avec son père : en tuant la figure paternelle, il finit par se libérer. Le goût de l’histoire vraie et son style faussement naïf, soutenu par un usage subtil et économe de la couleur, lui valent à juste titre un succès mondial.
• C’est en Tunisie, à la Goulette, que Gisèle Halimi voit le jour. D’un père berbère et d’une mère juive, elle naît sous le nom de Zeiza Gisèle Elise Taïeb. Très tôt confrontée au racisme et aux inégalités, la future militante
DANIELE MASSE ET SYLVAIN DORANGE, Gisèle Halimi : Une jeunesse tunisienne, Delcourt, 136 pages, 17,95 €.
MARGUERITE ABOUET ET CLÉMENT OUBRERIE, Aya de Yopougon 7, Gallimard, 128 pages, 18 €.
féministe, avocate, femmes de lettres et personnalité politique comprend que seules les études la sauveront d’un destin tout tracé. Dès lors, elle ne cesse d’être guidée par les droits des peuples et les libertés fondamentales. Gisèle Halimi : Une jeunesse tunisienne est le récit de sa résistance face aux diktats tant familiaux que politiques et de l’éclosion de ses engagements futurs. Porté par le « Ne vous résignez jamais » d’une combattante d’exception.
• Dix ans qu’on attendait ce 7e tome d’Aya de Yopougon. Traduites en 15 langues et adaptées en film d’animation en 2013, les aventures d’Aya, Bintou et Adjoua convoquent vitalité, amitié et sujets brûlants d’actualité. Nous sommes en 1981, période de fort développement économique en Côte d’Ivoire. Mais les problèmes vont bon train. Injustice sociale, sexisme et inégalités demandent aux personnages une bonne dose de détermination et de résilience. Les voilà en marche, engagés dans la lutte pour les droits des étudiants de l’université de Cocody et la défense des sans-papiers et des homosexuels. Un album empreint d’invention verbale et de situations cocasses. ■ C.F.

HAMZA, ROI DU RAP

L’artiste belge d’origine marocaine dévoile ses failles et ses espoirs dans son NOUVEL ALBUM.
LORSQU’ON appelle son album Sincèrement, Hamza, c’est qu’on ne compte pas faire appel à des faux-semblants. Et en effet, le rappeur belge a le don de partager ses états d’âme, sans pathos, ce qu’on entend dans « Ma réalité », « Plus jamais la même » ou encore « Tsunami », qui sont instantanément mémorables. Parmi ses influences, les sonorités synthétiques de Drake. Ainsi, le rap est autotuné, habité, aussi bien mélancolique que dansant, comme en témoigne « Nocif », porté par un sample de « Lady » du groupe Modjo ! « Je fonctionne au feeling. Quand j’ai envie de faire la fête, ça vient, quand j’ai envie de vivre mes émotions plus mélancoliques, pareil », commente celui qui affirme qu’il faut garder son âme d’enfant. Il avait pour mission d’être entièrement sincère avec lui-même comme avec son public : « Cet album, c’est juste moi, que je parle d’amour, m’amuse ou traite des relations humaines. À une époque, j’avais beaucoup plus de personnes autour de moi, mais j’ai réduit le cercle. On peut vite se faire dévorer par des gens qui sont motivés par des mauvaises raisons. Si je vois que la relation n’est pas authentique, c’est terminé. » En bonus : un duo avec le rappeur américain Offset, du trio Migos. « C’était une expérience
galvanisante de travailler avec lui en studio. » S’il fait désormais partie des figures les plus populaires du rap francophone actuel, Hamza a encore des rêves à réaliser. Comme se produire au Maroc : « Depuis qu’il y a des plates-formes dans la plupart des pays africains, je sens que plus de gens m’écoutent. Et ça me fait plaisir car je rêve de rencontrer mon public marocain, d’aller jouer dans ce magnifique pays. Et même partout en Afrique. Le marché musical est en train de devenir très important, à bien des égards. » D’ailleurs, loin de n’écouter que du hip-hop, il aime la pop américaine des années 1980 autant que les productions nigérianes et l’afrobeat : « C’est par curiosité que je pars à la découverte de ce qui se fait… La musique, je ne cesse de l’explorer, c’est un besoin vital. » ■ S.R. HAMZA, Sincèrement, Hamza, Trez Records.
UKANDANZ Crush éthiopien
Dans ce BOUILLONNANT Kemeken, le groupe explore avec force cuivres jazzy et rock progressif.


IL ÉTAIT UNE FOIS quatre jazzmen français amoureux de la musique éthiopienne, qu’ils mêlaient de plus en plus à leurs aventures sonores, jusqu’à vivre une sorte d’épiphanie en partageant, en 2010, la scène du Festival international des musiques éthiopiennes avec le chanteur Asnake Guebreyes. C’est le coup de foudre musical. Et il dure ! Aujourd’hui, Ukandanz livre un superbe Kemekem cuivré, électrique, rythmique, et parfois même psychédélique, comme sur le morceau-titre. Le timbre de Guebreyes habite des mélopées d’obédience folklorique ou prog rock, qui nous emmènent bien loin d’un quotidien morose, réconciliant les cœurs comme les continents. ■ S.R.
UKANDANZ, Kemekem, Compagnie 4000/InOuïe.
COUP DE PROJECTEUR LE BÉNIN S’INVITE AU MAROC
Une SCÈNE ARTISTIQUE contemporaine en pleine mutation.
PEINTURE, SCULPTURE, installation, vidéo, art numérique, dessin… À Rabat, les œuvres de 34 artistes, majeurs et émergents, du Bénin et de ses diasporas, célèbrent la vitalité et la vivacité de l’art contemporain de l’ancien Royaume du Dahomey. Cette présentation fait suite à l’exposition organisée l’année dernière au palais de la Marina, à Cotonou, qui mettait, de façon simultanée, un coup de projecteur sur les 26 trésors royaux restitués par le musée du quai Branly. Si les thèmes abordés ici mêlent visible et invisible, mythes et légendes, introspection, quête identitaire et problématiques contemporaines, le voyage se fait multiple, alliant passé et présent, individualité et universalisme. Engagée dans la valorisation de sa création contemporaine, la République du Bénin compte ainsi non seulement faire découvrir sa scène artistique par-delà ses frontières, mais aussi doter son territoire de quatre nouveaux musées d’importance internationale. Notamment le Musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè (MEARD), à Abomey, et le Musée d’art contemporain de Cotonou (MACC). À suivre. ■ C.F.
« ART DU BÉNIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : DE LA RESTITUTION À LA RÉVÉLATION (VOLET CONTEMPORAIN) », Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Rabat (Maroc), jusqu’au 15 mai. expoartbenin.bj

BEAU LIVRE UN ART ANCESTRAL ET MULTIPLE
Cet ouvrage précieux rend HOMMAGE AUX TISSUS du continent sous toutes leurs facettes.
DÉDIÉ AUX ARTS TEXTILES AFRICAINS, ce beau livre nous est proposé par deux chercheurs et une conservatrice. Relié sous étui et habillé de toile imprimée, ce précieux ouvrage plonge le lecteur dans un panorama de créations éblouissantes, provenant du Cap Vert, du Ghana, du Cameroun, du Mali ou encore de Madagascar. Comme le rappelle la collectionneuse de textiles MabatNgoup Ly Dumas dans la préface, la plupart des tissus présents dans ces pages ne sont plus produits, mais nombre de techniques dont ils sont nés perdurent, s’adaptent et continuent d’inspirer artisans et artistes à travers le monde. Ainsi, au fil des 200 notices et 400 images, on découvre des pièces uniques conservées par les plus importants musées du monde. Indissolublement lié à la culture, l’histoire et la vie des artisans, l’art du tissage témoigne, dans sa variété, de la richesse et de l’inventivité qui imprègnent le continent. ■ L.N.
DUNCAN CLARKE, VANESSA DRAKE
MORAGA ET SARAH FEE , Textiles africains, Citadelles & Mazenod, 448 pages, 165 €.

ÉLECTRO
COUP TRIPLE
Le nouvel opus d’ACID
ARAB confirme son propos fédérateur et dansant.
DEPUIS LEUR ALBUM RÉVÉLATION Musique de France en 2016, Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho, Guido Minisky et Kenzi Bourras n’ont pas chômé, publiant des compilations et créant leur propre label. Leur volonté de réinventer la musique traditionnelle arabe avec force boîtes à rythmes et synthétiseurs n’a pas faibli, comme l’atteste ce très réussi Trois, qui s’ouvre sur le superbe « Leila », partagé avec Sofiane Saidi. Il n’est pas seul à intervenir : ici, on entend Wael Alkak, Cem Yildiz, Ghizlane Melih, Khnafer Lazhar, Fella Soltana, Cheb Halim et, surtout, le regretté Rachid Taha. Né d’une improvisation nocturne sur un morceau techno, « Rachid Trip » rappelle toute l’intensité et l’authenticité de la rock’n’roll attitude du musicien algérien. ■ S.R. ACID ARAB, Trois, Crammed Discs/L’Autre Distribution/Pias. En tournée mondiale.

AWA MEITÉ, « STYLISTE PEINTRE »

« DALI », signifiant « fait main » en bambara, est le nom de la dernière collection d’Awa Meité, l’une des plus talentueuses designeuses maliennes. Ses créations, entre le boubou et l’habit moderne, sont pensées pour les hommes et les femmes qui aiment se sentir à l’aise au quotidien, tout en osant des tenues visuellement percutantes et de haute qualité. Véritable « styliste peintre », elle travaille ses silhouettes en coton et fibres naturelles comme des toiles. L’agencement des couleurs, la superposition des palettes et des matières, créent des reliefs et des motifs qui rappellent la nature – l’une de ses sources d’inspiration – et donnent du mouvement aux pièces. Pour cette collection, elle a notamment employé des chutes de fils pour créer des franges ou décorer les magnifiques plastrons en cuir touareg, et a joué avec les tonalités fluo, comme le rose ou le bleu clair, étonnante variation d’indigo. Le recours à des formes amples et souples et à de simples encolures bateau ou danseuse, au lieu de cols plus ou moins


ornementaux, est dicté par la portabilité des vêtements, qui n’ont ni boutons ni zips (ou presque). Chaque pièce est unique. Parce que, pour celle qui promeut depuis plus de vingt ans une mode durable, centrée sur les savoirs séculaires des communautés, la fabrication artisanale n’est pas une valeur ajoutée. Le tissage, le filage et la couture à la main sont au cœur même d’un métier qui a un impact socio-économique réel dans la région Bambara. Pendant sa carrière, qui l’a amenée à innover dans les compositions et les motifs tout en gardant une identité artistique reconnaissable, elle a toujours travaillé en étroite collaboration avec les différents artisans, qu’elle aime faire interagir les uns avec les autres. Au sein du centre de formation des métiers à tisser de Koulikoro, qu’elle a créé, comme dans son atelier, le partage de l’espace stimule la créativité et nourrit les liens sociaux, donnant vie à des pièces qui possèdent toujours une touche extraordinaire. ■ L.N.

La designeuse s’amuse avec les couleurs flashy et propose des tenues durables valorisant le FAIT-MAIN MALIEN.
DESIGN MOYO BY BIBI PLEIN LES YEUX
SI ELLE LE POUVAIT, elle couvrirait de perles colorées le monde. Pour l’instant, et depuis la naissance de Moyo By BiBi en 2016, Bibi Ahmed se contente (et c’est déjà beaucoup !) de décorer des accessoires de caractère dans son atelier au Kenya, avec une quinzaine d’artisanes. Manchettes, corsets, tours de cou, gants, couvre-chefs ou pochettes, tous sont soigneusement parés à la main de perles aux couleurs chatoyantes. Même si elle a évolué vers un style un peu plus classique pour ses dernières collections, déclinées en noir et or. Chaque pièce arbore des formes complexes ou des motifs étonnants.
La designeuse les imagine avec humour, inspirée par ce qui l’entoure, comme les craquelures des maisons en boue d’un village kényan ou un certain style british… Née à Mombasa et arrivée outre-Manche à 12 ans, elle garde les deux cultures dans son cœur (« moyo » en swahili), et ce mélange alimente depuis toujours sa créativité. L’idée de lancer son label lui est venue lors de l’enterrement de sa grand-mère adorée, au Kenya, en voyant les sandales à perles massaïs de sa tante. Aujourd’hui, ses créations se vendent partout dans le monde, et Bibi, qui n’est pas près de s’arrêter, envisage déjà de nouvelles collabs avec des stylistes africains. ■ L.N. moyobybibi.com

Avec ses créations vives et perlées par des ARTISANES KÉNYANES, la marque a su séduire fashionistas et Afropolitains.
SPOTS
PLACE AUX CHEFFES MAROCAINES
EN NOVEMBRE DERNIER, une nouvelle adresse a vu le jour dans le quartier marrakchi de Guéliz. Le Sahbi Sahbi, « âmes sœurs » en darija, met à l’honneur tant les cheffes que la cuisine marocaine. Tenu exclusivement par des femmes, le lieu a été dessiné comme un espace chaleureux et convivial, où le paradigme d’une tradition culinaire secrète, qui se transmet de mère en fille, est renversé. La cuisine ouverte devient l’épicentre du restaurant, et on assiste au ballet des cheffes, pendant qu’elles concoctent et racontent les plats traditionnels. À la carte : tagines, pastillas, et l’immanquable couscous (proposé tous les vendredis midi en trois versions différentes, comme celle au maïs). La déco artisanale participe à l’univers intimiste, jouant avec la lumière, les matériaux et les tonalités naturelles. sahbisahbi.com

L’emmenant du Maroc à la Suisse, la vie de la talentueuse Zizi Hattab l’a poussée à créer le premier restaurant suisse étoilé 100 % végan, Kle, où elle conçoit des plats sans oublier la tradition gastronomique de son pays d’origine. Le nom


du lieu fait référence au « sauerklee » (le terme allemand pour l’oxalis), une plante consommée depuis des millénaires. Dans ce petit restaurant de quartier plein de charme, on sert des menus dégustation qui changent suivant les saisons et mélangent les saveurs. Cet hiver est proposé du céleri-rave légèrement caramélisé, servi avec une version maison de la sauce mexicaine aguachile. Ou un baba au sirop de rhum avec mousse au chocolat, épices chai, amandes caramélisées et gianduja. restaurantkle.com ■ L.N.

Qu’elles renouvellent la tradition culinaire à MARRAKECH ou ouvrent un restaurant végan étoilé à ZURICH, elles sont à suivre de près.Le Kle propose des plats où règnent les légumes.
Tiskmoudine, ou le « tourisme régénératif »
EST-CE QUE LA RÉNOVATION raisonnée
d’un ksar (ancien village fortifié), en lisière du désert et en dehors des tracés touristiques, peut engendrer la régénération de toute une communauté ? C’est en tout cas avec cet objectif sur le long terme que Thierry Teyssier, déjà derrière le luxueux Dar Ahlam et l’hôtel itinérant 700 000 heures, a investi Tiskmoudine, dans le Sud marocain. Son idée est d’en faire un modèle de « tourisme régénératif », réplicable ailleurs en Afrique. Au départ, l’organisation
Global Heritage Fund (GHF) a rénové un ancien grenier collectif avec l’aide d’une association locale. Mais les villageois ont ensuite souhaité valoriser le minutieux travail de l’architecte Salima Naji, adepte de la restauration par des techniques vernaculaires. Sur commande de Teyssier et du GHF, elle a donc poursuivi la rénovation d’une dizaine de maisons, y compris le four à pain et les locaux destinés à la nouvelle coopérative de tisserandes, afin d’accueillir des voyageurs (six au maximum). Tout a été pensé
pour minimiser l’empreinte humaine et laisser la parole à l’histoire : ici, pas de tuyauteries pour l’eau courante ni de câbles électriques, mais des porteurs d’eau et des maîtres des lanternes. Même le chauffage, à bois, est réversible. Une part des recettes touristiques sont réinvesties dans le village, et les services sont fournis par les habitants. Un véritable cercle vertueux qui devrait permettre de développer d’autres projets et de relancer une économie qui s’étend au-delà du tourisme. ■ L.N.

Dans le sud du Maroc, la rénovation d’un KSAR RECONVERTI EN AUBERGE a permis de relancer l’économie de manière profonde.
Shaïn Boumédine
PARMI LES DOUÉS DE SA GÉNÉRATION,
le comédien, révélé dans Mektoub, my Love, d’Abdellatif Kechiche, est ce mois-ci à l’affiche de Pour la France, qui dépeint un lien fraternel complexe, évoquant le déracinement, l’assimilation. par Astrid Krivian

C’est l’histoire d’Aïssa, un jeune homme ayant fui la guerre civile des années 1990 en Algérie, avec sa mère (Lubna Azabal) et son frère, Ismaël (Karim Leklou). Rêvant de devenir officier de l’armée française, il intègre la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Lors d’un bizutage, il perd la vie, à 23 ans. Ismaël va alors batailler pour connaître la vérité et obtenir des funérailles dignes de son engagement, faisant ainsi ressurgir le passé. Dans ce film fort, poignant, Shaïn Boumédine offre un jeu plein de densité, de présence, et compose un protagoniste tout en nuances, explorant ses failles, entre intériorité et révolte viscérale. L’acteur de 26 ans partage avec lui ce désir de servir les autres, puisqu’il souhaite intégrer les pompiers volontaires. Né à Montpellier d’une mère d’origine marocaine et d’un père d’origine algérienne, le jeune homme pratique très tôt le football ; il aspire d’abord à une carrière de sportif professionnel, puis d’architecte, à la suite d’une blessure. Jusqu’à sa rencontre avec le 7e art. Adolescent, il accompagne un ami à une audition pour la télévision, et laisse ses coordonnées. Deux ans plus tard, la directrice de casting de Mektoub, my Love : Canto uno, d’Abdellatif Kechiche, le contacte. Le réalisateur franco-tunisien lui propose le premier rôle masculin, Amin, un passionné d’écriture et de photographie. Solaire, sensuel, le film suit la circulation du désir au sein d’une bande d’adolescents le temps d’un été à Sète. Shaïn abandonne alors ses études en travaux publics et fait ses gammes sous la houlette d’un cinéaste exigeant, très attentif aux détails, qui demande un engagement total à ses comédiens. « Intense, constant et précis, le travail avec Abdellatif a été mon école. Il m’a appris à décortiquer le personnage jusque dans ses moindres recoins. C’était une composition très délicate, sur le fil, qui jouait sur les silences : il fallait exprimer beaucoup de sentiments, d’idées, avec très peu de mots. » Il enchaîne les suites de ce premier volet, Intermezzo et Canto due (dont la sortie en salles est toujours attendue), ainsi que L’Été nucléaire, de Gaël Lépingle, Placés, de Nessim Chikhaoui, et la série télé Les Sauvages. Cinéphile éclectique, des comédies d’Alain Chabat aux œuvres du maestro Martin Scorsese, admirateur de la « carrière exemplaire » de Tahar Rahim, Shaïn aborde chaque rôle comme un défi. Pour lui, le métier de comédien passe d’abord par l’art de l’observation : « C’est ainsi que l’on peut retranscrire une réalité. Puis, on puise en nous des émotions proches de celles du personnage. » Passer des auditions est loin d’être une partie de plaisir, mais le Montpelliérain le prend avec philosophie : « L’acteur est à la merci du désir des autres : cinéastes, public, directeurs de casting… Il faut l’accepter ! » Passionné de sport, de mode et d’automobile, il rêve de camper un pilote de Formule 1 à l’écran. Attaché à ses racines, il vit toujours sous le soleil du Midi, entre mer et montagne. Et fréquente les mêmes amis depuis la maternelle : « Ils pensent que j’étais nommé pour un Oscar ! »
Un Oscar, pas encore, mais un César du meilleur espoir masculin, un jour peut-être : Shaïn a en effet fait partie des Révélations de l’année – une présélection pour ce César – pour son rôle dans Placés. Et c’était la deuxième fois ■

«L’acteur est à la merci du désir des autres: cinéastes, public, directeurs de casting… Il faut l’accepter!»
Contemporain, en prise avec cette
qui change, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, est votre rendez-vous mensuel indispensable.

❏
❏ Chèque bancaire


❏ par virement : CIC Paris Etoiles entreprises


IBAN : FR763006 6109130002026140 277
BIC : CMCIFRPP
ET NOS ANCIENS
Ces derniers jours, l’Hexagone s’enflamme au sujet des retraites. La population est vent debout contre l’allongement des cotisations et le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ au repos. Vus d’Europe, où la plupart des pays ont déjà repoussé la date fatidique bien plus loin et depuis longtemps, les Français font un peu figure de flemmards. Vus d’Afrique, c’est très différent. On pense, à juste titre, que c’est vraiment un problème de riches. Car le continent connaît une réalité bien différente. Dans la majeure partie des pays, dotés d’une pyramide des âges inversée, le vrai casse-tête du moment, c’est pas les vieux, ce sont les jeunes ! Depuis des décennies, l’espérance de vie très basse des populations a motivé des politiques de départ à la retraite très tôt, autour de 55 ans pour la plupart des fonctionnaires et autres cotiseurs. Au grand dam de ces derniers (l’inverse de chez nous !), car les pensions sont minables et rarement versées en temps et en heure, les caisses étant la plupart du temps exsangues. Moralité, on préfère travailler plus longtemps pour vivre mieux. Les quelques dernières mesures qui ont décalé l’âge de départ à 60 ans ont été applaudies !

Cela dit, elles ne concernent qu’une infime partie de privilégiés, car les économies tournent en général à 80 % dans l’informel, donc les cotisations pour toucher une pension, 80 % des Africains ne savent pas ce que c’est. Partout, l’assurance vieillesse, selon l’adage qui a la vie dure, ce sont les enfants ! Pourtant, au-delà du problème d’agrandir l’assiette des cotisations, les gouvernements devraient commencer à se pencher sérieusement sur le sujet. Car selon les projections les plus sérieuses, et tant mieux, l’espérance de vie progresse. Lentement, mais sûrement. Le nombre de personnes de plus de 60 ans sur le continent est ainsi passé de 12 millions en 1950 à 53 millions en 2005, et devrait atteindre, selon les estimations des Nations unies, 200 millions en 2050. Certains pays, un peu plus visionnaires que d’autres, ont déjà commencé à réformer leurs caisses de retraite pour faire face à l’allongement de la période de versement, comme le Maroc ou la Côte d’Ivoire. Car on peut aussi supposer que le développement du continent passera par la diminution du monde de l’informel et que l’urbanisation changera peu à peu les mentalités dans la gestion des vieux, des veuves et des orphelins par les familles. Bref, un vaste chantier à ciel ouvert pour demain. ■

 Le président français Emmanuel Macron et son homologue de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo saluent la foule à Bissau, le 28 juillet 2022.
Le président français Emmanuel Macron et son homologue de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo saluent la foule à Bissau, le 28 juillet 2022.
perspectives
LA FIN DE LA FRANCE EN AFRIQUE ?
Les liens sont anciens, profonds, marqués par une longue histoire commune parfois douloureuse, comme lors de l’époque coloniale. Aujourd’hui, cette relation multiforme est en crise. La France n’est pas exempte de reproche et l’Afrique cherche à construire une nouvelle souveraineté, en opposition à l’Occident dominateur… par Zyad Limam

Ce serait donc le début de la fin d’une longue histoire, d’une relation à la fois douloureuse et privilégiée entre la France et l’Afrique, en particulier l’Afrique francophone. Une relation immémoriale, marquée par la proximité géographique, que l’on peut faire remonter jusqu’à la mort du roi Louis IX, dit Saint Louis, devant les murs de Carthage (en 1270), en passant par les premiers comptoirs à Gorée (1677) ou Grand-Bassam (1893), le discours de De Gaulle à Brazzaville (1944), le temps pervers des colonies, illustré entre autres par le film d’Ousmane Sembene, Camp de Thiaroye (1988), ou, vu du côté « blanc », par le fameux Coup de torchon (1981), de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret. Et puis les guerres de libération, celle tragique d’Algérie en particulier, et les indépendances, le foccardisme, la Françafrique, les relations privilégiées d’un Omar Bongo ou d’un Félix Houphouët-Boigny, et puis Paris, capitale franco-africaine du monde aussi… Toute une autre époque.
Plus récemment, on se rappelle de Nicolas Sarkozy, évoquant à Dakar avec une condescendance certaine une Afrique qui n’était « pas assez entré[e] dans l’histoire », en juillet 2007. On se rappelle aussi, comme en contrepoids de ce discours, un François Hollande extatique, à Bamako, en février 2013, après que la France a stoppé la descente des djihadistes sur la capitale malienne, soulignant que ce jour-là « était le plus important de sa vie politique »… Ou bien encore le discours « refondateur » d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, en novembre 2017. Depuis, de l’eau tumultueuse a coulé sous les ponts : crise des visas avec de nombreux pays, dont ceux du Maghreb, quasirupture des relations diplomatiques avec le Mali, grand froid avec le Burkina Faso, saccage d’enseignes françaises à Dakar en mars 2021, apparition de juntes militaires plus ou moins hostiles, retrait de Barkhane en août 2022, attaques contre l’ambassade de France à Ouagadougou ou l’Institut français de Bobo-Dioulasso en octobre 2022, manifestations plus ou moins récurrentes au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, guérilla sur les réseaux sociaux, défiance massive des jeunes vis-à-vis de l’ancienne « métropole », remontée en puissance de la Russie et de ses « proxys », comme la force Wagner… Tout cela serait le signe d’une profonde rupture, multiforme, économique, sociétal, militaire, humaine entre la France et son Sud naturel.
Celle-ci est vulnérable. Son intervention militaire au Sahel l’a rendue « visible », « exposée ». Les images de soldats patrouillant à Gao, à Kidal ou ailleurs ont laissé des traces, elles réverbèrent avec l’histoire coloniale. Les bavures, assez rares, ont marqué les esprits. La France se retrouve en première ligne face à une opinion en colère, qui paye quotidiennement le prix de la dégradation sécuritaire, de la pauvreté, du mal-développement. Il faut bien qu’il y ait un « responsable ».


L’intervention militaire au Sahel l’a rendue « visible », « exposée ». Des images qui réverbèrent avec le passé colonial.À Niamey, au Niger, des soldats français montent à bord d’un avion pour se déployer au nord-est du Mali, en février 2020.
Pourtant, le bilan des opérations Serval et Barkhane reste à faire, avec plus de nuances. Sur le plan du contre-terrorisme, du « ciblage » d’un certain nombre de leaders djihadistes, elles ont été relativement efficaces. Mais près d’une décennie d’intervention sur le terrain n’aura pas ramené la stabilité et la sécurité intérieure. Les complexités du djihadisme, des situations locales, l’étendue immense des territoires à reconquérir ont rendu la victoire impossible. La France a perdu des hommes aussi, et parfois, elle se dit que ceux-ci sont passés par pertes et profits pour les opinions africaines. Elle s’est investie financièrement, humainement. Et au fond, il y a cette incompréhension sur les buts de guerre. Pour la France, il fallait protéger et sauver Bamako, soutenir les États de la ligne de front, leur donner du temps pour se réorganiser. Mais de puissance de soutien, elle est devenue puissance installée, tributaire des faiblesses et des errances des régimes en place. Elle a été perçue comme étant un acteur à part entière, plus encore un acteur dominant, « néocolonial ». L’échec lui est donc imputable. Pourtant, depuis le départ des forces françaises en août dernier, la situation au Mali s’est dégradée. Tout comme au Burkina, où le gouvernement central ne contrôle plus son territoire.
Il y a forcément un effet de loupe, un miroir déformant, en particulier sur les réseaux sociaux, utilisés à plein régime par les adversaires de Paris, et qui accentuent la portée d’un phénomène touchant avant tout les capitales et une partie des « élites » politiques, qui ont tout intérêt à instrumentaliser son rôle. Un miroir qui surjoue aussi l’importance stratégique réelle de la France, laquelle, après tout, n’est qu’un partenaire parmi d’autres dorénavant, soumis à la concurrence de la Russie évidemment, de la Chine, des États-Unis, du Brésil, de la Turquie, mais également, on le sait moins, de l’Allemagne ou des PaysBas… Des puissances qui ne sont pas toujours irréprochables, loin de là, qui portent leur lot d’erreurs et de politiques africaines « post-impérialistes ». Et qui ne font pourtant pas l’objet d’un procès aussi spectaculaire que celui mené contre Paris. Un miroir qui déforme enfin l’importance de l’Afrique pour la France elle-même. Chez les « Gaulois », la relation au continent n’est pas vraiment un sujet central, malgré l’évidence. Les échanges avec celui-ci (le vrai marqueur du degré d’intérêt) ne représentent que 5 % environ du commerce extérieur du pays (30 milliards d’euros sur un total d’exportations d’un peu plus de 500 milliards)… Pour l’opinion publique, l’Afrique reste encore une terre dangereuse, méconnue, souvent mal représentée par les médias, une terre synonyme de migrations incontrôlées, de violences et d’insécurité. Elle ne fait pas rêver…
Dans cette relation complexe, on ne peut pas non plus exclure l’histoire. La France a été une grande puissance impériale et coloniale. Certains Africains, âgés aujourd’hui, peuvent encore témoigner de cette époque. De la mise au pas, de l’exploitation, du sentiment d’humiliation, de l’effacement de l’histoire préalable, comme si tout ne commençait que sous le drapeau bleu-blanc-rouge. Le débat de fond sur ce siècle,
La session plénière du Nouveau Sommet AfriqueFrance 2021, à Montpellier, le 8 octobre. Les chefs d’État du continent n’ont pas été invités à l’événement.

ou presque, de domination s’ouvre à peine de part et d’autre. Comme celui d’ailleurs de l’esclavage, véritable tabou du « dialogue » entre l’Occident et l’Afrique. En février 2017, le jeune candidat à la présidence Emmanuel Macron avait parlé d’un « crime contre l’humanité » en évoquant la période coloniale. Des propos révolutionnaires, qui avaient déclenché la stupeur et la colère de la droite et de l’extrême droite, parlant d’« une détestation de [l’]histoire [de la France] ». À Paris comme en Afrique, le chemin de la réconciliation des mémoires sera long. Les blessures sont encore vives, comme le montre la relation franco-algérienne ou la question si complexe de la restitution des œuvres d’art.
LES VIEUX RÉFLEXES ONT LA VIE DURE
Dans la mésentente de part et d’autre, il y a aussi les aléas d’une politique africaine de la France toujours marquée par les vicissitudes du court-termisme, les méandres de la realpolitik, les réminiscences des réseaux qui perdurent tant bien que mal, la présence de missi dominici sulfureux. Le « reset » proposé par Emmanuel Macron a dû faire face aux complexités de la réalité. Ici, on dénonce un coup d’État, là, on soutient une succession dynastique et militaire, en déplorant officiellement la perte du père (comme au Tchad). Ici, on s’accommode, ailleurs, on condamne. Ici, on évoque l’intangibilité des droits de l’homme, les principes de démocratie, de transparence, ailleurs, on pratique un certain opportunisme sur la question de respect de la Constitution ou sur les successions… Cherchant l’ouverture, la
France a bien du mal à maintenir le contact avec la jeunesse, la société civile, les militants. Et lorsqu’elle tente de le faire, comme au Nouveau Sommet France-Afrique, à Montpellier, exercice baroque d’autoflagellation, en octobre 2021, elle se met à dos les chefs d’État, exclus du processus, et sans qui pourtant rien ne peut se faire.
Comme le constate un briscard expérimenté de la relation, les réflexes anciens ont la vie dure : « Chez nos élites, jusqu’au sommet, il y a toujours une part, même involontaire, de condescendance, de simplification des sujets, cette idée que l’Afrique est un tout, que sa multitude, sa diversité, ses évolutions nouvelles seraient au fond comme secondaires. Parfois, il semble y avoir une véritable perte de savoir, un déficit d’expérience, de compréhension des sujets, y compris sur les dossiers les plus chauds, comme le Sahel. » Remarque d’une haute personnalité africaine : « À Paris, on n’étudie pas assez les dossiers, on ne se plonge pas dans la réalité, on veut trop souvent faire vite. Mais les choses ne sont pas évidentes, en Afrique comme en France, ou ailleurs. Et puis, c’est vrai aussi que nous sommes attachés aux formes, aux protocoles, aux règles de bienséance, et parfois, nos amis français se comportent de manière un peu trop direct. Ça se sait. Ça descend dans les hiérarchies. C’est vécu comme un manque de respect… »
Le soft power souffre également des problèmes de la France elle-même. La coopération technique est en recul – la disparition de son fameux ministère étant peut-être le symbole le plus parlant –, le budget Afrique de l’Agence française de

L’autoritarisme masque le débat. La souveraineté réelle n’existe que si l’on a les
moyens de cette souveraineté…
développement (AFD) ne représente qu’un peu plus de 5 milliards d’euros par an, la francophonie n’est pas jugée comme un instrument essentiel, le continent ne fait pas rêver les étudiants, ni les banquiers, ni les assureurs-crédits, ni les PME qui se méfient des impayés. Le budget de Bercy a ses limites et ne peut pas répondre à tous les projets. Et l’idée des coentreprises, d’associations avec les acteurs locaux a encore du chemin à faire… Sur le chemin de la grande compétition économique pour l’Afrique, Paris prend du retard.
L’image que renvoie le pays au continent n’est pas toujours engageante. Les obsessions françaises sur l’identité, l’islam,
l’immigration renforcent l’idée d’un racisme systémique. La politique des visas, absurde, restrictive, coûteuse, sous-traitée à des officines privées, touche tout particulièrement les classes les plus francophones, les plus actives, celles qui pourraient incarner justement ce fameux reset de la relation : étudiants, artistes, entrepreneurs, chercheurs… Ces ruptures accentuent l’incompréhension. De toute évidence, il y a une nouvelle Afrique que la France comprend moins bien. Le continent, avec son milliard et plus d’habitants, sa démographie, son urbanisation galopante, sa connexion aux technologies digitales, change progressivement de paradigme. Même s’il reste globalement pauvre, fragile, comme sur un fil, il se veut plus indépendant. Maître de son destin. Comme le soulignait le général Bruno Clement-Bollée (ex-commandant des forces françaises en Côte d’Ivoire et de l’opération Licorne) dans une tribune diffusée par Le Monde, en janvier dernier : « Sur le plan historique, nous sommes tout simplement en train de changer d’époque, passant d’une Afrique dominée à une Afrique souveraine. Cela se déroule sous nos yeux, mais peu le comprennent. »
CHANGEMENT DE PARADIGME
L’Afrique sort donc de la phase coloniale, elle sort de la guerre froide, elle sort des alignements et des tutelles. Elle cherche à régler ses problèmes par elle-même. Comme le dit le président nigérien Mohamed Bazoum : « La télécommande est entre nos mains, pas celles de la France. » C’est un mouvement de fond qui est porté tout particulièrement par une jeunesse nombreuse. Il y a une volonté d’émancipation, d’affirmation, que l’on retrouve un peu partout ailleurs dans les sociétés émergentes, et même dans les minorités ethniques occidentales. Et jusque dans les cultures populaires mainstream, comme le mythe de Wakanda qui évoque un royaume africain puissant et secret.
Cette jeunesse-là n’a pas de lien notable à la France, d’autant plus que celle-ci, on l’a dit, n’envoie pas forcément les bons signaux. Cette jeunesse rêve de décolonisation 2.0. Elle est à l’écoute d’une nouvelle génération d’intellectuels africains, mondialisés, qui prônent une forme d’authenticité, de retour sur soi, de mobilisation de ses propres forces culturelles, artistiques, qui plaident parfois pour une sorte de découplage avec la doxa économique mondiale. Une effervescence des idées particulièrement révélatrice, incarnée par des personnalités comme Felwine Sarr, Achille Mbembe, Léonora Miano, Alain Mabanckou, l’historien Amzat Boukari-Yabara, l’économiste Kako Nubukpo, ou l’écrivaine Djaïli Amadou Amal, et aussi la nouvelle école de littérature nigériane. Des jeunes qui sont également fascinés par les succès planétaires de leurs vedettes, les Wizkid, les Burna Boy, et de leurs diasporas, comme le parcours d’un Trevor Noah ou d’une Aya Nakamura.
Des activistes, tel Kemi Seba, s’expriment via un agenda nettement plus radical, souvent racialiste, en opposition totale, en particulier vis-à-vis de la France, accusée des pires maux dans une exagération dangereuse et décomplexée, en
instrumentalisant un panafricanisme fantasmé, en peuplant les réseaux sociaux et les plateaux de télévision…
L’enjeu de cette effervescence et de ces débats dépasse largement la question de la présence et du rôle de la France. L’enjeu, c’est ce nouveau souverainisme africain qui reste encore à définir. On comprend la remise en cause, la contestation de l’ordre occidental, de ses codes, de ses valeurs, plus ou moins sincères. On comprend que 10 % de l’humanité (les pays riches du G7, avec l’Australie, la Corée du Sud) ne peut pas dicter la loi aux 90 % restants. Qu’un nouvel équilibre est à définir. Mais pour une partie des opinions africaines, l’Ukraine au fond, c’est la même chose que l’Irak, que la Libye, que la Palestine, un épisode de plus dans la volonté de « l’Occident » d’imposer son ordre… Et le besoin de « rééquilibrage » s’affirme en opposition au modèle libéral, s’accompagne d’une contestation radicale de « l’Occident dominant », d’une adhésion aux modèles autoritaires, comme celui de la Chine ou de la Russie. Avec en corollaire, le recul des démocraties, le retour des pouvoirs forts, des militaires ou des putschs, le regain de religiosité, que cela soit en terre d’islam ou en terre chrétienne, la promotion des valeurs mâles et viriles, le renforcement des conservatismes sur les questions sociales, l’éducation, l’émancipation des jeunes filles et des femmes, la protection des minorités sexuelles…
Ce regain autoritaire contourne la vraie question. La souveraineté réelle n’existe que si l’on a les moyens de cette souveraineté. Que si l’on dégage des richesses, que si l’on fait sortir sa population de la pauvreté, que si l’on est capable de défendre par soi-même l’intégrité de son territoire, que si l’on peut manœuvrer avec les exigences du capitalisme mondial, qui ne changeront pas du jour au lendemain, que si l’on peut promouvoir une forme d’État de droit, de citoyenneté pour entraîner une adhésion durable. L’Afrique ne pourra pas vaincre seule, par elle-même. Le repli n’est pas une option. Qu’on le veuille ou non, l’Occident reste, pour le moment, un partenaire incontournable, le quasi-maître du jeu du business mondial, malgré la Chine. Il faudra négocier, faire valoir ses intérêts, ses atouts, avec ceux qui comprennent la valeur stratégique du continent, ceux qui sont prêts à coinvestir, prêts à collaborer sur des termes de l’échange nettement améliorés (pour reprendre une expression clé des années 1970-1980).
Personne ne sait encore où cette nouvelle histoire africaine mènera. Mais la France a un rôle particulier à jouer. Elle a une expérience, des liens, des relations. Stratégiquement, le continent reste sa frontière sud. Et l’un des immenses enjeux de l’avenir, un vecteur de puissance. Débarrassée de ses oripeaux « postcoloniaux », mobilisant les diasporas et sa diversité, en refondant son approche sur la coopération et le partenariat, en ayant plus de cohérence sur les valeurs, en réformant les visas et les politiques migratoires, la France pourrait être alors un intermédiaire incontournable entre cette Afrique contemporaine et le reste du monde. Bref, un véritable changement de paradigme, au-delà des postures et des discours… ■
Calixthe Beyala « Les dirigeants français ont gardé leurs pantoufles ! »
La romancière franco-camerounaise, connue pour ses prises de position tranchées et son franc-parler, milite pour un changement de paradigme.
propos recueillis par Emmanuelle Pontié
AM : Comment expliquez-vous le rejet de la France par les peuples africains, un phénomène qui se répand dans les pays francophones ?
Calixthe Beyala : Je ne pense pas qu’il y ait un rejet des Français. Mais des institutions françaises, oui. Parce que la décolonisation s’est très mal passée. Nous n’avons pas soldé le passé. Il y a eu des guerres d’indépendance, comme en Algérie ou au Cameroun, mais on n’est jamais revenus sur cette histoire avec la France afin de mieux comprendre les nouveaux mécanismes qui se sont mis en place par la suite. Et surtout, la France a donné le pouvoir à ceux qui voulaient le moins des indépendances en Afrique, et non à ceux qui les souhaitaient.
De fait, elle s’est trouvée compromise dans les actions des divers dirigeants africains, qui se sont montrés très peu généreux avec leurs peuples. Du coup, cette rancœur envers ceux installés après la décolonisation a rejailli sur les relations avec la France. La vraie cause, ce n’est pas tant l’histoire coloniale de cette dernière, ou l’esclavage, que la décolonisation. Un peu partout, des régimes de terreur ont été mis en place. On a vu la légion française sauter sur Kolvesi, le Katanga, le meurtre de Sankara, ou celui de Kadhafi. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt : les Africains n’ont pas accepté ce qui s’est passé en Libye. Pour nos peuples, le « Guide » représentait un espoir de se libérer du joug occidental, n’en déplaise justement aux Occidentaux.

Vous incriminez en particulier l’activisme des « Françafricains ». Est-ce que la Françafrique existe toujours ?
La Françafrique de Foccart n’existe plus. Mais l’ingéniosité humaine a permis au système de continuer sous une autre forme. Avec à la fois des élites africaines et françaises qui ont permis de perpétrer le système d’exploitation des peuples. Quand la France intervient en Afrique soi-disant pour sauver des gens, c’est en réalité pour sauver les Françafricains. Ils possèdent des entreprises très florissantes, alors que les employés n’ont rien et travaillent pour trois sous. Ils arrivent même à déplacer l’armée française pour leurs propres intérêts, au motif de sauver les Africains. Il s’agit presque d’une nouvelle race. Ils opèrent ensemble, car même si leurs sociétés ont des enseignes françaises, des Africains en possèdent des parts. Et ces derniers, lorsque les populations s’échauffent contre la France, jouent double jeu en les soutenant. Pour sauver leur peau. Ils crient alors : « Regardez, ce sont les Français qui pillent vos pays ! » Alors qu’ils sont complices. Parce qu’en réalité, les intérêts français sur le continent ne sont pas aussi importants que l’on peut penser. Si l’on prend le cas du Cameroun, elle en a 9 % de parts de marché. Et encore moins dans d’autres pays. Ce sont les Noirs françafricains qui profitent le plus du gâteau.
On a assisté ces dernières années à cinq coups d’État dans des pays qui rejettent la France. N’est-ce pas pratique pour ces putschistes de la pointer du doigt afin de rester en place ? On sait que l’Hexagone est plus exigeant sur l’organisation d’élections.
Je pense que les coups d’État sont secondaires. Ces actualités africaines sont dues fondamentalement à la déstabilisation du Sahel depuis la guerre en Libye, avec ces djihadistes qui mettent les populations en danger. Il y a toujours cette même rancœur. Même au Cameroun, nous subissons les exactions de Boko Haram, qui enlève des jeunes filles et tue les populations dans les villages. Et au-delà de cette rancœur, il se trouve que la France a fait l’erreur de vouloir absolument intervenir par la suite. Or, il ne fallait pas. Je l’ai toujours dit. En effet, quand une armée étrangère stationne quelque part assez longtemps, les gens se sentent étouffés, veulent la voir partir. C’est comme si on leur enlevait quelque chose de leur dignité. Les peuples ont besoin de souveraineté, de liberté, de fierté. Et dans le cas du Sahel, les populations se sont rendu compte que les djihadistes continuaient leurs exactions malgré la présence de l’armée française.
En ce qui concerne le Mali, vous ne pensez pas que le conflit en Ukraine et l’influence russe à travers la milice Wagner ont joué un rôle dans la flambée de l’hostilité contre la France ? Depuis, il semble que la fierté des Maliens, qui ont vu leur armée reprendre le flambeau dans la lutte contre le djihadisme, ait été douchée par de piètres résultats.
La solution que j’ai toujours prônée, c’est de mettre sur pied
une très grande armée africaine ! Parce que nos micro-États ne peuvent pas avoir d’armées fortes. Et cela est dû encore aux trahisons qui ont eu lieu au moment des indépendances. Car il n’a jamais été question que soient créés de tels micro-États, dont la plupart sont enclavés, sans ouverture sur la mer, sans possibilité d’échanges ou de commerce. On peut d’ailleurs remarquer que ces derniers, coupés du monde, subissent le plus de coups d’État : la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso… Ces nations sont fermées, et leurs peuples plongés dans une forme de désespoir. Ils ne voient pas l’horizon. Les pères des indépendances africaines ne voulaient pas de ce morcellement surréaliste. Ils rêvaient de panafricanisme. Le nom de la Centrafrique par exemple devait recouvrir plusieurs pays actuels, qui auraient été des sortes de gouvernorats ou des États fédérés. En nous privant de créer cette géographie, on nous a empêchés de bâtir une ou plusieurs vraies nations fortes. Ce découpage portait déjà en lui les germes de la guerre.
égoïste d’un État. »
Qui avait alors intérêt à un tel découpage ? L’Occident, sûrement. Mais aussi les présidents en place, non ?
L’Occident, d’abord. Et les potentats qu’ils ont installés et pu contrôler.
D’accord, mais pourquoi ce sentiment anti-Français se développe-t-il précisément aujourd’hui selon vous ?
C’est le temps de la germination de la rancœur déclenchée en 2011 et l’intervention militaire en Lybie. La rancune, je le répète, vient de là. Elle a grandi avec les années. Souvenez-vous que Kadhafi, à l’époque, faisait énormément de dons, soutenait les pays financièrement. Et je ne crois pas à l’influence de la guerre en Ukraine et l’offensive russe en Afrique. Cela est très récent. Le soi-disant soutien des peuples africains à la Russie ressemble plus à une revanche, le coup de pied de l’âne contre la France. Pourquoi voulez-vous que l’on aime les Russes ? On ne les connaît pas. On ne parle même pas leur langue. C’est plutôt
« Les enjeux de l’humanité et de notre langue, c’est quand même autre chose que la petite fiertéUne manifestation pour demander le renvoi de l’ambassadeur français, à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 20 janvier 2023.
une réaction du genre : la France nous a embêtés, eh bien tiens, on devient pro-Russes juste pour l’embêter en retour ! Vous dites souvent que cette Afrique, profondément francophone et francophile, n’en veut pas à la France, mais plutôt à sa politique, à ses institutions, à sa posture. Comment tout cela peut-il évoluer selon vous ?
Cela va beaucoup dépendre de l’attitude de la France. Elle doit faire son mea-culpa et remettre sur la table les points d’achoppement avec nos peuples, comme cette décolonisation ratée par exemple, qu’il faut reconnaître et expliquer. Et nous attendons des excuses aussi. Elle ne veut pas les faire, et l’Afrique vit très mal ce manque de considération. La balle est dans son camp. Si l’Hexagone pose ces actes, les relations pourront repartir à la normale. Sinon, les relations entre lui et notre continent vont se détériorer, puis s’arrêter. Je le crains. Et si elle se désengage complètement de l’Afrique, quelles seront les conséquences, selon vous ?
Et sur le plan de la démocratie et des droits de l’homme ? L’Hexagone, contrairement aux autres partenaires que vous citez, est davantage regardant sur ces points.
Les Africains sont-ils très pointilleux sur ces points ? Je ne crois pas. Aujourd’hui, les peuples veulent d’abord manger, se vêtir, avoir de l’eau et de l’électricité. Justement, pour obtenir cela, ne faut-il pas avoir la possibilité de choisir ses dirigeants de façon transparente ?
C’est ce que les Occidentaux pensent. Mais ce n’est pas forcément le cas des Africains. Car sous couvert de démocratie, ils se sont retrouvés avec les plus grands pilleurs de l’histoire, qui ont piétiné leurs citoyens. Peut-être même davantage que dans certaines dictatures ! Ils ont vidé les caisses des nations et clament qu’ils ont été élus démocratiquement. Les coups d’État, avec de nouvelles têtes autoproclamées, redonnent-ils de l’espoir aux jeunes ?
Ils ont besoin de changement, oui. Ils verront bien si ces nouveaux dirigeants vont jusqu’au bout ou pas de leurs ambitions. Et les peuples ne sont pas idiots, ils sauront tirer leurs propres conclusions. On verra dans cinq ans s’ils sont plus heureux. Sinon, ils ressortiront dans les rues. Mais déjà, c’est une nouvelle expérience. Et on verra bien si tout était de la faute de la France ou pas. Pensez-vous que l’Hexagone soit capable de changer de posture envers le continent ?
La France perdra beaucoup sur le plan de son rayonnement international. Plus de 150 millions d’Africains parlent français et participent au poids de la francophonie dans le monde. L’économie, ce n’est pas très important. Je le dis depuis des années, la guerre du futur sera culturelle. Regardez la Russie aujourd’hui, elle mène un combat davantage culturel qu’économique.

L’Hexagone n’a pas intérêt à rompre ses relations avec notre continent. Car, vous savez, les Africains, en deux générations, peuvent facilement troquer le français contre une autre langue.
Et l’Afrique perdrait quoi ?
Une amitié. C’est tout. Nous avons d’autres partenaires, comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil. Encore une fois, la part du marché de la France est minime aujourd’hui dans nos pays. Mais ce serait dommage. Car nous avons une histoire commune, des enfants français, etc. Tout le monde y perdrait quelque chose, je pense.
Non. Je pense que les dirigeants parisiens se figurent que l’Afrique est encore celle du début du XX e siècle. Ils ont mis leurs pantoufles, et chaque fois qu’ils sont partis en Afrique, ils les ont gardées. Et aujourd’hui, ils sont totalement déstabilisés. Ils ne connaissent plus notre continent. Ils n’ont même pas eu la curiosité ne serait-ce que de fréquenter leurs propres compatriotes noirs en France pour savoir ce qu’ils pensaient. Nous avions prévu tout ce qui allait arriver. Mais ils n’ont jamais voulu discuter avec nous et nos mouvements. S’ils nous avaient écoutés, je pense que nous n’en serions pas là. Alors, s’ils ne sont pas capables aujourd’hui de demander pardon à l’Afrique, tant pis pour eux. Les enjeux de l’humanité et de notre langue, c’est quand même autre chose que la petite fierté égoïste d’un État.
Pour finir, votre solution pour que le continent s’en sorte, c’est le panafricanisme. Pourquoi et comment pourrait-il se mettre en place ? Est-ce réaliste ?
C’est tout à fait réalisable, car les jeunes générations sont profondément panafricanistes. Les seuls qui n’en parlent pas, ce sont les dirigeants qui veulent conserver leur pré carré. Le panafricanisme, c’est réunir tous les Africains du monde sur un même projet : construire une Afrique forte, grandiose. On n’a rien inventé. C’était déjà un projet porté par des hommes comme Kwame Nkrumah. Et moi, je vous dis que l’on va y arriver. ■
MOÏSE KATUMBI SE VEUT PROPHÈTE EN SON PAYS

Entrepreneur, golden-boy, politicien, charismatique, il veut se porter candidat à l’élection présidentielle congolaise, qui aura lieu en décembre 2023.

Face au président Tshisekedi. Le débat toxique sur la « congolité » souligne à quel point le chemin sera loin d’être évident pour ce métis, fils de réfugié grec. Portrait d’un ambitieux
atypique.
par Cédric Gouverneur«Guidé par la volonté de servir les Congolais, j’ai décidé de quitter l’Union sacrée [la coalition formée autour de Félix Tshisekedi, ndlr], et de présenter ma candidature à l’élection présidentielle », a annoncé Moïse Katumbi le 17 décembre dernier sur son compte Twitter. Trois ans après avoir créé son parti, Ensemble pour la République, l’ancien gouverneur du Katanga se lance officiellement dans la course à la présidentielle de 2023. Il joue volontiers de la résonance biblique de son prénom pour se poser en sauveur de la République démocratique du Congo (RDC). Le timing politique continental lui est propice : du Nigeria au Kenya, des candidats météoritiques bousculent les vieux partis, revendiquant un lien direct et transcendant avec les citoyens, ringardisant la classe politique (au sein de laquelle ils ont pourtant longtemps prospéré), et se présentant volontiers en « hommes du peuple » (malgré leur belle fortune) : William Ruto, élu président du Kenya en septembre, Peter Obi, ce mois-ci peut-être au Nigeria… Katumbi sera-t-il le troisième de cette série ? « Il est populaire au Katanga, mais pas au niveau national, confiait à Afrique Magazine un Congolais, observateur
avisé de la vie politique de son pays, qui doute de l’hypothèse Katumbi. Sans alliance sur le plan national, il aura beaucoup de mal. » Une autre personnalité nuance : « Il sait parler à la jeunesse. Il a des moyens et des réseaux internationaux. Il peut y arriver. » L’homme est relativement jeune (il fêtera ses 59 ans à la fin de cette année). Avec ses costumes blancs et ses chapeaux, il affiche un style de séduisant dandy, décontracté et dynamique. S’il est élu, il promet « un État juste, une république exemplaire, où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité par le fruit de son travail ». Un programme qui se présente comme un incommensurable défi au vu des problèmes pharaoniques qu’affronte le géant d’Afrique centrale, nation inachevée et fragile de plus de 80 millions d’habitants : pauvreté, inégalités, corruption, infrastructures défaillantes, chaos urbain de la mégapole Kinshasa, etc. Sans omettre les enjeux – civilisationnels à l’ère du réchauffement climatique et de la transition énergétique – de la gestion du patrimoine forestier (deuxième poumon vert du globe après l’Amazonie) et des richesses minières. Ni la violence endémique qui empoisonne l’est de la RDC depuis trois décennies, et qui menace désormais, via les rebelles du M23, de dégénérer en guerre ouverte avec le Rwanda de Kagame…
Certes, Moïse Katumbi ne doute de rien. Après tout, la chance sourit aux audacieux. Et nul ne lui reprochera de croire

en ses rêves et de tout donner pour les concrétiser. Ce métis athlétique, qui arbore un look de winner partout à l’aise, est « sûr de son destin, certainement courageux et peut-être idéaliste », écrivions-nous de lui en août 2016. L’homme a de qui tenir : il est en effet le fils d’un certain Nissim Soriano, Juif grec de l’île de Rhodes.
DE RHODES À LA RDC

Quittons un instant les rives du Congo pour celles de la Méditerranée… Dans les années 1930, Rhodes, petite île grecque de la mer Égée, était une possession italienne, où vivait paisiblement, depuis le Moyen Âge, une communauté juive. L’Italie de Mussolini étant alliée avec l’Allemagne d’Hitler, Nissim Soriano recherche prudemment une terre d’accueil. Plutôt que de s’exiler aux États-Unis ou même en Afrique du Sud, il s’intéresse au Congo belge, inspiré par l’exemple de Salomon Benatar, un Juif de Rhodes parti s’établir dès le début du XX e siècle à Élisabethville (ancien nom de Lubumbashi). Peu avant la Seconde Guerre mondiale, Nissim et ses sœurs embarquent pour l’Égypte, puis pour Beira (sur la côte du Mozambique, alors colonie portugaise), et enfin pour le Katanga, où ils posent leurs valises. Bien leur en a pris : en 1944, la sinistre mécanique génocidaire nazie submerge les îles de la mer Égée. Jusqu’au dernier
îlot, les SS déportent impitoyablement tous les Juifs en direction des camps d’extermination situés en Pologne. À Rhodes, le consul de Turquie (Selahattin Ülkümen, dont le nom mérite d’être tiré de l’oubli) parvient à en sauver quelques dizaines, en leur prodiguant des papiers d’identité turcs. Les autres – plus de 1 500 – sont exterminés à Auschwitz. Parmi lesquels les parents du père de Moïse Katumbi ; le patronyme « Soriano » est d’ailleurs gravé sur le mémorial de la déportation érigé à Rhodes.
Au Katanga, le rescapé Nissim Soriano ouvre une pêcherie sur les rives du lac Moero, près de la frontière avec la Rhodésie du Nord britannique (actuelle Zambie). On l’imagine contemplant le lac, songeant à la Méditerranée, pleurant sa famille et ses amis lâchement assassinés. L’homme relève la tête et repart de zéro. Il ne cherche pas à intégrer la communauté des colons belges, et choisit d’épouser la fille d’un chef bemba, Mwata Kazembe XIV Chinyanta Nakula, qui lui donne un premier fils, Raphaël. Après le décès de sa femme, il se remarie avec Virginie Mwenda, elle aussi d’une grande lignée bemba, qui donne naissance à Moïse, en 1964. Moïse et son demi-frère Raphaël – de vingt ans son aîné – sont nés à Kashobwe, près de la frontière zambienne, et ont été élevés dans la religion catholique (le judaïsme se transmet par la mère, non par le père). « Katumbi ne se définit pas comme Juif, mais il a une connexion chaleureuse avec le judaïsme et Israël », précisait en mars 2021, dans The Times of Israel, Menachem Margolin, un rabbin belge avec lequel l’homme politique a sympathisé.
Moïse n’a que 9 ans lorsque ce père atypique succombe à un cancer : ses sœurs et lui sont dès lors élevés par leur aîné, Raphaël Katebe Katoto, qui fera office de paternel de substitution. Celui-ci envoie le jeune Moïse dans un internat bénédictin. Après le lycée, le cadet part étudier la gestion à Kitwe, en Zambie, mais abandonne rapidement pour se lancer dans les affaires, des deux côtés de la frontière avec le Zaïre. Dès les années 1970, la prospère pêcherie industrielle familiale obtient le monopole de l’approvisionnement en poisson des cantines de la Gécamines, l’office minier zaïrois, puis le marché des cantines des établis-
L’homme joue volontiers de la résonance biblique de son prénom pour se poser en sauveur de la RDC.
sements catholiques. La popularité des frères Katumbi est déjà palpable : au début des années 1990, la population protège leurs biens contre les tentatives de pillage des Forces armées zaïroises (FAZ). Face au despotisme du régime de Mobutu déliquescent, Moïse passe la frontière et fonde, en Zambie, le groupe Chani, actif dans l’extraction d’émeraudes et l’import-export. Il devient alors proche du président zambien Frederick Chiluba (lui aussi bemba), qui facilite ses affaires.
CHAIRMAN
DU TPM ET « PREZ » DU KATANGA
Lorsque, en 1997, l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de Laurent-Désiré Kabila taille en pièces les FAZ et progresse vers Kinshasa, Katumbi participe au financement des rebelles afin de hâter l’agonie du mobutisme. Devenu président, Kabila père ne favorisera pourtant pas ses affaires. Qu’à cela ne tienne : celui qui revendique la pratique de trois à quatre heures d’activité physique par jour, avec une préférence pour le football et le tennis, investit dans le sport : il rachète la même année le Tout Puissant Mazembe (TPM), l’un des plus grands clubs de football du continent. Surnommés « les Corbeaux » en raison de leur maillot à dominante noire, ses joueurs ont été cinq fois champions d’Afrique et même,
en 2010, finalistes de la Coupe du monde des clubs (ils ont perdu contre l’Inter Milan). Devenir chairman (« président ») d’un club de foot aussi populaire lui permet de peaufiner son image : il assiste aux matchs tout de blanc vêtu, coiffé de l’un de ses célèbres chapeaux. Il fait même construire, en 2011, un stade de 18 000 places flambant neuf à Lubumbashi. En partenariat avec l’Unicef sont parfois, à sa demande, distribuées des moustiquaires aux supporters.
En froid avec Kabila père, Moïse se rapproche du fils, par l’entremise du gouverneur du Katanga, Augustin Katumba Mwanke. Son entreprise Mining Company Katanga (MCK) obtient trois gisements de cuivre et de cobalt au nord-est de Lubumbashi. En 2006, il soutient la campagne électorale de Joseph Kabila. L’année suivante, il est récompensé en étant désigné gouverneur du Katanga. Il se retire officiellement de MCK et inscrit la société au nom de son épouse, Carine (d’origine burundaise), afin d’écarter les soupçons de conflit d’intérêts. Cependant, « les mauvaises langues assurent que les camions rouges du gouverneur ne font jamais la queue à la douane », ironise Colette Braeckman, journaliste belge spécialiste des Grands Lacs, dans le quotidien bruxellois Le Soir, en mai 2009. En 2021, Katumbi est d’ailleurs cité dans l’enquête « Congo Hold-up », menée notamment par RFI et un consortium de journalistes d’investigation : « Entrepreneur actif dans le secteur des mines, Moïse Katumbi a continué à développer ses affaires alors qu’il était en même temps gouverneur de la province minière du Katanga », écrit alors RFI. L’ex-gouverneur a toujours démenti avoir tiré le moindre bénéfice de cette double casquette. Il se défend du moindre népotisme et insiste sur son bilan, plutôt flatteur : « Le Katanga est passé du troisième au premier rang des contributeurs au budget de l’État, avec des recettes qui ont bondi de 18 millions à 1,2 milliard par an », déclarait-il à Afrique Magazine

Devenir chairman d’un club de foot aussi populaire que le Tout Puissant Mazembe lui permet de peaufiner son image.
en 2016. Avant son arrivée à la tête du gouvernorat, « le minerai fuyait par camions entiers… Les douaniers arrivaient au travail à 11 heures et repartaient à 14 heures ». En 2007, l’un des premiers gestes du gouverneur nouvellement élu est d’utiliser les redevances minières afin d’acheter des ambulances et du matériel médical pour les dispensaires. Il interdit l’exportation de minerais bruts et investit massivement pour le faire raffiner sur le sol congolais. Selon African Business, en avril 2013,
la production annuelle de cathodes de cuivre est passée de 18 000 tonnes en 2007 à plus de 1 million de tonnes. Sous son mandat (2007-2015), un tiers des routes de la province sont rénovées, le nombre d’enfants scolarisés multiplié par trois, et 67 % de la population a accès à l’eau potable (contre 5 % auparavant). Un bilan non négligeable, sachant que la RDC se situe au 164e rang sur 174 de l’indice de capital humain : selon la Banque mondiale, deux tiers (64 %) des Congolais

(sur)vivent avec moins de 2,15 dollars par jour, et, selon l’Unicef, 33 millions n’ont pas accès à l’eau, dans un pays pourtant doté de la moitié des réserves aquifères du continent. Katumbi a acheté également, sur ses propres deniers, des livres scolaires et fait importer du maïs zambien à bas prix. Le « Prez » allait même jusqu’à distribuer des billets de 100 dollars aux nécessiteux, par exemple pour financer des soins médicaux urgents, l’organisation d’obsèques ou le rapatriement d’un corps.
En 2015, lorsqu’il devient évident que le président Kabila cherchera au mépris de la Constitution à se maintenir au pouvoir au terme de son second mandat, la jeune démocratie traverse une violente crise. En janvier, des émeutes éclatent à Kinshasa et font des dizaines de morts. En septembre de la même année, Katumbi rompt avec le chef d’État : il quitte son poste de gouverneur et annonce dans la foulée sa candidature à la présidentielle, citant pour modèles politiques Nelson Mandela et Léopold Sedar Senghor, notamment « parce qu’ils ont eu l’intelligence de partir ». Il reçoit le soutien du G7 (coalition de sept partis frondeurs) et de la plate-forme de l’opposition Alternance pour la République. Son programme : « Un État de droit avec un système éducatif fort, l’accès aux services de santé et des efforts pour diversifier l’économie. » Entre Kabila et Katumbi, la guerre est dès lors déclarée : le président va tout mettre en œuvre pour neutraliser son rival. En avril 2016, Darryl Lewis, un conseiller américain du magnat katangais, est interpellé par l’Agence nationale de renseignement et accusé d’être un mercenaire. Libéré après plusieurs mois de détention et autorisé à rentrer aux États-Unis, il portera plainte pour tortures.
Katumbi est quant à lui poursuivi en justice par un ressortissant grec, Emmanuel Stoupis, qui l’accuse de spoliation immo-
du pouvoir ». « Si l’on n’avait pas signé la condamnation, on aurait été condamnés à dix ans de prison », expliquait-elle à TV5 Monde en décembre 2016, fustigeant « un dossier politique, un procès bidon, monté de toutes pièces ». En mai 2017, devant le président Kabila en personne, même la Conférence épiscopale nationale du Congo déplore un « acharnement » et une « mascarade » à l’encontre de Katumbi. Mais force est de constater que la manœuvre s’est révélée efficace : finalement exilé en Belgique, l’homme s’est retrouvé dans l’incapacité physique de déposer sa candidature à la présidentielle avant la date butoir du 8 août 2018. Il a bien tenté de rentrer au pays au début du mois, mais son avion n’a pas été autorisé à atterrir, puis son convoi de véhicules a été bloqué au poste-frontière zambien de Kasumbalesa, à seulement 90 kilomètres de Lubumbashi. Katumbi n’a pu revenir en RDC qu’en 2019, après l’élection de Tshisekedi. À la présidentielle de 2018, il avait soutenu Martin Fayulu, mais n’a plus suivi le candidat malheureux lorsque ce dernier s’est obstiné à revendiquer la victoire, des mois après le scrutin. Félix Tshisekedi a d’ailleurs nommé au gouvernement plusieurs figures de la coalition menée par l’ancien gouverneur du Katanga, Ensemble pour le changement.
DES ORIGINES ATTAQUÉES
bilière. Ce dernier s’était déjà fait connaître pour des poursuites judiciaires envers un autre opposant, Jean-Claude Muyambo Kyassa, condamné à quatre ans de prison. Convoqué au tribunal de Lubumbashi les 9 et 11 mai 2016, l’ancien gouverneur est accueilli par des milliers de supporters, contre lesquels la police s’acharne. Blessé d’un coup de seringue lors de la cohue, il est autorisé à quitter le pays pour recevoir des soins en Afrique du Sud. En juin 2016, un tribunal le condamne, en son absence, à trois ans de prison et à 1 million de dollars d’amende. Dès le mois suivant, la juge Chantal Ramazani fuit la RDC, affirmant avoir condamné Katumbi contre son gré, « sous la contrainte
Un autre péril menace sa prochaine candidature : le piège de la « congolité ». En 2021, Noël Tshiani, obscur ancien prétendant à l’élection de 2018 (il n’avait recueilli que 23 548 voix), a fait une proposition de loi afin d’empêcher tout non-Congolais de père et de mère d’être élu chef de l’État. La mesure vise à l’évidence d’éventuels candidats ayant des parents originaires du Rwanda. Une telle loi aurait aussi pour effet d’invalider la candidature du fils de l’Italo-Grec Nissim Soriano… En juillet 2021, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, la cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour le Congo (Monusco), la Guinéenne Bintou Keita, a clairement mis en garde contre les « conséquences potentiellement dangereuses » d’un tel texte. En Côte d’Ivoire dans les années 2000, le concept xénophobe d’« ivoirité », agité par une partie de la classe politique afin de barrer la route à Alassane Ouattara, avait attisé la guerre civile. « Être né de parents congolais n’est pas une garantie de patriotisme », précisait dans les colonnes du Monde, en juillet 2021, le politologue Jean-Claude Mputu. « Cette loi repose sur des arguments populistes », ajoutait-il, estimant que « les populations parlant le kinyarwanda sont soupçonnées d’être déloyales à la RDC ». Interrogé en 2021 sur cette proposition de loi, Tshisekedi avait botté en touche, se disant « pas concerné ». Pourtant, depuis que Katumbi a officialisé sa candidature, les
Un autre péril menace sa candidature : les discours enflammés sur la « congolité », « la citoyenneté de souche ».
attaques du camp présidentiel fusent sur ses origines. « Il ne faut pas voter pour une chauve-souris dont personne ne maîtrise la mère et encore moins le père », fustigeait, le 7 janvier à Lubumbashi, le ministre des Hydrocarbures Didier Budimbu (du parti Autre vision du Congo). Ce proche de la première dame appelait les électeurs à « demeurer focus sur le deuxième mandat de Félix Tshisekedi pour ne pas écouter les sirènes d’imposteurs dont la place n’est pas ici ». Le lendemain, sur Twitter, un député du parti présidentiel (Union pour la démocratie et le progrès social), Éric Ngalula Ilunga, dénonçait la « nationalité étrangère de Katumbi ». Et le 12 janvier, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba, déclarait dans un meeting au Sud-Ubangi que « celui dont le père n’est pas congolais est notre ennemi ». Le même jour, dans un tweet, un militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), Fred Bauma, prévenait quant à lui en ces termes : « Si on ne prend pas garde, ces élections vont devenir une grosse campagne raciste, tribaliste et même antisémite. »
Par ailleurs, une enquête menée par Jeune Afrique et RFI a confirmé que Moïse Katumbi a bel et bien demandé, et obtenu, en 2000, la nationalité italienne. Rome, dont les émigrés ont fait souche dans le monde entier (France, États-Unis, Argentine, Australie, etc.), autorise en effet leurs descendants à solliciter un passeport italien : Rhodes ayant été italienne lorsque son père y est né, Katumbi a pu la requérir. Mais l’entrepreneur, qui a sans doute procédé ainsi pour faciliter ses déplacements dans l’Union européenne, a prudemment renoncé à cette nationalité de convenance en 2017. Cependant, selon la Constitution de 2006 de la RDC, la nationalité congolaise est « exclusive », et la double nationalité n’est pas reconnue. Les années italiennes de Moïse Katumbi pourraient-elles lui barrer la route du palais de la Nation ? Qu’un métis, fils d’un rescapé de la Shoah, soit empêché de se présenter à une élection présidentielle africaine en vertu de prétextes xénophobes constituerait une bien cruelle ironie : la notion de citoyenneté « de souche » s’inspire directement des thèses de l’extrême droite européenne. ■

Youssou Ndour

LA STAR SÉNÉGALAISE REND HOMMAGE,
dans son album Mbalax, à ce genre populaire dont il est devenu l’ambassadeur mondial. Confessions musicales et panafricaines. propos recueillis par Astrid Krivian et Cédric Bouvier
Le mbalax m’a vu grandir. J’ai commencé à chanter à 14 ans. J’ai vécu l’évolution de la musique, l’amplification du son, etc. Pendant longtemps, la musique cubaine avait le vent en poupe, au Sénégal. Au cours des années 1970, notre génération s’est tournée vers les percussions traditionnelles, comme le sabar, la marque de fabrique du mbalax. Sur ce rythme, les instruments modernes se sont ajoutés. C’est alors devenu la musique la plus populaire du pays !
Il raconte notre société, notre histoire, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous révolte. C’est en restant connecté avec le quotidien que l’on peut vraiment raconter des histoires. Sur mon dernier album, Mbalax [notamment présenté en octobre dernier à la Fiesta des Suds, à Marseille, ndlr], je parle des défis en matière d’environnement, et notamment de la question de l’eau – sa distribution, sa protection. À travers la musique, on peut faire passer des messages beaucoup plus rapidement qu’en politique, j’en sais quelque chose [rires] ! [Ministre de la Culture et du Tourisme sénégalais entre 2012 et 2013, il a ensuite été ministre-conseiller du président Macky Sall, ndlr.]
Ce qui a forgé ma réputation de musicien, c’est la world music, née dans les années 1980 de la rencontre des musiques africaines, orientales, avec la pop, le rock… J’ai collaboré avec Peter Gabriel, Paul Simon. Le mbalax est l’une de ses sources, mais ce n’est pas la world music ! J’aime le rappeler pour dissiper cette confusion. Ma mère appartient à la caste des griots, mais mon père, non. Ils se sont aimés malgré cette différence sociale. Cet héritage résume bien ma carrière, ma façon d’appréhender la musique, partagé entre le griot, né pour chanter, raconter l’histoire, et celui qui a dû travailler pour devenir musicien. À mes débuts, ce n’était pas simple de faire accepter à mon père ma vocation. Originaire de l’intérieur du Sénégal, il a quitté son village natal pour Dakar. Il n’a pas eu l’opportunité d’aller à l’école et tenait beaucoup à ce que moi, son fils aîné, étudie. Et voilà que je refuse pour faire de la musique ! Il a un peu bataillé. Mais quand je me suis vraiment lancé, il était fier de moi.
Pour imager mon attachement et ma présence à Dakar, je suis comme un pêcheur qui quitte les côtes sénégalaises, voyage et revient avec des poissons, sûr que les gens vont l’attendre et apprécier le fruit de sa pêche. J’aime le monde, parce que j’aime Dakar ! Je pars, je rencontre d’autres sonorités, mais chaque fois, je reviens pour m’assurer que ma musique est validée ici. C’est aussi ce qui m’a poussé à créer des infrastructures, un studio à Dakar. Avant, on galérait pour enregistrer : c’était soit à la radio nationale, soit à Paris. Les sessions à Paris étaient concentrées sur quelques jours, chaque heure était comptée, on était stressés ! Ça pouvait impacter le travail. Le jour où j’ai pu enregistrer, tout en faisant ma pause déjeuner avec mes enfants… Quel bonheur !
Il faut continuer à promouvoir le panafricanisme, l’harmonie entre les Africains, pour qu’ils parlent d’une seule et même voix. Et que sa jeunesse soit consciente. Cette nouvelle génération va vraiment prendre les choses en main. La force de l’Afrique, c’est sa jeunesse. ■

«Les Africains doivent parler d’une seule et même voix.»
Corne de l’Afrique
DJIBOUTI,VEILLE
Les élections législatives, prévues fin février, ouvrent une nouvelle séquence politique

D’ÉCHÉANCES
au moment où le pays se mobilise pour renouveler son modèle de croissance.
 par Thibaut Cabrera
De nouveaux logements dans la capitale.
par Thibaut Cabrera
De nouveaux logements dans la capitale.
En Afrique de l’Est, dans la corne du continent, dans cette région aussi tourmentée que prometteuse, Djibouti est certainement un cas tout à la fois symbolique et particulier. « Coincé » entre la très fermée Érythrée au nord, l’instable Éthiopie à l’ouest, et la turbulente Somalie au sud, le pays conserve depuis maintenant deux décennies un statut de plate-forme régionale stable soutenue par un ambitieux projet de développement. Petit en superficie, ce jeune État de 45 ans est pourtant le produit d’une longue histoire et d’une diversité des transhumances. La consolidation de la nation est l’un des défis lors de l’indépendance du pays le 27 juin 1977. Et ce n’est qu’en 2001, au sortir de la guerre civile, qu’il connaît un véritable apaisement. Vingt ans plus tard, Djibouti entre dans le club des nations émergentes, dotée d’une industrie portuaire, d’une véritable plate-forme logistique et d’une économie de service. Entre 1999 et 2012, le PIB a presque triplé. Et a été multiplié par 2,5 sur les huit années qui ont suivi. Quant au PIB par habitant, il est passé de 757 dollars en 1999 à 3 425 dollars en 2021 (+350 %). Des résultats liés au volontarisme du président Ismaïl Omar Guelleh (IOG), qui a su parier sur la situation géostratégique de Djibouti, au croisement des principales routes maritimes mondiales. Et à l’entrée du détroit de Bab el-Mandeb. En s’appuyant sur le marché éthiopien voisin, en organisant le dialogue avec les grandes puissances du monde, les États-Unis, la Chine, la France…, en manœuvrant habilement pour la défense de ses intérêts, Djibouti s’est ménagé un avenir et un espace diplomatique et d’influence notable.
UNE ÉCONOMIE FRAGILISÉE MAIS RÉSILIENTE
Réélu en avril 2021 pour un cinquième mandat consécutif de cinq ans, le chef d’État cherche à maintenir un rythme de croissance élevé et une dynamique forte de développement. Les élections législatives qui auront lieu fin février représentent une étape importante de cette nouvelle séquence. Et elles interviennent dans un contexte socio-économique complexe. Comme ce fut le cas pour toutes les économies africaines et mondiales, le Covid-19 a frappé de plein fouet le pays en 2020. La gestion de la pandémie a été saluée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et Djibouti fait partie des très rares États qui ont su préserver un taux de croissance positive (+0,5 %) cette année-là. Mais tout juste sortie de la tempête, l’économie va être confrontée à plusieurs événements successifs freinant sa relance.
En Éthiopie, l’instabilité et la violence des deux dernières années n’ont pas aidé. Ce géant de plus de 100 millions d’habitants est l’un des 44 pays dans le monde qui n’ont aucun accès à la mer. Depuis 1993 et la sécession de l’Érythrée, Djibouti est ainsi le principal débouché maritime de son grand voisin. Près de 95 % des exportations et 80 % de ses importations transitent via le corridor nord-est, par Djibouti et ses ports. La ligne de chemin de fer inaugurée début 2017 a fluidifié et densifié la
connectivité entre les deux pays. Dès lors, une crise grave en Éthiopie – principal marché pour le petit État – provoque, de manière quasi automatique, une contraction de l’économie djiboutienne. C’est le cas avec le conflit qui a opposé entre 2020 et 2022 le gouvernement fédéral aux forces du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT). Renchérissement du coût des transports, augmentation du tarif des exportations éthiopiennes, déplacements de réfugiés, et réémergence de tensions entre les ethnies afar et somali font partie des lourdes conséquences qui ont impacté le pays. Et pourtant, l’axe Djibouti-Addis-Abeba n’a jamais cédé. Les trains entre les deux capitales ont circulé sans discontinuer pendant ces deux années de guerre civile. L’exploitation du chemin de fer a généré plus de 86 millions de dollars en 2021, soit 37,5 % de plus qu’en 2020, et près de 47,5 millions de dollars sur les cinq derniers mois de l’année 2022. Depuis la fin du conflit, qui s’est conclue par la signature d’un traité de paix fragile en novembre dernier, la situation semble revenir très lentement à la normale.
Autre point de tension majeur pour l’économie, particulièrement fragile aux chocs externes : le conflit russo-ukrainien. Djibouti reste un importateur net de carburant et de nourriture – 90 % de ses besoins alimentaires sont importés, et 45 % de son blé provient d’Ukraine. Les conséquences de l’invasion par la Russie sont donc brutales. En 2022, le taux d’inflation annuelle, principalement portée par la hausse des prix des denrées alimentaires, a atteint 6,6 % en moyenne selon le Fonds monétaire international (FMI), un record sur les dix dernières années. De plus, plusieurs grands exportateurs ont instauré des mesures d’interdiction d’exportation concernant certains produits jugés vitaux, comme l’Inde ou la Malaisie, qui ont proscrit l’huile de palme raffinée, le blé ou les volailles. En juin dernier, le voisin éthiopien, lui, a tenté de compenser ses dépenses liées au conflit
Tant pour les États-Unis que pour la Chine et l’Europe, Djibouti doit rester un point de stabilité dans une région stratégique.
 Le président Ismaïl Omar Guelleh, dans son bureau. Il a été réélu pour la cinquième fois consécutive en avril 2021.
PATRICK ROBERT
Le président Ismaïl Omar Guelleh, dans son bureau. Il a été réélu pour la cinquième fois consécutive en avril 2021.
PATRICK ROBERT
tigréen en augmentant les tarifs de ses exportations vivrières, notamment vis-à-vis de Djibouti. Combinées à l’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse, ces tensions provoquent une hausse de l’insécurité alimentaire. Face aux risques, les appuis internationaux n’ont pas manqué. Et l’exécutif a adopté un plan d’action visant à stabiliser les prix des matières premières (sucre, huile de cuisson, lait, blé, etc.).

Conséquence de ces situations extraordinaires, Djibouti est confronté à des pressions financières à court terme. Des difficultés qui s’inscrivent aussi dans un contexte global de crise de la dette des pays émergents. Et qui paraissent maîtrisées au niveau de l’État. Les arriérés de la dette ont augmenté pour atteindre 3 % du PIB en juin 2022. Le coût du service de la dette extérieure a triplé entre 2021 et 2022, passant de 54 millions à 184 millions de dollars. Cette hausse, qui s’explique largement par l’expiration de l’initiative de suspension du service de la dette du G20, alimente évidemment les polémiques sur les capacités de remboursement du pays. Et ce, notamment auprès de la Chine, son principal créancier. Entre 2000 et 2020, Beijing lui a prêté un montant d’environ 1,5 milliard de dollars. Cette somme a permis de mener à bien plusieurs projets d’infrastructures importants et générateurs de plus-value : le chemin de fer avec l’Éthiopie, le port polyvalent de Doraleh (DMP), ou encore la zone franche de Djibouti. Dans tous les cas, le pays bénéficie de deux atouts permettant de garantir l’intérêt des investisseurs internationaux et la compréhension des créanciers. D’abord, la stabilité du franc djiboutien, la monnaie nationale, arrimé au
dollar (depuis 1973, 1 dollar = 177,72 francs djiboutiens), permet de maintenir la confiance et de limiter les effets inflationnistes provoqués par les différents chocs. Ensuite, le pays sait maintenir une diplomatie stratégique active à équidistance avec ces partenaires. Tant pour les États-Unis que pour la Chine et l’Europe, il doit rester un point de stabilité dans une région stratégique. Et début décembre 2022, Ismaïl Omar Guelleh profitait du sommet Chine-États arabes, à Riyad, pour s’entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping. Quelques jours plus tard, lors du sommet États-Unis-Afrique, à Washington, il rencontrait le dirigeant américain Joe Biden.
DES LÉGISLATIVES HAUTEMENT POLITIQUES
C’est donc dans ce contexte que, le 24 février prochain, la population sera appelée aux urnes pour les élections législatives. Deux ans après la présidentielle qui a reconduit IOG à la tête de l’État, et un an après les communales et les régionales remportées, elles aussi, par la coalition au pouvoir, l’Union pour la majorité présidentielle (UMP). Depuis l’instauration du multipartisme en 2002, l’opposition n’a jamais réellement pu émerger et s’inscrire dans la durée. En 2021, Ismaïl Omar Guelleh avait affronté un seul adversaire, l’homme d’affaires Zakaria Ismaël Farah, candidat du Mouvement pour le développement et l’équilibre de la nation djiboutienne (MDEND). Le reste de l’opposition avait boycotté le scrutin. Lors des élections communales et régionales de mars dernier, seules les listes de l’UMP concourraient dans cinq des six régions du pays.
Et de redonner de l’élan, de la perspective à l’action.

Pour les législatives, on se dirige vers un scénario relativement similaire avec un boycott de l’opposition radicale, déjà annoncé il y a plusieurs mois. Au total, quatre formations politiques ont déposé leurs listes : l’UMP, l’Union pour la démocratie et la justice (UDJ), dans les seules circonscriptions de Djibouti-ville et d’Arta, l’Alliance des mouvements pour l’alternance démocratiques (AMAD), à Djibouti-ville, et le Centre démocrate unifié (CDU), uniquement dans la circonscription d’Ali Sabieh. Le 31 janvier dernier, le ministre de l’Intérieur Said Nouh Hassan a pourtant finalement annoncé l’irrecevabilité

Il s’agit de souligner les acquis, les efforts collectifs.
des candidatures de l’AMAD et du CDU, qui n’ont « pas rempli les conditions ». À cause de pièces manquantes, d’un dossier incomplet ou d’un non-paiement de la caution – qui s’élève à 500 000 francs par candidat –, ces listes ne pourront pas concourir. Au micro de RFI, l’opposant Abdourahman Guelleh, président du Rassemblement pour l’action, la démocratie et le développement écologique (RADDE), parle, lui, d’un « scrutin sans enjeu » pour justifier le boycott de son parti.
Pourtant, le débat aura bien lieu d’une manière ou d’une autre. Comme le souligne un proche du palais : « Notre bilan est incontestable. Mais malgré les efforts continus du gouvernement, les réels progrès sur le plan social, les infrastructures, l’habitat ou encore l’éducation, la question de la pauvreté reste d’actualité. Et nous sommes victimes du contexte général, tant régional qu’international, qui a fragilisé notre économie. » La question du chômage, en particulier, reste urgente. En 2022, celui s’élevait encore à près de 50 %. Il s’agit donc pour le gouvernement et la majorité de souligner les acquis, les efforts collectifs, mais aussi de redonner de l’élan, du souffle, de la perspective à leur action.
Ces élections seront donc hautement politiques. Elles constituent une nouvelle étape dans le processus de construction institutionnelle. Des progrès ont ainsi été identifiés en matière d’organisation et de transparence. La Commission nationale de la communication (CNC) aura la charge, lors de la campagne, de garantir une répartition médiatique équitable du temps d’antenne des partis en lice. Son président, Ali Mohamed Dimbio, insiste : « Nous avons pour mission de veiller au respect d’une information plurielle à Djibouti. » Le jour du scrutin, la représentation de tous les groupes politiques sera également assurée dans les bureaux de vote. Enfin, dans la lignée des législatives de 2018, la représentation des femmes à l’hémicycle devra atteindre un minimum de 25 %. La Commission nationale électorale indépendante (CENI), en charge d’organiser le
vote, pourra s’inspirer du travail effectué par la Commission électorale régionale indépendante (CERI), qui était chargée des locales de 2022. Avec un taux de participation intéressant et de nettes améliorations logistiques, celles-ci ont permis de progresser dans le transfert de compétences aux collectivités territoriales. Les autorités souhaitent que les législatives s’intègrent dans cette même dynamique.
Elles marqueront enfin une étape nouvelle du mandat d’Ismaïl Omar Guelleh. Ce sera la dernière grande échéance électorale avant la présidentielle de 2026. Chacun connaît le sens du timing et des équilibres d’IOG. Mais certains observateurs n’excluent pas un remaniement ou des changements dans « l’organigramme du pouvoir ». En toile de fond se pose la grande question de la succession : l’article 23 de la Constitution fixe en effet l’âge limite pour tout candidat aux fonctions de président à 75 ans, et l’actuel chef d’État, qui vient tout juste d’atteindre cet âge, n’a pas donné l’impression de vouloir changer les textes. Les législatives permettront donc de tester le personnel politique. En particulier les troupes et les cadres du parti présidentiel, le Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), qui devrait être amené – sauf changement majeur – à désigner un successeur à Ismaïl Omar Guelleh.
En attendant ces échéances à la fois proches et lointaines, ce dernier reste concentré sur un chantier prioritaire : celui de l’unité nationale. C’est l’idée de la « djiboutinité », cette

Le gouvernement souhaite accentuer les investissements dans les domaines du tourisme vert, de l’énergie et de l’économie bleue.
appartenance à la nation au-delà des ethnies, des différences, la création progressive d’une identité commune. Une manière de faire front aussi face aux déstabilisations importées, de répondre par l’exception djiboutienne aux conflits qui déchirent les pays voisins. Le 27 juin dernier, lors des célébrations du 45e anniversaire de l’indépendance, le chef d’État inaugurait le Mémorial du barrage de Balbala, un véritable symbole pour le pays. En août 1966, les forces coloniales françaises installaient un double barrage, miné, pour isoler la presqu’île de Djibouti afin d’en contrôler les accès terrestres. Un « mur de la honte » pour les militants indépendantistes. Et qui impose aujourd’hui, selon les termes d’IOG, « un devoir de mémoire qui participe à la cohésion de [la] société et à l’affermissement de [l’]identité nationale ».
TOURNÉ VERS L’AVENIR
En tous les cas, « pour le président et pour le pays, le contexte est porteur à moyen terme », souligne un homme d’affaires de la région. Après un ralentissement du taux de croissance du PIB en 2022 (3,6 %, contre 4,8 % en 2021), la Banque mondiale anticipe son accélération en 2023 (5,3 % estimé) et en 2024 (6,2 %).
L’économie devrait bénéficier des retours positifs de la mise en œuvre du deuxième plan national de développement (PND), Djibouti ICI – pour Inclusion-connectivité-institutions – et des grands programmes d’investissement en cours. C’est le cas de
l’immense projet Djibouti Damerjog Industrial Development (DDID), prévu sur une période de quinze ans (2020-2035), et qui devrait accueillir deux raffineries, la jetée du terminal pétrolier et les premières unités d’industries lourdes du pays. Sa réalisation devrait entraîner la création de plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Et renforcer la place de Djibouti comme la plate-forme de choix entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Outre le développement industriel, le gouvernement souhaite accentuer les investissements dans les domaines du tourisme vert, de l’énergie et de l’économie bleue. Ainsi, dans le cadre du programme Vision 2035, le pays ambitionne d’atteindre les 100 % d’énergies renouvelables produites sur son sol. En janvier dernier, les dirigeants ont signé un accord préliminaire de coopération technologique avec la multinationale Hong Kong Aerospace Technology pour la réalisation d’une plate-forme de lancement de satellites et de fusées. Un projet assez fou, valorisé 1 milliard de dollars, et qui pourrait permettre un jour le lancement du premier satellite africain depuis le continent…
De l’intention aux réalisations, il y a évidemment quelques pas sérieux à accomplir. Et les ambitions de développement de Djibouti peuvent parfois paraître « hors de portée ». Pourtant, en observant l’évolution et la réalité du terrain depuis deux décennies, force est de constater qu’elles ne sont pas toutes irréalisables… ■


entretien
Tahar Ben Jelloun « ALLER VERS LA LUMIÈRE »

Son pays natal, le Maroc, est la source vive d’une grande partie de son œuvre. À travers l’intime, la vie quotidienne et citoyenne, les souvenirs ou l’actualité, l’écrivain et poète à la carrière internationale ne cesse d’interroger le monde qui l’entoure. propos recueillis par Catherine Faye
L’Orangeraie. Ce n’est pas un hasard si l’auteur de l’énigmatique L’Enfant de sable, de La Nuit sacrée, prix Goncourt 1987, ou encore du Racisme expliqué à ma fille, nous donne rendez-vous dans ce café parisien, tenu par un couple de Kabyles. Une manière pour cet homme de l’entre-deux de retrouver, au cœur de la capitale française, le goût du thé à la menthe et l’évocation du parfum de la fleur d’oranger. Entre le Maroc et la France, Tahar Ben Jelloun a connu mille et une vies. Philosophe, poète, opposant politique, journaliste, psychothérapeute, écrivain, juré littéraire… Depuis la publication en 1973 de Harrouda, son premier roman, avec lequel il fait scandale en abordant la sexualité, ce virtuose des mots et de la couleur ne cesse de construire une œuvre multiforme. Son dernier livre brosse un portrait des travers de son temps
(corruption, infidélité, richesse, pauvreté, islamisme…), tout en évoquant le « plus beau pays du monde », le Maroc, dénominateur commun de ces 14 nouvelles, incisives, poignantes, sensibles, tragiques, comme autant de tableaux, par celui dont le parcours n’en finit pas d’être guidé par deux passions : l’écriture et la peinture. Deux façons de dire le monde. Des tréfonds à la lumière. Et un cheval de bataille : la poésie, dont ces mots de la femme de lettres Andrée Chedid, et amie de l’auteur, nous disent la place du poète : « Nul mieux que lui ne s’accorde aux solitudes ; mais aussi, nul n’a plus besoin que sa terre soit visitée. » À l’automne paraîtront deux ouvrages : Les Arbres racontés aux enfants (L’Iconoclaste) et le Dictionnaire amoureux du Maroc (Plon).
AM : Votre nouvel ouvrage dépeint un Maroc tour à tour sublimé et critiqué. Quel lien entretenez-vous avec ce pays ?
Tahar Ben Jelloun : C’est une attache très forte et permanente, qui n’exclut pas la critique. Lorsqu’on aime, forcément, on désapprouve certaines choses. J’adore mon pays, et j’y vais le plus souvent possible, entre quatre et cinq mois par an. En même temps, quand j’arrive, certaines choses me sautent aux yeux. Pendant deux ou trois jours, je râle. Je suis alors un peu dans la peau d’un étranger. Je vois ce que les Marocains ne voient plus. Du reste, c’est le rôle de l’écrivain : être un témoin, qui regarde, observe et raconte des histoires, auxquelles il a été plus ou moins mêlé, qu’on lui a racontées ou qu’il a vu se dérouler devant lui. Dans ce livre, j’ai voulu faire un portrait de ce Maroc, qui reste pour moi le plus beau pays du monde, sur tous les plans. Sa diversité et la magie qui se dégage de bien des endroits sont indéniables. Je m’y sens bien. Ce qui n’était pas le cas lors des années de plomb, sous le règne d’Hassan II, durant lesquelles j’ai beaucoup souffert. J’évoque cette période dans La Punition, qui relate les dix-neuf mois de détention arbitraire d’étudiants, dont j’ai fait partie. Nous avions été sanctionnés pour avoir manifesté pacifiquement. Heureusement, depuis l’arrivée de Mohammed VI, tout le monde respire et vit bien ; il n’y a plus la pression d’autrefois. Mon rapport au Maroc n’est donc pas si simple. Qu’est-ce qui vous gêne le plus ?

D’abord, des problèmes quasiment endémiques : la situation dans laquelle se trouvent l’éducation et la santé, le rapport à l’administration, la corruption. Et, dans la vie quotidienne,
le manque de civisme des habitants. On le remarque surtout lorsqu’ils sont au volant. D’où un grand nombre d’accidents, de « crimes routiers », comme ils disent. Le Marocain pourrait, sur la base des valeurs qu’il porte, comme le respect de l’autre ou l’estime des personnes âgées, rester poli et vigilant. Tout vient du manque d’éducation : une base essentielle et profonde. En premier lieu, il faudrait former les enseignants ; c’est aussi à l’école que l’on apprend à être un bon citoyen. Je fais donc confiance à mon ami Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui a récemment réorganisé son ministère pour mieux réformer l’éducation. Parmi les villes évoquées dans votre livre, Tanger sort du lot. Pourquoi ?
Parce qu’elle a une identité particulière, avec une vocation internationale. Cosmopolite, elle a accueilli de nombreuses personnalités du monde de l’art, entre autres. Tanger est également un port ouvert à la fois sur la Méditerranée et l’Atlantique. Très peu de villes jouissent d’une telle double exposition, qui joue sur les mentalités, le comportement des gens. Enfin, le vent d’est, la proximité avec l’Europe, à 14 kilomètres de la côte espagnole, insufflent à cette ville de la pointe extrême du nord de l’Afrique quelque chose d’unique. Mohammed VI, qui l’aime beaucoup, contrairement à son père, qui la négligeait, a beaucoup œuvré pour l’embellir et pour son développement économique. Deuxième ville industrielle du pays, elle abrite le complexe industrialo-portuaire Tanger Med, une immense zone franche, et le TGV la relie à Casablanca. Je me souviens des critiques faites au roi lorsqu’il avait décidé de faire construire cette ligne. Il a bien fait de persévérer : le nombre d’accidents de la route a diminué, et les citoyens peuvent à présent se rendre en un peu plus de deux heures d’une ville à l’autre. Sans compter que le réseau fonctionne bien mieux qu’en France : ni grève, ni panne, ni retard. Ce TGV est une franche réussite, qui a transmis aux Marocains les notions de discipline et de ponctualité. En revanche, vous n’évoquez pas Rabat…
J’y ai fait mes études de philosophie dans les années 1960. Cette ville, jolie, très propre, ne fait pas rêver. Tout y est calme et tranquille. Parfaite pour les diplomates. Pour un romancier, Casablanca est plus intéressante ; c’est le bordel total. Il faut avoir un peu vécu dans cette mégalopole pour commencer à la connaître. C’est là que le Maroc des classes sociales se fait : avec une classe privilégiée, très fortunée, une
petite classe moyenne, pas encore bien formée, et une grande classe modeste, sinon pauvre. Tout ce monde coexiste dans une espèce de violence non dite, sous-jacente, avec une énergie extraordinaire. Autant, Rabat ou Tanger sont des villes où on prend le temps de paresser, autant, à « Casa », on n’a pas droit à cette nonchalance. C’est le Maroc moderne. J’y consacre d’ailleurs un livre, Les Amants de Casablanca, qui paraîtra en avril aux éditions Gallimard.
Comment vivez-vous votre double appartenance, française et marocaine ? Où vous sentez-vous le mieux ?
Je me sens très bien en Italie et chez moi, au Maroc. Depuis quelques années, je ne suis plus à l’aise en France. Par la France, j’entends Paris, qui est une ville extraordinaire, très belle, mais qui a été petit à petit défigurée par une femme incompétente. Nous, Parisiens, souffrons tous les jours des initiatives stupides et irrationnelles prises par Madame Hidalgo. Les transports en commun sont devenus d’une médiocrité inouïe, et les travaux en vue des jeux Olympiques sont tellement nombreux que, si vous prenez un taxi, vous tournez en rond. Je me sens bien chez moi, mais dès que je sors, je ressens une agressivité chez les gens. Il y a trois jours, alors que je faisais mes courses dans un supermarché, mon Caddie a touché celui de mon voisin : il s’est mis à me crier dessus. Les anecdotes en disent long du monde dans lequel on vit, de l’état d’esprit des gens. Paris est en train de perdre son âme, son humanité, sa poésie. La plupart des artistes que je connais partent. Pour ma part, mes quatre enfants sont là, et je ne peux pas ne pas les voir, me séparer d’eux. Je les aime, ils m’aiment, j’ai besoin d’eux, ils ont besoin de moi.
Le 14 décembre dernier, la demi-finale de la Coupe du monde de football a opposé le Maroc à la France. Qu’a évoqué ce match pour vous ?
J’ai regardé ce match au Maroc, ce qui a son importance. Je ne suis pas passionné de football, mais j’étais entouré d’amis exaltés, et c’est communicatif ! J’ai commencé à crier, moi aussi, c’était incroyable. Inutile de vous dire que j’étais 100 % marocain. J’aime beaucoup Mbappé, mais Hakimi est formidable également. L’équipe marocaine aurait pu gagner si l’arbitre n’avait pas refusé les deux penaltys… Bien entendu, c’est un jeu. J’aimerais bien qu’on résolve les problèmes par l’intermédiaire du sport. Au lieu de faire la guerre. Que nous dit ce sport universel, sans barrière de langue, de l’humanité ?
C’est une question que se posait déjà l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui détestait le football. Il a raconté qu’un jour, en ouvrant le journal, il avait lu que l’Argentine avait « écrasé » je ne sais plus quel pays. Avec ironie, il avait ajouté qu’il ne savait pas que, dans la nuit, il y avait eu une guerre. Ce sport éveille et attise les sentiments les plus primaires, avec des émotions absolument extraordinaires. À côté de moi, des hommes pleuraient lors de la demi-finale. Ils ne verseraient pas des larmes devant un tableau, mais, devant un match de foot,
ils le font ! Et c’est planétaire. Le football est en quelque sorte un phénomène de guerre qui, s’il génère parfois des bagarres, ne fait pas de morts. Malheureusement, il a été kidnappé par l’argent. Une Coupe du monde est regardée par 2 milliards de personnes. L’argent est en train de pourrir ce sport et d’en faire un business, où règne la corruption. Vous avez grandi à Fès et à Tanger. En quoi votre enfance continue-t-elle de vous habiter ?
Les écrivains puisent toujours dans leur enfance et dans leur adolescence. Je suis en train de lire une très bonne biographie de Philip Roth, dans laquelle on découvre que l’auteur américain a tout puisé dans sa jeunesse et dans sa relation avec ses parents. L’enfance détermine beaucoup de choses. Certains savent l’exploiter, en fabulant bien sûr, parce qu’il n’est pas question de se raconter tout le temps, sous peine d’être ennuyeux. Néanmoins, à partir de quelques détails, on peut écrire des histoires. Pour ma part, j’ai été élevé de manière très traditionnelle, dans le respect absolu de mes parents, dont je baisais la main, et des autres. Nous étions très pauvres, mais ne manquions de rien. J’avais deux chemises et deux pantalons ; mon père travaillait beaucoup, ramenait de quoi manger. Avec mon frère, nous étions heureux. C’était simple, nous nous contentions de ce que nous avions. Ma mère parlait très peu, ne disait du mal de personne. Elle était analphabète, mais elle avait sa culture, très respectable. Mon père savait lire et écrire, c’était un homme très drôle, sarcastique, qui faisait rire toute la famille. Il est mort depuis trente-trois ans, et pourtant, chaque fois que la famille se réunit, nous nous remémorons des anecdotes le concernant, et nous rigolons. J’ai hérité de cette dérision. Elle n’apparaît pas toujours dans mes livres,
« J’ai été élevé de manière très traditionnelle, dans le respect absolu de mes parents, dont je baisais la main, et des autres. Nous étions très pauvres, mais ne manquions de rien.»
mais dans la vie, je suis un peu comme ça. Je ne me prends jamais au sérieux.
Quel livre d’enfance vous a ouvert les portes de la littérature ?
Ils sont nombreux, car je lisais énormément ! Au moins un livre par semaine, que j’empruntais à la Bibliothèque française. Je pense à Thérèse Desqueyroux de François Mauriac, Sans famille d’Hector Malot, des extraits des Misérables de Victor Hugo, la comtesse de Ségur, La Fontaine, La Bruyère… À Tanger, nous allions au théâtre, voir des pièces classiques françaises. En réalité, ceux qui m’ont ouvert les portes de la littérature, ce sont les réalisateurs. Le cinéma a été pour moi une opportunité extraordinaire. Il m’a appris à raconter et à construire une histoire. Durant les années de collège et de lycée, je voyais un film par jour. Je me souviens des Quatre Cents Coups de François Truffaut, de L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford, de Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim – un moment très joyeux pour nous, au Maroc –, du mystérieux M le maudit de Fritz Lang. Avant toute chose, pour moi, il y avait Ava Gardner. J’allais voir tous les films où elle apparaissait ; j’en parle dans l’une des nouvelles de mon der-

nier livre, qui raconte la relation équivoque entre un homme et une sublime créature. J’y évoque Pandora d’Albert Lewin, un film sur le désir, l’amour fou, la beauté qui fait tourner la tête des hommes… Vous souvenez-vous des premières lignes que vous avez écrites ?
Je me rappelle les premières pages de mon premier roman, Harrouda, écrites sur du papier administratif marocain jaune, sur la table d’un ami peintre-architecte, à Casablanca, en 1971 ; un manuscrit que je ne parviens pas à retrouver, alors que j’en ai gardé une trentaine d’autres, consignés dans des cahiers. Harrouda prend sa source dans l’histoire extraordinaire d’une prostituée, vieille, qui mendiait dans les ruelles de Fès, et nous, enfants, lui demandions de nous montrer son sexe en échange de sucre. Alors elle soulevait sa robe, et on courait lui en chercher. À partir de cette image, inscrite dans ma mémoire, j’ai imaginé la vie de cette femme, puis, celle, distincte, de ma mère. Deux destins de femmes. J’y parle aussi de Fès et de Tanger, je les oppose. Ce qui me fait plaisir, c’est que, cinquante ans après sa parution, ce roman est toujours en vente. Lorsque je fais des dédicaces, on me demande chaque fois d’en signer un exemplaire.
Votre langue maternelle est l’arabe dialectal. Pourquoi avoir préféré le français pour écrire ?
Je me suis emparé de la langue française avec fougue et passion parce que je considérais que l’arabe était acquis et qu’il fallait briller dans une langue étrangère. Par ailleurs, je lisais beaucoup plus en français qu’en arabe. Surtout les grands poètes, notamment ceux de la Résistance, et les écrivains français du XIX e siècle et du début du XX e siècle. Ma culture, mes références sont majoritairement françaises. En tant que membre du jury de l’académie Goncourt, je lis aujourd’hui, chaque été, entre 30 et 40 romans contemporains pour le Prix. J’ai donc un peu négligé la langue arabe classique. Ce choix a été pour moi non discutable. D’autres écrivent en plusieurs langues, moi non. Pourtant, je rêve probablement dans les deux langues, comme dans la vie. Quelle relation entretenez-vous avec les mots ?
Vous vous souvenez de ce livre magnifique de Sartre, Les Mots ? L’auteur parle de l’enfance, des livres. Des mots pour exister. Tout y est dit. Cependant, les mots peuvent être dangereux, et le travail d’un auteur est de savoir être un bon ami, les utiliser, même parfois les tordre, sans qu’ils se fâchent. Et puis, il y a la poésie. Elle est fondamentale. C’est elle qui sauvera le monde. Il faut inciter les enfants à en lire, leur donner cette envie. Si on n’en lit pas, quoi que l’on veuille faire plus tard, ce n’est pas la peine. Je pense, par exemple, au poète congolais Tchicaya U Tam’Si, dans le sillage d’Aimé Césaire. À Aragon également, l’un des plus grands poètes du XX e siècle, dont on se souviendra à travers sa poésie, et non ses romans. Ce genre littéraire, c’est comme les mathématiques. Il doit être précis, le mot doit être à sa place, même si dans la vie courante, ce n’est pas le cas. Lorsque Paul Éluard écrit : « La terre est bleue comme une orange », rien ne semble être à sa place, et pourtant c’est l’un de ses plus beaux vers. Prononcé à voix haute, il fait rêver les enfants.
Un écrivain doit-il nécessairement
être un témoin de son époque ?
Il est témoin de tout, pas uniquement des drames, ou de la vie quotidienne. Dans la littérature contemporaine française, les écrivains sont trop souvent témoins d’eux-mêmes. Ils ne regardent pas ailleurs. Il me semble qu’on a abusé de l’autofiction. Pour moi, un auteur intéressant est celui qui nous amène ailleurs, nous emporte, comme le fait Le Clézio, par exemple. Celui qui nous raconte une histoire. Bien sûr, il y a aussi l’urgence, qui a toujours été le point de départ de l’écriture. Toute la poésie part d’ailleurs de là. Quand des personnes meurent assassinées, comme elles le sont en ce moment en Iran, on l’exprime par l’écrit, par la poésie. Il existe donc une urgence, une nécessité. C’est le cas, par exemple, du roman de Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes. Un livre nécessaire sur la condition de la femme au Sahel, où l’écrivaine camerounaise interroge la question universelle des violences faites aux femmes.
Depuis une quinzaine d’années, vous naviguez entre écriture et peinture. Peindre a-t-il changé votre rapport à l’écriture ?
J’ai toujours dessiné. Puis, j’ai peint. Aujourd’hui, la peinture est devenue un travail sérieux, professionnel. Qui révèle un autre aspect de moi-même. Si, dans l’écriture, je traque les problèmes, dans la peinture, je mets de la lumière, de la joie, du plaisir. J’ai exposé trois grandes toiles dans la prestigieuse basilique Sainte Marie des Anges et des Martyrs, à Rome, dans le cadre d’un hommage rendu au juge Rosario Livatino, assassiné par une organisation mafieuse en 1990 et béatifié l’année dernière. On m’a demandé d’apporter de la lumière, un regard optimiste. Sur l’un des tableaux, j’ai ajouté un vers de Dante : « Dans ton ventre se ralluma l’amour, par la chaleur duquel, dans la paix éternelle, est ainsi éclose cette fleur. » C’est la première fois qu’un artiste musulman entre, au travers de son œuvre, dans une cathédrale.
Que vous évoque ce vers de Jacques Prévert : « La couleur de la lumière et celle de l’obscurité sont deux sœurs jumelles de la même clarté » ?
La lumière et l’obscurité sont en effet toutes deux amoureuses de la clarté. Des ténèbres, on va vers la lumière. Une métaphore pour dire qu’au bout des tunnels, que sont les angoisses de tout un chacun, une lueur brille toujours. L’appel de la vie. Aujourd’hui, l’angoisse du monde est partout. En Europe, les gens manquent de spiritualité, vivent mal, même s’ils ont les moyens de bien vivre. Ailleurs, il y a la survie. Un tunnel fait de guerres, de violences, de privation de libertés. L’homme a besoin d’espoir. D’aller vers la lumière. ■
« Aujourd’hui, l’angoisse du monde est partout. En Europe, les gens manquent de spiritualité, vivent mal, même s’ils ont les moyens de bien vivre. »
Djamel Tatah

CONJUGUER LE « JE » ET LE « NOUS »
Puissante, méditative, sa peinture aux personnages énigmatiques questionne notre monde, la condition humaine, sa vulnérabilité. Entretien avec un artiste franco-algérien singulier, qui articule l’intime avec le collectif.
propos recueillis par Astrid Krivian

Àla fois figurative et abstraite, la peinture de Djamel Tatah témoigne des contradictions, des paradoxes de la condition humaine, entre solitude et quête du lien, évoque sa fragilité, prise dans la violence du monde.

Peuplant ses toiles, des figures humaines esseulées, tels des archétypes, figées ou en mouvement, en errance, en suspension, semblent prêtes à basculer vers une chute ou une élévation. Elles paraissent ignorer le spectateur, ou l’interpellent au contraire par un regard frontal.
Par un effet d’écho, de résonance, de répétition, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, un certain personnage est représenté dans une série de plusieurs toiles, quand d’autres sont réunis au sein d’un même tableau, à l’image d’un chœur de tragédie grecque. Placés dans un espace indéfini, sur des aplats de couleur, ses protagonistes sont à échelle humaine, dans des tableaux de très grand format, ce qui renforce leur présence, leur effet sur le regardeur. Énigmatiques, dépouillées (ni décor ni objets, à quelques exceptions près), en majorité sans titre, ses œuvres placent l’humain au centre, sont des méditations sur une épreuve intime ou un drame collectif – guerre, exil… –, des évocations de situations banales, quotidiennes. Elles laissent le spectateur libre d’imaginer, de ressentir, de se questionner.
Né en 1959 à Saint-Chamond, dans la Loire, ancien élève des Beaux-Arts de Saint-Étienne, Djamel Tatah expose son travail dans le monde entier. L’enjeu de son œuvre est de conjuguer le « je » et le « nous », le particulier et l’universel, l’altérité et le semblable. Derrière son style unique se trouvent un processus créatif singulier et une boîte à outils hétéroclite. L’artiste puise dans des sources iconographiques très diverses : photographies personnelles, clichés médiatiques des calamités actuelles, mais aussi fragments d’œuvres de l’histoire de l’art, toute époque confondue. Puis il amalgame, agrège, métabolise ces éléments variés à travers la numérisation, la palette graphique, le dessin. Il opère un travail de distanciation, détachant ces matériaux de leurs contextes historiques, politiques. Miroir de notre monde, son art porte aussi une dimension intemporelle.
AM : Votre exposition au musée Fabre, à Montpellier, « Le Théâtre du silence », rassemble une quarantaine de tableaux. Quelle place tient le silence dans votre travail ?
Djamel Tatah : Je ne travaille pas spécialement sur le silence, mais mon œuvre est reçue par certains spectateurs comme très silencieuse. En tant qu’artiste, on propose quelque chose que les autres perçoivent à leur façon. J’ai accepté cette interprétation autour du silence ; elle me plaît. Les commissaires de l’exposition, Michel Hilaire et Maud MarronWojewodzki, ont présélectionné certains tableaux et suggéré différents thèmes : « Aux origines de la peinture », « En suspens », « Répétitions », « Présences »… Ils m’ont demandé un titre pour l’exposition. Pour moi qui n’en donne plus à mes tableaux depuis longtemps, c’était très compliqué ! En fin de compte, j’ai trouvé que « Le Théâtre du silence », proposé par Maud Marron-Wojewodzki, sonnait juste.
Comment composez-vous vos personnages ? Leurs visages expriment un sentiment tout en s’écartant de la psychologisation du caractère. Mais ce qu’ils ont à vous dire ne vous intéresse pas, précisez-vous…
La dimension psychologique du modèle ne m’intéresse pas. Je m’en suis distancié très rapidement. Dès mes débuts, je ne voulais pas faire de portraits. J’aspirais à une représentation de l’humain de notre temps sans identité spécifique ou psychologie particulière. Je tends vers des figures beaucoup plus abstraites qui toutefois évoquent des sensations, des sentiments propres à chacun de nous. C’est l’humain qui est au centre de mon œuvre.
Le silence est-il aussi une résistance au bruit du monde, à ses violences ?
Oui. À travers ma peinture, j’essaie de résister à son bruit, de m’en écarter, mais, en même temps, je suis dans le monde. Il s’agit de faire trace, de montrer que le monde d’aujourd’hui n’est pas si différent de celui des anciens : guerres, injustices, misère sociale, échec du politique… L’humain échoue encore à bâtir une société juste et pacifique. Ma peinture est le témoin de notre temps et de ses résonances en moi.
Vos personnages semblent habités par une mélancolie et évoluer dans une solitude, « en quête de solidarité », pour vous citer…
Mon art évoque la solitude des êtres pris dans la violence du monde. À mes yeux, il existe deux formes de solitude : la sociale, que tout le monde peut connaître au cours de sa vie, à la suite d’un drame, d’une chute… Et celle que j’appelle la solitude vertueuse, dont on a besoin pour être avec nous-même et penser le monde. Dans un monde qui s’accélère, j’ai envie de ralentir. Pour ça, j’ai besoin d’être seul.
Une œuvre est réussie si, installée à côté d’un écran, elle parvient à captiver le spectateur ?
Nous sommes entrés dans un monde où le déferlement des images est un flux permanent, très rapide, considérable. On consomme des images comme de la nourriture. Pour moi, une œuvre d’art est bien plus puissante que ce bavardage incessant. L’idée est de faire jouer les tableaux entre eux, mais aussi qu’ils soient autonomes ?
La mise en perspective des tableaux les uns par rapport aux autres est une manière de mettre en œuvre sa pensée. Poser un tableau en face ou à côté d’un autre provoque toujours un sentiment nouveau, une idée nouvelle. En m’intéressant au cinéma, au montage, j’ai compris comment établir des liens entre les œuvres et comment faire entrer le spectateur dans un univers. Pour cette exposition au musée Fabre, nous avons veillé à créer des résonances entre les tableaux, à faire dialoguer les thèmes dans une mise en scène particulière, avec des espaces ouverts.
En découvrant notamment Shadows, d’Andy Warhol, lors d’une exposition, vous avez pris conscience dès vos débuts que peindre, c’était occuper un espace ?
Que le tableau était un espace en soi ?
En effet. Le principe répétitif de Shadows a éclairci quelques intuitions que j’avais en moi. On ne fait jamais les choses seul. Les artistes que l’on rencontre et que l’on affectionne nous enseignent toujours quelque chose de particulier, en lien avec ce que l’on cherche.
Pourquoi vos personnages sont-ils à échelle humaine ?
L’idée d’entrer dans un tableau à plein corps me plaît beaucoup. Des tableaux miroirs de Michelangelo Pistoletto à Un bar aux Folies Bergère d’Édouard Manet… De tout temps, l’artiste a eu envie d’inviter le spectateur dans la scène, de le mettre en situation. En témoignent aussi les grandes fresques au sein des églises, où la mise en scène est liée à l’architecture du lieu. En comprenant ce que j’aimais chez les autres, je me suis approprié le dispositif de représentation de la figure humaine à l’échelle du corps. Mon expérience s’est construite ainsi, en opérant des choix. Faire de l’art, c’est prendre constamment des décisions.

Pourquoi ne donnez-vous pas de titre à vos tableaux ?
On parlait du silence… Je ne veux pas enfermer le spectateur dans ma lecture personnelle de l’œuvre. C’est plus intéressant pour lui. Et pour moi [rires] ! Je n’ai pas d’imagination pour les titres. C’est aussi simple que ça ! Seule une minorité de tableaux ont un titre ; ce sont les tableaux du début.
« On consomme des images comme de la nourriture. Pour moi, une œuvre d’art est bien plus puissante que ce bavardage incessant. »
L’un de vos rares tableaux titrés, Les Femmes d’Alger (1996), propose une interprétation plus orientée. Il évoque les femmes algériennes pendant la guerre civile qui ravageait l’Algérie dans les années 1990… Oui. J’ai eu envie de rendre hommage à la grande force de résistance pacifique de ces femmes qui descendaient dans la rue pour manifester. À travers ce titre, j’ai ajouté un élément plus conceptuel : faire référence au tableau Femmes d’Alger dans leur appartement d’Eugène Delacroix, peint en 1833, dans les premières années de la colonisation française en Algérie. Même si, formellement, nos œuvres sont très différentes, c’est une façon de dire que, depuis l’époque coloniale, le pays ne s’en est pas sorti, son peuple souffre encore. Ces femmes adoptent une position hiératique par rapport à la violence du monde. Elles attendent leurs droits. Ce tableau résonne au-delà de l’Algérie ; aujourd’hui encore, les femmes revendiquent leurs droits partout dans le monde. À partir d’un événement précis, historique, j’ai essayé de proposer une lecture plus universelle. Dans le catalogue de l’exposition, sur le fait d’être français d’origine algérienne, vous indiquez être un « mutant » : « C’est quelqu’un qui a conscience de ses origines. Il porte en lui une ouverture sur l’autre, l’ailleurs… dans un devenir dont il ne maîtrise pas la finalité, et c’est sa richesse. »

On me demande sans cesse d’où je viens et qui je suis. Comme il faut bien à un moment donné se définir, je réponds que je suis un mutant. Ma famille vient d’Algérie, mais je suis né en France et je suis français. Visiblement, il faut sans cesse le répéter. Avant la colonisation française en Algérie, nous étions des Algériens, des Berbères, et basta ! Depuis 1830, on est assignés à une identité. Mais en fin de compte, la France est peuplée de mutants. Nous sommes tous en mutation. Au sein de votre arbre généalogique, vous trouverez toujours un ancêtre qui vient d’ailleurs… Je suis un Français en mutation. Je reconnais ma part d’ailleurs. J’ai récemment appris que Léopold Sendar Senghor avait créé l’Université des mutants sur l’île de Gorée, au Sénégal. Avec mon ami regretté Rachid Taha, on parlait instinctivement de ce concept ! D’ailleurs, ça veut dire quoi être français ? Moi, ce qui me plaît en France, c’est l’idée de République, l’État de droit, une valeur fondamentale peu respectée dans le monde. Mais au niveau identitaire, je suis un mutant.
Comment avez-vous connu Rachid Taha ?
Nous sommes originaires de la même région, lui de Lyon, moi de Saint-Étienne. J’étudiais aux Beaux-Arts, et lui venait
de créer son groupe Carte de séjour. On est devenus amis. On a grandi ensemble, en suivant des chemins parallèles. C’étaient de grands échanges amicaux, artistiques. Nous étions en conquête de la vie, nous sortions danser, boire des verres, visiter des expositions, nous partions en vacances ensemble…
Dans votre tableau Autoportrait à la stèle (1990), vous citez cette phrase d’Albert Camus, extraite de son recueil Noces : « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans mesure. » Ces mots sont gravés sur une stèle érigée en l’honneur de l’auteur à Tipaza, en Algérie, en 1961. Que représente-t-il pour vous ?
C’était un grand penseur humaniste en quête d’un monde juste. Il connaissait la nature humaine et en parle avec une gravité noble. J’avais 30 ans quand j’ai peint ce tableau. J’ai fait de cette citation un petit manifeste personnel. C’était aussi une manière de communiquer avec lui. C’est une très belle phrase qui porte une pensée magnifique : quand on découvre le monde et ce qui nous passionne dans la vie, on est attiré par cette force, mais on comprend aussi avec humilité que la gloire n’est pas grand-chose. Aimer est beaucoup plus important.
Quand est né votre amour de la peinture ?
Dans l’enfance. Comme j’adorais dessiner, mon père m’achetait des crayons, des pastels. C’était un moyen pour
« On me demande sans cesse d’où je viens et qui je suis. Comme il faut bien à un moment donné se définir, je réponds que je suis un mutant. »
lui que je reste à la maison, concentré, plutôt que de traîner dehors. Notre logement était exigu, nous étions nombreux, il n’y avait pas de livres… Alors, on allait dans la rue. J’ai arrêté l’école en troisième. J’ai enchaîné plein de jobs. J’ai travaillé dans une usine, et un jour, j’ai craqué. Cette vie n’était pas faite pour moi ! À 20 ans, j’ai eu envie de retourner au dessin, donc j’ai travaillé en vue de passer le concours de l’école des Beaux-Arts.
En quoi la peinture est-elle pour vous l’écriture la plus raffinée ?
La peinture est un langage visuel. Nul besoin de parler toutes les langues du monde pour regarder et comprendre un tableau. Deux personnes peuvent ainsi communiquer, le regardeur et l’artiste. C’est aussi un art qui fait trace. C’est le premier geste de l’humanité. En témoignent les peintures rupestres. Le processus de création est-il une joie ou une bataille ?
C’est un travail. Je ne crois pas du tout à l’inspiration. Il s’agit plutôt d’être en bonne condition physique, doté d’une énergie fraîche, tonique. C’est pour ça qu’il faut aller le plus souvent possible à l’atelier : chaque jour, on doit tenter sa chance [rires] ! En cas de fatigue ou de coup de blues, mieux vaut aller se balader.
Comment abordez-vous la toile blanche ? Comme un défi de nouveauté, afin de ne pas reproduire les normes esthétiques en vigueur et les discours déjà exprimés ?
Non, au contraire, j’aime bien me répéter dans mon travail. Il faut bien continuer à répéter un message pacifiste, car il n’a pas été assez entendu. D’un point de vue formel, je ne cherche pas à me renouveler, à déconstruire pour reconstruire. Refaire le même tableau ne me dérange pas, car l’énergie n’est pas la même selon les moments. En ce sens, je m’inscris dans le sillage de l’artiste suisse Alberto Giacometti : recommencer inlassablement pour faire mieux.
Des œuvres conceptuelles dans l’art contemporain restent indéchiffrables pour certains spectateurs. Proposer une œuvre accessible, lisible pour le plus grand nombre, fait-il partie de votre intention ?
Non. Je peins un tableau et, ensuite, il est accessible à qui le veut, à qui est disponible. Une œuvre d’art contemporaine peut être accessible au plus grand nombre, tout en étant très complexe. Il faut juste trouver un détail, une porte

pour y entrer. Parfois, des œuvres très simples de prime abord demeurent incompréhensibles. Faire dialoguer la peinture abstraite et la figurative est-il l’un des enjeux de votre travail ?
Ce n’est pas un concept que j’ai décidé de développer de façon consciente. Ce dispositif a trouvé sa voie empiriquement, à travers l’expérience. On fait des tentatives formelles, on voit si cela fonctionne, on poursuit, on reprend, on refait, jusqu’à trouver un résultat cohérent. C’est un état de fait : mon travail est figuratif et abstrait en même temps. Vous dites que vous allez au musée pour voir le travail d’artisans. Garder cette pratique de l’œil est très précieux pour vous…
Certains aiment se balader dans la nature. Moi, j’aime me promener au musée. Même si je le connais déjà, je découvre toujours des choses. J’essaie de retrouver dans une œuvre contemporaine une émotion analogue à celle que j’ai face à une du XIIe siècle. L’art est intemporel. Une œuvre d’aujourd’hui doit pouvoir être regardée et comprise dans cinq siècles. Quelle place tient la musique dans votre geste créatif ?
J’écoute de la musique, dans la vie et dans l’atelier, mais je travaille également dans le silence. Enfant, j’ai été bercé par le chaâbi, puis j’ai découvert le rock et la musique soul afro-américaine. L’album What’s Going On, de Marvin Gaye, est un véritable manifeste politique et spirituel. Cette musique sensuelle, aux textes pétris des questionnements de son temps, a influencé ma pratique artistique et les thèmes qui la traversent : la spiritualité, la guerre, la misère sociale ou encore l’injustice…
Le rôle d’un artiste est-il de questionner sa société, d’interpeller sur les maux qui la minent ?
Je n’ai pas de leçon à donner aux autres. Il existe autant de visions et de rapports au monde qu’il y a d’artistes. Le Danois Vilhelm Hammershøi a peint des intérieurs vides. Où est la dimension politique ? Est-ce engagé ? Je ne saurais le dire, mais c’est une grande œuvre. L’engagement, je ne sais pas ce que c’est. Et je ne suis pas militant. Mon art montre le vide de l’être, la solitude. Il évoque le monde dans lequel je vis. On retrouve certains personnages dans vos tableaux, au fil du temps. Vous hantent-ils, vous obsèdent-ils parfois ?
Pas vraiment. Je suis hanté par mes amours, mais pas par les êtres que je crée ! ■

Yamen Manai
AU BORD DE L’ABÎME
Le nouveau roman de l’écrivain tunisien porte la voix d’un adolescent révolté par la violence et l’injustice de sa société, dont il dresse un portrait au vitriol. Un texte coup-de-poing couronné par le prix de la Littérature arabe en 2022. propos recueillis par Astrid Krivian
C’est un roman fulgurant, fiévreux, qui emporte, bouscule, bouleverse le lecteur. L’histoire d’un adolescent en Tunisie qui s’insurge et se soulève contre les injustices de sa société. Face à l’hostilité et à la cruauté des adultes, il trouve en Bella, sa chienne, l’amour inconditionnel et le réconfort. Et gare à ceux qui osent s’en prendre à son amie… Quatrième roman de Yamen Manai, récit d’apprentissage dans un monde désenchanté, Bel Abîme est un texte percutant, une insurrection littéraire. Une plume trempée dans le feu de la révolte. Un verbe affûté, tranchant, pour dénoncer les maux d’une société, clamer la colère, la fureur de vivre d’une jeunesse.
Né en 1980 à Tunis, l’écrivain tombe dans le bain des mots dès l’enfance, dévorant les ouvrages de la bibliothèque familiale, des œuvres de l’Égyptien Tawfiq al-Hakim à celles du Français Émile Zola. Ingénieur dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, il vit aujourd’hui à Paris. Ses talents de conteur et ses analyses fines de la nature humaine, souvent teintées d’humour et d’ironie sont salués par la critique. Après un premier roman, La Marche de l’incertitude, en 2010, son deuxième, La Sérénade d’Ibrahim Santos, a été récompensé du prix Alain Fournier en 2012. Puis, L’Amas ardent a été couronné de huit prix littéraires, dont celui des Cinq Continents de la francophonie en 2017. Quant à Bel Abîme, il est notamment lauréat du prix Orange du livre en Afrique et du prix de la Littérature arabe 2022.
AM : Possédé par l’histoire de cet adolescent, vous avez écrit Bel Abîme en quelques jours, pris dans une forme de transe.
Yamen Manai : Des lecteurs pensent que j’ai emprunté la voix de cet adolescent, mais en réalité, j’ai l’impression que c’est l’adolescent qui m’a utilisé. J’entendais sa voix, j’avais la sensation qu’il était réel, de chair et d’os. Il était impossible pour moi d’interrompre son flux de paroles, qui m’étaient dictées. C’est inédit ; je n’ai pas connu cette transe d’écriture avec mes précédents romans – écrits sur des temps plus longs, de façon plus sereine. J’ai écrit Bel Abîme en une semaine, dans les conditions idéales dont rêve tout écrivain : seul et sans contrainte. Je dormais et mangeais très peu. Une fois terminé, j’étais aussi épuisé, vidé que mon personnage. Comment avez-vous imaginé le parcours de ce jeune qui n’a connu qu’un monde de violence et de cruauté ?
Mon vécu ainsi que celui de nombreux Tunisiens ressemblent fortement à ce que traverse cet adolescent. Dans cette société patriarcale, les violences faites sur les enfants,
notamment au sein du cercle familial, sont monnaie courante. Ce n’était donc pas difficile à imaginer. En vue de son prochain jugement, ce jeune fait le procès de sa société…
Dans la préparation de son jugement, il a le droit à un avocat et reçoit la visite d’un expert psychiatrique ; ces deux hommes essaient de comprendre les ressorts de ses actes. La seule justification qu’il peut leur donner, c’est qu’il est le pur produit de sa société. Il n’est que la manifestation des comportements qu’on lui a toujours inculqués. Pour comprendre pourquoi il en est arrivé à commettre de tels actes, il faut comprendre les mécanismes sociaux. C’est un réquisitoire contre ce qu’il a toujours connu.
Sans concessions, son propos est sombre, amer, désenchanté. Ne manque-t-il pas de nuances ?
Le texte est brut, mais porteur de nuances. Certes, cet adolescent ne concède rien, il est dans l’irrévérence, parfois même la véhémence. Comme toutes les paroles de vérité, son propos peut mettre mal à l’aise, déranger. Une fois adulte, on essaie de trouver les entourloupes permettant de maquiller la vérité et de continuer à justifier l’injustifiable. Mais ce ne sont pas des nuances, plutôt des mensonges ! La révolte de la jeunesse détient-elle cette vérité ?
En tant qu’adulte, on peut verser dans le politiquement correct, le conformisme, le compromis, voire la compromission…
Oui. On n’est jamais aussi proche de ses idéaux qu’à l’adolescence. On pense que le monde peut être juste et beau. Mais plus on ouvre les yeux sur lui, plus on se rend compte de son hypocrisie, qui dénature l’aventure humaine.
« La violence est comme une folie qui circule », écrivez-vous. Et les enfants du peuple ne sont pas tout à fait le « terminus de la cruauté » : ils se défoulent eux-mêmes sur les animaux…
Quand on subit la violence, on cherche hélas un souffredouleur. Tout ce qui ne peut pas se défendre, qui manque de représentants – comme l’environnement, les animaux, etc. –, devient une proie. Je décris d’ailleurs des scènes de violence réelles, lesquelles ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, qui montrent des enfants maltraitant les animaux du zoo de Tunis.
Pourquoi votre héros trouve-t-il son salut dans l’amour de Bella, sa chienne ?
Je connais l’amitié entre un homme et un chien. Je sais ce qu’elle peut apporter comme sentiment de réconfort, de compréhension, que l’on ne trouve pas parfois chez ses semblables ! En outre, le chien est aussi très représentatif de notre hypocrisie. Cet animal se fiche des conventions sociales – il urine
sur les murs des enceintes les plus sacrées, renifle sans honte le postérieur de son semblable dans les lieux publics, copule devant nous au point de nous mettre mal à l’aise… Il le fait naturellement et n’affiche pas des comportements différents selon la présence de ses congénères. L’humain réprouve ces comportements du chien, alors qu’il peut faire la même chose une fois que les autres ont le dos tourné. Conditionnés par cette hypocrisie, nous respectons ces règles de bienséance en plein jour, mais nous les transgressons dans l’ombre. Le livre montre ce basculement de valeur : cet enfant trouve l’humanité dans la bête, et la bestialité chez les hommes.
Le chien est considéré comme un animal impur par l’islam…

Il est considéré comme impur par ceux qui croient aux hadiths rapportés sur le Prophète, lesquels ne constituent pas l’intégralité de la religion musulmane. Mon roman donne aussi l’occasion de rappeler la valeur historique de cette parole, de remettre en question son authenticité. Bâtir une vision du rapport à l’animal sur une parole qui ne serait pas authentique est dangereux. Le chien n’est pas uniquement honni dans cette religion, mais au sein de plusieurs cultures.

L’expression « une vie de chien » désigne la limite de ce qu’un humain peut espérer. En Occident, se faire traiter de chien est une insulte. Les agents municipaux abattent les chiens errants afin de protéger la population de la maladie de la rage. Mais la rage sociale a déjà gagné la population, indique votre personnage…
C’est également une façon de tourner en dérision ce discours, lequel feint de ne pas voir la réalité en face. Beaucoup de Tunisiens sont très en colère par rapport à la situation depuis la révolution, l’état du pays qui se dégrade de jour en jour. La maladie de la rage est peut-être un fléau plus facile à traiter, contrairement à la grogne, à la rage sociale, qui nécessite une politique à tous les niveaux.
Votre précédent roman, L’Amas ardent, décrivait l’univers des abeilles. Pourquoi ce lien au monde animal vous intéresse-t-il ? Que dit-il de notre nature humaine ?
C’est plutôt l’absence de ce lien dans la littérature qui témoigne de notre vanité, de notre folie des grandeurs. L’humain se considère comme l’espèce élue, celle qui doit dominer la nature et l’ensemble du vivant. Or, je ne peux réduire l’être humain à ses interactions avec ses semblables. J’ai eu le privilège de grandir dans des endroits où ce lien au vivant était source de richesse, d’épanouissement. Je mesure le bien qu’il peut nous apporter, et à quel point le fragiliser nous appauvrit et nous plonge dans la médiocrité.
« La vérité, c’est qu’on ne mérite pas un si beau pays », écrivez-vous…
La Tunisie est un magnifique pays. J’ai connu celle des années 1980, avant la prolifération du plastique. Certains comportements ne sont pas à la hauteur de cette terre. Plusieurs plages où je me baignais enfant dans la banlieue de Tunis sont aujourd’hui impraticables. Dans des coins reculés de la campagne, des sachets plastique sont accrochés aux arbres. Le pays a souffert des comportements de ses habitants, même si je ne les pointe pas uniquement du doigt. C’est aussi un enchaînement d’histoires, d’un manque de politiques menées en ce sens. La Tunisie a aussi connu une explosion démographique – par rapport aux années 1980, la population a doublé. Mais plus globalement, mérite-t-on cette planète ? Un exemple parmi tant d’autres : face à la pression des lobbies, on peine à interdire l’usage d’insecticides, qui pourtant polluent et tuent le vivant.
« L’humain se considère comme l’espèce élue, celle qui doit dominer la nature et l’ensemble du vivant. »
Cruel, violent, le père de votre personnage est professeur d’université. Est-ce pour casser ce cliché qui voudrait que la violence soit le lot des classes défavorisées ?
La tendresse, la capacité d’aimer ne sont pas réservées à une seule couche sociale. Le fait d’être lettré, instruit ne sauve pas, malheureusement. Autour de moi, j’ai vu des médecins, des universitaires violenter leurs enfants, et des ouvriers être tendres avec leur progéniture… Que représente la main, que l’adolescent cherche à atteindre chez ses adversaires ?
Comme beaucoup de Tunisiens, il est fatigué des discours, des promesses non tenues. « L’humain est un être de parole », entend-on souvent. C’est grâce à cette faculté du langage qu’il serait devenu ce qu’il est. Mais pour cet enfant, la parole ne vaut rien, c’est du vent. Lui a besoin de voir du concret. La main définit notre humanité. Ce qui reste, c’est ce que l’on réalise, ce que l’on bâtit avec nos mains.
suffisant ? Quoi qu’il en soit, mon personnage est dans l’urgence. Les jeunes réclament un avenir digne, ils n’en peuvent plus d’attendre. Certains quittent même le pays au prix de leur vie. Ce bel abîme, c’est donc la Tunisie, ce pays où s’échouent hélas les rêves d’une jeunesse ?
En effet. Pendant longtemps, la Tunisie a tenu ce discours : sans ressources minières, pétrolières, gazières, sa seule richesse est sa jeunesse. Mais rien n’a été fait pour que celle-ci puisse s’exprimer, qu’elle soit à la source et à la récolte d’une transformation du pays. À juste titre, la révolution a été désignée comme celle de la jeunesse. Pourtant, le président d’alors [Ben Ali, ndlr] était l’un des plus vieux du monde. « Notre richesse, c’est la jeunesse » est un discours creux, insensé, contre lequel il faut s’insurger.
Vous dénoncez aussi cette manie de se comparer aux autres pays pour se consoler de sa propre situation…
C’est valable pour tous les États. En regardant les malheurs des autres, avec satisfaction, on est enjoints à relativiser notre condition. Je récuse cette idée, elle n’a aucun sens. Comparaison n’est pas raison ; chaque pays a sa trajectoire. Si une comparaison est à faire, c’est par rapport à notre propre état, à notre évolution, pour le meilleur ou le pire. À l’échelle individuelle comme à celle d’une société, nous devons être notre seul point de repère. Tout en nous inspirant du meilleur chez les autres.
Écrire vous a-t-il soulagé de votre colère ?
Tous mes livres ont eu une dimension cathartique. Ce qui déclenche ma plume, ce sont la laideur, la violence que j’observe, afin de les pointer du doigt, de les extérioriser. La littérature me débarrasse de ces visions, qui peuvent me contaminer, atteindre ma sérénité. Elle m’aide à sublimer, à dépasser ces sentiments. Quand il y a lieu de s’émerveiller, je n’écris pas, je me contente de contempler.
La littérature est-elle un moyen de provoquer une prise de conscience chez le lecteur ?
Son constat sur l’héritage de la révolution tunisienne est pétri de désillusions. Par exemple, la démocratie consisterait juste à choisir entre la peste et le choléra. Vous partagez son regard ?
C’est son droit de le penser. Pour ma part, je distingue toutefois des choses positives dans cette révolution. Elle a apporté son lot de problèmes mais aussi de progrès, peut-être infimes. Comme le fait que le droit associatif n’existait pas sous l’ère Ben Ali. Aujourd’hui, des associations sont créées pour prendre à bras-le-corps des questions sociétales : la défense des droits des mères célibataires, des homosexuels, des animaux, la protection de l’environnement, etc. La société civile a certainement plus de moyens pour rééquilibrer les mauvaises politiques. Est-ce
Je ne pense pas à la place de celui-ci. Je le laisse libre de juger ce que le livre peut lui apporter : une prise de conscience, une émotion, un simple divertissement… Chacun voit midi à sa porte ! La littérature a hélas toujours manqué de moyens pour contribuer à changer les choses. En témoigne la petite place qui lui est octroyée dans les médias, même en France, où l’on a l’impression que le livre se porte très bien. J’aimerais croire que la littérature est capable de bousculer le monde. En réalité, la plupart des écrivains galèrent. Il n’existe pas vraiment de politique de soutien. Être publié par Elyzad, une maison d’édition tunisienne, est-il important pour vous ?
Oui. Après plusieurs décennies de dictature, puis de gestion postrévolutionnaire calamiteuse, la littérature ne s’est pas épanouie en Tunisie. Il faut une politique qui encourage

l’édition, la diffusion, la distribution. Une dictature n’a pas vocation à rendre le livre attractif, au contraire : pour abrutir son peuple, elle coupe tout élan de l’esprit, dont la littérature est un symbole. Pendant des années, des bibliothèques, des librairies ont fermé. Les gens sont entrés en désamour pour les livres, au point que les chiffres sur la pratique de la lecture sont alarmants. Aujourd’hui, il convient d’inverser la vapeur, en donnant aux Tunisiens des ouvrages. Notre pays est capable de créer une littérature qui permet à ses habitants d’affronter le monde, de se regarder tels qu’ils sont. Aussi, dans l’espace francophone, le passage par Paris n’est pas obligatoire. Depuis un petit pays comme la Tunisie, il est possible de faire émerger des voix porteuses de sens.
Comment Bel Abîme a-t-il été reçu auprès des jeunes ?
Très bien. J’ai été ému par ce bel accueil. Surpris également. Comme tous les peuples, les Tunisiens n’aiment pas que leurs tares soient affichées en plein jour – ils préfèrent laver leur linge sale en famille. Je craignais que le roman soit mal accueilli, et que l’on me considère comme un traître à la nation. Mais c’était sous-estimer la nécessité de cette parole et l’intelligence des lecteurs. Beaucoup de personnes ont été très touchées par l’ouvrage et le partagent, le donnent à lire. Nombre d’enseignants l’utilisent dans leurs cours. C’est une belle satisfaction. Et cela prouve qu’il faut oser parler de ce qui fâche. Crever les abcès est une grande libération. Les livres sont le refuge de votre personnage. Est-ce le cas pour vous également ?
Oui. Ils sont le meilleur moyen de nous humaniser. En nous faisant vivre d’autres vies que la nôtre, dans des époques et des géographies différentes, les romans nous rapprochent de l’ensemble des humains. Ils nourrissent notre empathie, nous évitent de tomber dans les pièges du manque de nuances. En littérature, les monstres n’existent pas. Pour encourager les plus jeunes à lire, je leur cite souvent Nelson Mandela : « Une nation qui lit est une nation qui gagne. » L’accueil réservé au livre au sein d’une société en dit long sur son avenir et sur son présent. Étiez-vous un lecteur précoce ?
Effectivement. Dans les années 1980, les enfants disposaient de très peu de loisirs en Tunisie, en dehors du ballon rond, comme dans plusieurs pays africains. Face à ce vide, je suis tombé dans la bibliothèque de mes parents. J’ai compris le pouvoir de transformation qu’un roman opère sur nous.
J’ai plongé dans les œuvres des écrivains égyptiens Tawfiq al-Hakim, Ihssan Abdel Koudous, mais aussi dans celles d’Alexandre Dumas, d’Émile Zola, de Victor Hugo, Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swif, Robinson Crusoé, de Daniel Defoe… Ces lectures ont attisé ma curiosité du monde, suscité mon désir d’ailleurs.
Comment est venue l’écriture ?
J’ai été un peu poussé à suivre des études scientifiques. Ma génération a baigné dans ce discours ambiant : pour s’en sortir dans la vie, il fallait faire des études scientifiques, devenir ingénieur ou médecin. La littérature était considérée comme une voie de garage. Alors, je profitais des exercices littéraires, des dissertations pour m’exprimer, donner le meilleur de moi-même. Puis, à la fin de mes études d’ingénieur, j’ai lu des livres de littérature contemporaine française, très bien marketés, poussés en avant dans les médias à coups de prix littéraires, objet de toutes les attentions. Mais je les trouvais médiocres. En veillant à une écriture de qualité, ai-je pensé, j’aurais peut-être ma place. Comment conciliez-vous votre métier d’ingénieur avec celui d’écrivain ?
Tant bien que mal. Chaque ouvrage est un petit miracle. J’ai toujours réussi à dégager un peu de temps pour écrire. Mais c’est un combat, comme pour tous les artistes. On souffre de devoir affronter des questions très profanes, en contradiction
avec nos ambitions artistiques. Cela en dit long, encore une fois, sur l’état de cette société : elle peut rémunérer un footballeur des millions d’euros, et refuser des petites aides ou résidences à des artistes dans le besoin. Il faut faire avec. Cela ne fait qu’augmenter l’adversité et rendre le combat plus noble. Quel lien entretenez-vous avec votre terre natale ?
La Tunisie est mon soleil : si je m’en approche trop, ça brûle, si je m’en éloigne trop, ça glace. J’essaie de trouver la juste distance. Le pays natal reste toujours en nous. Et si je vis à Paris, l’essentiel de ma vie se passe dans ma tête ! Les livres sont ma patrie. Quand je vois une bibliothèque, même à l’autre bout de la planète, je me sens chez moi, apaisé. Comment regardez-vous la situation actuelle en Tunisie, en proie à une forte inflation ?
Avec beaucoup d’attention et d’espoir. Je suis plutôt optimiste. La Tunisie est à l’image du monde : on ne peut pas panser les blessures d’une société sans prendre en compte le petit village qu’est devenu le monde. Partout, il faut entreprendre une autre dynamique, poser la question du vivre-ensemble, à l’échelle plus large que celle entre les humains. ■
« Les romans nourrissent notre empathie, nous évitent de tomber dans les pièges du manque de nuances. »
Les belles avancées de la médecine
TECHNOLOGIES ET MÉTHODES NOUVELLES, progrès sur divers fronts sensibles, traitements qui font leurs preuves… Des innovations et des évolutions marquantes vont changer la façon de soigner et améliorer la santé.
par
Annick BeaucousinL’ARN messager va refaire parler de lui
Avec l’épidémie de Covid-19, le terme « ARN messager » est devenu presque familier. Et pour cause : le procédé a permis de mettre au point dans l’urgence des vaccins dans les pays occidentaux. Longtemps remisée au statut de recherche peu intéressante, cette technologie apparaît dorénavant comme une panacée thérapeutique. Les ARN messagers sont des brins de code génétique capables de faire produire par les cellules n’importe quelle protéine. Autrement dit, il est possible de faire synthétiser des médicaments par notre corps, en lui donnant le plan de fabrication de la protéine dont il a besoin. Ces commandes codées génétiquement pourront être utilisées pour traiter des cancers, des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, des maladies génétiques comme la mucoviscidose, ou encore des maladies cardiaques. Les essais cliniques sont déjà lancés dans plusieurs domaines, la difficulté restant de faire en sorte que l’ARN messager transmette son message aux bonnes cellules. La technique devrait également être utilisée pour concocter d’autres vaccins, par exemple contre le VIH, le virus Zika…
Cancer : des approches inédites
Tout d’abord, deux types d’anticorps thérapeutiques sont à l’étude. Les premiers sont les anticorps drogue-conjugués : associés à une thérapie classique, ils vont reconnaître la cellule tumorale, se faire absorber par cette dernière pour y déposer la molécule de chimiothérapie. La toxicité du traitement est ainsi diminuée, et son efficacité augmentée. L’autre famille d’anticorps, dits bispécifiques, a démontré également son efficience. Reconnaissant d’une part les cellules immunitaires et d’autre part les cellules tumorales, ces anticorps font en sorte que les deux types de cellules se touchent afin que les premières détruisent les secondes.
Autre progression de taille : la mise au point d’un vaccin thérapeutique. Dans de nombreux cancers, la reproduction illimitée des tumeurs est liée à la télomérase, une enzyme que ce vaccin détecte et détruit en activant le système immunitaire. Une aubaine pour les cancers difficiles à traiter, comme celui du poumon, l’un des plus mortels dans le monde. Son innocuité, sa bonne tolérance et son efficacité ont été observées chez 80 % des patients atteints de cancer du poumon métastatique. Prochaine étape : démontrer ses performances sur les tumeurs du cerveau, le cancer du foie ou les cancers liés aux papillomavirus. Les essais cliniques sont en cours.
Enfin, notons des progrès dans le domaine du dépistage. On sait qu’un peu d’ADN de chacune de nos cellules circule dans notre sang. Des recherches ont montré que des modifications chimiques de l’ADN permettent de détecter de manière précoce une cinquantaine de cancers. Des tests sanguins sont en cours d’expérimentation aux États-Unis.
VIH, le traitement intermittent efficace
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et réduire les coûts médicaux sont deux enjeux majeurs. Selon le projet Quatuor, mené en collaboration avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la prise de médicaments intermittente (quatre jours consécutifs, puis trois jours de pause), au lieu d’une quotidienne classique, se révèle tout aussi efficace pour supprimer la charge virale chez le porteur, et donc tout risque de transmission. L’observance, l’acceptabilité et la tolérance du traitement s’en trouvent accrues. Une annonce encourageante, alors que la lutte contre l’épidémie au niveau mondial est toujours de mise.
Drépanocytose et bêta-thalassémie : vers la thérapie génique
Ces deux maladies génétiques sanguines fréquentes se caractérisent par une baisse anormale du taux d’hémoglobine, réduisant l’espérance de vie. La seule option curative actuelle consiste à greffer des cellules de moelle osseuse issue de donneurs compatibles, ce dont peu de malades peuvent bénéficier. Une étude clinique de thérapie génique consistant à transplanter chez les patients leurs propres cellules souches de moelle osseuse génétiquement modifiées présente des résultats très prometteurs, qui se sont maintenus dans la durée. Chez les personnes bêta-thalassémiques, le taux d’hémoglobine est revenu à la normale, et a été corrigé pour deux tiers des personnes drépanocytaires.
Une lueur d’espoir pour les malades d’Alzheimer
Depuis de longues années, des chercheurs du monde entier sont dans la course pour trouver un traitement à cette affection neurodégénérative. Un tournant s’est produit avec la publication par The New England Journal of Medicine, en décembre dernier, des résultats d’un essai clinique mondial conduit sur dix-huit mois. Ceux-ci montrent l’efficacité d’un médicament expérimental, le Lecanemab : cet anticorps monoclonal ralentit la progression de la maladie d’environ 30 %, les meilleurs résultats jamais obtenus. Le déclin cognitif et fonctionnel des personnes traitées est beaucoup moins sévère que dans le groupe placebo. De plus, les images médicales mettent en évidence une forte régression des plaques amyloïdes, anomalies typiques de la maladie qui conduisent à la mort des neurones. Par ailleurs, une approche radicalement différente va être explorée par la Fondation Rothschild, à Paris. De récentes études ont démontré que les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques (comme la polyarthrite rhumatoïde) présentent 60 % de risque supplémentaire de développer la maladie d’Alzheimer. Mais, quand elles sont traitées par un anti-inflammatoire de type anti-TNF alpha, ce taux de risque redevient identique à celui de la population générale. Partant de ce constat, la technique du doppler transcrânien va être employée pour ouvrir, de façon brève et indolore, par ultrason, la barrière hémato-encéphalique du patient, facilitant ainsi la pénétration de l’anti-TNF alpha, dont l’action sur l’inflammation du cerveau sera potentialisée. Atouts : la pratique du doppler transcrânien est maîtrisée de longue date, et le traitement à l’anti-TNF alpha est bien connu.
Des prothèses toujours plus high-tech
Dotées d’une technologie ultramoderne, elles ouvrent des perspectives inédites. Citons la prothèse destinée à remplacer un bras à la suite d’un accident, par exemple : en la « commandant » uniquement par la pensée, le détenteur peut bouger le bras et la main, saisir des objets, et éprouver en partie le toucher grâce à des électrodes connectées à des nerfs. Une prothèse de jambe, conçue en partie sur le même principe et aujourd’hui en cours d’essai clinique, permet au patient de marcher, tout en lui faisant ressentir le sol et ses aspérités pour prévenir les chutes. Enfin, une puce informatique pour rendre la vue aux personnes aveugles devrait être bientôt implantée dans le crâne des premiers volontaires, et plus précisément cousue dans la matière grise pour former des connexions avec les neurones. ■
De bons résultats pour le vaccin contre Ebola
De nombreux pays d’Afrique subsaharienne font régulièrement face à des flambées épidémiques de virus Ebola. Dans ce contexte, la vaccination est essentielle. Le consortium international PREVAC, regroupant des scientifiques de l’Inserm et d’institutions africaines, américaines et britanniques, a publié dans The New England Journal of Medicine les résultats d’un large essai clinique effectué en Afrique de l’Ouest, chez les adultes et les enfants : ils montrent la sûreté de trois schémas vaccinaux, leur bonne tolérance, et le maintien de la réponse immunitaire à douze mois.
Interview
Carlos LopesLe Cameroun veut lancer son « biochar »
La Namibie protège ses nappes phréatiques
La faillite de FTX impacte le continent
Vaste projet ferroviaire en Tanzanie
La dette menace l’Afrique
Souvent libellé en dollars, pâtissant de la hausse du billet vert, des politiques anti-inflationnistes américaines et des contrecoups de la guerre en Ukraine, le stock d’endettement explose, menaçant l’équilibre social de nombreux pays. La zone CFA résiste mieux. par Cédric Gouverneur
Avec une dette se montant désormais à 80 % de son PIB, le Ghana se trouve confronté à sa pire crise économique depuis des décennies. Malgré des mesures de restructuration début décembre 2022 et l’octroi par le Fonds monétaire international (FMI) d’un programme de financement de 3 milliards de dollars, les autorités de ce pays anglophone ouest-africain ont dû se résoudre, le 19 décembre dernier, à annoncer la « suspension » du paiement d’une partie de sa dette extérieure. En d’autres termes, le Ghana se trouve en défaut de paiement… L’envoyée spéciale de RFI à Accra témoignait, le 2 janvier, d’« effets de la crise visibles partout dans la capitale » :
le trafic routier est étonnamment fluide faute de véhicules, les marchés et les boutiques sont déserts faute de clients. Concrètement, les habitants sautent des repas et se résignent à marcher, afin d’économiser sur le coût de transports. En Tunisie, la dette avoisine 100 % du PIB, contre 40 % en 2011. Sucre, beurre… Les pénuries alimentaires se multiplient et les rayons des supermarchés se vident, l’État, endetté, manquant de devises pour constituer des stocks. En octobre dernier, Tunis avait obtenu du FMI un crédit de 1,9 milliard de dollars, en deçà du montant espéré. Mais la réunion prévue en décembre entre les autorités et l’institution financière internationale a depuis été reportée sine die…
L’IMPLACABLE MÉCANISME
La dette extérieure du continent s’élève à environ 1 000 milliards de dollars, dont 700 pour l’Afrique subsaharienne. De nombreux pays se trouvent dans une situation critique vis-à-vis de leur dette : Tunisie, Égypte, Zambie, Angola, Éthiopie, Kenya… Et le FMI estime que la moitié connaît un risque de surendettement. « La dette publique s’est élevée à environ 60 % des PIB, des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis le début du millénaire », souligne sur son blog le directeur Afrique de l’institution, l’Éthiopien Abebe Aemro Sélassié. Les deux années de pandémie ont sabré les finances publiques en tarissant les flux de devises. En faisant bondir le
Au Ghana, la monnaie nationale a perdu en un an la moitié de sa valeur face au dollar. Le pays envisage de payer ses importations de carburant en lingots d’or.
















prix de l’énergie et des céréales, la guerre en Ukraine (qui entrera, le 24 de ce mois, dans sa deuxième année) s’est traduite, entre autres maux, par une inflation galopante qui rogne la croissance économique. Car afin de juguler la hausse des prix aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed) tire ses taux d’intérêt, au plus haut depuis quinze ans. Cela fait mécaniquement grimper le billet vert par rapport aux monnaies africaines, renchérissant les dettes libellées en dollars. Au Ghana, la devise nationale, le cedi (un mot dérivé de « cauri », le coquillage qui servait jadis de monnaie dans la région), a ainsi perdu en un an la moitié de sa valeur face au dollar ! À tel point que l’ancienne Gold Coast envisage de payer ses importations de carburant en lingots d’or… Toutes les monnaies nationales subissent la même dépréciation : -70 % pour
la livre égyptienne, -30 % pour le naira (Nigeria), -20 % pour le shilling kényan… En outre, l’écart – parfois quasiment du simple au double –entre le taux de change officiel et le taux de change du marché parallèle favorise l’évasion fiscale. Depuis mi-décembre, le Nigeria remplace ses billets de banque dans l’espoir de purger son système monétaire et de freiner l’inflation.
La zone CFA – dont le franc est arrimé à l’euro avec une parité fixe – résiste un peu mieux, malgré une monnaie européenne à son plus bas niveau depuis sa mise en circulation en janvier 2002. Après avoir dominé le dollar
les
subissent la même dépréciation : -70 % pour la livre égyptienne, -30 % pour le naira (Nigeria), -20 % pour le shilling kényan…
Qualifié de « vautour » par ses détracteurs, le fonds américain BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actif au monde.

pendant deux décennies (parfois 1 euro pour 1,5 dollar), les devises européenne et américaine se trouvent, depuis un an, pratiquement à égalité (environ 1 euro pour 1 dollar, et même 0,98 euro pour 1 dollar en juillet). Résultat : les dettes publiques de la zone CFA ont elles aussi augmenté. Au Cameroun, le directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA), Richard Evina Obam, a reconnu, en novembre, une hausse de la dette du pays de 11,2 % en un an. Le ralentissement de l’inflation outre-Atlantique (7,1 % en novembre, contre 7,7 % en octobre) a néanmoins conduit, mi-décembre, la Fed à amoindrir sa dernière hausse (0,5 %, contre 0,75 % pour les augmentations précédentes). Son président, Jerome Powell, table désormais sur une inflation de 3,1 % en 2023, contre 5,6 % en 2022. Et la mauvaise nouvelle pour les économies des pays émergents est que ce dernier entend réduire l’inflation américaine à 2 % ! Or, atteindre cet ambitieux objectif implique, pour le grand argentier de Washington, de nouvelles hausses des taux…
LE BOUC ÉMISSAIRE CHINOIS
L’ONG britannique Debt Justice déplore que ces « hausses de taux d’intérêt en réponse au pic global d’inflation » s’effectuent dans les pays riches « sans considération pour leurs débordements sur les pays en développement », « empirant une situation qui était déjà dramatique », en « accroissant le volume relatif des dettes ».
Toutes
monnaies
Debt Justice relativise par ailleurs le rôle de Pékin, décrié par les Occidentaux pour avoir prêté abondamment au continent dans les années 2000 et 2010, décennies de la « Chinafrique », notamment pour la construction d’infrastructures : lors de sa première visite sur le continent, en 2021, le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait ainsi accusé l’empire du Milieu, sans le nommer, de « piéger » l’Afrique avec ses prêts. La Chine a annoncé en août dernier renoncer à « 23 prêts arrivés à échéance auprès de 17 pays africains », sans entrer dans les détails. « Le G7 devrait s’attaquer aux prêteurs privés plutôt que de blâmer la Chine », estime Tim Jones, de l’ONG britannique, dans une étude publiée en octobre. Chiffres à l’appui, celui-ci pointe le fait que les créances chinoises ne représentent que 12 % de la dette des pays pauvres et émergents, tandis que 47 % sont dues à des créanciers privés, 27 % à des institutions multilatérales (FMI, Banque mondiale), et 14 % à d’autres États que la Chine. Debt Justice dénonce par ailleurs les agissements du fonds d’investissement américain BlackRock, qualifié de « vautour » par ses détracteurs : l’ONG a en effet calculé que, si la Zambie remboursait intégralement ce qu’elle doit au fonds new-yorkais, celui-ci réaliserait un profit de 110 % ! Une véritable « culbute » que d’aucuns trouveront quelque peu indécente, sachant que l’État zambien a dû amputer de 20 % les budgets des Affaires sociales et de la Santé ces deux dernières années… Une centaine d’économistes et d’universitaires ont appelé à l’annulation d’une part substantielle de la dette zambienne, « économiquement inefficace et moralement mauvaise ». ■
LES CHIFFRES
Jusqu’à 70 % des deux-roues vendus en Afrique subsaharienne à l’horizon 2040 seront électriques.
3,5 %
1,8 DOLLAR, SOIT LE COÛT AU KILO, HYPERCOMPÉTITIF, DE L’HYDROGÈNE VERT AFRICAIN D’ICI À 2030, SELON UNE ÉTUDE ÉMIRATIE.
8 700 dollars la tonne, soit le cours du cuivre, produit notamment en République démocratique du Congo et en Zambie. Il est au plus haut du fait du retour de la demande chinoise.
Telle est la prévision du FMI pour la croissance de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale en 2022.
30 MILLIARDS DE DOLLARS , C’EST LA VALEUR NETTE PAR AN DU CARBONE SÉQUESTRÉ PAR LA FORÊT DU BASSIN DU CONGO, ESTIME LE THINK TANK CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT.

650 millions d’Africains ont besoin d’être formés aux compétences numériques d’ici à 2030, selon le Boston Consulting Group.

Carlos Lopes « La réforme du système financier international est inévitable »
Depuis un an, la guerre en Ukraine impacte l’économie mondiale, sans épargner le continent. Après la pandémie, ce second choc externe démontre qu’il faut réformer les institutions, nous explique l’économiste bissau-guinéen, ex-secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) et professeur à l’université du Cap. propos recueillis par Cédric Gouverneur
AM : Ce mois-ci, la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année. Quels sont ses impacts sur l’économie africaine ?
Carlos Lopes : Les prévisions du FMI et de la Banque mondiale pour 2023 indiquent que le continent, malgré la crise, pourrait avoir une croissance au-dessus de la moyenne mondiale, aux alentours de 3,6-3,7 %. Ce qui, dans le contexte actuel, n’est pas négligeable. Cela étant, ces chiffres reflètent la compensation d’une période négative (crise sanitaire et conflit en Ukraine) et ne traduisent pas les difficultés vécues par les Africains. L’inflation est élevée, les prix des produits de consommation grimpent d’une façon faramineuse. Le continent importe pour environ 53 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Or, la plupart des pays connaissent des problèmes
de logistique. La période actuelle rappelle celle rencontrée au début de la pandémie, en 2020, lorsqu’il y a eu une perturbation de la chaîne logistique et de la disponibilité des cargos. De plus, avec la guerre en Ukraine, la plupart des investisseurs s’éloignent de l’Afrique pour préférer des environnements qui leur paraissent plus sûrs : l’accès au capital devient donc plus difficile. Ce qui a des conséquences sur les monnaies africaines, qui subissent une grande volatilité. L’année 2023 sera difficile. Dans ce contexte, le soutien international à l’Afrique s’est-il montré suffisant ?
Lors de la pandémie, le FMI a émis pour 33 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux en faveur du continent. C’est considérable, bien au-delà de la moyenne habituelle de l’aide au développement. Mais les autres promesses formulées ne se sont pas concrétisées. La Chine et d’autres donateurs ont beaucoup promis, et peu réalisé. Les mesures annoncées d’annulations de dettes peuvent par exemple voir leurs effets positifs remis en cause par d’autres décisions. La Chine n’a annulé que des dettes difficiles à faire payer et qui ne représentaient pas des sommes importantes (environ 2 milliards de dollars au total). L’Afrique a surtout besoin de liquidités. Le prix des céréales a grimpé à cause du conflit. Comment mettre fin à cette vulnérabilité, et enfin construire la souveraineté alimentaire de l’Afrique ?
Elle ne peut connaître de souveraineté alimentaire sans une transformation structurelle, laquelle mettrait fin à cette économie centrée sur la simple exportation de matières premières – un modèle issu de la colonisation et qui expose à la volatilité des cours. Or, il n’est guère possible d’accroître la productivité sans une industrialisation mettant en place de véritables chaînes de valeurs : l’aide de 10 milliards de dollars reçue annuellement pour l’agriculture ne parvient pas à augmenter la productivité du secteur. Et le poids
de l’économie informelle ne donne pas l’espace fiscal suffisant pour opérer les changements nécessaires. Le rôle de la spéculation est également dénoncé dans cette hausse des céréales ukrainiennes : connaît-on la proportion qui lui est imputable ? Comment la prévenir et la limiter ?
On ne connaît pas de façon précise le poids de la spéculation, mais on sait que les stocks de grains étaient significatifs avant le conflit : malgré cela, les prix ont grimpé, preuve du rôle de la spéculation. Pour contrer cette dernière, des mesures pourraient être mises en place. Tout dépend des régulateurs internationaux. Les pays européens se sont mis d’accord pour plafonner le prix du gaz. Il serait possible de faire de même pour les prix alimentaires. Mais remarquez qu’on ne le fait pas. Cela n’intéresse manifestement pas ceux qui ont le pouvoir de décision ! Justement, les facteurs externes pèsent sur les problèmes économiques africains : la hausse de la dette est en partie due à celle des taux directeurs de la Réserve fédérale pour juguler l’inflation américaine. Comment sortir du piège de la dette ?
Le système financier international a été ébranlé par la crise des subprimes en 2007-2008, puis par la pandémie,
et désormais par la guerre en Ukraine. Nous avons atteint la limite de ce que les instruments actuels peuvent offrir pour soutenir l’économie d’un pays en difficulté. Par exemple, lors de la crise sanitaire, trois mesures ont été prises : la suspension temporaire du service de la dette du G20, le nouveau cadre commun pour la restructuration de la dette des pays en difficulté du G20 et du Club de Paris (dont les résultats se sont avérés bien en deçà des promesses), et les droits de tirage spéciaux du FMI. Mais ces mécanismes n’ont pas résolu le problème de l’accès des pays africains aux liquidités. La réforme du système financier international est inévitable : la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, l’a évoquée, tout comme l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, lors de la COP27 à Charm el-Cheikh. Le système actuel est né à Bretton Woods, en 1944, en réponse à une crise majeure. Nous en traversons justement une, et c’est dans de tels moments que naissent les grandes réformes. Je n’ai aucun doute que cette réforme aura lieu. Mais dans quelle direction cela nous mènera-t-il ? Tout dépendra des négociations. Quel premier bilan pour la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) ? Comment peut-elle se renforcer ?
Le nombre d’adhésions aux différents protocoles et de ratifications augmente significativement. Cependant, négocier un accord commercial d’une telle ampleur prend du temps. En Europe, élaborer un système tarifaire commun a demandé plus de dix ans ! La Zlecaf n’en est qu’à sa troisième année. Une grande négociation est en cours sur le commerce, les services, la propriété intellectuelle, le certificat d’origine [preuve qu’un produit exporté provient bien du pays exportateur, ndlr], les subventions à un produit qui pourrait inonder de façon déloyale le marché des voisins, etc. En 2020, on m’avait demandé quand l’on verrait les résultats palpables de la Zlecaf sur le quotidien des Africains, et j’avais répondu : « 2024. » Je fais aujourd’hui la même réponse. Dès l’an prochain, les résultats seront concrets. Elle va permettre de négocier d’un seul bloc. Les États-Unis étaient vent debout contre cette zone, mais désormais, ils se rendent compte que négocier avec un seul interlocuteur commun est plus pratique. ■

« Les États-Unis étaient vent debout contre la Zlecaf, mais désormais, ils se rendent compte que négocier avec un seul interlocuteur commun est plus pratique. »
Le Cameroun veut lancer son « biochar »

Cofondé
notamment par un entrepreneur et un climatologue, NetZero capte le CO2 contenu dans les déchets agricoles pour le transformer en engrais.
La diversité des profils des cofondateurs de la start-up française NetZero est sans doute révélatrice des mutations du capitalisme à l’ère de l’urgence climatique : en 2021, l’entrepreneur camerounais Aimé Njiakin s’est en effet associé aux Français Axel Reinaud, qui a notamment collaboré au centre d’expertise financière du cabinet Boston Consulting Group (BCG), et Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Leur entreprise, NetZero, a été récompensée par

un chèque de 1 million de dollars lors du concours XPRIZE Carbon Removal, organisé par la fondation d’Elon Musk. Elle a ensuite décroché le label « Efficient Solution », délivré
par la Fondation Solar Impulse, pour son impact climatique jugé positif. Après trente années passées en France, Aimé Njiakin a en effet racheté l’usine de décorticage et de torréfaction de café abandonnée où travaillait jadis son père, à Nkongsamba (à environ 150 km au nord de Douala). Rebaptisée Synergie Nord Sud, elle récupère les rebuts agricoles des producteurs de café des environs, et notamment les parches (résidus du décorticage), afin de les valoriser : chauffés à haute température sans oxygène (un processus appelé « pyrolyse »), ces déchets végétaux trouvent une seconde vie en étant
L’usinerécupère les rebuts des producteurs de café des environs, afin de les valoriser.
transformés en biochar. Contraction des termes anglais « biological » et « charcoal » (« charbon de bois biologique »), le biochar possède la faculté de concentrer le dioxyde de carbone (CO2) capté par les végétaux et de le séquestrer en l’empêchant de se répandre dans l’atmosphère.
CORRIGER L’ACIDITÉ DES SOLS
La fabrication de biochar est reconnue depuis 2018 par le GIEC comme l’une des solutions permettant de lutter contre le réchauffement climatique. L’usine Synergie Nord Sud a obtenu de l’organisme finlandais indépendant Puro.earth une certification lui permettant d’émettre des crédits carbone, revendus par le biais d’un partenariat avec BCG. Au niveau local, le biochar produit à Nkongsamba est ensuite utilisé comme engrais par les agriculteurs de la région, notamment les producteurs de café. Ce capteur de carbone permet notamment de corriger l’acidité des sols en milieu tropical. NetZero travaille avec des ingénieurs agronomes de l’université de Dschang afin d’évaluer l’impact du biochar sur les rendements des différentes cultures vivrières locales.
NetZero et Synergie Nord Sud prévoient de produire jusqu’à 2 000 tonnes de biochar par an à Synergie Nord Sud, où sont employées environ 50 personnes. Cette année, la start-up a pour projet de s’implanter au Brésil – là également près d’une usine de café –, puis envisage en 2024 d’ouvrir un nouveau site dans un autre pays africain, pour le moment non précisé. Selon le cabinet Rystad Energy, le marché de la captation carbone devrait quadrupler d’ici à 2025 pour atteindre 50 milliards de dollars par an. ■
La Namibie protège ses nappes phréatiques

La mine d’uranium d’Omaheke, dans le centre-est de la Namibie, ne verra sans doute pas le jour : le ministère de l’Agriculture, de l’Eau et de la Réforme agraire a refusé d’accorder à Uranium One, filiale de Rosatom, agence russe spécialisée dans le secteur de l’énergie nucléaire, un permis d’exploitation minière de la région, fin décembre 2022. L’agence n’a pas réussi à convaincre les autorités de ce pays d’Afrique australe, en état de stress hydrique, que sa méthode d’extraction du minerai était sans danger pour l’environnement, et notamment pour les nappes phréatiques. Le porte-parole de la filiale, Riaan van Rooyen, a déploré auprès de la radio Voice of America cette décision, l’attribuant à « la peur de l’inconnu », et affirmant que cette
méthode d’extraction de l’uranium est « utilisée au Kazakhstan sans dommage pour l’environnement ». En gage de bonne volonté, et dans un contexte géopolitique tendu pour les intérêts russes, Rosatom y avait invité, en novembre dernier, une délégation namibienne afin qu’elle assiste à ses opérations minières. Ce voyage au Kazakhstan n’a visiblement pas suffi : le géologue Roy Miller a pointé par exemple le danger pour l’environnement « en cas de fuite ou de panne ». À l’inverse, Petra Witbooi, conseillère municipale de Leonardville, bourgade proche du projet, regrette que la Namibie renonce à cette mine et aux 600 emplois qui y étaient prévus : « Les avantages l’emportaient pourtant sur les inconvénients. » L’agence russe pourrait faire appel de cette décision auprès des autorités namibiennes. ■
Le géant russe du nucléaire Rosatom s’est vu refuser le permis d’exploitation d’un gisement d’uranium.La région d’Omaheke, au nord du pays, souffre d’un stress hydrique,
La faillite de FTX impacte le continent
L’effondrement de la plate-forme américaine d’échange de cryptomonnaies a affecté ses clients africains et fait plonger le cours du bitcoin.
Le 11 novembre dernier, FTX, deuxième plate-forme la plus importante du secteur des cryptomonnaies, se déclarait en faillite, accusant une perte de 30 milliards de dollars en une semaine. Les autorités financières américaines reprochent au groupe le détournement de 8 milliards de dollars, appartenant à environ 1 million de déposants : son fondateur, Sam Bankman-Fried, et plusieurs de ses collaborateurs

auraient utilisé l’argent de leurs clients pour spéculer par le biais de leur société Alameda Research, investir dans l’immobilier aux Bahamas (où l’entreprise avait ses bureaux), et faire des donations au Parti démocrate.
Beaucoup de leurs clients n’ont pas pu retirer leurs fonds avant la banqueroute, et leurs placements ont été bloqués, sinon perdus… Trois jours après le krach, le PDG de la start-up nigériane Nestcoin, Yele Bademosi,
annonçait sur Twitter que son entreprise était « contrainte de licencier », ayant « conservé [ses] actifs chez FTX pour gérer [ses] dépenses opérationnelles », et se trouvant dès lors dans l’impossibilité de les récupérer. Des particuliers sont également affectés : un jeune artiste zimbabwéen, Liam Vries, a par exemple raconté au journal britannique The Times, le 23 novembre dernier, avoir placé chez FTX environ 2 260 dollars, désormais « gelés et inaccessibles » :
« Je crois que j’aurais dû mieux m’informer avant d’investir », a-t-il admis. Le site Afrique IT News évalue à 100 000 les victimes africaines de cette débâcle. Ce groupe connaissait en effet un certain succès sur le continent, où les cryptomonnaies séduisent, car se présentant comme une solution aux problèmes liés aux transferts internationaux d’argent liquide, aux monnaies nationales volatiles et à la faible bancarisation de nombreux habitants. Peu avant sa faillite, la plate-forme avait envisagé d’ouvrir un bureau au Nigeria. En mars 2022, elle avait même signé un partenariat avec la société sud-africaine AZA Finance.
Sa PDG, Elisabeth Rossiello, a tenu à préciser que FTX n’était que client de son entreprise, qui ne serait donc nullement affecté par la banqueroute. La République centrafricaine, seul État au monde avec le Salvador à avoir adopté le bitcoin comme monnaie légale [voir Afrique Magazine n° 430], est indirectement impactée par ce krach : en décembre, Bangui annonçait le report de la cotation du sango, le jeton centrafricain de cryptomonnaie, invoquant « les conditions actuelles du marché ». Le cours du bitcoin s’effondre : après avoir culminé à 69 000 dollars fin 2021, il était, début janvier 2023, à moins de 16 000 dollars…
Extradé des Bahamas, Sam Bankman-Fried est accusé de huit chefs d’inculpation, dont « fraude » et « association de malfaiteurs ». Le 3 janvier, il a plaidé non-coupable devant un tribunal fédéral de New York. Le paiement d’une caution de 237 millions de dollars lui a évité l’incarcération. Placé en résidence surveillée chez ses parents, il attend son procès, prévu en octobre. Le milliardaire déchu, âgé de 30 ans, pourrait finir sa vie en prison. ■
Vaste projet ferroviaire en Tanzanie

Une ligne de 2 500 km devrait relier Dar es Salaam au Burundi, et par extension la République démocratique du Congo, d’ici à 2026.
La Tanzania Railways Corporation (TRC) a signé, le 5 janvier, un contrat de 2,2 milliards de dollars avec deux sociétés chinoises, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) et China Railway Construction Corporation (CRCC), afin de construire, d’ici à 2026, un tronçon ferroviaire de plus de 500 km entre Tabora (centre du pays) et Kigoma (nord-ouest), puis de ce point à Gitega (au Burundi). Après la fin des travaux, un réseau de chemin de fer d’une longueur de plus de 2 500 km permettra de relier Dar es Salaam au Burundi et, via le port lacustre de Kigoma, aux provinces orientales de la République démocratique du Congo (RDC). Les coûts de transport entre cette dernière et la côte orientale s’en trouveraient réduits d’un tiers.
« L’objectif de ces infrastructures est de faire de la Tanzanie un hub du business et des transports », a commenté la présidente Samia Suluhu Hassan, précisant que le coût total du projet dépassera les 10 milliards de dollars, empruntés à diverses sources. La bataille du rail s’en trouve relancée entre les deux États anglophones de la côte est, la Tanzanie et le Kenya, qui rivalisent pour s’imposer comme le débouché maritime privilégié de la région enclavée des Grands Lacs. En 2014, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda avaient signé à Kampala un accord avec la Banque africaine de développement (BAD) pour relier par le rail Mombasa, Nairobi, Kampala et Kigali. Mais ce projet est au point mort depuis 2019, du fait du manque de financements du Kenya, et d’une brouille entre les deux autres pays. ■
LES
11 Twitter, Facebook, e-mail, coup de fil ou lettre ?
Côté professionnel, mails. J’en ai écrit beaucoup aux chaînes et aux maisons de production, et j’ai décroché des rendez-vous et des castings. Je prends le temps de trouver les mots justes pour convaincre.
Khady Diallo
Comédienne, animatrice, chroniqueuse, formatrice, ancienne mannequin, cette TOUCHE-À-TOUT met en lumière les personnalités créatrices d’innovations sur le continent. Et prépare un nouveau talk-show. propos recueillis par Astrid Krivian
1 Votre objet fétiche ?
Une pierre trouvée dans un parc. Elle a la forme du continent africain ! Je l’ai fait sertir sur une bague.
2 Votre voyage favori ?
J’aime voyager partout, et surtout au soleil.
3 Le dernier voyage que vous avez fait ?
Au Sénégal. J’essaie d’y aller au moins une fois par an.
4 Ce que vous emportez toujours avec vous ?
Mon peigne afro.
5 Un morceau de musique ?
L’album Joyful, d’Ayo, magnifique ! Et je ne me lasse pas d’écouter les voix d’or : Baaba Maal, Whitney Houston, Oumou Sangaré…
6 Un livre sur une île déserte ?
Un ouvrage sur la phytothérapie.
7 Un film inoubliable ?
La Ligne verte, de Frank Darabont. Poignant !
8 Votre mot favori ?
« Influence » : j’aime l’idée de mouvement, d’inspiration ! Un mot riche à la sonorité mélodieuse.
9 Prodigue ou économe ?
Prodigue, car j’aime faire plaisir. Mais depuis quelques années, avec les responsabilités, je suis de plus en plus économe.
10 De jour ou de nuit ?
De jour.
12 Votre truc pour penser à autre chose, tout oublier ?
Faire du sport, prendre un verre dans mon café favori, ou aller à la piscine et au hammam !
13 Votre extravagance favorite ?
Aller au restaurant ! Si je pouvais, j’irais tous les jours.
14 Ce que vous rêviez d’être quand vous étiez enfant ?
Comédienne ! J’ai toujours suivi les ateliers de théâtre à l’école. Aujourd’hui, ma scène, c’est la caméra de télévision. Mais le cinéma m’intéresse !
15 La dernière rencontre qui vous a marquée ?
Baaba Maal, dans les studios de TV5 Monde, pour mon ex-chronique « Afrikhady » au Journal

Afrique. Je l’ai accueilli à l’entrée de l’immeuble en tenue traditionnelle et l’ai salué en peul – nous sommes de la même ethnie. Il me connaissait déjà et suivait ma chronique ! Un homme adorable.
16 Ce à quoi vous êtes incapable de résister ?
Le mafé de ma maman : plus que savoureux, il m’apporte du bien-être !
17 Votre plus beau souvenir ?
Des moments en famille, harmonieux, où le temps s’arrête, où l’on vit l’instant présent.
18 L’endroit où vous aimeriez vivre ?
Quelque part au soleil, avec les gens que j’aime et qui m’aiment !
19 Votre plus belle déclaration d’amour ?
Celle de ma nièce Fatou. À 4 ans, elle me considérait déjà comme sa deuxième mère, déclarant que j’étais sa « tata-maman » !
20 Ce que vous aimeriez que l’on retienne de vous au siècle prochain ?
Que j’étais une personne intègre, pleine de joie de vivre, utile à la société. Et une source d’inspiration pour mes enfants. ■
PROFITEZ D' 100 % NUMÉRIQUE
Être en Afrique et être dans le monde.
S'informer, découvrir, comprendre, s'amuser, décrypter, innover…
À tout moment et où que vous soyez, accédez en illimité à afriquemagazine.com !
POURQUOI S'ABONNER ?
Tout le contenu du magazine en version digitale disponible sur vos écrans.

Des articles en avant-première, avant leur publication dans le magazine.
Des contenus exclusifs afriquemagazine.com pour rester connecté au rythme de l’Afrique et du monde.


Des analyses et des points de vue inédits.
L’accès aux archives.
www.afriquemagazine.com



